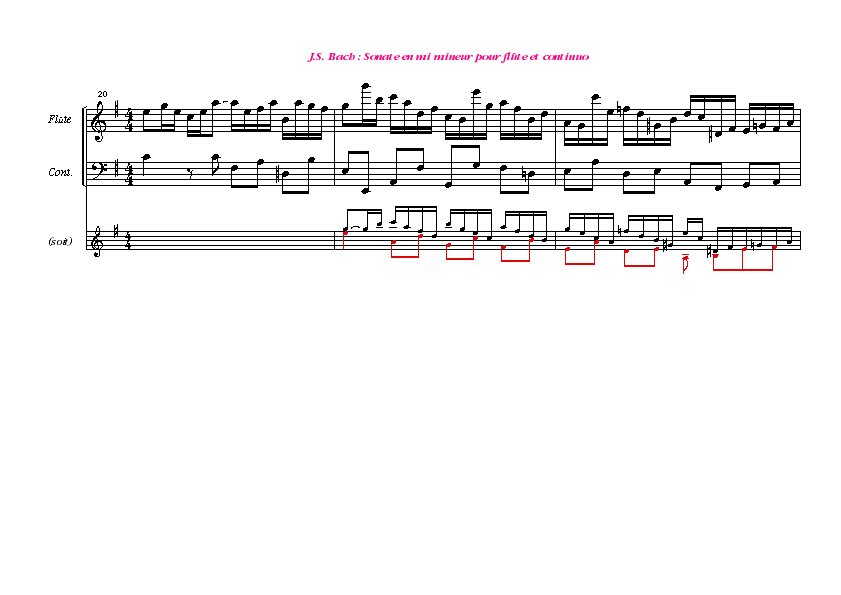
[ Catalogue | Bibliographie ]
Affect musical et singularité
instrumentale : À l'écoute de Spinoza...
François Nicolas
Est-il possible pour un compositeur de se référer positivement à la catégorie d'affect si l'on ne s'inscrit pas dans une logique de narrativité musicale ? Y a-t-il sens à revendiquer un tel terme et pourquoi apparemment le disputer à d'autres utilisateurs, a priori mieux placés pour le revendiquer, je veux dire les compositeurs qui inscrivent la théâtralité et, plus singulièrement, l'opéra au coeur de leur projet, ce qui n'est pas ma démarche ? Pourquoi alors ouvrir un débat autour de la catégorie d'affect et ne pas se contenter d'une situation où chacun resterait chez lui, cultivant, tel Candide, son petit jardin de métaphores ?
0
J'avais dans un premier temps envisagé de déployer la catégorie d'affects selon une toute autre logique que celle que je vais finalement vous présenter. J'ai en effet entrepris un travail personnel à partir de Spinoza, plus précisément du III° livre de l'Éthique, pour tenter de dégager ce qu'on pourrait appeler un topos spinoziste des affects. J'emploie ici le mot topos au sens mathématique du terme, tel en particulier qu'il est d'usage dans cette branche de la mathématique qu'on appelle la théorie des catégories ou encore théorie des topos . Mon idée en gros est la suivante : il s'agit d'examiner les liens logiques que Spinoza constitue entre ces entités qu'il appelle affects et pour cela de dégager la logique interne de chacun d'eux, tel que Spinoza les engendre, selon l'ordre des raisons, à partir de ces entités premières que sont le Corps, l'Esprit, le conatus, etc. Ceci permet de produire un diagramme (reliant des objets par des flèches) qui met en ordre logique le mouvement de déduction à l'oeuvre dans le "De Affectibus".
Pourquoi faire cela ? Parce que ceci permet de dégager quelques grandes opérations de déduction qui ont pour principale vertu de me stimuler dans mon travail pré-compositionnel car elle suggère, par analogie formelle, quelques opérations apparentées dans mon espace de travail. Vous présenter cela impliquerait de détailler quelque peu un aspect de ma problématique compositionnelle, celui qui engage une tension dialogique entre la catégorie de figure et celle de geste. Disons qu'un aspect important de mon travail pré-compositionnel consiste à me constituer une sorte de vocabulaire constitué de gestes, regroupés en espèces différentes, chacune dépendant d'un genre plus général qui se réfère à ce que j'appelle une figure. Veuillez pardonner l'abstraction trop grande de ces propos, mais j'ai choisi de ne pas vous exposer aujourd'hui en détail ce dispositif . J'indique simplement que ce réseau de gestes et de figures peut lui-même se caractériser comme un topos de gestes et qu'il est, de ce point de vue, stimulant de comparer les propriétés formelles des deux topos ainsi dégagés : celui spinoziste des affects et celui qui m'est propre des gestes musicaux. C'est en ce sens que je proposais, dans l'intitulé initial de cette intervention de parler d'algèbre des affects, par analogie formelle ou logique avec cette algèbre des gestes sur laquelle je travaille.
Comparer les propriétés du topos spinoziste des affects et celles du topos de mes gestes, mettre en dialogue leurs algèbres respectives devait à mon sens se faire de manière purement formelle, c'est-à-dire sans jamais soutenir quelque équivalence réelle que ce soit entre geste et affect, sans donc jamais soutenir qu'un geste tel que je l'entends serait un affect, ou même serait "comme" un affect. Je souhaitais, sur ce plan, m'écarter d'une interprétation de nature "affective" de ces gestes, qui les aurait conçus comme autant d'équivalents musicaux des affects humains. Il ne s'agissait, encore une fois, que d'isomorphismes d'ordre logique, tenant le plus possible à distance tout rapprochement quant à l'être respectif des affects et des gestes, disons tout rapprochement d'ordre plus spécifiquement ontique.
Je vous expose ce que je ne ferais pas, aujourd'hui en tous les cas, car il me semble que cet exposé initialement prévu serait en retrait par rapport aux enjeux mêmes du colloque, s'enfermerait dans le splendide isolement du compositeur venant faire visiter son monde intérieur. Je ne suis pas sûr que ceci soit toujours plein de charme pour qui n'y habite pas et ce genre de visite laisse souvent, à qui ne fait que passer, la même étrange impression que celle que l'on a à lire le compte-rendu d'un rêve que l'on n'a pas vécu : on n'y ressent aucune intensité et l'anecdote n'offre guère d'intérêt pour qui ne l'a pas éprouvé en songe.
J'ai ainsi gardé une impression pour le moins mitigée des cours que donnait Olivier Messiaen, commentant, en même temps qu'il les jouait au piano, telle ou telle de ses oeuvres, enchaînant dans un discours - qui ne semblait en vérité adressé qu'à lui-même - les noms d'oiseaux et les caractérisations de couleurs qu'il était seul à voir : pourquoi exposait-il ainsi ce qui ressemblait à une pratique étrangement solitaire ? Sans doute restait-on fasciné par l'aplomb avec lequel il faisait discours public d'une rêverie intérieure, et ceci suffisait à encourager chacun de ses auditeurs à faire confiance en ses intuitions les plus intimes - ce qui, d'ailleurs, n'est pas rien et suffit à expliquer que ceux qui y ont assisté puissent lui en avoir conservé reconnaissance -. Mais enfin, on aurait pu attendre d'un vieux Maître qu'il fasse un usage plus explicite de la raison et qu'il ne situe pas l'exercice de la liberté en une pratique pouvant n'apparaître que capricieuse.
Je ne peux, je ne veux donc pas me tenir à un usage trop formel de la catégorie d'affect : ceci passerait à côté d'un débat qu'il me semble devoir mener sur cette catégorie. Au-delà de la référence formelle précédemment évoquée, il me semble en effet que cette catégorie recouvre, dans ma pensée compositionnelle, un point tout à fait précis et qui peut contrepointer significativement d'autres approches. En ce point, le rapprochement musique-affects n'apparaît plus seulement de type formel mais engage une essence plus intime et de l'une et de l'autre. Quel est ce point ? Je l'appellerai, de manière très ramassée, la singularité instrumentale. De quoi s'agit-il ici ?
I
Je vous fais d'abord entendre quatre exemples musicaux :
- le premier, extrait de la sonate en mi mineur pour flûte et continuo de J.S. Bach,
- le second, extrait de Night Fantasies pour piano d'Eliott Carter,
- le troisième, extrait de Togo, composition de jazz d'Ed. Blackwell et faisant surtout entendre au début la trompette de Don Cherry ,
- le quatrième enfin extrait d'une de mes récentes oeuvres, Dans la distance, commande de l'IRCAM et créée par l'EIC .
Pourquoi ces exemples ? Pour deux moments, très particuliers, relevés dans les deux premiers exemples : mes 15 et surtout mes. 21-22 dans le premier, mes. 15-16 dans le second. Disons que pour moi le premier met à jour quelque chose comme une singularité de la flûte quand le second fait de même avec le piano. A contrario, le troisième exemple fait entendre ce que j'appellerai une particularité de la trompette, dont le jazz tire particulièrement bien parti et qui, je dois l'avouer, m'a empêché jusqu'à aujourd'hui d'écrire pour cet instrument. Enfin le quatrième introduit au parti compositionnel qu'il me semblait devoir tirer du deuxième exemple.
J'utilise, pour commenter ces exemples, d'une distinction qui m'est chère : entre particularité et singularité. Disons, en première approximation, que la particularité est ce qui se rapporte à la généralité, alors que la singularité se rapporte à l'universel. Précisons, pour continuer, que le général est ce qui se rapporte à un "pour tous" quand l'universel est ce qui se rapporte à un "n'importe qui", ce qui est tout différent : l'existence d'un seul particularisme suffit à interdire l'existence d'une généralité alors qu'elle ne saurait, à elle seule, déqualifier l'universel.
Illustrons ce point, qui aura quelque importance pour la suite de mon propos, par l'anecdote suivante :
J'entendais récemment un musicologue réfuter l'idée d'une universalité de l'art musical occidental en arguant d'une expérience faite auprès des pygmées d'Afrique Centrale et qui montrait qu'ils étaient indifférents à la musique de Mozart comme d'ailleurs au jazz. Le raisonnement implicite se faisait par l'absurde : s'il existait quelque individu particulier imperméable à l'art considéré, c'est que cet art n'avait rien d'universel et ne relevait que d'une culture particulière.
À cela il me semblait légitime d'opposer ceci : L'expérience rapportée attestait sans doute que tous les hommes n'aiment pas Mozart, à mesure ce qu'un au moins déclare ne pas l'aimer, ce qui est véridique mais ne nécessite guère, pour ce faire, de convoquer quelque individu du fond d'une forêt africaine : il suffirait tout aussi bien, pour en attester, d'interroger quelques passants dans la rue la plus proche... Mais l'universalité de l'art musical ne postule nullement qu'il touche tous les individus sans en rater aucun. Il postule simplement que lorsqu'il touche quelqu'un, c'est au nom de ce qu'il y a en lui de quelconque et non pas de son acculturation particulière, qu'il le touche donc en l'arrachant à son ordinaire, par indifférenciation de ses particularités plutôt qu'au nom d'une reconnaissance identitaire de ses racines. Et c'est précisément ce qui constitue la puissance d'universalité de l'art : comme la Grâce, il est en droit de toucher en vérité aussi bien un africain des forêts qu'un blanc des villes.
Que pour rencontrer l'art et sa puissance universelle il faille réunir des circonstances spécifiques - a minima dans notre cas pouvoir ne serait-ce qu'entendre la musique en question - est une trivialité. Mais précisément il n'y a nulle raison de considérer que l'expérience isolée d'une heure de Mozart ait dû ipso facto assurer la touche singulière d'un des humains rassemblés ce jour-là - sans compte d'ailleurs que le musicologue en question ne pouvait garantir qu'il n'y ait pas eu, chez au moins l'un d'entre eux, un effet, à plus long terme et plus souterrain, de cette écoute inhabituelle... -.
Créer une distance de pensée entre général et universel, mais surtout aujourd'hui entre particulier et singulier me semble une occasion de liberté donnée à la pensée. Pour reprendre mes exemples musicaux, le premier comme le second me semblent dégager une singularité instrumentale (respectivement pour la flûte et le piano) quand le troisième déploie à l'inverse un particularisme dont je m'empresse de préciser qu'il est pour moi d'une extrême séduction sonore quoique à mon sens la pensée musicale - peut-être ma pensée et elle seule... - ait en ce point plus de mal pour y tracer sa voie, le quatrième, enfin, présentant une sorte de résonance compositionnelle de la singularité pianistique apparue dans le second. Pourquoi répartir ainsi ces exemples entre singularité et particularité ?
1) Il me semble que l'attaque de la trompette est particulièrement relevée lorsqu'elle est cuivrée selon la manière dont procède Don Cherry, et il me semble également - habitude d'écoute ? - que ce type d'attaque s'épanouit en plénitude dans le phrasé de jazz. Il est d'usage, en musique classique, de gommer ce type d'attaque cuivrée, de la lisser en sorte de mieux intégrer la trompette au phrasé général de l'orchestre. A contrario, quand j'entends ce type d'attaque en musique contemporaine, j'ai toujours l'impression que cette particularité reste incongrue car inintégrée à un phrasé comme seul, à mes oreilles, le jazz sait mettre en oeuvre.
2) La sonate de Bach propose un tout autre contexte. L'écriture n'assume nullement une particularité de l'instrument " flûte ", et on pourrait tout aussi bien jouer cette partie sur un violon - même s'il n'est pas d'usage de le faire, nul ne pourrait dire qu'il s'agit là d'une totale aberration : on sait combien Bach était familier de telles transcriptions -. Le miracle qui à mon sens se produit dans les mesures précédemment relevées est que cette écriture relativement indifférente aux particularités de la flûte va mettre à jour quelque chose qui à mon sens lui est cette fois singulier, qui est cet effet de souffle si particulier qui apparaît lorsque l'instrumentiste doit parcourir de larges intervalles de sixtes descendantes (venant en renversement des tierces initiales).
C'est un peu comme si en ce point le tissu instrumental, distendu par l'écriture, faisait alors apparaître un filigrane ou un tramé peu sensible dans les conditions ordinaires. On sait que Bach était familier de l'opération consistant à incarner une même voix (au sens de l'écriture) successivement en des instruments fort différents (une bonne partie de ses arias de Cantates met ainsi en dialogue selon un même parcours mélodique une voix et un instrument, et l'on sait combien les chanteurs peuvent ressentir cela comme une violence faite aux particularités du cantabile). Ce qui m'intéresse en cet exemple, c'est que la singularité émerge au prix d'une certaine violence exercée contre les particularités instrumentales, ce qui se donne en l'occurrence dans le fait que l'écriture n'est pas ici ordonnée au " bien écrire " pour la flûte : ce n'est pas qu'elle serait un " mal écrire " mais plutôt qu'elle est indifférente à ces critères du " bien " ou " mal " écrire.
Exemple musical 1 :
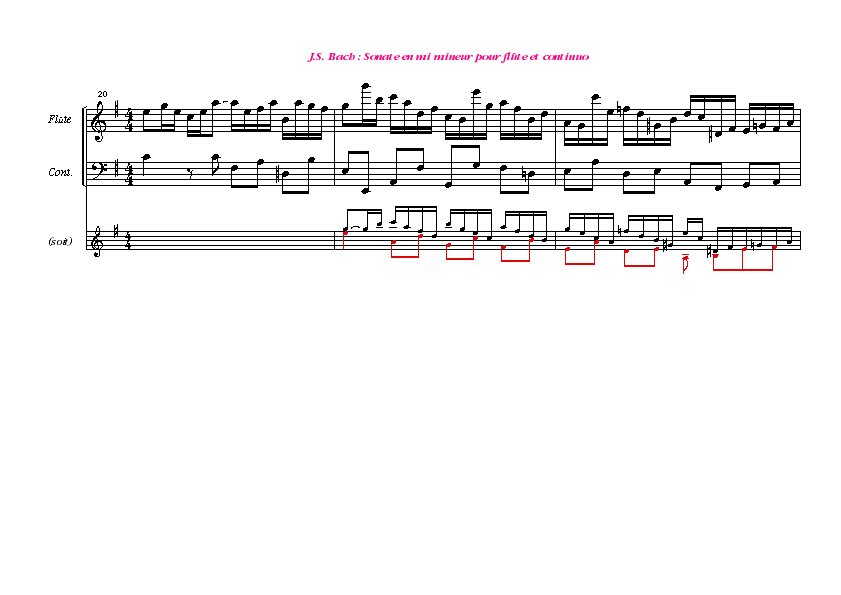
3) L'exemple prélevé chez Eliott Carter est un peu différent : le moment qui m'arrête ici est caractérisable comme fluidité singulière d'un geste, geste d'écriture musicale plutôt que geste physico-instrumental, et cependant geste qui déploie à mon sens quelque chose de spécifique au piano : une manière de fluidifier, par un travail rythmique très précisément détaillable, une évolution qui pourrait a priori paraître raide, et d'autant plus raide qu'elle s'adresse à un instrument malgré tout de nature percussive.
Peut-être faut-il parler ici moins de singularité pianistique que de spécificité, en introduisant ce faisant une distinction seconde par rapport à celle prévalant entre particularité et singularité. L'idée serait que le singulier est en puissance d'engendrer de l'universel lequel, lorsqu'il fait retour vers la singularité qui l'a engendré, produit alors du spécifique, qui s'avère en léger écart par rapport au singulier initial. Mouvement donc à trois termes plutôt qu'à deux... Mais laissons ici de côté ce point pour nous concentrer sur la singularité.
Exemple musical 2
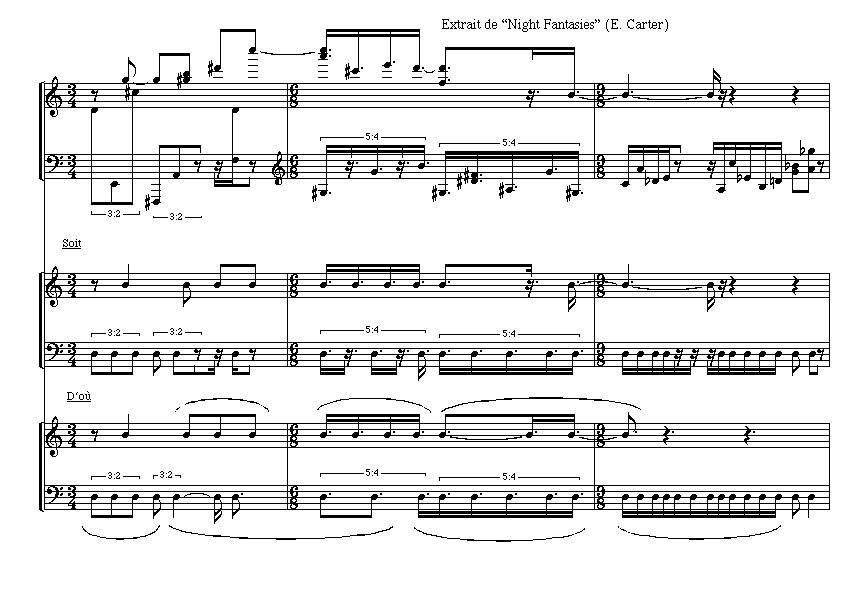
4) Une question compositionnelle qui m'occupe actuellement est de dégager, pour mon propre compte, ce qui constitue de telles singularités pour chaque instrument de l'orchestre ; et c'est, pour indiquer ce point, que je vous ai fait entendre le quatrième exemple, que je ne commenterai pas aujourd'hui plus avant car cela nous renverrait à ce que j'ai appelé mon algèbre des gestes.
À mon sens, ce travail de singularisation ne va nullement de soi. En particulier, il ne saurait fonctionner par transmission et héritage. Ce qu'on transmet, ce sont des savoirs ; et les savoirs, ici, sont plutôt ce qui épingle les particularités instrumentales - les traités d'instrumentation et d'orchestration sont de ce point de vue tous ordonnés à ce même objectif -. Mais la singularisation d'un instrument relève - j'espère que mes exemples vous en auront donné quelque intuition - d'un tout autre travail qui relève moins des savoirs que des vérités car il y s'agit somme toute de la vérité d'un instrument telle qu'une pensée musicale singulière l'épingle ou la met en jeu.
On peut également dire : il s'agit là de liberté, la liberté pour un compositeur de penser musicalement les instruments qu'il met en oeuvre, et cette liberté ne peut agir qu'en traversant des particularismes plutôt qu'en s'y ordonnant ; il ne s'agit donc pas d'ignorer l'existence de ces particularités mais parfois, et en des points soigneusement choisis, de les ignorer comme tels, c'est-à-dire de ne pas s'y soumettre, et de poser qu'ils vous sont indifférents.
Toute liberté, me semble-t-il, fonctionne ainsi au régime de décider ce qui pour elle est même et ce qui pour elle est autre, ce qui pour elle diffère et ce qui pour elle indiffère. Et toute liberté de penser est ainsi à la fois l'opération de discernement (qui distingue deux choses là où l'opinion n'en voit qu'une) et l'opération inverse qui considère comme insignifiante telle distinction constituée.
Dans mon propos précédent, il s'agit à ce titre de différencier particularité et singularité et, inversement, de soutenir l'indifférence à tel ou tel particularisme instrumental. Pour nommer l'unité de ces deux aspects - car il s'agit d'un seul et même geste de pensée - je parlerai désormais de "singularité indifférente".
II
Quel rapport ceci, brièvement esquissé, entretient-il avec notre question des affects ?
Je soutiendrai la thèse suivante : ces moments de singularité indifférente - ces moments où la pensée compositionnelle singularise, via l'écriture, tel ou tel instrument, ou encore, ces moments où la pensée musicale spécifie via la partition telle ou telle pratique instrumentale - ces moments constituent à l'intérieur de l'oeuvre un analogon assez précis de ce que Spinoza appelle les affects actifs dans la proposition 58 du III° Livre de l'Éthique. C'est à ce titre que la catégorie d'affect me semble avoir une pertinence musicale et compositionnelle. Je voudrais maintenant expliciter ce point.
Je ne prétends pas récuser d'autres usages de la catégorie d'affect. Chacun, bien sûr, a le droit de fixer son vocabulaire, de préciser le sens qu'il donne à telle ou telle catégorie et nous en débattons précisément dans ce colloque. En soutenant ma propre acception du terme, je propose simplement d'élargir les conceptions jusque là retenues, d'agrandir l'espace de pensée convocable sous cette catégorie et de maintenir une distance vis-à-vis de ce que je me risquerai à nommer une réduction signifiante de la catégorie d'affect.
L'acception dont j'essaye ici de me distinguer serait celle où l'affect aurait ceci de spécifique qu'il viendrait faire momentanément coïncider deux ordres distincts de temporalités : disons, pour faire simple, celui de la vie subjective ordinaire et celui de l'oeuvre ; ou encore celui d'un temps narratif et celui d'un temps musical. Il y aurait un moment particulier, nommé affect, qui serait commun à ces deux ordres et qui ferait office entre eux de point de capiton, ou autrement dit, et en une métaphore mieux adaptée au fait qu'il s'agit ici de relier en un moment unique deux évolutions temporelles continues et non pas deux chaînes en un élément unique, qui ferait office de tangente commune, ou de différentielle partagée.
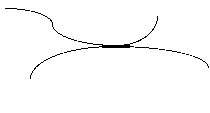
L'acception que je voudrais avancer est un peu différente ; elle est déplacée par rapport à cette dimension temporalisée de l'affect et elle reste purement immanente à la pratique musicale. J'ai en effet quelque réticence d'ordre esthétique face à une acception trop proliférante de l'affect en musique. J'adopterai sur ce point une position fermement spinoziste : les affects relèvent trop massivement de la passivité pour être revendiqués par une oeuvre musicale qui souhaite se déployer librement, dans la puissance de son agir propre, et sans verser dans la servitude de quelque ordre extérieur, ou, pour parler comme Spinoza, de quelque " cause inadéquate ".
Il y a un impératif de liberté pour l'oeuvre musicale qui, loin d'être un renfermement sur soi est la condition même d'un échange possible de l'oeuvre musicale avec d'autres. Somme toute, il y a sens à tenir que l'oeuvre d'art peut être elle-même pensée comme sujet et c'est à ce titre qu'il me semble possible de caractériser ce qu'il peut y avoir d'affect.
Sous cet angle, il est clair que l'affect ne saurait être ce qui la relie au monde, à l'espace des choses extérieures car l'affect, en son état ordinaire, est trop marqué de causes inadéquates, de fausses représentations. Vouloir tramer de part en part une oeuvre musicale par un dispositif d'affects me semble, au regard d'une acception de l'oeuvre d'art comme sujet (et non pas comme objet proposé au désir d'un sujet extérieur, auditeur préconstitué) la maintenir dans une compréhension romantique.
Je ne suis pas sûr que notre époque musicale, paradoxalement, ait entièrement dépassé l'horizon romantique. Et ce n'est pas ce qu'il y avait de positiviste dans le sérialisme qui attesterait du contraire... Qu'il faille, pour dépasser le romantisme, prendre en partie appui sur le classicisme ne serait pas alors étonnant, et c'est un peu à ce titre que je me tourne vers une philosophie classique des affects plutôt que vers celles qui l'ont suivie.
Pour en revenir à Spinoza, si le monde des affects est massivement marqué d'une instabilité incompatible avec l'existence de l'homme libre et vivant sous la conduite de la raison, il existe cependant parmi les affects une voie étroite pour une activité non marquée de passivité. J'en restitue ici les grandes lignes :
Proposition 58 : "Outre la Joie et le Désir qui sont des passions, il y a d'autres affects de Joie et de Désir, qui se rapportent à nous en tant que nous agissons."
Proposition 59 : "Parmi tous les affects qui se rapportent à l'Esprit, en tant qu'il agit, il n'en est point qui ne se rapportent à la Joie ou bien au Désir" et donc aucun qui se rapporte à la Tristesse.
Scolie : "Toutes les actions qui suivent des affects se rapportant à l'Esprit en tant qu'il comprend, je les rapporte à la Force d'Âme [Fortitudo], que je divise en Fermeté [Animositas] et en Générosité [Generositas]. Car par Fermeté j'entends le Désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison. Et par Générosité, j'entends le Désir par lequel chacun, sous la seule dictée de la raison, s'efforce d'aider tous les autres hommes, et de se les lier d'amitié. Et, donc, les actions qui visent seulement l'utilité de l'agent, je les rapporte à la Fermeté, et celles qui visent également l'utilité d'autrui, à la Générosité. Donc la Frugalité [Temperentia], la Sobriété [Sobrietas], la Présence d'Esprit dans le danger [Præsentia in periculis animi], etc., sont des espèces de la Fermeté ; et la Modestie [Modestia], la Clémence [Clementia], etc., des espèces de Générosité."
Ces "affects actifs" constituent le point d'appui de l'homme libre, de l'homme vivant sous la conduite de la raison.
III
Ce sont ces affects actifs qui me semblent correctement nommer les moments musicaux dont j'ai parlé précédemment, moments que j'ai nommés de " singularité indifférente ". Pourquoi un tel rapprochement ?
Pour qu'il y ait affect, il faut qu'il y ait un corps engagé. Ce point ne me semble pas assez souvent relevé. Sans corps, la catégorie d'affect n'a guère de sens. Mais de quel corps va-t-il s'agir ici ? Du corps de l'auditeur ? Pas essentiellement à mon sens, s'il est vrai que ce corps ne sera affecté que par résonance, en vertu de cette loi de contagion des affects dont Spinoza fait grand usage.
Plus essentiellement, le corps dont il est question dans l'affect musical engage à mon sens la pratique instrumentale. Somme toute pour qu'il y ait musique il faut qu'il y ait l'engagement de deux corps : le corps-machine de l'instrument, et le corps humain de l'instrumentiste. Je ne suis pas (plus) sûr qu'il faille exactement nommer ce rapport "corps à corps". Il me semble plus approprié d'évoquer ici la constitution, absolument propre à l'acte musical, d'un corps musical unique que je nommerai alors, en référence à l'image si habituelle de l'instrument devenu prolongement du corps de l'interprète, le corps interprète-instrument.
On peut remarquer que soutenir un tel rôle du corps dans la musique conduit à récuser l'idée que la musique purement électroacoustique puisse être encore à proprement parler de la musique. D'où deux positions possibles : soit, comme Pierre Schaeffer puis surtout Michel Chion, on tient avec courage qu'il s'agit en vérité dans cette pratique de fonder un nouvel art (l'art des sons fixés) plutôt que de continuer la musique ; soit on tient que la musique exclusivement électroacoustique produit des images de musique plutôt qu'à proprement parler de la musique, les haut-parleurs étant radicalement hétérogènes à la puissance d'un corps.
La musique se joue donc en cet engagement d'un " corps interprète-instrument ". Il est ici loisible d'envisager le rapport entre la musique et ce corps comme analogue à celui que Spinoza institue entre corps et esprit : non point, à la manière de Descartes, deux entités indépendantes dont l'une commanderait à l'autre (la musique commandant au corps interprète-instrument comme l'âme commanderait au corps), mais comme une seule et même " chose " vue sous deux modalités différentes : l'une (la musique) sous l'angle des idées instrumentales, l'autre (l'interprète-instrument) sous l'angle de l'étendue corporelle
Si, à la suite de Spinoza, on nomme alors affect "les affections du corps en même temps que les idées de ces affections" (Définition III, p. 203), il est pertinent de nommer affect musical une idée musicale en tant qu'elle est idée instrumentale, je veux dire nommer affect ce type particulier d'idées musicales qui a pour réalité d'être idée de telle ou telle pratique instrumentale (j'entends par pratique instrumentale précisément ce qui articule le corps interprète-instrument).
Si l'oeuvre musicale est thématisable comme sujet, alors c'est pour elle une seule et même chose que d'exister et que d'être libre.
Je livre ce point à la réflexion générale : peut-il exister une oeuvre qui soit serve ? Cela me semble-t-il porte un nom, et cela s'appelle l'académisme, dont on sait bien qu'il n'est pas de l'art et qu'il ne produit pas d'oeuvres mais de purs et simples objets fonctionnels.
Pour autant que l'oeuvre est conçue comme sujet, elle doit s'exercer exclusivement aux affects actifs, ces très rares affects où la pratique instrumentale se donne comme véritable action, comme cause adéquate et comme idée vraie.
Ces affects sont les moments où l'oeuvre pointe une vérité musicale de la pratique instrumentale ; ce qui est propre à chaque compositeur est alors le choix de ces moments : j'ai indiqué qu'ils étaient pour moi indexés d'une singularité indifférente, mais cette caractérisation n'est pas forcément commune à tous les compositeurs. Disons que si ma caractérisation n'est pas générale, elle peut cependant avoir quelque valeur universelle.
C'est entre autres à partir de tels moments que l'oeuvre peut dialoguer avec d'autres oeuvres et par là assumer sa finitude. Car le corollaire de la position que je soutiens est que non seulement l'oeuvre est finie mais qu'elle assume cette finitude dont elle fait son enjeu propre : une effectuation de sa liberté est précisément d'apprendre à se finir. Dans le dialogue critique entre oeuvres Spinoza nous indique encore la voie quand il écrit : "Il n'y a rien qui soit plus utile à l'homme qu'un autre homme, libre et vivant sous la conduite de la raison." . En le paraphrasant je dirais : "Il n'y a rien qui soit plus utile à une oeuvre musicale qu'une autre oeuvre libre et vivant sous la conduite de la pensée."
L'enjeu du travail d'un compositeur doit alors se mesurer à cette aune : produire des oeuvres qui soient en puissance de cette liberté, qui agissent musicalement en prenant appui sur une idée singulière de ce corps que j'ai nommé interprète-instrument. C'est pour moi à cette condition que la catégorie d'affect pourra continuer de servir la création musicale.