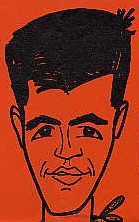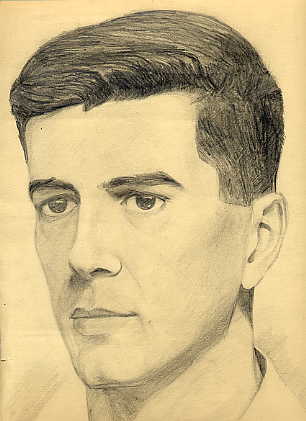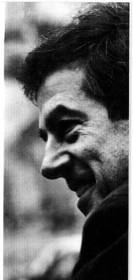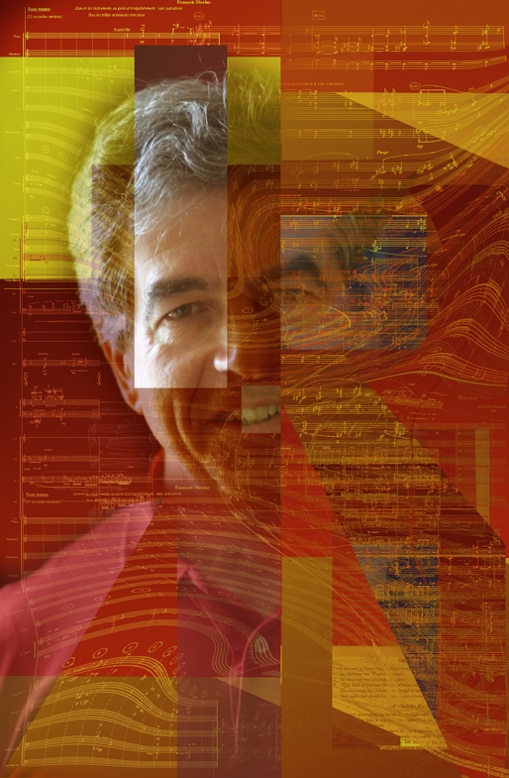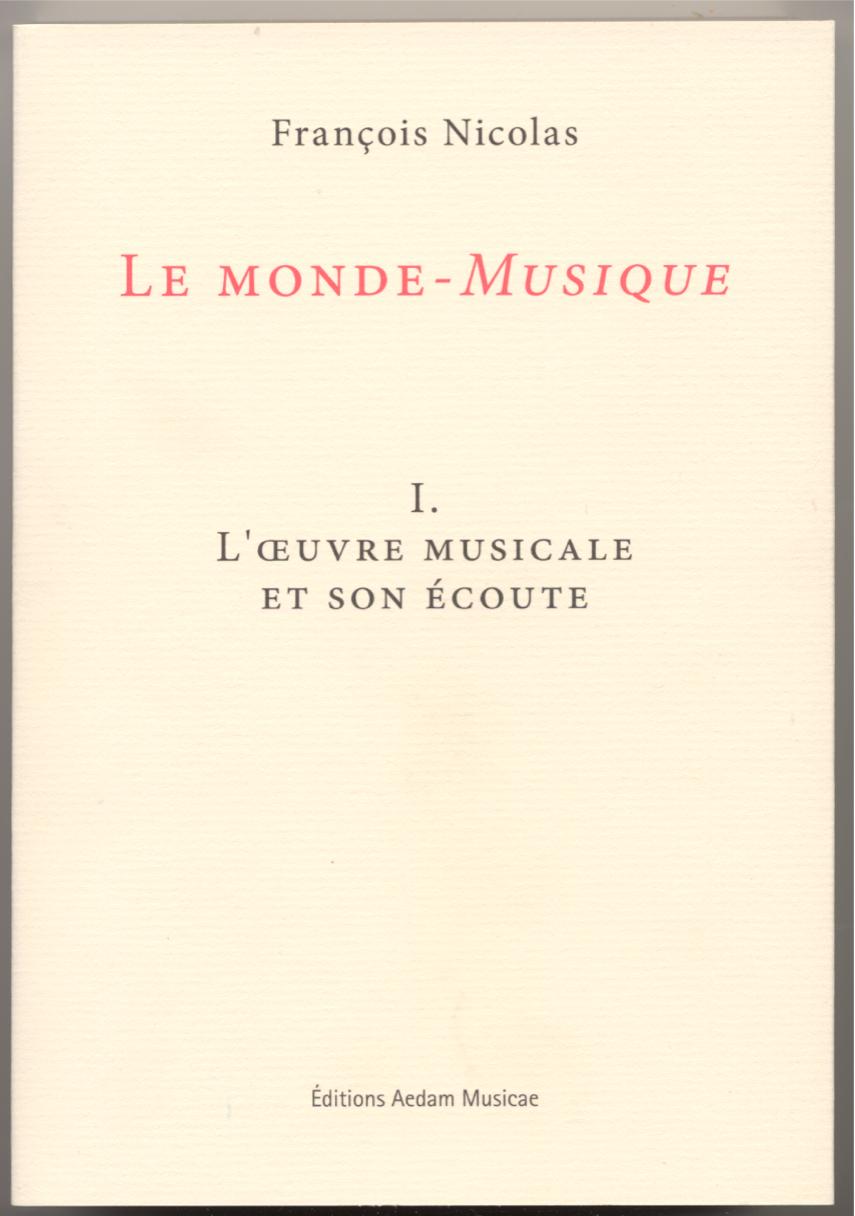•••
François NICOLAS, compositeur : Éd. Jobert & Éd. Lemoine
Catalogue | mp3 | Bibliographie | Photos | Vidéos | Dailymotion | Youtube
Pour se faire une idée de la musique de F. Nicolas : collage (23’) de 8 extraits (mp3 : 32 Mo)
english | español | português | deutsch |
polonais | român | magyar
Michel Douay - Guy Vivien – Laurent Simon
Les quatre tomes du « Monde-Musique » sont désormais mis en ligne à l’adresse :
https://fnicolas1947.fr/musique/le-monde-musique
Journées d’étude critique
sur Le
monde-Musique : 8 & 9 avril 2016 (Ircam, Paris)
(cliquer sur
chaque lien pour accéder à la vidéo Youtube correspondante ou
au texte pdf)
Deux entretiens sur Le monde-Musique avec Aliocha Wald Lasowski :
www.youtube.com/watch?v=dlS4VL3fZVY - www.youtube.com/watch?v=bK6plFt2IX8
Le monde-Musique
Comment comprendre que la musique puisse constituer un monde à part (ce
qui n’est pas dire un espace autarcique), un monde qu’on nommera monde-Musique, un monde fait de morceaux de
musique plutôt que de musiciens, un monde où l’existence se concentre dans des
morceaux singuliers qu’on appellera œuvres,
un monde dont l’intensité sensible relève de l’écoute, un monde dont l’autonomie relative procède d’une logique
originale (le solfège), un monde que les musiciens ne cessent de visiter pour y
prêter leur corps en jouant sans parler, un monde apte à résonner/raisonner
avec un environnement non musical ?
Répondre, avec la rigueur requise, à ces
questions nécessitera quatre tomes : successivement une théorie de
l’écoute musicale à l’œuvre (I), une
théorie de la logique d’écriture légitimant qu’on parle ici d’un
« monde » musical (II), une théorie de cette discursivité langagière
propre au musicien qu’on nommera intellectualité
musicale (III), une théorie de ces rapports du monde-Musique avec son environnement qu’on nommera raisonances (IV).
|
À quel titre la musique est-elle un art de
l’écoute ? Qu’est-ce qu’écouter musicalement ? :
est-ce seulement percevoir, auditionner, appréhender ?,
s’agit-il de la même écoute que celle (religieuse) des fidèles ou celle
(flottante) des psychanalystes ?, à quelles
conditions musicales une telle écoute est-elle possible ?,
comment suivre à la trace le travail musical d’une telle écoute lorsqu’elle a
la grâce de pouvoir s’engager ? La thèse centrale sera la suivante :
pour que l’auditeur de musique puisse devenir un écouteur, il faut qu’en cours d’œuvre, il arrive quelque chose à
la musique : on nommera moment-faveur
cette surprise musicale où l’œuvre avoue ce secret qu’on nommera intension. On examinera minutieusement comment ce
tournant interne au discours musical autorise qu’un écouteur puisse, à partir
de là, tricoter les mailles d’un temps musical qui viendra, une fois l’œuvre
achevée, déposer dans la mémoire du musicien cette Forme qu’on nommera inspect. |
La musique vit d’un grand écart : d’un
côté art de l’écoute (I), elle est l’emblème - avec la poésie - du sensible
« concret » qui ravit ; de l’autre, discipline de l’écriture
(II), elle est l’emblème - avec la mathématique - de l’intelligible
« abstrait » qui se déchiffre. Et c’est cette tension vivifiante
qui rend la musique capable de faire monde propre. On théorisera le monde-Musique - à la lumière de la mathématique (Grothendieck) et à
l’ombre de la philosophie (Badiou) - en soutenant que son cœur logique est
cette écriture spécifiquement musicale - le solfège - déjà millénaire. Ce
faisant, il s’agira donc de tirer toute conséquence du fait que la musique
est le seul art à s’être jamais doté de sa propre écriture. En quel sens entendre une telle existence
du « monde-Musique » ?
Quels en sont les acteurs et les corps, les opérations et les instruments, la
logique et les frontières, les relations et les processus ? À quelles
conditions ce monde ne deviendra-t-il pas submergé, au XXI° siècle, par
l’inflation numérique et sonore ? |
Depuis trois siècles, des musiciens
s’attachent à formuler, par écrit, les enjeux de la musique qu’ils
pratiquent : il y a ainsi des intellectualités
musicales qui nomment et énoncent sur une musique dont pourtant la pensée
propre, non langagière, ne nomme ni n’énonce. Pour qu’un tel projet émerge à partir de
Rameau, il aura fallu que la musique se constitue en monde (relativement)
autonome [tome II], que la philosophie en prenne mesure (Descartes) et qu’un
embrasement idéologique sans précédent (les Lumières) vienne mobiliser le musicien. D’où un nouveau type de
discursivité musicienne conjoignant une théorisation,
une critique et une esthétisation de la musique aux fins
d’encourager les musiciens aux tâches musicales de l’heure et
de convaincre les non-musiciens de la portée générale de ces dernières.
L’articulation variée de ces
trois opérations engendrera une constellation disparate d’interventions, à
l’écart de toute continuité disciplinaire d’ordre académique (telle la
musicologie, née plus tardivement). À ce titre, on monographiera
ici les intellectualités musicales de Wagner, Boulez, Boucourechliev et Rosen (à rebours des anti-intellectualités musicales de
Chopin, Debussy, Varèse et Berio) pour les confronter à quelques
intellectualités d’un autre type : mathématique, philosophique et
architecturale. |
Si l’autonomie du monde-Musique ne signifie pas son autarcie,
quel parti musicien tirer des liens
exogènes de ce monde avec un environnement de pensée dont il n’est pas
indépendant ? Sans faire système général de ces liens
(cela supposerait une théorie, encyclopédique et inconsistante, du chaosmos),
ce quatrième volume propose une analyse monographique de ces résonances entre
raisons disparates qu’on propose d’appeler raisonances. Elles concerneront ici les rapports de la
musique non seulement à d’autres arts (l’architecture et le cinéma en
l’occurrence) et à la poésie (Hopkins) mais également aux mathématiques et à
la politique, à la philosophie (Deleuze) et à la psychanalyse, à l’histoire
et à la musicologie (Deliège). Parcourir un tel archipel, intensifier
ainsi les affinités que les musiciens œuvrant
entretiennent avec ces autres pensées créatrices dont ils partagent le même
temps, c’est élargir la base de notre pyramide (celle, en quatre tomes, dont
l’écoute musicale constitue la pointe) et parachever une Idée classique de la musique contemporaine
qui s’attache, contre un nihilisme omniprésent, à continuer l’art musical en
le renouvelant. |
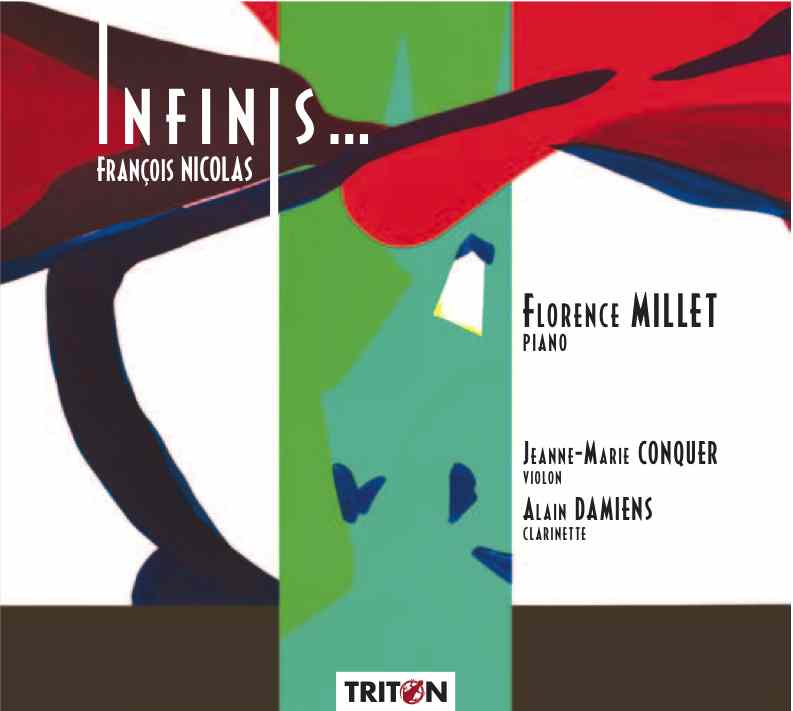
« Florence Millet joue
François Nicolas »
en compagnie de
Jeanne-Marie Conquer (violon) et Alain Damiens
(clarinette)
Nous buvons la hantise
des causes
dans le pétillement
vénéneux de nos coupes
et nous frôlons de nos
crochets
des infinis subtils comme
une mort légère.
Mais où les jonchets
s’entremêlent
l’enfant reste sans mots
:
l’univers dort dans le
berceau
d’une petite éternité.
Ossip Mandelstam
Au sommaire :
1. Toccata (2002)
pour piano - 6’39’’
2. Trio Transfiguration
(1997) pour violon, clarinette et piano - 22’53’’
3. Sonate (2003)
pour piano - 28’19’’
4. Des infinis
subtils (1995) pour piano - 16’35’’
––––
Biographie
o en français
o en anglais (biography in English)
o n espagnol (español)
o en portugais (português)
o en polonais
Biographie
Ancien élève de l’École Polytechnique, titulaire d’un DEA de philosophie, François Nicolas étudie l’orgue avec Albert Alain, le piano avec Carlos Roque-Alsina et l’écriture musicale avec Michel Philippot.
Après avoir pratiqué quelque temps la scène du jazz comme pianiste, il se tourne vers la musique contemporaine.
Il rencontre Mauricio Kagel et Luciano Bério (Acanthes, 1981 et 1983), participe aux confrontations de Darmstadt en 1982 & 1984 et suit la formation en informatique musicale dispensée par l’Ircam aux compositeurs.
Il enseigne ensuite au CNSM, intervenant également comme producteur invité de France-Musique, et cofonde l’ensemble de musique contemporaine Entretemps.
François Nicolas participe ultérieurement à l’Ircam comme compositeur en recherche, en particulier à la mise au point du logiciel Modalys (synthèse par modèles physiques) puis à celle de la Timée (source multi-hauts-parleurs).
Toutes ses œuvres sont éditées chez Jobert.
Il travaille actuellement à un vaste projet compositionnel sur Mai 68 : Égalité ’68 (symphonie, cantate, madrigal et opéra)
François Nicolas associe la composition à une réflexion théorique sur la musique.
Cofondateur en 1986 de la revue Entretemps, il anime depuis les années 90 les Samedis d’Entretemps (rencontres autour de livres sur la musique) et différents séminaires (musique & : mathématiques/psychanalyse/philosophie/histoire…).
Il est depuis 2003 à l’École normale supérieure (rue d’Ulm,
Paris), professeur associé (2003-2006) en charge de la musique contemporaine
puis chercheur associé (Collectif Histoire-Philosophie-Sciences et Centre
international de recherche philosophie, lettres,
savoirs
CIRPHLES – USR 3308 CNRS/ENS).
Il vient de terminer un vaste ouvrage Le monde-Musique (et son écoute à l’œuvre) [en cours de publication chez Aedam musicæ] et prépare un livre sur Parsifal.
François
Nicolas is a Researcher and Associate Professor in charge of contemporary music
at the École normale supérieure (Ulm) and Ircam. As a composer he combines composition with theoretical reflection.
Having studied philosophy at the École Polytechnique (Paris), organ with Albert
Alain, piano with Carlos Roque-Alsina, and composition with Michel Philippot,
he performed jazz before turning to contemporary music.
Nicolas
met Mauricio Kagel and Luciano Bério (Acanthes, 1981
and 1983), attended lectures at Darmstadt (1982 and 1984), and took the Ircam
computer training course for composers. He is currently working on “Égalité ’68” a large-scale compositional project on
May ’68 consisting of a symphony, a cantata, a madrigal, and an opera. His
musical works are available through Jobert.
He
lectured for some time at the Conservatoire National Supérieur de Musique in
Paris and was also a guest producer at France-Musique. Together with Hacène
Larbi he founded the Entretemps ensemble and
contributed at Ircam to the production of the Modalys software and
Timée multi-loudspeaker source.
From
1988–2004 he was a member of the editorial board of the Revue de musicology.
Cofounder in 1986 of the Entretemps review, since the early ‘90s he has run the Samedis d’Entretemps
(meetings around books on music) and different seminars (music and
mathematics/psychoanalysis/philosophy/history…). He has just completed the
large book Le monde-Musique (et son écoute
à l’œuvre) [The World-Music (and its Listening in
the Work)] and is preparing a book on Parsifal.
265, rue du Faubourg-Saint-Martin — 75010.Paris (France)
tél. : +33 (0) 1 44 65 01 40
fax : +33 (0) 1 46 07 27 58
fnicolas [at] ircam.fr