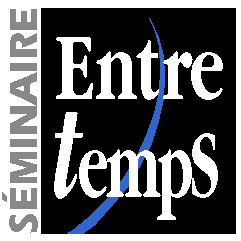 Musique,
mathématiques et philosophie
Musique,
mathématiques et philosophie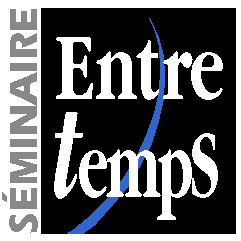 Musique,
mathématiques et philosophie
Musique,
mathématiques et philosophieThomas Sylvand
Je reviens sur votre argumentation et tout d'abord, sur
votre interprétation du triangle mathématiques /
musique / philosophie qui le transforme en une sorte de croix
ou de T renversé.
Remarquez que si le segment mathématiques / philosophie
tendait sur ce dernier schéma à se réduire
en un point, nous aurions alors une sorte d'équivalence
entre les mathématiques et la musique. Or par bien des
points de votre exposé, nous sommes tentés de faire
abstraction du pôle philosophique que vous convoquez, à
moins d'identifier celui-ci à une pure et simple logique,
ce à quoi se résume d'ailleurs la philosophie mathématique
telle qu'elle est définie par Russel.
D'ailleurs, au terme de votre exposé, vous faites directement
référence à une logique musicale autonome
(c'est l'objet de vos cinq derniers points) dont vous concevez
qu'elle possède un rapport d'équivalence avec la
logique mathématique - tout au moins cette hypothèse
se trouve dessinée en filigrane -. Le corollaire en est
que la référence à une dimension philosophique
se trouve alors superflue.
En particulier, les arguments que vous donnez comme obstacles
à des rapprochements entre musique et mathématiques
(sans médiation) ne sont pas valables. Sur le nombre par
exemple : la question de savoir ce qu'on peut transposer du nombre
en musique n'a pas d'objet, puisque, depuis Russel et Frege, le
nombre mathématiquement n'est pas lui-même un objet.
Il est même ce qui permet de fonder toute la mathématique.
La question n'est donc pas de savoir s'il y a des nombres en musique
comme il y en a en mathématiques mais de savoir si la musique
pourrait recevoir un fondement similaire à celui de la
mathématique.
De la même façon, la différence des conventions
de notation n'est pas un obstacle. Il n'est d'aucune utilité
de savoir si l'on peut utiliser des chiffres pour transcrire la
musique. La question se pose en fait en termes logiques : Frege
a montré que la possibilité d'utiliser des symboles
logiques pour transcrire les propositions mathématiques
fait des chiffres une convention accessoire de la représentation
des mathématiques. Du reste, c'est Frege toujours qui est
à l'origine de la méfiance à l'égard
de l'utilisation du langage usuel pour décrire les mathématiques,
en montrant que les structures logiques apparentes de la langue
et les structures logiques réelles ne sont pas identiques,
le langage n'étant pas suffisamment rigoureux. Et il est
alors plus que probable que toute musique peut se codifier à
l'aide de tels symboles logiques même si ceux-ci sont peu
maniables et qu'on leur préférera des raccourcis
conventionnels plus présentables.
Si l'on raisonne strictement sur la nature logique des mathématiques,
un théorème « découvert » et
défini par ses relations logiques aux axiomes ne présente
plus d'intérêt au niveau de la recherche, en dehors
de son éventuelle applicabilité (le fait par exemple
qu'on l'utilise tous les jours pour intégrer des fonctions).
Bref, c'est figer une propriété que de continuer
d'affirmer qu'un théorème est important une fois
qu'il est clairement exposé : il n'est plus qu'une propriété
logique dont on s'est assuré qu'elle ne déroge pas
à la loi des fondements. Le fait que le résultat
soit facile / difficile à exploiter ou à se représenter,
voire paraisse « beau » ou élégant,
relève d'une toute autre considération, extramathématique
en quelque sorte.
Ces considérations soulèvent alors quatre points
importants dans la présente discussion. Si l'on admet que
les mathématiques sont fondées - et elles le sont
bien -, qu'elles sont ancrées de manière solide
dans le domaine vaste et rigoureux de la logique (dont les résultats
de Gödel ne sont qu'une propriété), et si l'on
poursuit le parallèle avec la musique au-delà d'une
simple applicabilité, alors :
1) On se demande quel est le rôle du troisième terme
philosophique qui ne détermine même pas les conditions
d'applicabilité de la logique au musical (en vertu d'une
hypothétique autonomie de cette dernière).
2) Cela revient à supposer un fondement logique ou rationnel
à la musique dans son ensemble, sinon on ne verrait pas
comment cette musique logique ainsi définie n'apparaîtrait
pas au sein de toute la musique comme un domaine particulier d'application
de la logique mathématique. Or je crois qu'esquisser les
bases d'une science qui explorerait les purs fondements logiques
de la musique dans le contexte (occidental !) qui est le nôtre
est un des exercices les plus difficiles qui soit.
3) De plus, si l'on admettait que toute la musique, malgré
sa variété, obéit à un certain nombre
de règles logiques fondamentales (comme toutes les mathématiques,
malgré leur diversité, obéissent à
un certain nombre de règles fondamentales, réductibles,
pour une mathématique donnée, à une logique
donnée - intuitionniste par exemple), alors le fait que
l'activité des musiciens s'inscrive ou non de manière
consciente dans cette rationalité est complètement
indépendant de la nature logique du musical, puisque les
données fausses peuvent être aussi logiques que les
vraies.
D'ailleurs, du point de vue logique, l'attitude d'un compositeur
artisan est peut-être bien plus riche que celle d'un compositeur
pensif individuellement conscient, ne serait-ce que parce que
le premier met en jeu bien plus qu'une donnée logique individuelle.
Et si le compositeur pensif est susceptible de faire usage d'un
certain savoir, alors il ne se définit pas contre l'artisan
mais comme quelqu'un possédant quelque chose de plus que
lui, ce qui paraît une définition dangereuse...
4) Nous pourrions imaginer que l'espoir d'un compositeur pensif
est de mettre en avant la nature de tels fondements, d'engendrer
de tels processus, de la même manière que des mathématiciens
ont eux-mêmes érigé les bases de la mathématique
et de la métamathématique. Le problème est
qu'un logicien ne se distingue pas d'un mathématicien.
Cela conduit à se poser la question des fondements :
pourquoi la musique posséderait-elle des fondements et
pourquoi ne serait-elle pas plutôt contextualisée,
soumise à des conventions irrémédiablement
ajoutées par les hommes pour leur confort ? La question
du fondement des mathématiques était vitale car
on pressentait que de nombreuses applications allaient en être
faites, mais c'est loin d'être le cas de la musique.
Les fondements logiques de la musique souffrent de l'ombre que
constituent les fondements de la logique mathématique.
À l'aide de la philosophie certes, il est possible d'atténuer
cet obstacle :
- soit en se convainquant (à l'aide de certains arguments
philosophiques) que la mathématique n'est peut-être
pas aussi fondée qu'elle le voudrait, ce qui recule peut-être
plus le problème qu'il ne l'avance ;
- soit en se convainquant philosophiquement que la musique peut
quasiment constituer un monde en soi qui mérite une reconstruction
de manière à ce que nous ayons l'impression de ne
rien appliquer des mathématiques.
Mais cela, à mon sens, signerait une distinction radicale
entre musique et mathématique puisque les mathématiciens
n'entreprennent jamais de reconstruire un résultat qui
leur est déjà donné. Une règle d'or
en effet est que la mathématique se donne tous les moyens
pour ne jamais devoir revenir en arrière (tel Sisyphe)
et pour ne pas avoir à redéfinir des résultats
déjà vérifiés. La gratuité
esthétique qu'il y aurait de refonder un monde similaire
échappe complètement à la mathématique.
Le geste apparaîtrait comme d'emblée infiniment faussé.
Je suis désolé de pousser les hypothèses à une telle extrémité, mais il me semble important d'admettre qu'une différence fondamentale entre mathématique et musique tient à la nature conventionnelle (sur laquelle on peut arbitrairement intervenir à chaque instant) de cette dernière, même si cette restriction semble nous empêcher d'aller bien loin. Cela ne nous empêche cependant pas d'étudier quantité d'applications des mathématiques à la musique, applications qui semblent, elles, bien réelles.
François Nicolas
Quelques réactions immédiates et locales
à vos propos.
· Vous dites :
Si le segment mathématiques / philosophie tendait à
se réduire en un point, nous aurions alors une sorte d'équivalence
entre les mathématiques et la musique.
Il est vrai que la distinction mathématiques / philosophie
peut être débattue. René Guitart, par exemple,
tient que la mathématique est une partie de la philosophie,
ce qui est une thèse assez étonnante mais, finalement,
qui peut être comprise comme une simple conséquence
de l'équation d'Alain Badiou « mathématiques
= ontologie » sous l'hypothèse alors, soutenue pendant
longtemps par les philosophes (mais récusée par
Badiou), que l'ontologie fait partie de la philosophie.
· Vous avancez l'idée d'une « philo (logique) musicale » laquelle est bien intéressante. Elle est peut-être une version rétrécie de l'idée d'une philosophie - mathématique. Elle pose cependant de gros problèmes philosophiques. En tous les cas je ne pense pas que la logique musicale puisse être considérée comme une philosophie musicale (lors même, pourtant, que j'inclus bien la dialectique musicale dans la logique musicale), ne serait-ce que parce que si je reconnais l'existence d'une logique musicale, je ne vois guère ce que serait une philosophie musicale. Questions de terminologie, me direz-vous ? Pas seulement, je crois.
· Vous précisez :
Vous faites directement référence à une
logique musicale autonome dont vous concevez qu'elle possède
un rapport ou caractère d'équivalence avec la logique
mathématique - tout au moins cette hypothèse se
trouve dessinée en filigrane -. Le corollaire en est que
la référence à une dimension philosophique
se trouve alors superflue.
Oui, s'il était vrai que logique musicale et logique
mathématique s'équivalaient. Mais je soutiens le
contraire dans mon texte « Questions de logique »
distribué en complément de mon exposé .
Je relève également votre assertion :
Le nombre n'est pas un objet. Il est même ce qui permet
de fonder toute la mathématique.
Si je suis d'accord sur le fait que le nombre n'est pas un
objet, je suis en désaccord avec l'idée que le nombre
permettrait de fonder toute la mathématique. En théorie
des ensembles, les nombres ordinaux (ou cardinaux) ne constituent
que des ensembles d'un type particulier, et ils ne fondent nullement
cette même théorie. C'est très exactement
l'inverse : c'est la fondation des mathématiques par la
théorie des ensembles qui permet l'établissement
des nombres comme sous-catégorie d'ensembles.
· À propos de votre remarque :
l'attitude d'un compositeur artisan est peut-être bien
plus riche que celle d'un compositeur pensif [...] et si le compositeur
pensif est susceptible de faire usage d'un certain savoir, alors
il ne se définit pas contre l'artisan mais comme quelqu'un
possédant quelque chose de plus que lui, ce qui paraît
une définition dangereuse.
Compositeurs pensif ou artisan sont pour moi
des déterminations subjectives, non objectives. «
Compositeur artisan » désigne quelqu'un se disant
tel (car je crois que tout compositeur est aussi artisan). C'est
seulement de ce point de vue subjectif qu'on peut distinguer,
comme je le proposais, celui qui se dit pensif de celui qui se
dit simple artisan.
· Je reste également réservé sur
votre affirmation :
Le problème est qu'un logicien ne se distingue pas d'un
mathématicien.
Est-ce bien vrai ?
1. La logique se distingue-t-elle de la mathématique ?
Je le pense, pour ma part : la plupart des théories mathématiques
(ne serait-ce que la théorie de l'intégration évoquée)
ne sont pas intelligibles comme pures et simples théories
logiques : la mathématique déborde de toutes parts
la logique.
2. Si tel est bien le cas, comment alors un logicien pourrait-il
ne pas se distinguer d'un matheux ?
· Enfin, dernière réaction. Vous dites
:
Une règle d'or est que la mathématique se donne
tous les moyens pour ne jamais devoir revenir en arrière
(tel Sisyphe) et avoir à redéfinir des résultats
déjà vérifiés.
Je n'en suis pas du tout sûr. Par exemple, les mathématiques
sont bien amenées à redémontrer autrement
des théorèmes déjà démontrés.
N'est-ce pas là une manière de « revenir en
arrière » ? Et certaines refondations mathématiques
opérées il y a cent ans ont, me semble-t-il, le
même caractère de reprise...
Thomas Sylvand
Une remarque sur votre dernier point. Je veux dire que
lorsqu'un théorème est vérifié, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a pas lieu de montrer qu'il était faux, la
mathématique ne revient pas en arrière à
son sujet. Toute nouvelle démonstration (autre démonstration)
n'est qu'un domaine ajouté, en plus. De la même façon,
les tentatives de refondation des mathématiques sont une
tentative pour leur donner plus de rigueur, mais certains anciens
résultats, tels les postulats d'Euclide, peuvent toujours
être considérés comme valides. Même
les constructions alternatives (voir les logiques intuitionnistes
et modales ou les géométries non euclidiennes) sont
conçues comme des additions de domaines à la mathématique.
Laurent Mazliak
Je reste assez peu convaincu par la distinction faite
par François Nicolas dans son exposé entre «
une formule » et « une théorie ».
En fait, je ne suis pas sûr que, comme il l'affirmait, un
théorème soit en soi différent de ce même
théorème complété de sa démonstration.
Nous connaissons tous des exemples où la démonstration
obscurcit les choses plus qu'elle ne les éclaire (attention
: ceci n'en invalide en rien la nécessité) et je
pense qu'on est un peu revenu de la vision purement bourbachiste
des mathématiques.
Pour donner un exemple concret relevant de ce lycée dont
il a été mentionné les déficiences,
je ne pense pas que la construction du corps des complexes à
partir des matrices carrées d'ordre 2, construction qui
se faisait auparavant en terminale, apprenne quoi que ce soit
sur la puissance ou la richesse de ces nombres.
De même, on s'est mis à hurler quand on a supprimé
des programmes du supérieur toute construction de R, mais
je pense qu'on l'a fait pour de mauvaises raisons : cette construction
n'apprend rien sur R qu'on ne puisse concevoir axiomatiquement
; la question relève simplement d'un point de satisfaction
intellectuelle.
De ce fait, quand Alain Connes dit qu'un mathématicien
a compris un théorème quand il en a compris la démonstration,
je ne crois pas qu'il entende exactement ce que Nicolas en disait
mais plutôt qu'il peut extraire de la démonstration
la dynamique sous-jacente qui est éventuellement créatrice
de nouvelles idées. Bien sûr, ceci ne signifie pas
que je suis satisfait du massacre des mathématiques qui
a été effectué dans les programmes du secondaire
mais je pense qu'on sera d'accord pour dire que ce n'est pas parce
que c'est dramatique maintenant qu'il faut dire que c'était
parfait avant !
François Nicolas
Plusieurs réponses à Laurent Mazliak.
1. Je ne pense pas que rehausser l'importance de la démonstration en mathématique soit particulièrement bourbachiste. La preuve, si je puis dire : Arpad Szabo (qui n'est aucunement bourbachiste) et qui insiste sur l'importance (en termes de fondation des mathématiques) de l'invention de la démonstration à l'époque des Grecs.
2. Les deux exemples donnés (nombres complexes et R)
me semblent poser des problèmes de natures assez différentes.
D'abord donner une démonstration d'un théorème
est un peu autre chose qu'exposer une théorie, a fortiori
la construire de la manière dont on peut construire les
réels par les coupures de Dedekind. Par exemple on pourrait
(et on devrait) démontrer aux élèves de Seconde
l'irrationalité de racine de 2 comme l'ont fait les Grecs
: cela éclaire immédiatement le point de l'irrationalité.
Démontrer cela est une chose, construire les réels
en est une autre. Si on ne démontre pas cette irrationalité,
que peut en comprendre celui à qui on dit simplement qu'il
y a des irrationnels, à qui on se contente d'en énoncer
l'existence ?
3. L'exemple de construction des réels est pour moi
un très bon exemple car il fut précisément
lié à un « événement »
important dans mon rapport aux mathématiques. Mon professeur
de taupe avait exposé cette construction (à partir
des coupures de Dedekind) et ce qui m'avait alors sidéré,
c'est d'abord que l'on entreprenne ainsi de fonder ce qui pouvait
paraître aller de soi, et ensuite (rétrospectivement)
que ce que je croyais établi et assuré (parce que
je calculais depuis longtemps avec cela) n'avait en vérité
aucun statut évident et que j'aurais pu tout aussi bien
ne bâtir depuis longtemps à partir d'eux que ce que
l'on bâtit à partir de licornes ou de chimères.
C'est précisément par cette construction que le
cours de mathématiques sortait d'un coup de son régime
usuel de calculs pour taupins et futurs ingénieurs et accédait
enfin à un statut de pensée proprement dite.
Je dirais donc volontiers que tant qu'on n'a pas compris la nécessité
de fonder l'ensemble des réels R, on n'a pas compris ce
que sont les mathématiques. Ou encore, je n'imagine pas
un mathématicien qui puisse se déclarer indifférent
à l'existence d'une telle construction (et qui soutienne
par exemple : « peu importe qu'elle existe ou non »).
4. Un théorème peut avoir une dynamique créatrice
mais il l'a aussi pour partie à mesure de la dynamique
dont il procède, de son amont et pas seulement de son aval.
La récente démonstration du théorème
de Fermat semble bien attester ce point (pour ce que j'en ai compris
!) puisqu'elle crée des connexions entre domaines ou théories
mathématiques a priori bien éloignés.
Au total, je maintiens donc qu'un théorème sans
sa démonstration, c'est une météorite ou
un bout de musique traditionnelle dont on ne connaîtrait
pas l'entour. Bien sûr, on peut toujours se mettre à
rechercher le contexte dont cette partie serait extraite comme
on peut entreprendre de découvrir l'insertion d'un énoncé
mathématique et d'où il provient. Mais précisément
cette attitude est alors tout le contraire d'une indifférence
à la démonstration de cet énoncé !
On pourrait accumuler les métaphores : je le ferai ici,
pour stimuler la controverse. Un théorème sans démonstration,
c'est comme celui qui réduirait un roman au sommaire de
son intrigue et résumerait ainsi 50 % des romans : «
un jeune homme rencontre une jeune femme et l'aime ». C'est
comme résumer les sonates de Beethoven et autres classiques
viennois à « exposition, développement et
réexposition ». Un théorème sans démonstration,
c'est comme la morale d'une histoire mais sans l'histoire en question
; c'est comme la conclusion d'une fable mais sans la fable elle-même
; c'est comme la chute d'une blague mais sans la blague elle-même
; ou c'est le dénouement d'un roman policier mais sans
le roman.
Ce n'est donc pas simplement une question de contexte mais cela
tient au fait que cet énoncé (le théorème)
est amené là selon une procédure réglée,
selon des enchaînements codifiés. Or il se trouve
que les mathématiques règlent leur discipline de
pensée sur ce genre de déduction (les démonstrations),
comme les fabulistes règlent la leur sur d'autres, ou les
musiciens sur le développement. Il faudrait donc se demander
quel peut bien être l'intérêt d'un théorème
sans sa démonstration, de même que l'on peut se demander
quel serait l'intérêt de ne voir que les dernières
minutes d'un film policier ou de lire les seules dernières
pages d'un Agatha Christie, ce que personne, à ma connaissance,
ne fait. Qui lirait de même des pages de théorème
sans qu'ils soient l'aboutissement de leurs démonstrations
? Qui ferait cela ne comprendrait pas plus à ce qui est
pensé dans un théorème que ne le peut celui
qui ne connaîtrait de la Fontaine que « la raison
du plus fort est toujours la meilleure » : ce qu'il ferait
alors, c'est traiter La Fontaine en moraliste sentencieux (en
La Rochefoucauld) plutôt qu'en écrivain...
Ce que dit vraiment un théorème tient à ses
corrélations. Dit encore autrement : le propre d'un énoncé
scientifique, singulièrement mathématique, est qu'il
peut être détaché de toute position d'énonciation
(il n'y a besoin de savoir que c'est Monsieur Dedekind qui a parlé
de « coupure ») mais ceci ne veut pas dire que cet
énoncé est pour autant détaché de
tout contexte mathématique, bien au contraire. C'est précisément
parce qu'il est détachable d'une position d'énonciation
qu'il est plus fortement attaché à d'autres énoncés
mathématiques. À l'inverse, un énoncé
philosophique (tel le cogito « je pense donc je suis
») et a fortiori littéraire (« Longtemps je
me suis couché de bonne heure... ») reste attaché
à son contexte d'énonciation et par là seulement
à d'autres énoncés : sa connexion aux autres
énoncés du Discours de la méthode
ou de la Recherche du temps perdu passe ainsi par cette
énonciation singulière et n'est pas intrinsèque.
L'énoncé de type particulier en quoi consiste un
théorème porte, lui, des connexions intrinsèques
à d'autres énoncés et c'est pour cela que
la découverte d'une nouvelle démonstration d'un
théorème peut devenir en soi un événement
mathématique.
Frédéric Voisin
Posons la question naïve suivante : y a t-il un nom
différent pour « théorème démontré
» et pour « théorème non démontré
mais dont on subodore qu'il le sera un jour ? » Autrement
dit : un théorème est-il un théorème
s'il n'est pas démontré ?
Un « théorème » non encore démontré
pourrait à mon avis avoir des implications implicites qui
ne soient pas « inutiles » à la compréhension
d'un concept (plus ou mois explicite) : un « théorème
non démontré » (une conjecture ?) a déjà
le mérite d'être posé, ce qui n'est pas rien.
Et la dynamique du théorème sans démonstration
(même si celle-ci existe par ailleurs) n'est pas nécessairement
la même que la dynamique de sa démonstration.
François Nicolas
Y a t-il un nom différent pour « théorème
démontré » et pour « théorème
non démontré mais dont on subodore qu'il le sera
un jour ? » Autrement dit : un théorème
est-il un théorème s'il n'est pas démontré
?
Non, je ne pense pas ! Un théorème, par définition,
est démontré. Ce qui ne l'est pas est au choix :
- une proposition fondatrice : un axiome, supposé
indémontrable, mais dont l'implication ou l'influence (bref
ce qui se situe en aval) est supposée déterminant
(puisque c'est à partir de cet axiome qu'on va développer
une théorie) ;
- une proposition intermédiaire indémontrée
qu'on espère pouvoir démontrer un jour (une conjecture)
et à partir de laquelle on va déduire de nouvelles
propositions (dont la démonstration restera donc subordonnée
à celle, manquante, de la conjecture) ;
- une proposition intermédiaire non démontrée
qu'on pose provisoirement (une hypothèse donc) pour
mieux tenter de la démontrer ou de la réfuter par
examen de ses conséquences.
Mais pas de place, me semble-t-il, pour un « théorème
» indémontré.
Un « théorème non démontré
» (une conjecture ?) a déjà le mérite
d'être posé, ce qui n'est pas rien. Et la dynamique
du théorème sans démonstration (même
si celle-ci existe) n'est pas nécessairement la même
que la dynamique de sa démonstration.
Je dirais volontiers (voir la discussion précédente
avec Laurent Mazliak) que l'amont et l'aval d'un théorème
n'ont pas en général même puissance : la dynamique
de la démonstration ne dit pas forcément grand-chose
sur la dynamique de ce qui se déduit à partir du
théorème. D'où la difficile question des
théorèmes dits « intéressants »
: qu'est-ce qui fait qu'un théorème est dit «
intéressant » ? Pourquoi cet intérêt
d'un théorème n'est pas a priori lisible dans sa
démonstration ? Pourquoi un théorème «
intéressant » (c'est-à-dire en général
intéressant pour ce qu'il ouvre plutôt que pour ce
qu'il achève) n'a pas forcément une « belle
» démonstration ? Etc.
Donc tout à fait d'accord pour disjoindre l'amont et l'aval
mais je maintiens qu'on ne peut comprendre ce que pense un théorème
si l'on ne s'intéresse aucunement à sa démonstration.
Par exemple, je ne suis nullement en état de comprendre
la démonstration de la conjecture de Fermat mais je ne
peux pas imaginer que la démonstration qui vient d'en être
faite n'éclaire pas son sens mathématique profond.
Frédéric Voisin
Je suis parfaitement d'accord quant à la distinction
des énoncés selon qu'ils sont ou non démontrés.
Et en effet, c'était bien dans ce sens qu'allait ma remarque
: qu'y a t-il d'intéressant dans un théorème,
dans un axiome, dans une conjecture ? La dynamique n'est pas la
même pour chacun de ses objets.
On peut dire en effet qu'« un mathématicien a
compris un théorème lorsqu'il en a compris la démonstration
», ou bien qu'« un théorème sans
sa démonstration est une météorite ou un
bout de musique traditionnelle dont on ne connaîtrait pas
l'origine ». J'apprécie beaucoup la référence
ici à la musique traditionnelle. En effet, en ethnomusicologie,
on ne saurait que faire d'un extrait de musique dont on ne connaîtrait
pas l'origine (le contexte). Je suis bien placé pour le
savoir.
Cependant, certains, non-ethnomusicologues, n'auront que faire
de connaître l'origine de ce bout de musique et en tireront
profit en s'en inspirant... Ainsi, la dynamique de ce bout-de-musique-inconnue
peut échapper à sa fonction originale. On pourrait
alors aller jusqu'à dire que le statut de ce bout de musique
change selon qu'il est appréhendé avec ou sans son
contexte.
De même pour le théorème : avec sa démonstration,
il s'adresse à une communauté particulière
qui a appréhendé le théorème dans
sa fonction première (être démontré)
alors qu'un théorème dont on ne connaîtrait
pas la démonstration (ou qu'on ne saurait refaire) changerait
de statut : il deviendrait un axiome, ou une espèce particulière
de conjecture. Du coup, un théorème sans démonstration
n'est plus un théorème : c'est une sorte d'axiome
(personnel). Cela ne l'empêche donc pas d'être intéressant
pour autant, bien que sa fonction ait été détournée.
Et telle était mon hypothèse : insister sur l'importance
du contexte (souvent implicite) qui détermine la fonction
de l'objet (théorème ou autre).
D'autre part, peut-on raisonnablement penser qu'un théorème (donc pourvu d'une démonstration) puisse être redémontré ? Cela impliquerait donc qu'un théorème est à la fois théorème dans un contexte donné (telle théorie) et axiome ou conjecture dans un autre contexte. Un théorème serait donc potentiellement un « autre » théorème ? L'exemple de la construction des réels comme cette dernière question nous ramène donc à la question de l'identité.
François Nicolas
Peut-on raisonnablement penser qu'un théorème
puisse être redémontré ? Cela impliquerait
donc qu'un théorème est à la fois théorème
dans un contexte donné et axiome ou conjecture dans un
autre contexte. Un théorème serait donc potentiellement
un « autre » théorème ?
Il arrive en effet constamment qu'un même théorème
ait plusieurs démonstrations, d'ordres très différents.
Il y a donc sens à « redémontrer » un
théorème à partir d'une autre théorie
mathématique.
Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse pousser très (trop)
loin l'analogie entre démonstration et contexte : une démonstration
mathématique d'un théorème est bien plus
qu'une contextualisation d'un énoncé. La contextualisation
mathématique d'un énoncé existe : cela consiste
à plonger un théorème (venu d'ailleurs) dans
une autre théorie. Mais faire ceci n'est pas pour autant
produire une nouvelle démonstration de ce théorème
dans cette théorie. En ce sens, démontrer
n'est donc pas simplement contextualiser.
On le voit a contrario en musique où il y a sens à
contextualiser mais guère à « démontrer
». Un objet trouvé musical peut être recontextualisé,
ayant été précédemment décontextualisé.
Mais l'idée de sa possible « démonstration
musicale » n'a guère de sens. Tout au plus peut-on
parler d'une éventuelle déduction musicale, mais
le mot « déduction » devient ici très
ambigu, un peu comme le mot « logique ». Je crois
d'ailleurs que Tom Johnson compte nous parler de tel type d'objets
à notre séance de janvier.
Pour éclairer notre débat sur l'importance ou
non des démonstrations en mathématiques, et sur
l'existence ou non de théorèmes sans démonstrations,
on peut se reporter à l'exemple du grand mathématicien
Ramanujan (1887-1920) qui s'était formé tout seul
par lecture d'un synopsis de 6 000 formules et théorèmes
mathématiques présentés sans démonstrations
! À partir de là, ce mathématicien (génial)
avait, tout seul, d'une part reconstitué la « logique
» de ces formules, d'autre part produit lui-même des
centaines d'autres formules, toutes plus pénétrantes
les unes que les autres. Ayant présenté son travail
au mathématicien Hardy, celui-ci avait découvert
:
- que certaines formules étaient des redécouvertes
de théorèmes déjà démontrés,
- que d'autres étaient des propositions novatrices,
- que certaines étaient fausses, mais, comme le dit Hardy
, ces énoncés faux pouvaient s'avérer des
plus stimulants pour une recherche ultérieure,
- que toutes ces formules étaient, d'une façon ou
d'une autre, profondes.
Ramanujan ignorait en fait la catégorie de démonstration.
Il travaillait semble-t-il par induction à partir d'exemples
numériques et, une fois que sa conviction s'était
constituée (par un mélange d'intuition et d'évidence),
il considérait alors que la formule (ou l'énoncé)
était vraie. Ce qui opérait ainsi (pour un génie
des mathématiques !) dans 95 % des cas butait cependant
sur des erreurs ou des situations où une démonstration
s'avérait absolument nécessaire. Comme le dit Hardy,
si vous voulez par exemple vous convaincre que le nombre 2127-1
est premier, vous ne pourrez le faire que par une démonstration
et nullement par une quelconque intuition globale : l'analyse
des enchaînements est ici nécessaire et nulle synthèse
ne saurait s'y substituer. Hardy donne un autre exemple, toujours
dans la théorie des nombres premiers (qui a vertu pour
nous de se donner dans des énoncés immédiatement
intelligibles) : le « théorème » des
nombres premiers propose une majoration de la quantité
de nombres premiers inférieure à un nombre donné.
Or une formule, avalisée par Gauss, qui s'avérait
non seulement plausible mais confortée par l'évidence
de tous les faits connus, a été réfutée
par Littlewood en 1912 sur la base d'une valeur plus qu'astronomique
(10 puissance 10 puissance 10 puissance 34 !). Littlewood bien
sûr n'est pas tombé sur ce nombre par hasard mais
l'a construit pour les besoins de sa cause. Comprendre cette construction,
et par là la démonstration réfutant le pseudo-théorème
précédent, est alors bien le seul moyen d'accéder
à une compréhension de ce qui se joue dans ces conjectures.
Frédéric Voisin
François Nicolas : « Démontrer n'est pas
simplement contextualiser. On le voit a contrario en musique où
il y a sens à contextualiser mais guère à
démontrer. »
Je suis d'accord sur cette distinction entre contexte et démonstration,
et je ne voulais pas faire d'amalgame. La contextualisation d'un
théorème en mathématique consisterait donc
à importer dans une théorie un théorème
issu d'une autre théorie ; sa démonstration reste
alors à refaire (dans ce nouveau contexte) et de ce fait
le théorème n'est plus un théorème,
mais une conjecture.
Le parallèle avec la musique est évidemment dangereux,
mais on peut cependant, dans le domaine cognitif plus large que
constitue la logique, trouver un parallèle musical à
la démonstration mathématique : considérons
pour cela un théorème comme un énoncé
(une assertion). La démonstration n'est pas immédiatement
donnée avec le théorème, elle reste implicite
et fait sens dans un certain contexte précis (dans un univers
cognitif donné). L'acte de démonstration, il me
semble, donne alors à voir (à entendre) la consistance
implicite de l'énoncé.
Le parallèle serait alors celui-ci : l'analyse musicale,
du moment qu'elle est cognitivement pertinente (emic) montrerait
la consistance de l'énoncé (musical). Ainsi un énoncé
musical peut être importé hors de son contexte cognitif,
sans connaissance de son niveau emic. Ainsi, de même
qu'un énoncé mathématique est théorème
ou conjecture selon le contexte, il serait pertinent d'effectuer
le même genre de distinction pour un « même
» énoncé musical selon qu'il est pris avec
ou sans son contexte d'origine (voir la vieille distinction etic
/ emic qui devient trop souvent aujourd'hui une considération
sur l'« ethnique » - ethmic ?).
François Nicolas
Lorsque vous dites : « l'analyse musicale montrerait
la consistance de l'énoncé musical », on perçoit
déjà là un premier décrochement :
l'énoncé musical dont il est ici question est, j'imagine,
sonore ou du moins écrit en notes. L'analyse musicale qui
va en « montrer la consistance » est, par contre,
en mots. D'où un décrochement entre deux registres
hétérogènes (l'énoncé musical
et son « analyse ») qu'il n'y a pas en mathématiques
entre énoncé-théorème et sa démonstration
(qui s'établit dans le même registre de la «
langue » mathématique).
En toute rigueur, il faudrait donc comparer l'énoncé
mathématique déplacé d'un contexte théorique
à un autre à une citation musicale faite dans un
autre contexte sonore et musical que celui d'où cette citation
est prélevée.
De même qu'un énoncé mathématique
est théorème ou conjecture selon le contexte, il
serait pertinent d'effectuer le même genre de distinction
pour un « même » énoncé musical
selon qu'il est pris avec ou sans son contexte d'origine.
Autre distinction, dont il faut ici tenir compte : une démonstration
d'un énoncé mathématique n'est pas n'importe
quelle contextualisation. On peut contextualiser un énoncé
mathématique (en montrer par exemple les conséquences,
la richesse d'éclaircissement) sans pour autant le démontrer.
Cette distinction n'a pas exactement de sens en musique. On peut
bien sûr introduire une citation musicale sans ouvrir les
guillemets c'est-à-dire sans faire remarquer qu'il s'agit
là d'une citation. Alors on peut dire qu'on crée
de nouveaux antécédents à cet énoncé
musical mais comme par contrecoup cet énoncé n'est
alors plus mis en valeur en sa singularité, on se retrouve
à nouveau très loin d'une démonstration mathématique
qui, au contraire, choisit toujours d'amplifier le moment de la
conclusion, celui où l'on arrive enfin au résultat
recherché (en général d'un C.Q.F.D.
percussif).
Bref, à ce niveau (qui est celui des logiques de discours),
les différences et impossibilités de faire que discours
mathématique et discours musical se recouvrent l'emportent
sur les ressemblances. C'est aussi pour cela que j'avançais
l'idée que la musique peut fonctionner comme modèle
pathologique d'une théorie mathématique, car un
modèle (au sens mathématique du terme) n'a nullement
la même structure que la théorie qui le formalise.
Dans cette acception du mot modèle, modèle
et formalisation ne sont en effet nullement isomorphes.
Mais finalement je me demande si tout ce débat n'a pas à voir avec la différence subjective entre mathématiques et informatique. C'est une question que je me pose, que je vous pose : quel est le rapport aux mathématiques d'un (des) informaticien(s) ?
Frédéric Voisin
De même qu'une morale n'a pas besoin d'histoire(s),
celle(s)-ci n'intéressant que les amateurs de littérature
ou les structuralistes, de même un informaticien ne cherchant
pas à entrer dans des considérations théoriques
pourra trouver le théorème adéquat à
un certain problème en cherchant par exemple dans les «
Numerical Recipes ». On peut donc penser que la façon
de poser le problème déterminera le théorème
« utile ». J'aurais donc tendance à penser
que la question du contexte est essentielle puisque c'est le contexte
qui détermine la pertinence, si bien qu'on pourrait placer
le contexte au-dessus de la démonstration, et cette dernière
au-dessus du résultat.
Pour moi le contexte n'est pas une théorie mais plutôt
un ensemble de croyances d'ordre cognitif plutôt que formel
(cognitif voulant dire un ensemble d'attitudes perceptives,
de sensibilités que l'on doit au rapport entre l'inné
et l'acquis, à l'apprentissage). Donc par contexte j'entends
un niveau phénoménologique qui est loin d'être
négligeable, surtout en logique pure.
On peut à partir de là se demander où réside
l'aspect fonctionnel d'un théorème : est-ce l'énoncé
ou la démonstration ? La démonstration n'est-elle
pas plus fonctionnelle que l'énoncé ? Peut-on imaginer
un théorème sans énoncé (là
où le contraire - un énoncé sans théorème
- est un axiome) ? Certaines sociétés (telles les
bouddhistes) ont souvent un raisonnement circulaire plutôt
que dialectique tout en étant également productrices
de savoirs et de technologies (traditionnels) : la structure des
fables de la Fontaine comme celle de la Bible est ainsi beaucoup
plus linéaire que celle du Mahabarrata ou du Ramayana
: y a- t-il en effet une conclusion dans ces deux dernières
mythologies ? La forme sonate n'existe pas dans les musiques de
ces sociétés : en Afrique comme en Asie du Sud-Ouest,
voire en Amazonie, la musique n'a ni commencement, ni fin.
François Nicolas
Frédéric Voisin : « Peut-on imaginer un
théorème sans énoncé ? »
Là, je ne comprends pas bien : un théorème
est un énoncé (d'un type particulier). Donc je ne
vois pas du tout ce que pourrait être un théorème
qui ne serait pas un énoncé.
Je vois bien par contre que la question du contexte nous partage.
Mais je maintiens qu'elle est autre que la question de la démonstration,
laquelle nous partage également.
Y a-t-il alors une raison pour que soient associés ces
deux partages ? Je ne le pense pas parce que retirer à
un théorème sa démonstration, c'est aussi
lui retirer son contexte (on en a déjà parlé),
c'est ôter l'eau dans lequel baigne le théorème-poisson.
Donc défendre la contextualisation et en même temps
séparer le théorème de sa démonstration
comme vous le faites me semblent un peu contradictoires.
Quant à la question du contexte (faut-il ou non contextualiser
?), la réponse dépend bien sûr de ce que l'on
entend par contexte, car il y en a de types bien différents.
Dans mon cas, si démontrer est interprété
comme une manière de contextualiser, alors en revendiquant
d'associer un théorème à sa démonstration,
je prône bien une forme de contextualisation. Par contre,
si contexte veut dire énonciation d'un énoncé
(et il me semble que toute une part de ce que vous formulez va
dans ce sens), alors je soutiendrai au contraire qu'un énoncé
scientifique se distingue d'un autre énoncé, précisément
parce qu'il peut être décontextualisé au sens
précis de détaché d'une position d'énonciation.
L'énoncé « Longtemps je me suis couché
de bonne heure » ne peut être détaché
de l'énonciation « Recherche du temps perdu
» qu'au prix de sa banalisation et de l'évaporation
de son contenu de pensée (sensible). L'énoncé
« Dans un triangle, le carré de l'hypoténuse
est égal à la somme des carrés »
peut par contre être détaché de son énonciation
(par Pythagore ?), ce qui ne veut pas dire extrait de son contexte
mathématique qui précise, seul, ce que voudra dire
« triangle », « hypoténuse
», etc.
Plus généralement, cette question du contexte
partage aujourd'hui fortement les consciences. Je tiens que la
pensée naît en général au point où
quelque proposition se détache d'une gangue, s'isole, au
point donc où opère un saut, une discontinuité,
une rupture, à tout le moins quelque chose qui ne saurait
s'expliquer par le contexte, par la continuité, par le
prolongement. Ce type de saut, dans les mathématiques,
ce sont des axiomes. Mais les mathématiques sont déjà
par elles-mêmes un tel saut de la pensée au regard
de leur contexte social et culturel (voir Arpad Szabo : il montre
que la démonstration, singulièrement celle par l'absurde,
n'est nullement une constante de la pensée humaine mais
une invention apparaissant à un moment de l'histoire, et
inaugurant alors quelque chose de radicalement neuf - les mathématiques
en l'occurrence - qu'on ne saurait assimiler aux dispositifs antérieurs
de calculs).
Donc pour résumer ma position :
- oui pour la contextualisation mathématique d'un théorème
(incluant donc sa démonstration) ;
- non pour une contextualisation des mathématiques qui
les rabattraient et les homogénéiseraient à
un dispositif culturel et technique de calcul.