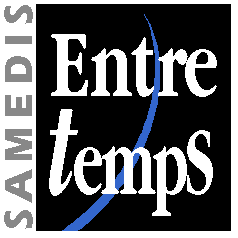
La Singularité Schoenberg de François Nicolas
Samedi 27 février 1999 (Ircam)
Le geste musical mis à nu
François Wahl
Posons pour disposer d'un appareil consistant : tout perçu lie un divers sensible ; il ne se résume ni en la passivité d'impressions, ni en la positivité de structures perceptives ; il se constitue comme mise en relations de termes qui revêt d'emblée la forme, logique, d'un énoncé. Ce que le perçu a lié, le faire esthétique le délie pour le relier autrement. Cette différence s'explique pour ce que le perçu, en liant le sensible, vise à constituer l'étant ; sa fin n'est pas le sensible, dont il prend seulement appui pour prononcer le faire-Un de l'étant ; le faire esthétique, lui, saisit le sensible, la matière du sensible, dans son immanence et, ce faisant, délie le perçu, pour relier à soi le sensible dans sa matière même. C'est dire qu'il n'emporte pas moins que le perçu une opération intellectuelle, qu'il ne revêt pas moins la forme d'un énoncé, mais celui-ci à découvert parce qu'inscrit, toute la difficulté est là, dans la seule matérialité du sensible.
Ces propositions élémentaires permettent de mesurer la justesse de l'entreprise de François Nicolas cherchant à définir ce qu'est "l'intellectualité musicale". Comme intellectualité ou pensée, oui, mais à l'oeuvre dans la musique, à même l'oeuvre, comme son "vouloir être". C'est le premier point que je veux souligner.
Tout penser est faire-Un. Déliant du dedans la matière sonore et l'ayant à disposition pour la reconstituer, le musicien a pour premier impératif de bâtir un ensemble consistant. Cela doit s'entendre - à tous les sens du mot - non seulement de la construction - de ce qui fait qu'une pièce est une dans son développement - mais du matériel sonore - de ce que François Nicolas appelle la "sensation" - et du mouvement qui l'anime, de sa poussée intérieure - de ce que François Nicolas appelle "l'expression". Encore ne suffit-il pas que l'unité soit globale, qu'elle vaille pour l'oeuvre en son entier : une oeuvre pensée est une aussi bien localement que globalement et dans la reprise du local par le global.
S'agissant de Schoenberg, on sait - et on entend - de fait combien ce fut là son problème, dès lors, Dahlhaus y insiste, que l'affranchissement de la tonalité supprimait une ressource majeure de l'unité. Remarquons tout de suite qu'une mauvaise façon d'aborder Schoenberg est de le définir par tout ce qu'il évite : comme il dit, par "ce qu'il fait" et qui interdit bien d'autres recours que l'accord tonal ; la bonne façon de l'aborder se dit, je le cite encore, en entendant "ce qu'il est". Et il est, aussi bien que dans l'harmonie, dans le rythme, dans le timbre, dans la dynamique, le gouvernement du sonore par l'écart : son univers sonore est sous la prescription du délié. D'où le problème que Nicolas résume fortement : assurer l'unité sans l'unicité. Comment d'une "variation développante" continue sans retours faire un unique tissu - le Concerto pour piano -, comment disperser l'instrumentation et lui assurer cependant une continuité logique - la mélodie de timbres -, ne jamais laisser s'éteindre le mouvement expressionniste de la passion à travers une dynamique sans cesse mobile. Je proposerai pour ma part de dire que, plus facilement saisissable dans les oeuvres à matériel sonore réduit comme Pierrot lunaire et la Sérénade, Schoenberg a ouvert de l'intérieur la musique : sans la norme tonale, donnant la même importance au vertical et à l'horizontal, éparpillant les timbres et privilégiant le pointé ou le pincé, il se plaçait - surtout avant l'invention de la série - dans le multiple, le divers comme libre. Et que dans le même temps, il a toujours récusé l'anarchie. Schoenberg, c'est une tentative inouïe de composer le dispersé.
Mais l'essentiel de ce qui constitue l'intellectualité musicale n'est pas encore dit avec le principe d'unité. L'essentiel, il me semble, de ce qu'apporte François Nicolas, c'est l'affirmation qu'il s'agit de l'intellectualité de l'oeuvre elle-même, et d'elle seule. Autant dire, philosophiquement, que l'oeuvre est un en-soi pour-soi. D'où que la pensée de l'oeuvre doit être pensée sans référence à l'auteur, qui n'est plus ici qu'un "reste". D'où que la sensation n'est pas celle de l'auditeur, pris dans la subjectivité de ce qu'il sait ou ne sait pas percevoir et de toutes les connotations qui en lui se réveillent ; la sensation est celle de la musique elle-même, c'est-à-dire tout le matériel de relations sonores qu'elle met en jeu et combine, en soi, de par soi. D'où enfin que le discours musical n'a pas d'autre sujet que lui-même. J'insiste sur ce point que j'avais, moi aussi, avancé s'agissant du tableau : toute oeuvre est un discours, et ce discours se supporte d'un sujet qui n'est rien que le sien. Ce qui n'étonne pas si, comme je le fais, on tient que le concept de sujet n'a pas d'autre sens : il n'y a chaque fois sujet que d'un discours, qui le porte et dont il répond, et nous-mêmes ne sommes sujets que pour autant que nous nous identifions avec "notre" discours. Je regrette que, dans un texte ultérieur à La singularité Schoenberg, François Nicolas, sans d'ailleurs rien récuser de l'ensemble de son analyse, se soit quelque peu effrayé du pas philosophique qu'il avait accompli en posant l'oeuvre comme sujet d'elle-même.
Le fait est que chaque, comme il vaut mieux dire, oeuvre-Schoenberg est sujet d'elle-même, chaîne de décisions ou événements intérieurs qui la structurent, autour de son ouverture par le dedans, extraordinairement imprévisible, et cependant sujet affirmé par l'implacable cohérence qui s'y reconnaît, dont la série ne sera que l'aboutissement. Musique où l'autre ne cesse pas d'être à distance le même. Comment décrire autrement dans la Suite pour sept instruments, op. 29, les constantes variations de tempo, de carrure, de style, les brusques interruptions et redéparts, commandant autant de séquences quasiment indépendantes, en même temps que l'homogénéité totale gouvernée par le privilège, dans la série, de quatre notes à fonction thématique ? La musique est là, qui choisit d'un instant à l'autre, se choisit, péremptoire, sans jamais se perdre, sans jamais cesser de s'affirmer comme le même sujet.
C'est pourquoi ce qui a été montré jusqu'ici prescrit enfin une théorie de l'écoute. Nous savons déjà qu'elle ne se tournera ni vers ma subjectivité d'auditeur, ni vers le fantasme de l'auteur. Mais encore faut-il qu'elle sache retrouver quelle nécessité lie entre eux tous les éléments de la partition, tous les événements que l'oeuvre enchaîne pour en faire un seul discours. C'est pourquoi François Nicolas propose une première écoute "naïve", "au fil du temps", y accrochant le divers des événements : accords, motifs, rythmes, timbres... Est en toute rigueur requise une seconde écoute, qui est la lecture de la partition : lecture analytique, reconstitution de l'édifice musical. Alors peut venir la véritable écoute, "intégrante" ou "réflexive" ; dans une formulation admirable, où se marque la cohérence de son propos, François Nicolas écrit que ce qui s'entend alors c'est l'oeuvre "s'écoutant elle-même", ou mieux "écoutant la musique" : ce qu'elle fait du musical.
Le fait est qu'écouter Schoenberg, pour quelqu'un qui comme moi a seulement une position d'auditeur, requiert un travail d'accommodation à l'intellectualité musicale multiple. L'écoute naïve balance entre l'évidente continuité envers l'histoire de la musique, restée toujours présente, et l'ouverture que je disais, qui entraîne la difficulté à repérer les figures et leur retour. Continuité dans le souci macroscopique de conserver les grandes formes classiques - que lui a reproché Boulez - ; dans l'utilisation récurrente de la carrure du temps des danses et des marches si fréquent déjà chez Mahler ; dans une parenté bien connue avec Brahms, que je reconnais pour ma part pas seulement dans la superposition de voix indépendantes, aussi dans la matière grinçante du son des cordes, mais l'importance de la clarinette avec la mandoline pourrait aussi bien renvoyer à Mahler. Difficulté du repérage microscopique : quand bien même on a au départ le motif ou la série qui fait motif, le fait que son parcours opère par "variation développante" selon une exigence de non répétition, avec des variations internes de timbre et des déplacements d'accent, requiert un réapprentissage de l'écoute. Au point que, quand il y a une véritable reprise - ainsi, pour revenir à la Sérénade, cette très jolie petite phrase lente de la clarinette qui revient trois fois à la fin de la Tanzscene et une fois vers la fin du Finale -, on risque de lui prêter une importance impertinente ; plus pertinente sera la saisie, dans la Marche, de la superposition sans point d'appui de deux rythmes - large du motif, extraordinairement serré de l'accompagnement -, de l'échange de leurs timbres et de leur venue alternée au premier plan : simple exemple. Il faut une écoute autre, qui se plie à la variation continue en sachant y poursuivre l'objet de la variation et tout le divers dont est faite la variation elle-même tout à la fois. Est-ce complètement possible sans la partition ? Mais la partition dit-elle tout ce qu'elle a à dire pour qui ne s'est pas heurté aux apories de la composition ? Telle est la question que soulève le précepte de François Nicolas. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'au terme des écoutes, l'audition a changé, s'est emparée sinon de tout au moins d'une large partie de tout ce que gère l'oeuvre de sa substance sonore : je ne suis plus devant la particularité Schoenberg mais devant la singularité de cette oeuvre-ci, de ce discours musical, prononçant son propre énoncé musical, et se prononçant sur la musique. Encore faut-il l'intégrer - retour au macroscopique - à l'expression si singulière à son tour : que je qualifierai, passé le romantisme des premières partitions, d'affirmation péremptoire, mais non délivrée. Entendant par là qu'elle récuse de se livrer. On touche là à l'intonation ; et si je me défie des qualificatifs que je viens d'employer, qui psychologisent, qu'il soit entendu que je l'ai fait seulement pour donner un repère. Repère de ce trait singulier dont je ne suis pas sûr que François Nicolas sera heureux que je le nomme : cette musique s'impose sans savoir accueillir. Pour être un peu plus clair, je dirai qu'une poussée qui s'éprouve toujours suspendue, qui ne parvient pas à se livrer complètement, à trouver une expression libérée, même quand elle est enjouée, fait sens d'une butée. Peut-être parce que l'image, l'image de Dieu, est interdite. La musique, chez Schoenberg, échoue à être heureuse. C'est ce qui ferait de la phrase sur laquelle Moïse et Aaron s'interrompt la clé de toute l'oeuvre-Schoenberg : "Ô mot, mot qui me manque !" François Nicolas a raison d'écrire que c'est l'indécision - et la décision à prendre - sur la victoire ou la défaite de la musique, de ce que je qualifie comme la musique ouverte dans sa substance, qui est là - et qui est là continûment - en cause. Il y a un Cogito Schoenberg, mais c'est un cogito amer : sans cesse conscient de la précarité de ce qu'il a d'être.
Il faut à présent venir, c'est le second point que je veux traiter, à ce qui conduit François Nicolas à "vouloir Schoenberg", à le vouloir comme compositeur, c'est-à-dire à le vouloir comme posant des questions auxquelles la composition doit répondre, auxquelles peut-être Schoenberg a répondu avant de les avoir posées.
Tout ce qui précède mettait de préférence l'accent sur le geste liant de la musique. Ce qui va suivre rencontrera, à l'acmé du lien, un geste en quelque sorte second, de déliaison. Un apport tout à fait original des analyses de François Nicolas est l'isolement dans certaines oeuvres de ce qu'il appelle un "moment favori", par où il entend un moment qui ne ferait aucun sens isolé, qui ne se distingue pas non plus par ses qualités esthétiques, un moment de "décision" où l'oeuvre "avère le sujet qu'elle est" en faisant signe vers tout ce qui, dans sa saisie du musical, reste "en suspens" : moment où se laisse entrevoir la puissance débordante de l'immanent dont elle est faite. Moment d'ouverture où tout le tissu du discours musical antécédent et conséquent soudain se défait ou se brouille en une sorte ou de décomposition ou d'agglutination de sa matière, dont l'infini des ressources se dévoile d'un coup. Quelque chose comme un "voilà, c'est ça !". François Nicolas a, dans un autre texte, analysé et distingué les occurrences où le moment favori "cristallise" - mot d'Adorno - la composition, violente l'expression, creuse la sensation. Il me semble qu'un exemple de moment par ouverture d'une faille pourrait être ces chutes où, dans une sorte de désespoir, d'impossibilité de continuer, tout l'édifice mahlérien, toutes composantes mêlées - suspens de la composition, extinction progressive de l'instrumentation, vertige du vide - s'écroule sur lui-même, quitte laborieusement à repartir un instant plus tard. Un exemple de moment par agglutination est fourni par l'analyse éblouissante que François Nicolas donne de cinq mesures de la troisième des Cinq pièces pour orchestre de Schoenberg où canon, harmonie, rythme, dynamique, répartition des pupitres, en une sorte de précipitation, récapitulent le matériel de la pièce entière, non par addition mais comme en travers, le jusque-là distinct devenant, tout en se maintenant, l'indiscernable, le générique. François Nicolas a de nouveau là des formules saisissantes : le moment favori est fragment "choisi par l'oeuvre elle-même", en une place cruciale, "excès du désir stratégique sur l'état actuel de son travail injecté dans la matière de l'oeuvre au nom du sujet qu'elle est" ; comme moment, il dit "Bref ! Tranchons !" ; comme récapitulation excédante, il est ce temps où "l'oeuvre écoute la musique", peut-être faut-il même dire est "amour de la musique".
S'agissant de Schoenberg et de sa mise au travail obstinée de tous les formants de la musique, j'ajouterai qu'on peut parfois hésiter devant ce qui n'est peut-être que mise à nu de tout ce qu'enferme de puissances un, un seul, de ceux-ci, pour quoi François Nicolas refuserait sans doute d'y déceler proprement un moment favori. Je pense à Moïse et Aaron, à ce qui s'y développe comme autant de pièces brèves, nettement distinctes dans leur carrure, portées par une écriture, elle, absolument homogène dans son insistance sur l'écart, et par un maniement de la dynamique qui, lui, est ou me reste assez imprévisible ; il y a vers la fin du second acte - un peu avant le retour de Moïse, si mes souvenirs sont exacts - une pièce orchestrale, une sorte de passacaille, où soudain toutes les ressources du contrepoint partout présent se rassemblent et s'exposent justement comme ressource infinie : j'y verrais bien un moment favori partiel, à une seule dimension. Moment assurément moins riche que celui que François Nicolas analyse.
Ce concept du moment favori est en tout cas remarquable en ceci : d'un côté il vise un instant singulier pour l'écoute réflexive, instant où le discours apparaît se défaire ou s'excéder non par accident mais, comme un fruit s'ouvre, pour découvrir à l'état brut tout ce dont la musique, telle que traitée par l'oeuvre est dans sa matière capable ; d'un autre côté, il reçoit son intelligibilité de ce que tout faire-Un s'arrache à une infinité qui le déborde et au risque du retour de laquelle il ne cesse pas d'être suspendu. On pourrait montrer que, pour tout sensible, l'infini est celui de sa continuité essentielle, dans laquelle deux termes au moins - deux notes, deux durées, deux timbres, etc. - viennent ponctuer de leur qualité deux places en ouvrant entre eux un écart. Quoi qu'il en soit, le moment, comme dépli de l'Un sur son propre excès, appelle à l'évidence la référence à ce que Lacan appelait le "trou" ouvert dans le défini du savoir par l'immaîtrisable du Réel ; et ce qu'Alain Badiou renomme le débordement du discernable par l'indiscernable. C'est aussi bien ce qui fait écrire à François Nicolas que le moment, comme décision, est au sens le plus propre un événement : décision de reconnaître au bord de l'Un ce qui l'excède.
Cela dit, François Nicolas avance, à travers l'analyse des Cinq pièces que je viens de citer, un concept complémentaire, celui de diagonal dont on peut lui reprocher que l'articulation avec le moment favori n'est pas explicitée, et qu'il serait permis de comprendre comme une autre face - proprement interne à la musique - du moment favori décelé par l'écoute. Mais à la réflexion, ce n'est pas cela. Si j'entends bien le propos de Nicolas, le diagonal est une espèce du moment favori. Et cette espèce est proprement caractéristique, elle est la singularité Schoenberg. En sorte que vouloir Schoenberg, c'est vouloir le diagonal. Telle est indubitablement la direction dans laquelle progresse le livre de Nicolas. Qu'est-ce donc que le diagonal ? L'image du raccourci que prend un développement, dans le cas de Farben sur les timbres, l'idée d'une résolution précipitée ne prend ici son sens qu'entendue comme la substitution au distinct du quelconque indifférenciant les éléments que le développement alignait. Quelconque ou générique : la musique décide abruptement de ne plus rendre discernables tels de ses formants, dont le multiple devient comme anonyme. Indifférencié, il s'ombre, et c'est plutôt comme l'ombre du dessein musical qui s'entend. Et il faut, avec François Nicolas, citer Mallarmé : "causer l'ombre en soufflant sur la lumière". De ce biais, puisque je disais que Schoenberg a ouvert la musique dans sa substance sonore, dans les composants de cette substance, je dirai maintenant que la diagonale ouvre l'écart sur le continuum que recelait sa combinatoire. Invoquant la diagonale de Cantor, François Nicolas rappelle que, pour essentiellement distinct qu'il soit, l'ensemble des nombres réels n'en est pas moins indénombrable dans chacun de ses intervalles mêmes. C'est cela, le "quelconque" du diagonal. Le ressurgir de l'infini comme le quelconque par le dedans. Le quelconque ou le soudain in-différent vaut comme exposition d'une exhaustivité impossible à parcourir. Et, si je comprends bien François Nicolas, il veut dire que le parcours n'est pour Schoenberg que le moyen de tourner autour de l'exhaustif, le moment nodal étant celui où il "trace une ligne de fuite au sein même d'un champ ordonné". La fin est de "profiler au sein d'une situation soigneusement composée, la diagonale de ses possibles". Ou de faire entendre ce que jamais on n'entendra. Et de conduire vers ce point la poussée interne - l'expression - de l'oeuvre.
Je ferai ici quelques remarques. Il me semble que Nicolas théologise quelque peu le moment favori, et nommément le diagonal, en doctrinant qu'il n'y en peut avoir qu'un par pièce. Je sais bien la préoccupation Schoenberg de non répétition. Mais je ne vois aucune raison pour qu'une musique ne fasse pas retour sur le surgi du moment. En second lieu, tenant pour tout à fait convaincants les exemples donnés par François Nicolas, je n'ai en revanche guère réussi, réécoutant beaucoup de Schoenberg - peut-être par défaut personnel - à en trouver d'autres ; en particulier, je n'en ai pas trouvé de significatifs dans l'ensemble des pièces pour piano. En revanche, il m'a semblé que fulgurantes dans leur brièveté, les Trois pièces pour orchestre de chambre de 1910 constituaient autant de moments favoris paradoxaux, à l'état nu, livrant sans ombrage mais dans l'ultra économie de leur parcours, l'exhaustif incalculable de ce dont pourrait être faite une oeuvre. Enfin et surtout, il ne me paraît pas possible - et je ne veux pas dire que Nicolas le fasse - de définir Schoenberg par le seul diagonal : j'ai assez insisté sur ce que toute sa musique - au moins dès les Trois pièces pour piano, op. 11 - travaille l'écart dont la série apportera en somme l'assurance. Le diagonal doit alors être pensé comme l'estompement propre de l'écart.
Que François Nicolas tienne le diagonal comme le vouloir être Schoenberg s'illustre de ce qu'il en élargit le concept pour en faire la définition d'un style de pensée musicale, le "style diagonal" dont il s'attache à explorer toutes les figures. Nicolas soulignant que la sensation y est toujours prévalante, car c'est dans le matériel du son que passe proprement la "diagonale de l'ombre" : ainsi des voix chantées ombrant dans tel passage de Moïse et Aaron la voix parlée, avec l'oblique d'un canon instrumental. Mais dépliant à partir de là l'ensemble de l'appareil musical : ainsi, tenu que la construction peut être d'un homogène hiérarchiquement ordonné, ou d'un empilement de couches hétérogènes, ou d'un arrimage à des points entre lesquels elle est tendue, Nicolas assigne la deuxième forme au diagonal : bâti non hiérarchisant qui ne cesse de "bifurquer" d'une couche à l'autre, d'un "principe d'ordre" à l'autre. Ce qui décrit en effet fort bien la composition Schoenberg, sauf qu'on pourrait aussi bien dire, je crois, qu'elle est tendue par arrimage et donc plus topologique que bâtissante : les variations bifurcantes y étant autant de tensions depuis des points très contrastés d'arrimage : pour me risquer à un exemple, la 3e pièce - thème et variations - de la Suite pour sept instruments, op. 29, qui démarre sur l'exposé thématique d'un chant populaire, à allure de choral, nimbé de triplets nerveux, on peut bien y entendre une mobilité des couches, le chant devenant secondaire et les triplets passant par moments au rang de thème principal, avec échange des timbres ; mais je puis aussi bien l'entendre comme une pièce tendue entre ses deux pôles qui la soutiennent de la tirer chacun à soi. C'est de la même façon que, pour l'expression, qui serait la poussée arrivant à son point de saturation, Nicolas propose de distinguer, chez Schoenberg même, entre occupation - plus constructiviste - de tout l'espace chromatique, sa compression - proprement expressionniste - et une logique diagonale - du flux et reflux, avec de brusques retraits révélant le manque sous la plénitude apparente. Mais le plus important me semble la redéfinition qui est donnée de la sensation : comme ligne de fuite ou ombre, elle s'atteste dans le diagonal comme une "toute puissante fragilité", "errante puisqu'investie en chaque instant où ce qui suit n'est jamais exactement collé à ce qui précède, où ce qui s'affirme peut à chaque instant s'interrompre", ouvrant à chaque instant un "vide infime". Je ne saurais trop dire la justesse de cette définition, qui dépasse beaucoup le diagonal si elle s'y donne à entendre, convaincu que je suis, contre à peu près toute la tradition, que le sensible, loin d'être par excellente le présenté, voire le présent, ne cesse pas d'être au risque de son absence : essentiellement évanouissant ; et que la musique n'existe que d'être à chaque instant au bord du silence. Toute l'ambiguïté du diagonal tient à ce que son "Tranchons !" fait ou atteste le vide pour rendre témoignage de l'excès.
Ce qui nous ramène au point de départ, c'est que le moment du diagonal, et plus généralement le moment favori, est l'instance locale, liée, d'une exposition de l'infini, du délié. Ce qui est proprement, en toute espèce de discours, le lieu de sa vérité : celui où la distinction essentielle au discursif avère l'indistinct, l'excès, dont il s'arrache. De toute nécessité en un point du discours : il n'y a de vérité que locale. Mais substantiellement, ouvrant sur ce qui, du sein du discours, déborde le discours même : il n'y a de vérité qu'infinie. Ce qui autorise François Nicolas à écrire qu'il y a une vérité du sujet musical - bref, de l'oeuvre - et qu'entendre est saisir le point où elle se prononce.
L'évidence que donne François Nicolas à cette démarche fait le prix, exemplaire, de son discours. Il n'est pas de possibilité de tenir sur le musical un propos qui ne soit bavardage hors de la recherche de ce qui y est la pensée à même le musical. Le musical, c'est la matière sonore saisie dans son immanence comme écart fixant le développement des relations, tendu sur le vide débordant de la séparation. En ouvrant l'appareil de la relation même, Schoenberg a mis le geste musical à nu. Et la mise à nu a opéré dans l'oeuvre un peu comme le procès d'une psychanalyse : si butée il y a eu, c'est qu'une ouverture toujours aussitôt se referme.