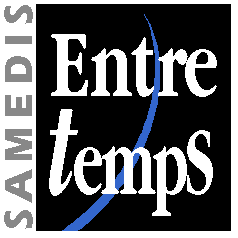
La Singularité Schoenberg de François Nicolas
Samedi 27 février 1999 (Ircam)
Raymond Court
Dans son livre La singularité Schoenberg, François Nicolas, pour une approche de cette musique, oppose aux deux formules " Schoenberg est mort ", " Aimer Schoenberg ", cette troisième : " vouloir Schoenberg ". Reconnaissons en effet d'abord que Schoenberg n'a jamais été un théoricien doctrinaire et encore moins un praticien rigide (et, à cet égard, les analyses d'Adorno paraissent mieux rendre justice à sa musique que celles de Leibowitz). On ne saurait donc en ce domaine récuser le musicien sous prétexte des indubitables excès et impasses de certains épigones. D'autre part on peut hésiter à transférer sur Schoenberg le " Aimez-vous Brahms ? " de l'auteur de Bonjour tristesse. Car si une musique est souvent âpre, sinon ingrate à écouter par défi jeté au sentiment de beauté suave, c'est bien celle-ci.
Reste à cerner et analyser la " singularité Schoenberg ". Certes, à l'intérieur du trio qui couronne de haut toute la musique de ce XXe siècle qui s'achève, les deux autres héros, à savoir Debussy et Stravinsky, peuvent prétendre à une reconnaissance analogue, mais à des titres différents. Ainsi, à l'inverse même de toute notre tradition musicale occidentale à dominante anagogique, héroïque ou passionnée, bien singulière se révèle la plongée debussyste dans la " divine nature " et son fond d'immanence où " la musique est un total de forces éparses ". De son côté également le jeu virtuose stravinskien avec les styles en leur éclatement propre à notre modernité (" le style est mort " selon un mot célèbre) et l'installation, au travers de cette distanciation, d'un rituel souverain portent, de manière infaillible, la marque indélébile du geste stylistique unique du compositeur . Comment alors dans le cas Schoenberg répondre à semblable questionnement ?
Du point de vue de la méthode, F. Nicolas met l'accent sur la nécessité d'accorder priorité à une analyse centrée sur l'oeuvre, celle-ci étant d'emblée posée, quant à son statut, au-delà de l'opposition constructivisme/expressionnisme (quand la forme est en sa plénitude, l'expression est à son sommet). Ce faisant, on se trouve, je crois, proche en esprit de ce qu'Adorno nommait " contenu de vérité ". Force en tout cas est de constater qu'une telle approche se trouve en consonance parfaite immédiate avec une oeuvre comme celle de Schoenberg plus qu'avec toute autre. Ainsi, de manière explicite et forte, le Traité d'harmonie affirme, au-delà de l'importance des savoirs et des techniques, la prééminence du souci et de la quête de vérité : " l'artiste n'a pas besoin de la beauté. La vérité lui suffit " (p. 408). Ceci signifie qu'outre l'exigence d'une rigueur sans concession dans l'écriture, il faut ne pas oublier que la singularité de Schoenberg se situe bien au-delà du système sériel, à savoir dans la " teneur de vérité " de l'oeuvre musicale elle-même (F. Nicolas, p. 91, 126, 181). On pense bien sûr notamment à cette présence de l'inconscient si génialement dégagée par Freud, contemporain viennois de cette musique (que d'ailleurs il ignore). À propos d'Erwartung Adorno a parlé à juste titre de " psychanalyse en musique ", note certes fondamentale pour caractériser notre modernité. Cependant, toujours d'ailleurs dans la foulée adornienne, il convient d'aller plus loin dans cette exploration du contenu pour atteindre en plein coeur la " singularité Schoenberg ", ce qui nous conduit jusqu'à Moïse et Aaron auquel F. Nicolas consacre toute la troisième partie de son livre. Je prendrai prétexte de certaines indications qui me paraissent significatives dans ce dernier et importantes pour rebondir à ma manière.
Au dire d'Adorno, cet opéra, dont la composition remonte à 1930-1932, est " à la fois l'oeuvre maîtresse de Schoenberg et une authentique oeuvre d'art sacré " (" Un fragment sacré " in Quasi una fantasia. Gallimard). Opéra inachevé, on le sait, qui s'interrompt à la fin du deuxième acte sur cette interjection de Moïse : " Ô mot qui me manque ! ". Ce qui a fait couler beaucoup d'encre mais qu'on ne saurait pour autant écarter de tout essai d'interprétation comme propos vain et oiseux, si du moins on ne veut pas renoncer à penser cette musique comme elle nous y convie elle-même. Cette oeuvre fondamentale est en effet surdéterminée en profondeur avec son centre théologique et ses résonances esthétiques et historiques fondamentales.
Que dans le polythéisme les dieux soient nommés, ceci implique une continuité entre l'homme et le divin et donc la magie (posséder le nom de, c'est avoir pouvoir sur) et le sacré (comme opposé au Saint comme Tout Autre) . Comment nommer l'innommable ? Tel est le véritable sujet-aporie de Moïse et Aaron : une question à laquelle il n'y a pas de réponse directe, d'où l'opéra inachevé. Rappelons que, dans Exode 3, 14, à Moïse demandant à Dieu son nom il n'est pas répondu, sinon dans un deuxième temps et par un verbe : " je suis celui qui suis ". Ce que Meschonic commente dans Traduire le sacré ainsi : " Ce n'est pas un nom sur lequel, comme dans le polythéisme, par la magie, on aurait un pouvoir. C'est un verbe. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est une promesse ". Celle-ci, toujours selon le même texte biblique, s'énonce : " dis aux enfants d'Israël : Je suis m'a envoyé vers vous ". Or ce geste est celui même de l'Alliance fondatrice de l'histoire au coeur du mystère de laquelle nous transporte Un Survivant de Varsovie. Et sans doute est-ce dans cette direction qu'il faudrait chercher le sens profond de la remarque de Luigi Nono selon laquelle Un Survivant de Varsovie serait le véritable troisième acte de Moïse et Aaron... (F. Nicolas soulève cette question p. 189, note 1).
Nous touchons là, je crois, au noyau théologique de l'oeuvre de Schoenberg et nous baignons dans une climatique très proche, mutatis mutandis, de celle de la pensée de Walter Benjamin. Le texte de Benjamin sur la crise de l'aura est à mettre en rapport avec l'analyse tout à fait complémentaire qu'il a faite de l'allégorie (cette thématique scellant l'unité des deux grands massifs de son oeuvre, l'Origine du drame baroque allemand et Paris capitale du XIXe siècle) . L'avènement des " valeurs d'exposition " marquait l'apparition d'un " art de masse " (avec, au tout premier plan, l'invention du cinématographe par les Frères Lumière) . Benjamin soulignera la dimension politique de cette révolution dans la fonction et " le caractère général " de l'art. Il prend " politique " ici au sens majeur d'un rapport à l'histoire en tant que celle-ci engage le tout de l'existence humaine collective dans sa globalité la plus concrète. Les Thèses sur la philosophie de l'histoire (début 1940), qui résument toute la trajectoire spirituelle de leur auteur, sont une méditation sur l'histoire dans une perspective eschatologique (c'est-à-dire relative aux fins dernières de l'homme et de l'humanité) avec une attention particulière portée au sort des plus pauvres et des persécutés.
Ce questionnement se révèle en dernière analyse de nature théologique dans la mesure où la visée de l'histoire y est placée sous le signe de l'allégorie. Contre-figure esthétique du symbole lumineux et du beau, celle-ci, qui est de l'ordre du sublime, exprime la facies hippocrarica de l'histoire, un monde voué à la catastrophe (" elle est chez elle dans la chute ", affirmait Benjamin dans l'Origine du drame baroque allemand), mais en même temps promis aussi à la rédemption. Ainsi l'Ange de l'Histoire, emprunté par Benjamin à l'Angelus Novus de Paul Klee et réplique moderne de l'Ange de la Mélancolie chez Dürer à l'âge baroque, apocalyptique à l'instar du nôtre, n'est pas seulement le spectateur impuissant des ruines que la catastrophe de l'histoire amoncelle, il est aussi celui qui voudrait " réveiller les morts et rassembler les vaincus " et tous les opprimés et les écrasés de l'histoire.
Or aucune oeuvre, je crois, mieux qu'Un survivant de Varsovie (quasi-ultime composition de Schoenberg : op. 46, 1947), ne permet d'illustrer la pensée profonde de Benjamin sur cette dimension à la lettre messianique de l'art. Elle paraît issue musicalement en droite ligne de la grande filiation baroque luthérienne par son cri qui s'achève en prière, le Shema Israël (Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu... Dt 6,4), récité quotidiennement par les fidèles. En elle, la remémoration, à l'échelle historique (à la différence de celle, purement individuelle, du temps retrouvé proustien) pour sauver de l'oubli ceux que la barbarie avait voulu rayer du monde des morts comme de celui des vivants, se transcende en commémoration, au sens plénier de la Thora et de la théologie juive pour laquelle justice signifie salut. Dans ses Thèses sur la philosophie de l'histoire, Benjamin écrivait : " Il y a un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie nous-mêmes ". En touchant à cette interaction entre le passé et le présent où s'effectue l'entrelacement des libertés à travers le temps, l'oeuvre de Schoenberg nous conduit au coeur même du mystère de l'histoire en nous transportant dans notre contemporanéité la plus tragique . Assurément " ce grand cri de l'âme qui s'élève vers les hauteurs " appartient, comme le soulignait Adorno à propos de Moïse et Aaron, à l'ordre du sublime et de l'allégorie et non pas du beau et du symbole comme présentation directe d'une nature transfigurée .
Ne pourrait-on chercher là, sinon une réponse, du moins un élément de réponse à la question d'Adorno : comment une oeuvre d'art est-elle possible après Auschwitz, voire à cette question sans doute jumelle, quelle prière après Auschwitz ? Si l'on ajoute que cette oeuvre, outre son rapport au sacré (au sens large), est en même temps totalement moderne par son écriture sans concession aucune à la facilité ou à une quelconque démagogie, pour toutes ces raisons peut-être pourra-t-on mieux comprendre pourquoi " la singularité Schoenberg " est dans notre modernité de l'ordre de l'exemplarité. Cette esthétique se situe en tout cas aux antipodes du courant analytique contemporain d'origine anglo-saxonne attaché en priorité à la désacralisation de l'art. Or se trouve ici engagé le conflit esthétique sans doute majeur de notre siècle.
En opposition à la tradition continentale dans son ensemble, le nouveau courant de pensée prétend vouloir assumer pleinement la rupture totale accomplie selon lui par rapport à l'art du passé, en particulier au travers de pratiques comme celles de Marcel Duchamp ou Andy Warhol (auxquelles on pourrait joindre en musique celles de John Cage). Avec le passage (par radicalisation des techniques de collage et montage) au fameux " ready-made " se trouvait en effet subverti le rapport entre oeuvre et objet banal et ainsi abolie toute frontière prétendument " essentielle " entre art et non-art. Dès lors ce qu'on nomme la " dimension " esthétique ne reposerait en fait sur aucune propriété occulte (le " sacré " ?) mais simplement sur un certain " usage " fait de l'objet et sa mise en rapport avec un autre contexte, objectif, institutionnel, voire à la limite un monde du marché. Se trouverait ainsi déboulonné de son piédestal l'art traditionnel et désormais il faudrait dire avec Picabia : " L'Art... est partout ". Dès lors, en lieu et place des spéculations fumeuses et jargonnantes qui ne sont que galimatias pseudo-théologique, il conviendrait de substituer la question de fait (au sens de matter of fact des empiristes anglais) : " Quand y a-t-il art ? " à la question métaphysique : " Qu'est-ce que l'Art ? ". Telles apparaissent les conditions d'un désensorcèlement de l'Art qui le libérera des fantasmes de révélation ou (ce qui ne vaut pas mieux) des dérives utopiques délirantes, toutes formes en définitive d'illusion théologique. Ainsi, dans la foulée de Wittgenstein, puis de Nelson Goudman (pour ne citer que les plus grands et les plus nuancés), il faudrait affirmer que la notion d'usage remplace désormais celle de révélation (et les polémiques sur " la crise de l'art " ne seraient de ce point de vue que les symptômes de cette mutation décisive du statut de l'art dans nos sociétés occidentales).
On mesure ainsi l'ampleur de l'enjeu en question. Si l'on ajoute les ambiguïtés très réelles d'une attitude pragmatiste fortement teintée de subjectivisme non critique face à la réalité esthétique, on comprendra mieux le risque redoutable chez certains, sous prétexte de " vouloir " un art en prise sur nos sociétés néo-libérales avancées, d'éclectisme, de nomadisme, de zapping tous azimuts au gré des pressions non-contrôlées du milieu social. Ce serait l'abandon de toute véritable autonomie de l'oeuvre comme réelle présence pour une écoute attentive et critique. Ne convient-il pas alors, à la suite d'Adorno, de saluer Schoenberg comme authentique héros de notre modernité par sa résistance au nouveau fatum que représentent, dans leur conjonction, croissance des media et industrie culturelle ? Exemplaire à cet égard serait l'oeuvre de Schoenberg dans sa lutte contre les idoles, à la fois par son refus intransigeant de toute concession à la facilité ou à une quelconque démagogie et pour toutes ces hautes exigences sublimement tenues. Force en tout cas est de reconnaître la singularité d'une pensée qui, à coup sûr, déborde le seul champ musical et devrait nous permettre de prendre une plus claire conscience des enjeux d'un conflit autour de la modernité, sans doute plus grave que jamais, entre deux esthétiques contraires. En ce sens ne faut-il pas comme nous y invite F. Nicolas, " vouloir Schoenberg ", son ascétisme et sa rigueur ?