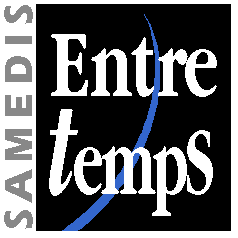
La Singularité Schoenberg de François Nicolas
Samedi 27 février 1999 (Ircam)
Philippe Albéra
Le livre de François Nicolas est tout autant un livre sur Schoenberg que l'exposé d'une conception de la musique propre à l'auteur. L'insistance sur un " vouloir Schoenberg ", au détriment d'un " aimer Schoenberg ", renvoie à cette élaboration théorique personnelle, où Schoenberg n'est plus qu'un prétexte, le lieu d'une démonstration. Il ne s'agit pas, en effet, pour François Nicolas, de reprendre les problèmes musicaux auxquels s'était confronté le compositeur de Moïse et Aaron, en les replaçant dans leur contexte historique, ni de se situer dans le champ des problématiques contemporaines, telles qu'elles apparaissent dans les oeuvres, mais d'aborder la musique dans son essence, et plus précisément, en tant que pensée propre. Cette démarche, qui présente certaines analogies avec la méthode phénoménologique, pose un certain nombre de problèmes que j'aimerais aborder ici de façon critique.
L'idée centrale qui commande toute la construction théorique est qu'" en musique, le sujet véritable, c'est l'oeuvre, non le musicien " (18). L'idée n'est certes pas nouvelle, même si elle s'oppose à une conception encore courante où l'oeuvre est un " objet " produit par un " musicien-sujet ". Elle apparaît comme une conséquence et dans l'acceptation de François Nicolas, comme une radicalisation d'une évolution historique à travers laquelle le champ artistique a conquis son autonomie ; dans le domaine musical, cette idée de l'oeuvre comme sujet (même si le terme n'a pas été utilisé) a culminé du point de vue musical dans le sérialisme de l'après-guerre, dont les fondements conceptuels sont assez proches de ceux du structuralisme qui se développait alors dans les différents domaines des sciences humaines. Il existe tout un réseau de faits et de pensées qui forment le substrat d'une telle conception, et l'une des questions posée par le livre de François Nicolas serait de savoir pourquoi elle reparaît avec tant de force aujourd'hui.
L'idée de l'oeuvre comme sujet ne recouvre pas complètement celle de l'oeuvre autonome, de l'oeuvre qui se produit par elle-même et forme un " monde en soi " (Tieck), dont la théorie s'élabora aux débuts du romantisme allemand, puis dans le domaine plus spécifiquement littéraire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle en France. Car si le " monde " de l'oeuvre autonome réfracte des significations provenant du monde réel, traversé par le sujet, l'oeuvre comme sujet et il faudrait dire ici : comme sujet absolu est fermée sur soi. Elle évacue tout ce qui est de nature historique et sociale, tout ce qui appartient à l'ordre du vécu. Elle s'apparente à une Idée platonicienne, comme le laisse entendre François Nicolas lorsqu'il écrit que " ce qui existe musicalement existe en soi " (62). Ainsi avance-t-il que " s'il y a du sujet en musique, et non pas face à elle, [...] c'est l'oeuvre qui en tient lieu, et rien qu'elle " (18, souligné par moi). Cette autolimitation de l'oeuvre, qui dresse une barrière entre ce qui est " musical " et ce qui ne l'est pas, rappelle fortement les propos du premier Stockhausen, le " principe d'un ordre immanent découlant de l'idée " .
S'il existe néanmoins un rapport entre l'oeuvre-sujet et le musicien-sujet, c'est uniquement, pour François Nicolas, en tant qu'" intellectualité musicale " (21). Or, qu'est-ce que cette intellectualité musicale pour Nicolas, sinon la pensée musicale qui se pense elle-même à travers les mots, sans créer de faille avec son objet, à la différence d'un discours critique, de nature philosophique, esthétique ou sociologique : " L'intellectualité est une énonciation du musicien-sujet sur le sujet musical, une énonciation en pensée et non pas l'émission d'une opinion, d'un sentiment ou d'une impression " (58). En d'autres termes, " l'intellectualité musicale est intérieure à la pratique musicale " (59). Mais les oppositions terminologiques, qui apparaissent comme des évidences demandent à être réfléchies, les termes d'" opinion ", de " sentiment " et d'" impression " ne constituant pas une alternative satisfaisante à celui d'" énonciation de pensée ". On pourrait avancer en effet que toute " énonciation de pensée " concernant une réalité artistique comprend en elle une part d'impression, de sentiment et d'opinion. Au demeurant, on ne peut pas assimiler l'émotion esthétique à la seule réaction du sujet face à l'oeuvre : elle concerne aussi l'étonnement, l'ébranlement, le choc éprouvé vis-à-vis d'une réalité non conceptuelle, comme l'a fait remarquer Adorno. Il y aurait une opposition plus pertinente, entre une pensée instrumentale de nature quasi axiomatique, et une pensée critique qui se pense tout en réfléchissant son objet. La congruence de la pensée musicale et de la pensée verbale est une illusion, la différence entre les deux, aussi minime soit-elle, créant de toute façon une relation entre sujet et objet qu'il faut assumer. Dans les oeuvres d'art comme dans la conscience réfléchissante, sujet et objet sont constamment entremêlés. On connaît la formule d'Adorno, comme quoi le matériau est aussi " sujet sédimenté ". La pensée de François Nicolas, comme celle de Stockhausen à ses débuts, est fondée sur l'élimination des contradictions que recèle la dialectique du sujet et de l'objet, et de la complexité du fait musical. De même, on ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les différents " moi " qui sont à l'oeuvre dans l'expérience esthétique, et dont l'un des aspects essentiels est sans doute qu'ils s'apparentent en maints aspects à un " nous ". Cela nous amènerait à reprendre la réflexion de François Nicolas sur la relation entre le particulier et l'universel, qui exigerait d'autres développements.
Sur la base d'affirmations avancées comme des axiomes dans les premières pages du livre, François Nicolas tente de dégager les catégories qui seraient propres à l'oeuvre-sujet. Insistons sur le terme de catégorie, qui se différencie de celui de concept, dans la mesure où il ne renvoie pas à une philosophie de la musique, à une réflexion sur la musique, mais à la pensée musicale elle-même. En effet, l'oeuvre-sujet met en jeu une pensée spécifique, qui se pense elle-même, et dont la " fonction critique " (46) n'apparaît que dans son rapport aux autres oeuvres. On l'aura compris : l'effort consiste ici à définir un ensemble de notions capables de dire ce qu'est la musique en son essence, hors de toute extériorité. Si les termes choisis par François Nicolas sont empruntés à l'esthétique et à l'histoire des styles, voire au langage courant, ils sont pourtant redéfinis dans le sens d'une autonomie absolue de la pensée musicale. C'est ainsi que la subjectivité elle-même est rapportée à l'oeuvre : elle est son propre déploiement, son " vouloir-être " par rapport à un " être-là " qui caractérise " l'objet décoratif et fonctionnel " (78). L'oeuvre n'existe qu'en se projetant elle-même (où l'on retrouve quelque chose de la pensée sérielle des années cinquante : la forme comme déploiement et réalisation d'une structure initiale), mais elle se désolidarise de ce qui l'a précédé ; ce qu'il y a de préformé en elle, ce qui la détermine du point de vue historique ou social, est tout simplement nié. L'acte de création est un acte de volonté, un hic et nunc faisant du passé table rase (une position évidemment marquée historiquement).
Trois catégories principales traversent l'ensemble du livre, en tant que " mouvement même de l'oeuvre musicale " : la " construction ", l'" expression " et la " sensation " (18). Ces termes, purifiés des significations accumulées en eux, deviennent des catégories en soi. L'" expression " ne renvoie pas à un sujet préexistant à l'oeuvre, ou travaillé par elle, mais au " mouvement même de l'oeuvre sous la poussée immanente de son propre excès intérieur " (19) ; les sensations ne renvoient pas aux individus, mais à la " manière dont l'oeuvre musicale se déploie en une matière sonore et sensible, existant ainsi indépendamment de tout auditeur concret " (19). La définition de ces trois catégories est sans cesse reprise dans le livre, telle quelle ou avec des ajouts et des nuances, et produit par dérivation des catégories comme " style constructiviste ", " style expressionniste ", et " style diagonal ", ou comme " construit ", " ossature " et " bâti ", liés à la prédominance respective du compositeur, de l'interprète et de l'auditeur à l'intérieur du processus musical. Ces catégories fondamentales qui articulent la " pensée musicale " se dégagent, bien que brièvement, par opposition à une notion qui en est le contre-modèle : celle d'" impressionnisme ". Il est difficile de savoir à quoi se rapporte réellement un terme que bien peu de musiciens ont revendiqué, même si François Nicolas l'associe à celui de " musique "à effet" ", et notamment à des " pans entiers de l'oeuvre de Ligeti ou de Xenakis " (62), amalgame inacceptable pour qui regarde de près les partitions et les textes théoriques du compositeur hongrois. En tout état de cause, l'impressionnisme est défini négativement et péremptoirement comme n'étant pas un " mode de pensée musical " (62).
On ne s'étonnera pas que la cohérence d'une démarche visant à refermer la pensée musicale sur elle-même, à l'épurer de tout corps étranger, englobe finalement le sujet que constitue l'auditeur, nié dans l'affirmation selon laquelle " la musique n'est pas faite pour être entendue " (63). François Nicolas dénie à une musique qui circulerait " à l'intérieur d'un soi préexistant " de constituer un " véritable acte d'audition musicale " ; ce qu'il entend par là, c'est au contraire une " radicale sortie de soi ", un acte d'arrachement " à sa condition d'animal social " (63). La coupure entre le moi concret de l'auditeur, façonné par sa propre histoire, et donc forcément " préconstitué ", et le moi idéal qui se projette à travers l'oeuvre, ou que celle-ci crée littéralement, reproduit la coupure radicale que Stockhausen, qui parlait alors d'" écoute méditative ", exigeait entre l'oeuvre reposant sur un " ordre total " et tout ce qui est " préformé ". François Nicolas n'est pas très éloigné d'une telle idée, même si l'on peut trouver paradoxal qu'il s'appuie ici sur un compositeur comme Schoenberg, qui est aux antipodes d'une telle position. Il faut toutefois se rappeler, pour circonscrire la nature de cette relation entre l'oeuvre et l'auditeur, que " la musique et les oeuvres qui la composent ne communiquent rien " (62), une phrase qui renvoie directement à l'idéologie de la musique néo-classique telle que Stravinsky l'a exposée, et dont on peut penser qu'elle ne constitue pas un modèle pour François Nicolas. Non nommée, la notion d'extase est ici sous-jacente : elle indique la dimension foncièrement idéaliste des conceptions avancées, qui ne sont pas très éloignées du concept de " sujet absolu ", et tend vers une dimension magique, voire mythique de la musique, sublimée par la théorie (on signalera là encore que dans son évolution, Stockhausen s'est dirigé précisément vers le mythe et la magie, qui mettent en jeu un moi hypertrophié, après avoir atteint les limites du cadre conceptuel qu'il s'était fixé au début des années cinquante : un retour significatif du refoulé !).
Toutefois, cette construction théorique n'a pas seulement pour objet de rendre compte de la pensée musicale en soi (une abstraction difficilement tenable), mais voudrait encore définir une forme de pensée spécifique, dont Schoenberg serait le précurseur, et qui constitue l'enjeu réel du livre ; François Nicolas lui donne un nom : " style diagonal ". Par diagonal, ce n'est pas seulement l'antinomie de l'expression et de la construction qui est dépassée, mais aussi la déperdition du sens propre à l'oeuvre qui est évitée. Car ce n'est qu'avec le style diagonal que l'excès de l'oeuvre peut être redirigé à l'intérieur de son processus, et non plus maîtrisé de l'extérieur, comme dans le constructivisme, ou exprimé dans l'extériorité, comme avec l'expressionnisme. Il ne s'agit rien moins que de trouver ici une formule capable de créer une circulation strictement interne à l'oeuvre, dans la logique d'une construction où tout ce qui n'est pas purement musical est éliminé. François Nicolas l'appelle " un point de fuite interne à l'oeuvre, [...] un gouffre intérieur dans lequel la musique se précipite " (100). Cette " ligne de fuite " est en même temps une " anticipation ", et non une " rétroaction ". Elle constitue un acte de volonté, une précipitation de la subjectivité propre à l'oeuvre elle-même, qui n'attend pas son déploiement systématique, selon un ordre logique ou préalable, mais se propulse au contraire directement jusqu'aux limites de ses possibles. On retrouve ici la figure du " vouloir-être ", au nom de laquelle " ce qui est " ou " ce qui fut " sont en quelque sorte éliminés. Le " style diagonal " n'apparaît pas en tant que forme globale de pensée, mais s'incarne dans un moment particulier, qu'au travers d'une expression ambiguë et assez peu satisfaisante, François Nicolas appelle le " moment favori " (l'adjectif " favori " évoque plutôt la délectation qu'une forme d'objectivation théorique). C'est à l'intérieur du " moment favori " que l'excès creuse un espace que l'on pourrait appeler la mise en abîme de l'oeuvre. En tant que moment, il fait appel au temps musical ; mais la temporalité est elle-même intégrée en tant qu'élément structurel, comme manifestation du sens interne de la musique : le moment décisif, où l'oeuvre révèle son écart intérieur, est celui d'un " pas encore " qui serait aussi un " déjà là ". L'essence de l'oeuvre, en dernière instance, est insaisissable, elle est cet intervalle de temps que Bergson, déjà, ne savait comment décrire : non une structure, mais un mouvement. S'il n'avait cherché à vider son vocabulaire de tout ce qui pourrait faire référence à une extériorité de l'oeuvre en tant que telle, François Nicolas aurait pu faire référence à la notion joycienne d'épiphanie. Mais ici, la subjectivité de l'oeuvre se joue uniquement dans le moment où s'ouvre sa propre faille.
Comment cerner cette idée de " moment favori " ? Voyons ce que François Nicolas nous en dit : le " moment favori " est bref (il dure quelques secondes) ; il est situé temporellement (on ne peut donc le détacher de son moment d'apparition) ; il crée une rupture (un contraste, une interruption) ; il n'est pas autonome (incomplet, il est pris dans un mouvement). Je passe sur ses rapports aux catégorisations déjà nommées la construction, l'expression et la sensation -, pour relever le type de " moment favori " qui semble le favori de l'auteur : les moments de vertige (on ne s'étonnera pas de voir apparaître ici une figure corollaire à celle d'extase). L'une des caractéristiques principales de ce moment, c'est, semble-t-il, qu'il forme une échappée et se dérobe à une explication rationnelle. Il est donc un point de fuite et un moment fuyant. C'est un chemin de traverse, que François Nicolas rattache par analogie conceptuelle à la figure du clinamen chez le philosophe Lucrèce, puis à celle de la diagonale chez le mathématicien Cantor. François Nicolas explicite ce concept de " moment favori " à partir d'une analyse de la troisième pièce de l'opus 16 de Schoenberg (le moment en question apparaît entre les mesures 245 et 249). Mais peut-on vraiment parler ici d'un " parcours du champ des possibles " qui s'exprimerait en " raccourci " dans le " moment favori ", et qui s'appuie sur l'épuisement des combinatoires de timbres ? Au lieu d'une " mélodie de timbres " (la fameuse Klangfarbenmelodie, concept assez flou), nous aurions donc ici un ordre combinatoire celui des groupes instrumentaux en alternance qui serait diagonalisé dans le " moment favori ", c'est-à-dire accéléré, exprimé en raccourci, et épuisé (ou plus exactement, dont on montrerait l'inépuisable potentialité). Curieusement, l'explication ramène l'ordre de la sensation, auquel se rapporte à l'évidence la pièce et son idée de mélodie de timbres, à quelque chose de plus volontaire, de plus rationnel et construit (ce qui en même temps contredit l'analogie avec le clinamen, dont l'existence est due, chez Lucrèce, au hasard). Mais en même temps, l'analyse de François Nicolas met en évidence une ambiguïté dans la pièce : celle qui existe entre l'immobilité des successions d'accords/timbres, qui devrait provoquer une sensation en deçà de toute forme rationnelle, et l'organisation un peu conventionnelle de la pièce en trois parties, celle du " moment favori " étant une intensification qui prélude à une " reprise ".
Or, si le " moment favori " est cette condensation d'un ordre qui a été posé préalablement, ou la reconduction d'un excès à l'intérieur de l'oeuvre, son avènement ne peut constituer véritablement une rupture, il ne peut être défini comme un chemin de traverse : c'est au contraire l'essence même de l'oeuvre, son idée fondamentale qui se révèle à travers lui (une approche affleurée par l'auteur). Le moment n'est-t-il pas placé au " centre de gravité " de la pièce ? Si la structuration poussée du matériau, dans le moment, exacerbe le principe de composition, ce n'est toutefois pas en visant un accomplissement, mais au contraire, en révélant une fragilité, comme le signale François Nicolas. Ce qui se défait, au lieu de s'ériger en son point culminant, renvoie à cet horizon inaccessible, à cette visée vers l'indicible qui fut au centre de la vision romantique allemande (on perçoit ce que l'idée centrale de Moïse et Aaron lui doit). Si la structure du moment se rapporte à l'ordre combinatoire des timbres exposé dans la première partie, faisant apparaître l'orchestre, selon les termes de François Nicolas, comme une " formation de chambre devenue générique ", elle n'est pas perceptible en tant que telle, puisqu'elle apparaît au contraire comme une dissolution du matériau ouvrant à une plus grande subjectivisation. Pour l'audition, et je dirai même, pour la sensation, ce moment est une rupture ; il crée un mouvement précipité, une accélération soudaine et un désordre, soulignés par la courbe des intensités, alors que la musique se déployait jusque-là dans une relative immobilité et dans une grande stabilité dynamique (que le balancement rythmique régulier soutient par ailleurs). Il en résulte une dialectique entre le caractère " objectif " du déploiement de l'harmonie-timbre dans la première partie, et le caractère hautement " subjectif " du moment.
La troisième pièce de l'opus 16 utilise les " motifs " pour en dépasser le concept. L'idée d'une forme reposant sur un canon ou un choral, relevée par François Nicolas, à laquelle on pourrait ajouter celle un peu saugrenue d'une fugue, avancée autrefois par Max Deutsch, est secondaire. On peut se rapporter à ce qu'écrivait Schoenberg dans une lettre à Busoni qui est contemporaine de la composition des Pièces pour orchestre :
- " J'aspire à : une libération complète
- de toutes les formes
- de tous les symboles
- de la cohérence et
- de la logique.
- Donc :
- en finir avec le "travail motivique"
- En finir avec l'harmonie comme
- ciment ou comme pierre à bâtir d'une architecture.
- L'harmonie est expression
- et rien d'autre "
Chez Schoenberg, les formes rigoureuses sont utilisées pour atteindre et dépasser une limite, et non dans le sens d'une plénitude. Le contrepoint le plus poussé tend, dès la Symphonie de chambre opus 9, à créer des turbulences, une déstabilisation de la forme et de la construction tonale ; le resserrement de la composition vise à l'exacerbation expressive, l'épuisement rapide des combinaisons structurelles produisant des changements d'état semblables à ceux que l'on observe dans les processus chimiques. Il n'existe pas de contradiction entre construction et expression du point de vue de la composition : c'est par la multiplication des liens structurels entre les motifs, et entre les fragments mêmes de motifs (voir les analyses de Schoenberg sur les oeuvres du répertoire), que l'on parvient à une densité expressive qui a pour modèle celle de l'inconscient. La fameuse phrase de Schoenberg dans une lettre à Kandinsky datée de 1911 : " l'art appartient à l'inconscient " , est en ce sens significative ; le compositeur en appelle à une autre logique. Les motifs circulent à travers tout l'espace sonore, sans respecter les anciennes hiérarchies ; ils naissent du flux temporel plutôt qu'ils ne le structurent, apparaissant et disparaissant sans qu'il soit possible de rationaliser leur organisation après coup. L'oeuvre ne se construit pas à partir de catégories, mais à partir de liens internes multiples, souvent occultes. Dans la troisième pièce de l'opus 16, comme dans les oeuvres atonales de Schoenberg en général (surtout celles de 1909), ce sont l'espace et le temps qui constituent les véritables " motifs " de la composition, et non les événements motiviques au sens traditionnel du terme, fussent-ils des structures de timbres. Il n'y a pas contradiction entre la structure et son effet pour la perception, mais entre la description de la structure et sa signification.
Le concept de " moment favori " pourrait être confronté à celui de " percée " avancé par Adorno, ce moment où l'oeuvre s'ouvre sur autre chose, se dépasse elle-même, atteignant sa propre transcendance (Adorno parle aussi de protestation, geste de la subjectivité s'il en est, disant à propos de Mahler que l'oeuvre préfère " s'en aller en morceaux " plutôt que de " faire croire à une réconciliation ", une phrase qui s'applique très bien à la troisième pièce de l'opus 16 aussi). Si le " moment favori " chez Nicolas voudrait être la clé de l'oeuvre, le moment où l'oeuvre se révèle à elle-même, en tant que sujet fermé sur soi, la percée adornienne est ce moment où jaillit la subjectivité, la revendication du sujet tel que l'oeuvre le compose. L'enjeu tient ici dans la relation de la forme musicale avec le réel et avec l'histoire, préoccupation constante de Schoenberg que la question juive n'a fait qu'aviver à partir des années vingt.
Car on ne peut pas évacuer le " contenu " immanent à la forme la plus autonome, qu'il renvoie au sujet-compositeur (" tout ce que j'ai écrit à une ressemblance intérieure avec moi ", écrivait Schoenberg en 1930 à Alban Berg à propos de Moïse et Aaron), ou à cette sédimentation historique dans le matériau et dans les formes qu'Adorno a relevée. Si l'on pense, avec l'auteur de la Dialectique négative, que " les antagonismes non résolus de la réalité se reproduisent dans les oeuvres d'art comme problèmes immanents de leur forme " , alors on peut envisager que le travail de Schoenberg vise précisément à dépasser l'antinomie entre construction et expression, non par un terme supérieur, une synthèse, ou un concept abstrait, mais dans le travail compositionnel proprement dit, en créant un champ de tensions spécifique à partir de ces deux termes. La troisième pièce de l'opus 16, exemple d'une telle recherche, ne pourrait exister sans un contexte d'idées qui a mené Schoenberg à la conception d'une relation essentielle entre la structure de l'oeuvre et l'inconscient, réélaboration radicale du rapport entre oeuvre et sujet. Parti de l'idée schopenhauerienne de la musique comme essence du monde et de l'idée kantienne du génie comme expression directe de la nature, Schoenberg en est venu à l'idée de l'inconscient comme source de la créativité, puis à celle d'intériorité et de spiritualité comme contenus d'une musique ayant renoncé à l'imitation, au matériau préformé, aux conventions formelles, au décoratif, etc. Si l'oeuvre s'est autonomisée, rejetant ses bases " universelles " comme la tonalité, les formes répertoriées, la construction traditionnelle des phrases, etc., c'est afin de sauver le sujet de la réification, et non pour l'éliminer.
C'est pourquoi, pour Schoenberg, l'oeuvre ne se révèle pas dans un moment, fût-il favori, mais dans sa totalité, dans le mouvement qui la traverse de part en part. C'est le sens du passage auquel nous renvoie François Nicolas, tiré d'un article sur Mahler très significatif pour le Schoenberg d'avant la Première Guerre mondiale, et qu'il a mal interprété. Schoenberg y parle de " beaux passages ", et il tente de les énumérer dans l'oeuvre de Mahler, visant ainsi ses détracteurs. Mais ces " beaux passages " deviennent rapidement des mouvements dans leur ensemble, des oeuvres entières, et Schoenberg conclut : " chez les grands maîtres, il n'y a pas de beaux passages, mais seulement des oeuvres magnifiques dans leur totalité " ! Pour Schoenberg, l'Idée de l'oeuvre, ce n'était pas un thème, une construction, ou un moment, mais bien sa totalité, c'est-à-dire la multiplicité de ses liens, cette polyphonie sur laquelle le langage verbal échoue et qui rend compte de la complexité du réel ; elle offre différentes perspectives ne pouvant être regroupées en un tout homogène, mais constituant pourtant une unité. La totalité, ce n'est pas l'oeuvre d'art totale, comme le remarque justement François Nicolas, mais l'inclusion de ce qui est autre, de ce qui est exclu d'une proposition ou d'une affirmation, de cet autre versant des choses qui conduit à l'impossibilité de la représentation, à une expression qui ne se laisse réduire ni à sa construction, ni aux catégories traditionnelles de l'expression, et que l'opéra Moïse et Aaron, comme l'a bien vu François Nicolas, pose non seulement d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue éthique, philosophique et historique, toutes notions qui sont à l'oeuvre dans l'ensemble de la production schoenbergienne. C'est pourquoi je retournerai le texte de François Nicolas dans un sens qui est masqué chez lui, et je placerai cette exigence schoenbergienne comme une des principales exigences présentes, la plus urgente même, qui suppose de dépasser l'antinomie biaisée entre un sujet-oeuvre absolu et un sujet-compositeur conventionnel. Schoenberg a occupé en son temps une position inconfortable en cherchant l'articulation des extrêmes, aussi bien à l'intérieur du matériau musical que dans sa relation avec la société. Moïse et Aaron expose cela dans la construction musicale, tout en thématisant le rapport entre l'individu et le groupe ; c'est aussi à ce titre que l'oeuvre ne pouvait s'achever : elle met en jeu un processus, et non une conception arrêtée des choses. Schoenberg est trop directement intervenu au tournant des années vingt et trente dans le débat esthétique entre modernité et néo-classicisme un débat qui renvoie à l'opposition du sujet et de l'objet -, à travers des oeuvres comme les Trois Satires ou l'opéra Von heute auf morgen notamment, pour qu'on ne puisse lire dans la tension entre l'exigence visionnaire de Moïse et le pragmatisme d'Aaron, confrontés l'un et l'autre à une communauté qu'il s'agit de conduire vers la Terre Promise, la tension strictement compositionnelle entre l'exigence de l'oeuvre et l'exigence de la réception.
La construction théorique de François Nicolas, aussi séduisante soit-elle, est par nature tautologique. Elle repose entièrement sur des postulats de départ, sur une décision que la figure de la volonté exprime de façon significative, au lieu de provenir du mouvement des choses dans une trajectoire historique. L'acte initial est aussi subjectif et arbitraire que l'acte de fondation de l'oeuvre dans l'idée que s'en fait Nicolas, bien qu'il se présente sous la forme d'une objectivation. Le détachement de l'oeuvre, devenue sujet absolu, vis-à-vis de ce qui est social, vis-à-vis de la réalité empirique dans laquelle sont pris les individus, est lui-même un acte social qui détermine en profondeur les choix compositionnels. La négation du sujet qui ne serait pas entièrement défini en tant qu'oeuvre, comme l'idée d'une écoute qui serait essentiellement une sortie de soi, un arrachement à l'être réel et à l'expérience vécue, apparaît tout à la fois comme une tentative de sauver le sujet de la réification généralisée, et comme une aliénation à celle-ci. Au bout du compte, la revendication d'autonomie de l'oeuvre entièrement déliée des déterminations externes, où se lit un geste quasi autistique d'existence en soi et pour soi, tend vers une forme indifférenciée, dans laquelle le moment visé comme essentiel se confond avec la logique du tout (une problématique qui renvoie une fois encore au sérialisme radical des années cinquante). L'idée de l'oeuvre comme sujet absolu, posée de façon autoritaire plutôt que simplement visée, comme la Terre Promise dans le Moïse et Aaron de Schoenberg, se confond avec l'oeuvre comme objet. Ce n'est pas son propre écart intérieur qui produit cette dynamique où le moment de la plus grande subjectivité acquiert une consistance universelle, mais la tension provoquée par ce qui n'a pas été dominé et enfermé dans son concept. S'il y a bifurcation, reprenant l'antique figure du clinamen, c'est que quelque chose d'inexpliqué, de non rationalisé, infléchit la trajectoire déjà tracée ; c'est qu'à l'intérieur du processus, au coeur même de la structure, existe une différence, une contradiction, une force indomptée qui fait advenir ce qui est autre. Le matériau et la forme de la musique, isolés du sujet social, de cette confrontation et de ce frottement qui produisent les tensions expressives dont vit l'oeuvre autonome, risquent de devenir de simples éléments interchangeables ; ils débouchent sur un pur jeu sonore. Mais surtout, l'apparente logique d'un système clos sur lui-même, et qui ne peut exister qu'en éliminant toute contradiction (laquelle devait au contraire alimenter sa dynamique propre), court le risque majeur de verser dans l'idéologie, et de rendre stérile le champ de la production elle-même. Le propre d'un système fondé sur des a priori, qui devrait commencer par penser la contradiction qu'il instaure avec une pensée musicale qui se veut justement détachée de tout a priori, ne peut que refuser, avec la véhémence de ce qui s'impose par la force, ce qui n'entre pas dans sa propre logique. En cela, il est déterminé par des représentations sociales qui le traversent de part en part, produit d'un moment historique qui s'est figé et qui, en se radicalisant, retourne son utopie en aporie.