Journée Richard Wagner [1]
(Ens,
14 mai 2005)
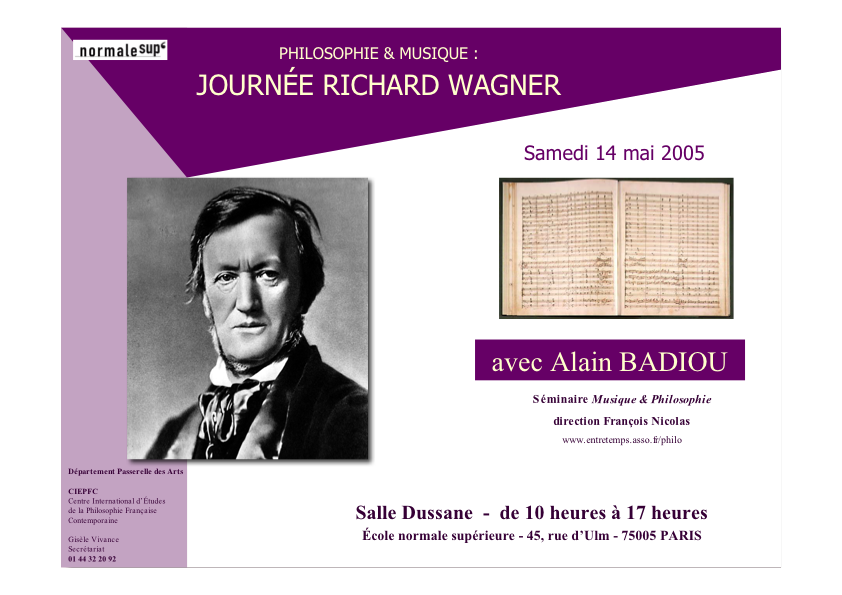
[
voir enregistrement de la journée : https://youtu.be/9M36pIyhAN0
et https://youtu.be/stips83RhZk ]
Plan
(transcription
par Nancy Mentelin)
Alain Badiou : Présentation
philosophique.................................................................................. 3
François Nicolas : Introduction musicienne................................................................................. 4
Une généalogie…..................................................................................................................... 4
Un déplacement surprenant…................................................................................................... 5
Quel aujourd’hui musical ?....................................................................................................... 5
Une première période, de cinquante ans.................................................................................. 5
Une seconde période, d’un siècle............................................................................................ 6
Une troisième période, d’un millénaire.................................................................................... 7
Wagner aujourd’hui ?............................................................................................................... 8
Wagner pour le XX° siècle musical…...................................................................................... 8
Pourquoi Wagner ?................................................................................................................ 9
Mais Wagner quand même….................................................................................................. 9
Wagner, pour l’œuvre grande.................................................................................................. 10
Alain Badiou.............................................................................................................................. 12
0 — Ouverture........................................................................................................................ 12
Une série généalogique........................................................................................................ 12
Une série idéologico-politique.............................................................................................. 12
Premier procès.................................................................................................................... 14
Deuxième procès.................................................................................................................. 14
Troisième procès.................................................................................................................. 14
Quatrième procès................................................................................................................. 15
Cinquième procès................................................................................................................ 15
Sixième procès..................................................................................................................... 15
Écoute du quintette (scène 4 de l’acte III) des Maîtres
Chanteurs........................................ 18
1 — Musique et unification..................................................................................................... 19
Écoute du monologue de Sachs, au début de l’acte III des Maîtres
Chanteurs....................... 19
2 — Musique et déchirement/souffrance.................................................................................. 21
Écoute du récit du voyage à Rome au troisième acte (scène 3)
de Tannhäuser...................... 23
3 — Musique et résolution des différences............................................................................... 25
Conclusion du Crépuscule des Dieux.................................................................................... 25
Conclusion des Maîtres Chanteurs........................................................................................ 26
Conclusion de Parsifal.......................................................................................................... 26
Présentation de la fin du Crépuscule des Dieux par
François Nicolas................................... 28
Écoute de la fin du Crépuscule des Dieux.......................................................................... 29
Écoute du monologue final de Sachs dans Les Maîtres Chanteurs....................................... 30
Écoute de la péroraison de Parsifal.................................................................................... 32
4 — Musique et théâtralisation................................................................................................ 34
Écoute du grand monologue de Wotan au second acte (scène 2) de
la Walkyrie.................... 35
5 — Musique et attente vaine.................................................................................................. 36
Écoute du second monologue de Tristan du début de l’acte III............................................. 36
6 — Musique et transition....................................................................................................... 37
Le temps du passage entre les mondes................................................................................... 37
Présentation de la « scène de la transformation »
dans Parsifal par François Nicolas............ 38
Écoute de la scène de la transformation dans l’acte I de
Parsifal.......................................... 38
Le temps de l’intervalle incertain.......................................................................................... 38
Écoute de l’ouverture de l’acte III de Tannhäuser............................................................... 39
Le temps du paradoxe logique.............................................................................................. 39
Écoute du monologue de Hagen (acte I, scène 2) du Crépuscule
des Dieux.......................... 40
François Nicolas : Remarque............................................................................................... 40
Conclusion............................................................................................................................. 41
1. La création d’impossible................................................................................................... 41
2. La multiplicité des hypothèses........................................................................................... 41
3. L’acceptation au présent de la division.............................................................................. 41
4. La non-dialecticité des résolutions.................................................................................... 41
5. La métamorphose sans finalité.......................................................................................... 42
*
**
Alain
Badiou : Présentation philosophique
Cette journée est consacrée à Richard Wagner, à ce que
Nietzsche il y a assez longtemps déjà appelait « le cas Wagner ».
Nous suscitons, traitons et ressuscitons le cas Wagner, et
je voudrais juste dire, avant de passer la parole à François Nicolas, que cette
journée a au moins un triple caractère :
• D’abord, et c’est probablement l’aspect le moins
important, elle a une forte dimension subjective car Wagner est pour moi un
signifiant important de très longue date.
Permettez quelques points de biographie un peu
insignifiants, bref plongeon dans l’antériorité historique des choses : ma
mère était passionnée de Wagner, je dirais même que c’était sans doute son
rapport à la sphère de l’art en général le plus significatif et le plus
important, et j’avais un peu envie de lui dédier cette journée.
Il en est résulté un point encore plus contingent, à savoir
que je suis allé à Bayreuth extrêmement tôt, à l’âge de seize ans, presque à
l’époque où Bayreuth reprenait, après la guerre : j’ai donc vu les toutes
premières mises en scènes de Wieland Wagner. Cela constituait évidemment dans
l’histoire des mises en scène de Wagner une révolution d’une amplitude
considérable : c’était vraiment une métamorphose de la conception scénique
de Wagner, fondée en particulier sur une destruction de toute dimension
anecdotique. La mise en scène était directement, si l’on peut dire, à nu sur
les symboles.
Ensuite, avec ma femme, Françoise Badiou, qui est d’ailleurs
présente aujourd’hui, ces expéditions à Bayreuth sont devenues en quelque
manière amoureuses.
Enfin, il s’est trouvé que, dans le cadre des études
elles-mêmes, Wagner a eu une importance symbolique à cette époque où l’école
était autre chose que ce qu’elle est devenue, puisque j’ai conclu ma copie de
concours général de français par une référence à la représentation de Parsifal
à Bayreuth.
Vous voyez, il y a là une surcharge subjective considérable…
J’ai traversé une longue période de semi-répression
idéologique de Wagner ; nous reviendrons sur ce point concernant
précisément les démêlés du cas Wagner.
Puis, pour toutes sortes de raisons, il m’est venu l’idée de
reprendre le combat, de marcher de nouveau sous le drapeau de Wagner en le
transformant un peu, en le regardant de plus près. C’est l’une des
significations subjectives de cette journée.
• La deuxième, c’est que cette dernière porte sur un
point précis de ce que j’appelle le rapport entre la philosophie et ses
conditions puisque Wagner sollicite – comme on le verra – de se disposer comme
condition de la philosophie de façon particulièrement forte : il y a quelque
chose, chez lui, qui attire tantôt l’amour du philosophe, tantôt sa haine, ou
bien la succession ou le mélange des deux.
Il y a aussi bien le cas Nietzsche, dans sa relation à
Wagner.
Sur la question de la philosophie et de ses conditions, on
touche là à un point sensible, nodal, qui constitue évidemment l’hypothèse de
cette journée, peut-être en voie de rénovation, de transformation, s’ouvrant à
des hypothèses nouvelles.
• Le troisième point présente une interlocution
effective avec la musique et les musiciens, à travers la personne de François
Nicolas ici présent : il s’agit donc non seulement abstraitement de la
philosophie et de la musique mais vraiment d’une disposition concrète de ce
type-là.
Cela implique que c’est une journée qui a des aspects que je
qualifierais de techniques au bon sens du terme : nous n’allons pas
seulement être dans la parole, nous allons également regarder du Wagner, en
assez grande quantité à vrai dire — je dis regarder parce qu’à la faveur des
merveilles du DVD, on va être comme à l’opéra — et nous allons l’entendre
autrement, peut-être de façon plus aiguë et plus structurale parce que nous
aurons accepté de faire quelques incursions analytiques, si je puis dire, dans
la partition pour vous les faire entendre au piano. Nous voilà nantis d’un
dispositif digne du show-business… C’était là ce que je voulais dire.
Le déroulement sera le suivant : François Nicolas
proposera une introduction où il va exprimer le point de vue du musicien sur
cette affaire ; ensuite, je développerai l’ensemble des points que j’ai
envisagés sur Wagner et la philosophie. Je le ferai en partie sous la forme
d’un immense plaidoyer pour un autre Wagner, qui sera précisément entrecoupé de
projections et d’écoutes puisque mon intention est, pour des raisons
nécessaires que j’expliquerai, de travailler au plus près des exemples.
À toi, François.
François
Nicolas : Introduction musicienne
Merci, Alain.
Une
généalogie…
Je vais vous présenter la généalogie de cette journée du
point du musicien, en commençant par préciser comment on en est venu à la
préparer et à la contextualiser.
Tout ceci découle d’un séminaire « musique et
philosophie » qui a commencé cette année — j’indique qu’il va se
poursuivre l’année prochaine — dans le cadre d’un programme général pour lequel
cette école est à mon avis particulièrement bien appropriée, qui est de
rapporter la musique aux autres formes de pensée. C’est pourquoi le titre
générique de ces séminaires est : « La musique ne pense pas
seule ».
Cette année, notre thème de travail était la Dialectique
négative d’Adorno. Il ne s’agissait pas à proprement parler, dans ce
séminaire, pas plus que dans cette journée, de « philosophie de la
musique » — au passage, c’est d’ailleurs le titre d’un livre d’Adorno de
1948 : Philosophie de la nouvelle musique. En effet, le musicien
déploie de manière immanente à son art une réflexion esthétique : en un
certain sens, il n’a pas besoin pour cela de la philosophie.
J’aime de ce point de vue distinguer trois dimensions dans
l’intellectualité musicale, cette dernière désignant la part réflexive du
musicien, l’aspect du musicien pensif, et pas simplement du musicien
artisan :
— une dimension critique (qui concerne le rapport du
musicien aux œuvres et donc sa capacité de discriminer les grandes œuvres des
petites, les œuvres importantes de celles qui ne le sont pas, etc.),
— une dimension théorique (qui porte plutôt sur la
musique comme monde ou comme langage, disons sur la figure de consistance de la
musique)
— et une dimension que l’on pourrait appeler esthétique,
non pas au sens de la philosophie, mais en un sens interne à la musique, qui
serait le rapport du monde de la musique à son époque, aux autres formes de
pensée.
Donc le musicien n’attend pas que la philosophie lui
fournisse une esthétique, c’est-à-dire un rapport à son époque. S’il
s’intéresse à la philosophie, s’il envisage de travailler avec des philosophes,
et tel est le propos du séminaire, c’est pour de toutes autres raisons. Je ne
m’étendrai pas sur ce point-là — j’ai écrit un long article sur musique et
philosophie dans un volume de textes réunis par Danièle Cohen-Lévinas, qui
vient de sortir dans la collection l’Orfeo.
En deux mots, il s’agit pour le musicien de penser la
musique avec d’autres types de pensée, d’où le titre générique « la
musique ne pense pas seule ».
Pour n’en donner quun seul exemple, il y a du point de
l’intellectualité musicale un principe que j’appellerai le principe du
contemporain et qui porte sur ce que l’on pourrait appeler les théories
musiciennes de la musique. Il y a en effet différentes formes de théories de la
musique : il y a des théories mathématiques (notamment aujourd’hui, comme
celle de Guerino Mazzola), il y a des théories philosophiques de la musique
(Schopenhauer, etc.)… Donc la question du musicien est de savoir s’il y a des
théories proprement musiciennes de la musique, sachant qu’une théorie musicale
n’est pas forcément musicienne. Pour l’intellectualité musicale, je formulerai
ainsi le principe du contemporain : une théorie de la musique contemporaine
doit être une théorie contemporaine de la musique. Il y a un déplacement
du terme contemporain qui, au passage, est dual d’un déplacement
équivalent formulé par Adorno dans sa Philosophie de la nouvelle musique,
où il écrivait qu’« une philosophie de la musique aujourd’hui doit
être une philosophie de la nouvelle musique » : autrement dit,
si l’on veut faire une philosophie aujourd’hui de la musique, il faut se
soucier de ce qui se fait aujourd’hui en musique.
Le problème du musicien serait plutôt, pour théoriser l’art
de son temps, d’être capable de le théoriser dans les conditions de son temps,
dans une acception contemporaine de ce que veut dire théoriser.
En voici trois exemples :
• Pour Rameau, une théorie de la musique tonale
(qui est pour lui la nouvelle musique) doit être une théorie cartésienne
de la musique et non plus une théorie aristotélicienne. Lorsque Rameau
essaie au XVIII° siècle de théoriser la musique de son temps, il fait ainsi
appel à Descartes : il semble que pour lui, il faille être contemporain du
mode de théorisation cartésien.
• Dans le cas de Wagner, au XIX° siècle, on peut dire
de la même manière que, pour lui, une théorie de l’œuvre d’art de l’avenir
– qui n’est autre selon lui que celle qui doit être faite maintenant – doit
être une théorie érotique de la musique, érotique signifiant ici
une théorie de la musique conçue comme organisme féminin fécondé par la poésie
en sorte de générer le drame. On voit bien là aussi que pour Wagner, théoriser
l’œuvre d’art de son époque doit se faire dans une modalité de la théorie qui
est propre à son temps.
• Enfin, chez Boulez, on trouve très clairement ce
point : une théorie de la musique sérielle doit être une théorie axiomatisée
et formalisée de la musique, et non pas une théorie empirique. La
question de savoir si Boulez en fin de compte produit bien cette théorie
formalisée et axiomatisée est une autre affaire, mais en tout cas la
prescription est celle-là.
Dans ces trois réquisits, la théorie musicienne de la
musique, qui est le propre d’une théorie musicale vue par le musicien, se met à
l’école des autres types de pensée : de la philosophie pour Rameau, de
l’amour pour Wagner, et de la science pour Boulez. Ce n’est pas que le musicien
demanderait aux sciences ou à la philosophie de théoriser la musique à sa
place, c’est que le musicien, pour théoriser son art, doit apprendre des autres
ce que théoriser veut dire dans les conditions de son temps. Je ne m’étends pas
sur ces points. Je voulais seulement indiquer que le séminaire, donc cette
journée, rapprochent musique et philosophie à égalité de pensée, et nullement
dans le but que la philosophie dirige la pensée musicale ou la pensée
musicienne.
C’est aussi pour cela que le thème retenu par le séminaire
était la Dialectique négative, c’est-à-dire le texte d’Adorno qui est à
la fois le plus philosophique et le moins musical, puisque si l’on y trouve le
concentré de sa philosophie, on n’y trouve rien qui se rapproche directement de
la musique. Il s’agissait donc de s’intéresser à Adorno en philosophe, et
nullement en un supposé « philosophe de la musique ».
Un
déplacement surprenant…
La surprise, pour moi, a été que l’intervention d’Alain
Badiou dans ce séminaire (22 janvier 2005) l’a conduit à formuler les thèses
philosophiques suivantes : « Wagner a créé une situation nouvelle
quant aux rapports de la philosophie et de la musique », et « il
pourrait y avoir chez Wagner aujourd’hui des appuis pour une articulation entre
musique et philosophie ».
Il y a donc eu une sorte de déplacement : ce qui, pour
nous musiciens, constitue un cas (qui est en vérité le cas Adorno) s’est
transformé en ce qui constitue pour les philosophes un autre cas : le
cas Wagner, un cas. Il m’amuse de dire que, pour le musicien, Adorno est un
cas qui le conduit à rouvrir le dossier Wagner, tandis que pour le
philosophe, c’est le cas Wagner qui l’incite à rouvrir le dossier
Adorno… D’où le projet, plus proprement philosophique que musical, de cette
journée, qui va être essentiellement nourrie par les propositions d’Alain
Badiou.
Pourquoi cette surprise pour le musicien ?
Parce que, de prime abord, la musique de Wagner ne sollicite
guère les musiciens contemporains. On a affaire ici à ce que j’appellerai une
dissonance entre pensée musicale et pensée philosophique.
Ce type de dissonance ne doit pas nous étonner, nous
musiciens en tous les cas, mais je ne pense pas non plus que les philosophes
s’en étonnent. Il est au principe même, me semble-t-il, des rapports
musique/philosophie, ces rapports que j’aime appeler « raisonances »
pour évoquer la capacité des deux raisons (musicale et philosophique) de se
stimuler sans pour autant envisager une résolution de leurs différences de
pensée.
Examinons donc cette dissonance concernant Wagner
aujourd’hui entre musique et philosophie.
Quel
aujourd’hui musical ?
Quel est d’abord l’aujourd’hui pour un musicien ?
Je procéderai brièvement : il s’agit pour moi de situer musicalement le
projet de cette journée, donc de composer avec Alain Badiou une sorte de petit
contrepoint en faisant résonner, au début, la voix spécifique du musicien.
L’aujourd’hui voit selon moi converger trois périodisations
d’échelles temporelles très différentes.
Une
première période, de cinquante ans
Une première échelle est la fin d’un cycle de cinquante ans,
ouvert dans l’après-guerre, dont le titre d’un récent livre de Célestin Deliège
donne bien la tonalité : Cinquante ans de modernité musicale, de
Darmstadt à l’IRCAM.
On peut dire que ce cycle serait globalement le cycle
sériel, incluant dans le sérialisme le post-sérialisme. L’idée de la fin de ce
cycle voudrait dire que le sérialisme ne serait plus la référence pour penser
le présent, fût-ce pour le dépasser, fût-ce dans la modalité du
post-sérialisme. En un certain sens, on pourrait dire que l’on est aujourd’hui
dans un post-post-sérialisme, et que ce faisant, le sérialisme est désactivé,
fut-ce comme adversaire. Mais je ne crois pas qu’un « post-post »
existe : cela n’a pas de sens subjectif, me semble-t-il.
Une
seconde période, d’un siècle
Deuxièmement, il s’agit de la fin, en tout cas de la crise,
d’une séquence qui cette fois est à échelle de cent ans, et recouvre en gros le
XX° siècle : il s’agit là de la mise en crise d’un programme musical qui
avait été ouvert au début du XX° siècle par Schönberg et Debussy (lesquels
constituent les deux grands pôles du XX° siècle) et que je caractériserai
essentiellement comme un programme soustractif.
On peut dire que, dans l’art musical du XX° siècle, il
s’agissait d’assumer le faisceau de quatre soustractions :
— D’abord, une soustraction de la tonalité, d’où le thème de
la musique atonale ;
— Ensuite, une soustraction de la métrique, au sens musical
de la régularité d’une carrure, donc d’une certaine forme de régularité du
discours, d’où l’idée d’une musique sans mètre, sans carrure, dont la figure
positive est la figure de la prose musicale. La question est ici de savoir
comment faire une musique qui fonctionne comme une prose, c’est-à-dire qui soit
soustraite à la loi du mètre et de la carrure.
— À cela s’ajoute la soustraction du thématisme sous la
forme d’une musique qui serait athématique.
— Reste la soustraction de la Forme (au sens musical du
terme) codifiée, prédéfinie par le cadre de la tonalité, bien sûr, mais pas
simplement : il ne suffit pas de retirer la tonalité pour que la question
de la forme soit elle-même épongée. D’où une musique qui inventerait sa Forme,
tendance qu’Adorno a lui-même philosophiquement aggravée en prônant une « musique
informelle » ; mais, à mon avis, ce nom « musique
informelle » ne correspond pas exactement à ce dont il s’agit, parce qu’il
est trop philosophisant, trop pris dans la problématique propre d’Adorno.
— On pourrait éventuellement ajouter une cinquième
soustraction, mais je la négligerai ici, qui concernerait la question de
l’instrumental, du grand orchestre. On pourrait dire en effet que se pose
également la question de savoir comment soustraire le discours musical aux
fonctions rhétoriques instrumentales et orchestrales, ce qui fait déjà résonner
la musique de Wagner.
Retenons en tout cas le programme général d’une musique qui
serait atonale, athématique, et soustraite au carcan du mètre comme de la
grande Forme. Le XX° siècle a entrepris d’affirmer une musique qui assumerait
cette quadruple soustraction.
Cette affirmation s’est déployée de différentes manières
durant le XX° siècle :
— D’abord, par une nouvelle logique de construction musicale
qui a donné le dodécaphonisme, le sérialisme, etc., mais qui a eu aussi sa part
de construction rythmique avec Stravinsky ;
— Deuxièmement, par une nouvelle manière de redistribuer les
dimensions musicales. C’est un point assez important. On pourrait l’associer à
un renouvellement de la pensée du timbre à partir de Debussy, c’est-à-dire à
une nouvelle manière de fondre les différentes dimensions de la musique, à
savoir la hauteur, la durée, l’intensité et le timbre, de manière à produire
une catégorie transversale qui permette de repenser et de réaffirmer un certain
nombre de développements musicaux.
— Troisièmement, cette soustraction se déploierait dans une
tentative d’inventer de nouvelles morphologies musicales, au sens de ce qui
remplacerait le thème, c’est-à-dire des gestes, des figures, des espèces
d’entités qui donnent non pas exactement des objets musicaux mais qui
permettent d’avoir un découpage dynamique d’entités, comme l’indique par
exemple la question du phrasé. Comment renouveler la question du phrasé au XX°
siècle si celui-ci est précisément atonal, athématique, etc. ? On a donc
de nouvelles modalités discursives : cette question de la nouvelle
morphologie est à mon avis au cœur de tentatives très récentes de compositeurs
comme celle de Brian Ferneyhough qui travaille sur la problématique de la
figure, ou au cœur de la problématique de Lachenman, lequel tente lui-même de
constituer de nouvelles discursivités à partir de nouvelles morphologies
sonores.
Or le principe de la quadruple soustraction est aujourd’hui
remis en question au nom du fait qu’il ne délivre pas par lui-même de principes
affirmatifs et qu’on pourrait donc tout aussi bien affirmer de nouveaux
principes musicaux en faisant l’économie de ces soustractions. D’où il suit
qu’en un certain sens aujourd’hui, une manière de retour au ton, au mètre, au
thématisme et pourquoi pas même à la Forme canonique n’est pas forcément
intelligible comme un pur et simple académisme mais désigne une véritable
position réactive au sens où Alain Badiou parle du sujet réactif.
Il est clair que la mise en question du programme
soustractif au principe du XX° siècle musical est encouragée par la péremption
de la séquence sérielle et tire profit d’une certaine synchronisation entre les
trois cycles, c’est-à-dire entre ce premier cycle de cinquante ans (1950-2000),
cet autre de cent ans (XX° siècle) auxquels va donc s’ajoute une troisième
scansion, à échelle cette fois du millénaire et qui elle-même est en crise
aujourd’hui.
Une
troisième période, d’un millénaire
En deux mots, la musique s’est constituée en monde à partir
du moment où elle s’est dotée d’une écriture musicale. La constitution d’une
écriture musicale est un événement de pensée sans égal pour l’humanité dans
aucune autre civilisation, et sans égal à l’intérieur même des arts. Je
rappelle que le seul équivalent de cela, c’est l’écriture mathématique et que
même les sciences ne sont pas dotées d’écritures autonomes : elles
s’écrivent dans l’écriture mathématique, comme par exemple la physique,
dépourvue d’écriture propre.
La musique est le seul art à s’être doté d’une écriture,
qu’il faut bien distinguer d’une notation. On voit qu’aujourd’hui la danse est
en train de travailler sur la question d’une notation, je ne sais pas si elle
accédera à une écriture. Je distingue notation et écriture. Techniquement,
c’est très simple : la notation musicale c’est la notation grégorienne, et
l’écriture c’est la note. Ce point est capital : je rappelle qu’au départ,
l’entreprise philosophique de Descartes est partie de la sidération, dans le Compendium
musicae de 1618, devant l’existence d’une écriture musicale, et il est
intéressant de voir comment lui-même s’est mis à l’écoute de cette nouveauté.
L’écriture musicale a été décisive pour constituer une
logique musicale autonome, c’est-à-dire pour doter la musique d’une capacité de
s’émanciper d’un certain nombre de fonctions dont au passage, l’architecture,
me semble-t-il, n’est toujours pas délivrée. Peut-être ne devrait-elle pas
l’être, mais cela m’étonne toujours pour ma part que l’architecture soit encore
à ce point encombrée de fonctions. La musique, en tous les cas, a pu
s’émanciper à mon avis par le fait qu’elle s’est justement dotée d’une
écriture. Pour faire une analogie avec les thèses d’Alain Badiou, on pourrait
dire (j’espère ne pas trop dissoner par rapport à toi !) que l’écriture
musicale serait comme le transcendantal qui permet à la musique de se doter
d’une consistance de monde.
Or aujourd’hui, l’écriture musicale est en crise : il y
a une crise de la note qui a traversé tout le XX° siècle, crise dans l’aptitude
de la note à continuer de mesurer adéquatement l’existence musicale. Par
exemple, dans la musique mixte ou électroacoustique, la note devient un
opérateur qui n’est plus très sensible à l’existence, et il y a par ailleurs la
tentation, très grave à mon sens, du pur codage informatique. Même Boulez a
là-dessus des déclarations que je ne reprendrais pas, lorsqu’il considère que
l’écriture informatique serait elle-même une écriture : elle l’est
certainement, mais elle n’est en tout cas pas une écriture musicale !
C’est un point capital.
L’effet en retour de cette crise de l’écriture consiste en
des tentatives de refonctionnaliser la musique : l’une des dimensions par
lesquelles il y a une historicité de la musique, c’est que la musique doit
constamment conquérir de nouveaux territoires sonores, car l’époque lui offre
de nouvelles sonorités (songeons au XX° siècle avec, par exemple, les sonorités
des manifestations et de la foule politique, ou les sonorités industrielles et
urbaines). L’une des questions de la musique est de savoir comment on peut
musicaliser ces sonorités, c’est-à-dire comment la musique, dans sa consistance
propre, peut se les approprier et faire de la musique avec ces nouvelles
sonorités. Il ne suffit évidemment pas de les reproduire, c’est une tout autre
affaire. Or, de ce point de vue, la capacité d’écrire ces sonorités au sens
musical, donc de trouver les nouvelles modalités de la lettre musicale pour que
la musique puisse s’approprier ces sonorités, est une question essentielle et
là, il est vrai que la note qui vient du bas Moyen-Âge vacille.
L’effet en retour sera donc des tentatives de
refonctionnaliser la musique qui vont plaider : « À quoi bon
l’écriture musicale ? La musique doit se revassaliser ». Et qui,
alors, de faire l’éloge des fonctions sociales (la fameuse distinction…)
de la musique, des fonctions étatiques de la musique (en termes de
représentation), des fonctions liturgiques (de sacralisation) et, bien sûr, des
fonctions ludiques (de divertissement)… Les candidats affluent pour évincer
l’écriture de manière à ce que la musique retrouve son statut antérieur.
Puisque l’on est dans un cadre philosophique, je rappelle
cette citation qu’il m’amuse toujours de ressortir, citation de Saint-Thomas
d’Aquin qui au début de la Somme théologique, prenait la musique comme
exemple de subordination : lorsqu’il voulait en effet prôner la manière
dont la théologie devait se subordonner à la Révélation, il exaltait l’exemple
de la musique qui se courbait devant l’arithmétique. Au XIII° siècle, il est
vrai que l’écriture musicale n’était pas encore constituée et Descartes, au
début du XVII° siècle, a bien vu que les choses avaient changé. Disons
simplement qu’il y a des gens qui voudraient nous faire revenir à l’époque de
Saint-Thomas d’Aquin, à ceci près que les révélations ne sont plus aujourd’hui
les mêmes…
L’autonomie du monde musical traverse une crise singulière.
Je dirais en résumé que notre aujourd’hui est un moment où convergent des
questions à échelles très différentes : à une échelle de cinquante ans
avec la péremption du sérialisme comme repère, à une échelle de cent ans avec
une réévaluation et la mise en cause du contexte soustractif pour affirmer une
nouvelle musique, et à une échelle de mille ans avec une crise de l’autonomie
de pensée musicale, du principe même donnant consistance à un monde de la
musique.
Wagner
aujourd’hui ?
C’est donc dans cet aujourd’hui que Wagner fait dissonance
entre musique et philosophie.
On peut reformuler cette dissonance en repartant de la
prescription que donnait Nietzsche en 1888 dans l’Avant-propos de son Cas
Wagner, où il écrivait : « J’entends proclamer à qui Wagner
est indispensable : au philosophe. D’autres peuvent sans doute se tirer
d’affaire sans Wagner ; mais le philosophe n’est pas libre d’ignorer
Wagner. »
Je dirais volontiers qu’aujourd’hui, Wagner n’est plus
indispensable au compositeur qui peut ainsi se tirer d’affaire sans lui. En un
certain sens d’ailleurs, tant le sérialisme que le XX° siècle inventif ont
ignoré Wagner. On pourrait même dire que le programme soustractif tel que je
l’ai rapidement esquissé a pour une bonne part été un programme visant à
soustraire la nouvelle musique à un horizon wagnérien, aux ressources
wagnériennes.
Wagner
pour le XX° siècle musical…
Ceci est assez patent concernant les dimensions atonales et
athématiques de la musique du XX° siècle.
• En matière d’atonalité, par exemple, le diagnostic
debussyste est à mon sens assez pertinent : Wagner a été un crépuscule
plutôt qu’une aurore, c’est-à-dire qu’il a chromatiquement saturé la tonalité
(on le verra dans un motif de Parsifal, où il est absolument splendide
et génial) sans indiquer la possibilité même de s’y soustraire radicalement. Et
évidemment, tout ceci se termine par Parsifal, qui est tout de même la
réaffirmation de la tonalité de manière cardinale autour d’un la bémol.
• En matière de thématisme, il en va de même :
Wagner a densifié les opérations thématiques par une prolifération, une
pluralisation des thèmes — la foule des Grundthema (thèmes fondamentaux)
— sans se soucier d’esquisser un pas de côté par rapport au thématisme. En un
certain sens, on y reviendra, Liszt a été plus radical de ce point de vue.
• En matière de mètre musical, si Wagner a négligé la
carrure, il faut bien reconnaître que son travail séquentiel, cet élan
inlassablement pris sur le fameux bar — cette structure a-a-b -,
maintient sous de nouvelles modalités le principe même d’un cadrage métrique.
• C’est seulement du côté de la Forme que la musique de
Wagner peut préfigurer le souci du XX° siècle de s’abstraire de schémas
préétablis. Le point est que Wagner l’a fait dans la seule modalité de la très
grande forme, qui plus est de la forme opéra, ce qui relativise
considérablement l’idée d’une référence Wagner pour le XX° siècle.
Si l’on parcourt de ce point de vue les grandes entreprises
musicales du XX° siècle, il est patent que pour chacune d’elles, et selon des
modalités différentes, Wagner constituait fondamentalement une figure du passé.
• Pour Debussy, je l’ai rappelé, Wagner relevait de la
clôture du XIX° siècle, d’un « beau coucher de soleil », et non pas
d’un « chemin ouvert sur l’Avenir ». Debussy, pour cela, mobilise une
comparaison que l’on trouvait déjà en 1888 sous la plume de Nietzsche :
celle d’un Wagner en « Victor Hugo de la musique » en sorte qu’il
fallait selon Debussy chercher « après Wagner et non pas d’après Wagner ».
Je renvoie par exemple, concernant cette comparaison, à ce que disait Jacques
Roubaud dans La vieillesse d’Alexandre sur le rapport de Victor Hugo à
l’alexandrin.
• Du côté de Schoenberg, l’influence de Wagner a
d’abord été considérable — songeons par exemple aux Gurre-Lieder de sa
jeunesse — : il reconnaissait avoir toujours beaucoup appris de Wagner,
essentiellement en matière de traitement thématique et motivique. Mais le geste
schönbergien de 1908, rompant avec la très grande Forme comme avec la tonalité
(sa rupture à l’égard du mètre et du thématisme est moins marquée : les
jeunes sériels le lui reprocheront vertement) fut une manière pour lui de
tourner radicalement la page wagnérienne. Il est à ce titre frappant de
constater que lorsque Schoenberg tente de désigner dans le XIX° siècle des
figures actives, il désigne plutôt Liszt et Brahms, comme ayant été plus
novateurs que Wagner.
• Berg ne parle quasiment pas de Wagner.
• Webern, quant à lui, soutient qu’il est bien plus
intéressant de citer Brahms que Wagner car, en ce qui concerne les relations
harmoniques, Brahms est plus riche. Là aussi, on a une généalogie assez étrange
pour nous, parce que du point de vue des compositeurs de cette époque-là, la
référence, y compris harmonique, est du côté de Brahms, non de Wagner.
• Quant aux sériels, ils n’ont eu aucun rapport à
Wagner, en tout cas jusque dans les années 1960.
— Certes, Messiaen était un passionné de Wagner, l’analysant
et le faisant travailler par ses étudiants, mais ses élèves se sont ainsi
référés à Wagner comme à un maître du temps passé, ce qui ne suffit nullement à
constituer une proposition pour un présent.
— Pour Barraqué, celui d’entre eux qui dès les années 1950
était le plus directement intéressé par la question de la grande Forme dans un
cadre soustrait aux anciens canons formels, le diagnostic est de même en
1962 : « Les pas en avant qui l’eussent projeté vers des espaces
insoupçonnés, Wagner ne les a pas faits. Le premier, Debussy, commencera à
assumer la révélation d’un monde sonore vierge, malgré l’influence profonde
qu’elle laisse. En dépit des innombrables suiveurs, disciples et imitateurs,
l’aventure wagnérienne reste une expérience isolée ».
— Enfin, Boulez lui-même reconnaissait que, pour sa
génération, Wagner était une musique oubliée, qui ne suscitait
qu’« indifférence » (Relevés d’apprenti, p. 103).
Ainsi, le XX° siècle s’est déployé dans une polarité
Schoenberg/Debussy dont les sources revendiquées dans le XIX° siècle sont moins
à chercher du côté de Wagner (qui a eu évidemment une influence sur Schönberg
comme sur Debussy), que du côté d’une polarité qui serait Brahms/Moussorski.
On voit le contraste, qui accentuerait la figure d’un Wagner
comme crépuscule clôturant une époque. On ne saurait donc dire que le XX°
siècle s’est déployé contre Wagner, mais plutôt à l’écart de lui, ou sans lui.
Pourquoi
Wagner ?
D’où l’étrangeté du propos philosophique d’Alain Badiou, de
soumettre à nouveaux frais la philosophie aujourd’hui à l’expérience de Wagner.
Que Wagner puisse ou doive ainsi être philosophiquement
réexpérimenté, je me suis demandé si cela ne découlait pas, somme toute, d’un
certain retrait de la musique dans le livre consacré par Alain Badiou récemment
au XX° siècle conceptualisé comme siècle de la passion du réel. Retrait pour
moi à dire vrai un peu étrange car ce que j’ai esquissé ici d’un souci musical
d’affirmer — sous condition d’une quadruple soustraction — me semble au
contraire s’accorder à cette caractérisation du siècle ; nous examinerons
tout ceci à l’Ircam lors d’un samedi d’Entretemps consacré l’année prochaine
(le 13 mai 2006) à ce fort livre d’Alain Badiou.
Wagner serait-il ce qui rendrait compte pour Alain Badiou
d’un siècle somme toute sans musique, ce qui est tout aussi bien dire d’un
siècle qui aurait trop consommé de musique ? Ou encore, si la nouvelle
musique du XX° siècle s’est faite dans l’indifférence à Wagner (selon le terme
de Boulez), un siècle indifférent à cette musique ne doit-il pas en effet
chercher son point musical de différenciation dans ce qui n’est pas apparu dans
ce siècle, donc dans ce Wagner qui en dessine une frontière qu’il s’agirait
peut-être de penser comme intérieure ?
Telle est, me semble-t-il, la suggestion faite au musicien
par le philosophe : examiner si Wagner, extérieur en un certain sens au
XX° siècle musical, ne constituerait pas une sorte d’extérieur interne, y
faisant trou, ou occupant cette position que Lacan appelait celle de
l’extime ? Wagner comme extime du XX° siècle musical : telle serait,
au seuil de cette journée, l’hypothèse musicale, raisonnant à la frappe ou à la
touche philosophique.
Mais
Wagner quand même…
À commencer de réfléchir cette hypothèse, certains traits me
semblent en effet pouvoir lui donner une certaine portée proprement musicale,
et là, je vais infléchir mon premier propos.
D’abord, n’oublions pas la dimension intellectuelle de
Richard Wagner : si l’intellectualité musicale a connu, depuis sa
naissance avec Rameau (c’est-à-dire vers 1750, au moment même où Bach saturait
le baroque qui ne lui survivrait pas), un développement accéléré,
l’intellectualité musicale wagnérienne ne peut être ignorée des musiciens, et
d’ailleurs aucun des compositeurs dont j’ai parlé n’a été indifférent sur ce
plan à cette intellectualité musicale.
Pour Barraqué, par exemple, les écrits de Wagner « sont
souvent d’une importance capitale et prophétique » et « l’analyse
qu’il fait du romantisme musical après le contrecoup beethovénien est d’une
frappante perspicacité » (1968). En 1962, il écrit : « À
l’exception de Wagner dont les analyses sont d’une importance capitale et
prophétique, les écrits des grands musiciens romantiques sont décevants,
surtout ceux de Liszt et de Berlioz. » Je m’accorde d’ailleurs sur ce
point avec lui…
Du côté de l’intellectualité musicale, on voit que Wagner a
été actif pendant le XX° siècle. Mais, à bien y réfléchir, le compositeur
Wagner est également sorti de l’indifférence à partir de la fin des années 60,
en tout cas pour un certain nombre des compositeurs précédemment mentionnés. Il
l’a fait, somme toute, à un titre essentiel : comme maître de la grande
Forme, si bien que certains compositeurs ont commencé à aller y voir de plus
près lorsqu’ils ont eux-mêmes souhaité bâtir de plus vastes architectures
temporelles.
— C’est ainsi le cas de Stockhausen qui déclare en 1971 à
Jonathan Cott, à propos d’une remarque de Stravinsky selon lequel
« l’échelle temporelle de Stockhausen est celle du Crépuscule des
Dieux » : « Stravinsky aurait dû comprendre que Wagner,
plus qu’aucun autre compositeur occidental, avait élargi l’échelle
temporelle ; il a allongé de façon incroyable la respiration, la durée,
désormais indépendantes de ce que le corps humain peut produire. » On
voit bien que là, Wagner est de nouveau convoqué.
— C’est en un sens également le cas de Boucourechliev qui a
fait toutes ses analyses de la Tétralogie dans ses volumes de L’Avant-scène
au début des années 70. Lui-même a tenté de thématiser Wagner comme une
nouvelle figure de l’œuvre ouverte, de le réactualiser comme la grande œuvre
ouverte.
— C’est encore plus exemplairement le cas de Boulez qui, à
partir du moment où il va se mettre à le diriger, remet sur la table le dossier
Wagner. Boulez a commencé de diriger Wagner en 1966 avec Parsifal en 66,
68 et 70 puis avec la Tétralogie entre 76 et 80. Et, comme le dit
Boulez, « quand on dirige Wagner, on ne peut pas ne pas être
influencé ». Comme me le disait Alain, on ne dirige pas Wagner
impunément ! Il est ainsi très frappant de voir à quel point Boulez va
édifier sa nouvelle problématique compositionnelle sur Wagner : le grand
tournant chez lui, à mon sens, intervient en 1963 mais l’effectuation de
l’affaire, tant compositionnellement qu’intellectuellement, doit attendre le
milieu des années 70, en prenant donc appui sur Wagner. Donnons de cela
quelques repères.
Boulez déclare à Célestin Deliège à la fin des années
60 : « L’influence de Wagner est à la base de mon projet »
(Par volonté et par hasard, p. 66). En effet, Boulez va
progressivement mettre la question du thématisme au cœur de son propre bilan du
travail motivique de Wagner. Finalement, toutes les nouvelles catégories
bouléziennes qui ont été très importantes dans ses cours au Collège de France
entre 80 et 85, comme les catégories de thématisme, de signal, d’enveloppe,
de points de repère ou de jalons peuvent être chez lui
directement mises en parallèle avec les traits qui l’ont intéressé dans la
musique de Wagner, singulièrement dans son usage des leitmotive.
Dernier point : Boulez relève aussi que son intérêt
pour Wagner a pris une nouvelle intensité quand il s’est demandé s’il était
lui-même capable d’une « œuvre plus longue, faite d’un seul geste »,
ou s’il était « capable d’avoir des idées qui supportent la durée ».
C’était dans les années 1966-67, quand il composait Éclat/Multiples, au
moment même où il commençait à diriger la musique de Wagner (1966).
Ainsi, l’hypothèse d’un Wagner extime à notre aujourd’hui
musical a quelques raisons proprement musicales d’être mise à l’œuvre.
Wagner,
pour l’œuvre grande
Je conclurai en formulant ici une hypothèse : si l’on
n’est pas, à la différence d’un Boulez, véritablement intéressé à une
reconsidération du thématisme, fût-ce sous la forme très altérée que lui donne
ce dernier, ne faut-il pas se tourner vers Wagner comme possible indicateur de
ce que la musique aujourd’hui non seulement pourrait, mais devrait
prétendre à la grandeur ?
Pourquoi devrions-nous, nous musiciens, nous compositeurs,
entériner l’opinion aujourd’hui commune, qu’il ne saurait plus y avoir de grand
art musical, et que toute ambition au grand devrait être raturée ? À ne
vouloir que le petit, ne sommes-nous pas somme toute condamnés à ne rien
vouloir ? Donc combattre le nihilisme, n’est-ce pas aussi réafficher
l’ambition du grand ? Au passage, Boulez tient là-dessus ce propos en
1976 : « L’ambition de Wagner était, grande, démesurée. Tant
mieux. »
Cette interrogation générale se décline aussi dans cette
question plus technique, que Boulez comme Stockhausen ont posée à la musique de
Wagner : pourquoi ne pourrions-nous pas déployer des idées musicales de
grande portée et par là composer des œuvres de grande envergure ? Bien
sûr, la grandeur d’une œuvre n’est pas fonction de sa durée. On pourrait donc
non pas demander ce qu’il en est d’une grande œuvre au sens esthétique du
terme, mais d’une œuvre qui serait grande, d’une œuvre grande. Wagner ne
pourrait-il pas nous aider à concevoir cela aujourd’hui ?
Il me semble que oui, et que Nietzsche, somme toute, nous
met ici sur la voie en rehaussant en Wagner le maître de la miniature, en
écrivant que ses chefs-d’œuvre ne durent le plus souvent qu’une seule mesure.
Ce Wagner, ironiquement décrit comme écrasant d’avance Webern tant par la vaste
durée de ses œuvres (l’œuvre de Webern tout entière dure seulement deux heures,
soit seulement un acte de Parsifal !) que par la concentration de
ses chefs-d’œuvre (le plus court chez Webern – Bagatelles, opus
9 – atteint malgré tout huit
mesures, et dure donc huit fois plus longtemps que ceux de Wagner…), ce Wagner
tel que saisi par Nietzsche nous donne peut-être le chiffre possible, non pas
de la grandeur artistique ni de la grande œuvre, mais de l’œuvre grande.
Mon hypothèse de travail serait la suivante : une œuvre
serait grande par sa capacité de faire simultanément fonctionner différentes
échelles de manières non synchrones. Le grand ainsi ne serait pas affaire de
long, mais capacité d’articuler local, régional, global (et d’autres échelles
encore) sans que ces différentes échelles soient homothétiques.
Il est bien connu que le système tonal organise un espace
d’échelles autosimilaires puisque, par exemple, le rapport élémentaire des deux
notes do-sol équivaut au rapport des deux accords do-mi-sol et sol-si-ré,
lequel équivaut, à échelle supérieure, au rapport des tonalités de do majeur et
sol majeur, lequel à son tour équivaut, à grande échelle, aux deux régions
tonales de la plupart des grandes formes tonales telles que la sonate. Or cette
autosimilarité, à mon avis, n’est pas signe de grande œuvre, et ce que Wagner
peut-être nous indiquerait, ce serait de chercher du côté de miniatures
assemblées selon d’autres principes que ceux guidant leur structure interne, en
sorte qu’une œuvre grande ne serait pas nécessairement longue, mais par contre
tresserait un réseau d’idées inhomogènes et à portée très variable.
Voilà peut-être une piste, au moins pour moi, en vue
d’éventuellement réactiver musicalement Wagner, sans bien sûr vouloir pour autant
revenir sur les pas gagnés par le siècle passé, en particulier sur le cadre
soustractif que j’ai esquissé.
Cela revient à dire que l’hypothèse musicale, en particulier
pour cette journée, serait celle-ci : tout en soutenant un cadrage
soustractif pour la musique d’aujourd’hui, comme pour celle du XX° siècle,
cadrage soustractif dont il reste vrai qu’il pourrait être tenu pour une
soustraction de Wagner, l’affirmation musicale qui doit découler de ce cadrage
retrouverait, ou pourrait retrouver Wagner, un Wagner qui, en un certain sens,
chassé par la porte, reviendrait par la fenêtre, un Wagner à partir duquel il
resterait possible, somme toute, de rethématiser les différentes affirmations
dont j’ai parlé tout à l’heure, c’est-à-dire d’une part, une nouvelle
problématique du timbre, ce à quoi Stockhausen nous rend sensibles, et qui est
tout à fait frappant à l’écoute de la musique de Wagner et d’autre part, plus
essentiellement encore, une nouvelle logique musicale du discours. C’est cet
horizon que Wagner esquissait en 1882, après Parsifal, dans une
conversation avec Liszt (que Cosima nous rapporte dans son Journal),
lorsqu’il parlait de composer des symphonies qui dépassent et abandonnent le
développement beethovénien, qui organisent donc une forme de déploiement qui ne
serait plus exactement un développement.
*
Ainsi le programme de cette journée, esquissé par Alain
Badiou, pointe directement cette dimension wagnérienne puisqu’un certain nombre
de thèmes dont il va nous parler sont à mon avis en consonance avec ces
préoccupations musicales. Autant dire combien les musiciens peuvent espérer
tirer profit pour leur art d’entendre aujourd’hui Alain Badiou nous exposer son
expérience philosophique de Richard Wagner.
Alain
Badiou
On a eu la parole du musicien, après quoi je propose une
entrée ou une dialectique assez substantiellement différente. Mais comme vous le
verrez, elle s’avérera conclusivement plutôt voisine, étrangement voisine.
0 —
Ouverture
Le nom Wagner, le signifiant Wagner intervient
de longue date dans le problème musique et philosophie. Je l’ai soutenu :
il a une fonction absolument singulière et je crois que pour nous, ou en tout
cas pour le XX° siècle finissant, cela est dû à ce que l’on pourrait appeler la
conjonction de deux séries : une série généalogique et une série
idéologico-politique.
Une
série généalogique
La série généalogique, qui est en vérité intra-philosophique
ou intra-esthétique, déploie l’histoire de la constitution ou du développement
du cas Wagner, c’est-à-dire la construction du cas Wagner qui est, si je puis
dire, une construction non immédiatement donnée par l’œuvre de Wagner lui-même :
c’est une construction. Wagner avait certainement le grand désir d’être un cas,
il faisait tout pour cela, et Nietzsche a écrit de belles pages sur
l’indubitable côté histrionique de Wagner, mais en réalité la construction du
cas et la dramatisation du cas Wagner se sont prolongées bien au-delà et ont
été une entreprise particulière.
Je rappelle qu’elle va de Baudelaire à Lacoue-Labarthe, à
François Regnault, à Slavoj Zizek ou à moi-même, en passant par Mallarmé, par
Nietzsche, par Thomas Mann, par Adorno, par Heidegger : c’est un dossier
considérable, sans équivalent à vrai dire, s’agissant d’une référence musicale
s’entend. Il n’y a pas l’ombre d’un doute là-dessus. Et ce dossier fait jusqu’à
aujourd’hui de Wagner une sorte de centre herméneutique crucial pour les
rapports entre la philosophie et sa condition artistique, en particulier sa
condition musicale, entre le milieu du XIX° siècle et aujourd’hui, soit dans ce
qu’on pourrait appeler la période de la modernité puis la période de sa critique :
il y a quelque chose comme la traversée de la séquence de la modernité et de sa
critique.
Il est tout à fait intéressant qu’au moins en France,
Baudelaire, classiquement considéré comme l’inventeur poétique premier des
figures essentielles de la modernité, soit aussi celui qui a ouvert avec un
particulier brio la construction du cas Wagner.
Une
série idéologico-politique
C’est là la première série, à laquelle succède une série
idéologico-politique qui a aussi des racines dans le XIX° siècle mais qui, à mon
sens, va des années trente à aujourd’hui, qui est d’ailleurs tout à fait
présente aujourd’hui, et qui a pour centre de gravité la corrélation entre
Wagner et les origines du nazisme.
À la fois hétérogène et liée à l’autre, c’est une série dont
la base empirique s’inscrit indubitablement entre, d’un côté, les déclarations
antisémites de Wagner, et de l’autre la récupération de Wagner par les
dirigeants nazis : pensons au rapport singulier d’Hitler en personne à
Bayreuth.
Je crois alors que le cas Wagner dans sa figuration
contemporaine est au croisement de ces deux séries : d’une part, la
généalogie philosophique de la construction du cas Wagner et d’autre part, le
dossier Wagner repris, ressaisi, réarticulé dans l’importance centrale
aujourd’hui de la question de la destruction des Juifs d’Europe, de
l’antisémitisme, du nazisme, etc. Wagner est en compromis dans cette affaire
comme beaucoup d’autres, mais avec une position elle-même généalogique, ce qui
aboutit à l’expression souvent employée à son propos, notamment par Zizek,
selon laquelle il y a chez Wagner quelque chose de proto-fasciste.
Donc le cas Wagner est un cas esthético-philosophique et un
cas idéologico-politique.
Là-dessus il y a, me semble-t-il, deux références
intellectuelles pour nous, qui s’avèrent tout à fait décisives pour la tenue du
dossier après la guerre mondiale :
— Il y a d’abord Adorno, cela a déjà été dit, depuis son
œuvre de jeunesse sur Wagner jusqu’à la grande interrogation de la possibilité
de l’art après Auschwitz. Évidemment, Adorno est dans une position qui est de
façon tout à fait significative au croisement des deux séries, et c’est pour
cela qu’il a un rôle malgré tout très important : c’est d’ailleurs par lui
que nous sommes entrés dans la question. Adorno est à la fois celui qui a pris
position sur la nécessité de laisser Wagner à l’horizon philosophiquement et
d’autre part celui qui a pris position sur la question de ce qu’était l’art
après le nazisme et après la destruction des Juifs d’Europe. C’est là un
premier dossier.
— Le second que je voudrais signaler — on en aura des
extraits -, c’est l’ensemble des films de Syberberg. Cet ensemble constitue un
dossier d’analyses tout à fait exceptionnel, en particulier sur les différentes
séries constitutives du cas Wagner. Je rappelle quand même qu’il a tourné Ludwig
— Requiem pour un roi vierge en 1972 (film sur Louis II de Bavière saturé
de Wagner et qui est aussi un film sur la relation entre Wagner et
l’Allemagne), le film de 1975 Winifred Wagner et l’histoire de la maison
Wahnfried entre 1914 et 1975 (gigantesque entretien entre le cinéaste et ce
dernier qui a, si je puis dire, été celui qui a offert Bayreuth à Hitler,
constituant donc un témoin capital dans cette affaire), Hitler, un film
d’Allemagne, en 1977 (film de sept heures sur la question de Hitler, du
nazisme et à nouveau de Wagner), et Parsifal (film réalisé sur
Parsifal en 1982, dont nous passerons deux extraits aujourd’hui). Tout cela
est très important parce que l’on peut dire que cette fois, ce qui est énoncé,
ce qui est figuré, c’est la question du rapport de Wagner à celle de
l’Allemagne.
Qu’en est-il ? Peut-être le mot Allemagne
était-il justement ce qui organisait le croisement des deux séries dont je
parlais, Wagner étant aussi compris comme porteur de la question de l’Allemagne
— nous pourrons revenir sur ce point. Or le nouage des deux séries,
c’est-à-dire la série généalogique et la série idéologico-politique, consiste à
identifier en général, pour le courant dominant concernant Wagner, dans la
philosophie artistique de Wagner ou dans le socle métaphysique de cette
philosophie artistique, le principe abstrait de ce que l’on pourrait appeler un
révolutionnarisme réactif. La ligne générale de l’investigation de
Wagner par les courants anti-wagnériens dominants depuis Nietzsche dans ce
dossier, c’est que la philosophie artistique de Wagner, essentiellement son
propos d’artiste, réside dans le déploiement du principe d’un révolutionnarisme
réactif, c’est-à-dire de ce que Marx avait appelé le socialisme féodal.
Il y a beaucoup d’arguments en faveur de cette thèse selon
laquelle Wagner serait le grand artiste du socialisme féodal, je ne la présente
pas du tout comme insignifiante. Le proto-fascisme, de façon plus moderne,
serait une ressaisie post-nazie du socialisme féodal en réalité wagnérien,
c’est-à-dire de ce révolutionnarisme réactif qui, vu d’aujourd’hui, aurait joué
un rôle généalogique ou fondateur dans la dimension alors proprement fasciste
que prend le socialisme féodal dans le national-socialisme. La thèse est alors
la suivante : Wagner impose une rupture — personne ne peut le nier sur un
certain nombre de points -, rupture à la fois scénique et musicale : on ne
peut ignorer que l’opéra après Wagner n’est plus l’opéra d’avant, scéniquement
et musicalement. Cependant, cette rupture serait essentiellement nostalgique,
ce qui éclairerait peut-être certains des aspects du laisser-être au passé de
Wagner. Avoir un schème artistique et idéologique de type socialisme féodal ou
révolutionnarisme réactif serait essentiellement nostalgique parce que chevillé
au thème d’une nouvelle mythologie : c’est l’argument constamment mis en
avant. La fonction de l’art serait de créer une nouvelle mythologie. Plus
précisément, d’après une description nietzschéenne qui a été constamment
reprise depuis, une sorte de sensualité nouvelle mais emphatique viendrait en
somme clouer ou unifier le public sous l’idée suivante : que faire pour
réconcilier l’énergie populaire et l’idée ? Voilà le programme.
Pour proposer cette réconciliation, il faudrait fasciner le
public pour lui imposer la solution finalement proto-fasciste de la question,
parce que cette solution serait de proposer une mythologie nouvelle — grand
thème de Lacoue-Labarthe et de beaucoup d’autres — qui serait située au-delà de
la division entre les anciens dieux et le nouveau dieu chrétien. La sensualité
emphatique de Wagner et le réseau des moyens artistiques seraient déployés afin
de créer un état d’hypnose publique favorable à l’imposition de schèmes
mythologiques destinés à aller au-delà de l’opposition entre les anciens dieux
et le nouveau dieu chrétien. Ce serait donc une mythologie qui serait à la fois
un paganisme de la mort des dieux, soit un paganisme des dieux grecs ou de
leurs équivalents germaniques (c’est le même système en réalité) et, dans leur
état crépusculaire, un paganisme de la mort des dieux et/ou un christianisme
outrepassé.
C’est la question de la signification réelle de Parsifal
dont on discute encore aujourd’hui, parce que franchement ce n’est pas très
clair… Mais en tout cas, cela se termine sur l’idée de la rédemption du
rédempteur. Il faut une deuxième rédemption, qui est ce par quoi est outrepassé
en réalité le christianisme dans sa réaffirmation. Il y a donc quelque chose de
nietzschéen dans cette idée que le christianisme réaffirmé est finalement
acceptable, non pas comme christianisme ou comme religion à tous les niveaux,
mais précisément comme nouvelle mythologie, intégrée à la mythologie de sa
propre affirmation. Alors, la patrie de cette nouvelle mythologie serait
l’Allemagne : on aurait une nouvelle mythologie, au-delà du paganisme et
du christianisme, avec comme site l’Allemagne.
Ce n’est pas une idée absolument neuve, car pour Hegel le
site de l’idée absolue était déjà l’Allemagne, la bureaucratie prussienne.
L’Allemagne de Wagner, on y reviendra, est plus incertaine. La question
« Qu’est-ce que l’Allemagne ? » devient chez lui réellement
compliquée.
On aurait ainsi la fusion d’une téléologie de l’art par la
circonstance musicale, scénique : comme vous le savez, Wagner prétendait
réaliser la synthèse de l’art par un art total. On a donc une téléologie de
l’art destinée à l’imposition d’une mythologie qui surmonterait finalement
l’opposition de la Grèce et du christianisme, et cela serait lié à un
radicalisme politique, à un radicalisme révolutionnaire déporté, investi vers
l’affirmation nationale. On aurait donc l’exemple canonique de ce que Benjamin
appelait une esthétisation de la politique, et c’est le motif qui va
parcourir toute cette critique de Wagner : on aurait une esthétisation de
la politique, c’est-à-dire le croisement d’une téléologie mythologique de l’art
et d’un radicalisme qui finalement affecte la théorie de la rupture
révolutionnaire à la constitution du peuple.
Alors, les moyens dans ce procès dont je me fais le
procureur provisoire, seraient nécessairement des moyens impurs, néfastes, on
pourrait presque dire dégoûtants : c’est là une chose récurrente dans ce
qui est dit sur Wagner. Parce qu’elle serait une musique de la séduction
emphatique, la musique wagnérienne proposerait en effet comme moyens
partiellement nouveaux des moyens essentiellement impurs ou néfastes du point
de vue du devenir de la musique elle-même.
C’est un point très important sur lequel Nietzsche a eu une
très grande acuité, à mon avis pour deux raisons connexes : ils seraient
impurs parce que d’abord ce seraient des moyens dialectiques (ils auraient
l’impureté et en même temps l’arrogance des moyens dialectiques, de toujours
prétendre surmonter les différences et les contradictions que l’on crée) et,
d’autre part, parce qu’ils relèveraient en réalité de contraintes
artificielles. Il y aurait une novation dans les contraintes qui toutefois
s’avéreraient finalement être des contraintes artificielles subordonnées à
autre chose que la musique elle-même.
Cela ouvre les six grands procès intentés à Wagner du point
de vue, cette fois, de la scène, de la critique artistique.
Premier
procès
Le premier procès concerne une réduction du flux musical à
une proposition de continuité (cf. la théorie de la mélodie continue, etc.) du
flux musical dont en réalité le paradigme serait l’unité artificielle du vécu.
Donc le paradigme véritable serait de configurer le flux musical sur le modèle
du flux subjectif. Ce serait une sorte d’émotion discursive imposant des
identités, et cette imposition des identités en tant qu’identités du vécu
donnerait justement à la musique de Wagner et au continu wagnérien son côté de
fascination extra-musicale, c’est-à-dire que l’effet musical ne serait pas
réellement immanent mais passerait toujours par un paradigme émotif subjectif
qui lui demeurerait extérieur. C’est là notre premier point, celui de la
critique radicale de ce qui se cache, si l’on veut, sous le type de la mélodie
continue.
Deuxième
procès
Le deuxième de ces procès qui s’enchaînent serait une
récupération de la souffrance et de la pitié (motifs fondamentaux dans la
dramaturgie wagnérienne), laquelle en fait dissout la première dans la
rhétorique de la seconde : autrement dit, au lieu de se tenir en face de
la souffrance du même de façon authentique et véritable, elle la dissout dans
une rhétorique de la pitié qui finit par donner des jeunes gens abrutis, en
culotte courte bavaroise, qui contemplent de façon stupéfaite quelqu’un qui se
roule par terre en souffrant énormément, et qui à ce moment-là ont une
révélation, celle du nouveau dieu. Ce serait donc là véritablement du
Schopenhauer du pauvre, c’est-à-dire quelque chose comme une articulation de la
souffrance qui, au lieu d’être, comme Adorno le voudrait, le point
d’interruption de toute rhétorique, en est au contraire l’aliment immédiat. Il
y aurait alors en réalité une soumission de l’insoutenable au devenir, et la
musique organiserait cela, en sorte qu’il ne s’agit pas là simplement d’un
point dramaturgique : il y aurait vraiment une soumission de
l’insoutenable au devenir au lieu de saisir de cet insoutenable le présent
comme tel, et pitié serait le nom rédempteur ou artificiel de cette
soumission du présent pur de la souffrance à un devenir qui en est la
dissolution rhétorique. On aurait alors une organisation typique musicalement
prédéterminée du personnage de la souffrance qui est toujours disposé dans une
prédétermination musicale dont il serait le résultat, alors qu’évidemment,
toute la thématique du pur présent de la souffrance consiste à dire qu’elle
n’est pas un résultat mais avant tout une expérience. Il faut d’abord être dans
une pathétique essentielle de sa réception. Wagner contournerait tout cela et
livrerait la souffrance à la rhétorique du devenir.
Troisième
procès
Le troisième grand procès, c’est que la stratégie
fondamentale de Wagner serait dialectique au mauvais sens du terme, si tant est
qu’il y en ait un bon : les différences ne seraient que les moyens de la
péroraison affirmative. On s’enfonce en effet apparemment dans les différences,
dans les dissonances, dans les discontinuités, mais le point fondamental c’est
qu’il s’agit en réalité de la réconciliation. C’est la péroraison affirmative,
et la dissonance n’est pas explorée du point de son avenir, mais de sa résorption
ultime, fût-elle différée, retardée ou particulièrement retorse. Il y aurait
une ruse wagnérienne essentielle, recoupant tout à fait ce que disait Barraqué
ou quelque chose de cet ordre : il n’y aurait pas du tout chez Wagner un
pas créateur sur l’horizon d’une modification du langage, mais simplement un
usage étiré et rusé de la soumission de tout écart à la péroraison finale, soit
finalement l’organisation musicale d’un équivalent du savoir absolu comme
figure en résultat, comme figure terminale de la discursivité.
Quatrième
procès
Le quatrième procès vise ceci : outre une stratégie
dialectique, outre la sensualité emphatique qui la charrie, il y aurait en
réalité l’artifice d’une construction analytique. Évidemment, si vous voulez
soumettre la souffrance à la sublimation du devenir, vous devez forcer les
choses et trouver l’artifice de cette soumission. Il y aurait donc en réalité
dans la cuisine musicale wagnérienne une construction analytique qui en
définitif soumet la musique à la narration. C’est là un point central qui est
déjà présent chez Nietzsche, que l’on retrouve chez Thomas Mann, et qui est
complètement déployé avec Lacoue-Labarthe : c’est l’idée que si l’on veut
déployer musicalement une stratégie dialectique dans des conditions qui ne sont
pas directement celles des formes héritées, des formes traditionnelles comme
par exemple les mouvements de la symphonie, mais dans un discours qui a
l’apparence de la continuité, c’est-à-dire qui se présente comme mélodie
continue sans les artifices de la discontinuité formelle, on doit dans un
premier temps faire en sorte que la musique affecte les différences à une
résolution. Or comme cette résolution n’est pas directement la résolution
classique, comme c’est une autre proposition, alors on soumet secrètement le
discours musical à la narration, c’est-à-dire à la théâtralité qui finit par
commander le procès musical lui-même. La forme est la surimposition
artificielle de signes narratifs au développement musical, elle prend des
signes narratifs constamment imposés comme construction analytique sous-jacente
à la prétendue continuité du développement musical : c’est la fonction des
leitmotive, conçus dans cette polémique comme surimposition des signes au
développement musical pour que ce dernier soit au service du résultat.
Cinquième
procès
Le cinquième procès consiste à dire que la preuve de tout
cela, c’est que Wagner est incapable d’organiser une attente véritable. Le
procès d’Adorno est spécifique mais à mon avis tout à fait important : la
preuve que l’on est dans le présent des choses, c’est que l’attente peut être
une attente vaine, c’est-à-dire une attente qui n’est précisément pas
subordonnée à ce qui vient au terme de l’attente. On retrouve ici l’opposition
d’En attendant Godot à Wagner : Beckett serait le dramaturge de
l’attente moderne et Wagner le serait de l’attente encore métaphysique, de
l’attente du résultat. L’incapacité de Wagner serait l’incapacité à produire
une attente qui soit autre chose que ce qui va être comblé et surcomblé par le bénéfice
de son résultat.
Sixième
procès
Le sixième procès, peut-être le plus important, c’est que la
musique de Wagner se serait révélée, pour toutes ces raisons, incapable de
créer un temps, c’est-à-dire d’être la création d’un temps, ou même d’être une pensée
du temps, parce qu’elle serait l’artifice de la surimposition artificielle de
signes à une durée elle-même subordonnée à son résultat. Dès lors, le temps se
trouve verrouillé : Wagner ne pouvait donc pas faire une proposition
créatrice sur le temps lui-même. Pour tous ceux qui pensent que la musique en
définitive est l’une des modalités de la pensée du temps, il y aurait échec
musical foncier de Wagner par incapacité à être réellement dans les
dispositions pour y arriver ; en particulier, les fameuses longueurs,
c’est-à-dire le fait que Wagner paraît toujours trop long, seraient simplement
le signe structural de cette incapacité à créer un nouveau temps. Cela serait
trop long par essence parce qu’en réalité c’est un temps fallacieux. On aura
beau même le réduire, faire des coupes, ce sera toujours aussi long, ce que
tout le monde a expérimenté : coupez la moitié de l’opéra, il paraît
toujours aussi long. On peut interpréter cela de bien des façons, et dire que
c’est justement parce qu’il y a une telle création temporelle qu’elle est d’une
résistance extraordinaire, et qu’elle est localement présente, jusque dans une
mesure. Cette interprétation sera la mienne. Mais l’interprétation agressive
consiste à dire qu’il n’y a là rien d’étonnant, et que cela tient au fait qu’il
n’y a pas de proposition temporelle véritable ou authentique. On aurait donc le
sentiment insupportable que l’on nous impose une temporalité qui n’en est pas
une, dans laquelle nous ne pouvons pas entrer. Cela tiendrait au fait que la durée
ou la longueur wagnérienne serait réductible à des schémas résolutifs dont
l’existence ne serait pas réellement liée à l’authenticité d’un temps mais à
l’attention d’un certain nombre d’effets. Il y aurait subordination de la
temporalité à la production des effets, et ce serait une musique de l’effet
qui, en tant que telle, ne pourrait pas proposer véritablement, de façon
immanente, un temps nouveau.
Tels seraient donc les six grands procès intentés à Wagner,
faisant au fond de ce dernier le symbole de l’échec du grand art : il
signerait la fin du grand art, au sens où le grand art musical viserait
l’invention, au travers d’un nouveau temps, d’une nouvelle figure de la grande
œuvre. Le grand art ne serait pas exécuté dans une figure figée de la grande œuvre,
ce serait une proposition novatrice sur ce que c’est que la grande œuvre. C’est
évidemment le point de vue de Wagner, mais il aurait échoué.
Nietzsche est celui qui a pensé qu’il fallait remplacer le
projet du grand art par celui de la grande politique : le Nietzsche
terminal est absolument hanté par le projet de la grande politique et, à mon
sens, la nature véritable du conflit terminal entre Nietzsche et Wagner est que
Nietzsche est parvenu à la conclusion que ce n’était pas du grand art dont le
siècle finissant avait besoin mais de la grande politique et que le prétendu
grand art de Wagner n’était aucunement une grande politique, et ne saurait en
être le substitut. Il fallait selon Nietzsche déblayer, oublier Wagner pour
créer une grande politique.
Ensuite, est venue l’idée que la novation musicale devait
faire l’économie du projet mythique du grand art, et ne plus s’inscrire dans
l’horizon du projet du grand art. On parlera de ce soustractivisme qui domine
non seulement la musique mais une grande partie de l’art du XX° siècle :
— la poésie doit devenir indiscernable de la prose,
c’est-à-dire cesser de vouloir être la grandeur métrique de la langue ;
— l’imposition de la forme picturale doit laisser la place à
la précarité fugitive des installations qui se dissolvent sans jamais proposer
le paradigme d’une grandeur stable ou d’une éternité quelconque ;
— la danse peut devenir exposition du corps réel, fugitif,
supplicié ou soustrait ;
— le roman en tant que synthèse générale de l’histoire est
impraticable ;
— quant à la musique, elle doit être atonale…
Wagner devient alors négativement une figure essentielle en
tant qu’au fond il serait l’achèvement du grand art : on pourrait presque
dire que, de ce point de vue-là, Wagner occuperait dans l’histoire des arts la
position de Hegel dans l’histoire de la métaphysique, qu’il serait le Hegel de
l’art dans le sens où il achèverait dans les schèmes systématiques le projet du
grand art comme projet adéquat à l’absoluité de ce dont il traite. Autrement
dit — et c’est à mon avis pour cette raison que Wagner est resté un cas -, ce
que l’on réexposerait à propos de Wagner, c’est l’équivalent interne de la
critique de la métaphysique dans sa forme directement artistique. Cela
reviendrait à deux grandes thèses : le grand art est impossible et doit
être critiqué ou déconstruit, parce qu’il est esthétisation de la totalité,
qu’il suppose la totalité, qu’au fond il a comme propos la séduction de la
totalité et que pour ce faire, il est obligé d’ajuster à son propos des moyens
dialectiques qui sont aussi des contraintes artificielles.
Donc Wagner aurait survécu, à l’instar de Hegel d’ailleurs,
(ils se portent tous deux assez bien après tout !), comme la borne qui
atteste de la fin de quelque chose, la borne monumentale sur laquelle serait
écrit : « Ici s’achève le propos du grand art » ou « Ici
est la dernière grande métaphysique ». Il serait le grand monument du
cimetière des grandeurs impossibles. En ce sens, c’est pour cela qu’il se
serait maintenu comme cas.
Mon intention est alors d’instituer un contre-courant en
soutenant que si tout cela a bien sa cohérence et sa force, nous devons
maintenant écrire un chapitre supplémentaire en torsion dans la série des cas
Wagner. Comme toujours, quand on propose d’écrire un chapitre supplémentaire,
c’est que l’on se situe ailleurs que dans le propos général de Wagner comme
Hegel de la musique, c’est-à-dire ailleurs par rapport à la question du grand
art.
Je dirais que la position dans laquelle je tente d’inscrire
tout cela est que Wagner serait convoqué au seuil d’une restitution du grand
art. L’hypothèse est que le grand art est redevenu notre avenir — je ne sais
pas du tout comment — mais c’est mon hypothèse absolue. J’entends même quelque
chose comme cela dans ce qui a été dit tout à l’heure par le musicien : le
grand n’est plus seulement notre passé, il est aussi notre avenir. Bien
entendu, ce n’est pas le même. De quoi s’agit-il donc ?
Il s’agit certainement du grand art en tant que délié de la
totalité, c’est-à-dire du grand art non pas du tout en tant qu’esthétisation de
la totalité, mais en tant qu’il en est délié. C’est donc évidemment une
grandeur d’un type particulier, et il y a plusieurs manières de le dire :
ce serait un héroïsme sans héroïsation, une soustraction de la grandeur au
paradigme de la guerre, etc. Mais cela serait constitutif de notre horizon
actuel en sorte que nous puissions nous installer entre deux Wagners.
Tout d’abord, le Wagner dont j’ai parlé tout à l’heure, dont
je n’entends pas dire qu’il n’existe pas, puisque ce cas a été dûment constitué
et argumenté, est tout entier lié à l’hypothèse que le grand art est
fini : il occupe cette position du grand art comme fini. Mais si le grand
art est aussi une proposition et non pas simplement une finition, si son
horizon est la restitution, si même la vie de l’art est aujourd’hui subordonnée
pour part au tâtonnement inévitable, au regard de ce que peut être un grand art
délié de la totalité, alors Wagner est reconvoqué avec des moyens différents.
Peut-être devons-nous saisir Wagner comme celui qui a dit quelque chose sur le
grand art que nous pouvons entendre aujourd’hui, autrement que comme il
l’entendait lui-même, et telle est mon hypothèse : Wagner a dit quelque
chose dans son œuvre sur le grand art qui peut être aujourd’hui entendu
autrement que lui-même l’entendait ou autrement que ceux qui ont construit le
cas Wagner l’ont entendu.
On ne peut dès lors pas se confronter à Wagner exclusivement
au régime de la totalité, puisqu’il s’agit de la grandeur déliée de la
totalité. Il va donc falloir pénétrer dans une fragmentation wagnérienne, ce
qui ne veut pas nécessairement dire ne pas connaître ce qu’est la totalité,
mais que c’est dans la fragmentation, dans la localisation que l’on peut
trouver cette piste, c’est-à-dire là où réellement s’affrontent musicalement et
scéniquement la continuité et la discordance, le local et le global. Si l’on
fait comparaître Wagner là où il y a cet affrontement de la continuité et de la
discordance, du local et du global, dans sa fragmentation propre, c’est-à-dire
dans son devenir, dans son procès y compris microscopique, si je puis dire, on
peut, je crois, plaider autrement les six procès. On peut passer de la position
du procureur à la position de l’avocat, la cause ayant évidemment changé :
ce n’est plus exactement le même procès.
C’est ce qu’après avoir donné l’état de la question, je
voudrais essayer de faire, mais je voudrais commencer par dire un mot qui me
paraît important sur ce que j’appellerai le volontarisme ascétique de Wagner.
On a beaucoup daubé sur le grand sorcier, le sensuel,
l’érotique, le « grand enchanteur » comme disait Nietzsche, avec
toujours ces expressions extraordinairement ambiguës de Nietzsche sur
Wagner : Wagner a probablement été l’unique grande passion de Nietzsche
dans sa vie, et quand il a fallu le sacrifier pour la grande politique, cela
s’est fait à travers des énoncés très ambigus.
Revenons sur le volontarisme ascétique : avant Wagner,
quelles étaient les voluptés de l’opéra, puisque l’on est dans l’érotique,
après tout ? Tout le monde est d’accord pour dire qu’il y en avait
beaucoup. Parmi les grandes voluptés de l’opéra, très sensibles aujourd’hui, il
y a tout de même les ensembles, c’est-à-dire ce dont l’opéra est capable à la
différence du théâtre : faire parler et chanter les gens ensemble, avec
autant de trios, des quatuors, de chœurs… Dans l’histoire de l’opéra, avant
Wagner, on trouve des choses vraiment extraordinaires sur la volupté immédiate
que prenaient certains ensembles absolument caressants… Par exemple, je pense
au quatuor de Rigoletto de Verdi : même Hugo en était envieux, lui
qui disait pourtant qu’il n’aimait pas qu’on dépose de la musique le long de
ses vers… Puis cela a continué après Wagner : pensons au trio des femmes à
la fin du Chevalier à la rose, etc. Or, c’est un geste wagnérien
essentiel que d’y renoncer. Cette volupté-là est terminée : plus de trio,
plus de quatuor, plus de quintette, seulement des chœurs très restreints.
Cette renonciation, dans laquelle on peut dire qu’il sera
suivi de façon réellement implacable par Debussy, tient à une raison à mon avis
essentielle qui amorce la pente ascendante, à savoir que la volupté opératique
de l’ensemble est emblématique d’une fonction musicale d’unification de la multiplicité.
Elle en est l’exhibition, et la volupté vient sans doute d’ailleurs de là. Elle
est probablement, et c’est complètement réussi, dans le jeu quasiment murmurant
de la multiplicité qui murmure à l’intérieur de l’unité, ou quelque chose de ce
genre… C’est donc réellement cela qu’une soumission de la différence à la
finitude ; c’est d’ailleurs toujours une forme affirmée, avec un début et
une fin tout à fait perceptibles. C’est un fragment d’un où murmure le
multiple, et c’est à cela que Wagner va renoncer.
Il faut prendre ce symptôme au sérieux : il y renonce
alors que précisément il est accusé très souvent par ailleurs de soumettre la
différence à la finitude ou à la clôture. C’est bien là un paradoxe que le
musicien ainsi accusé soit celui-là même qui le premier a déclaré qu’il allait
y renoncer. L’objection serait alors que ce n’est pas un vrai renoncement parce
qu’il n’aurait tout simplement pas su le faire, qu’il n’était capable que de
faire parler interminablement des gens.
En réalité, il sait le faire aussi bien que personne, sinon
mieux que personne, et c’est par là que je voudrais commencer. Il y a de cela
dans l’œuvre de Wagner deux exemples essentiels, où a subsisté si je puis dire
ce à quoi il a renoncé, et où l’on conçoit qu’il aurait pu en faire des cent et
des mille. Il y a d’abord, dans le Crépuscule des Dieux, le terrible
trio tragique, assez verdien dans sa construction, où l’on jure la mort de
Siegfried, ainsi que le quintette de la scène 4 de l’acte III des Maîtres
Chanteurs que nous allons entendre maintenant.
Nous allons nous-mêmes directement renoncer en donnant la
volupté d’abord avant de l’abandonner… Je situe ce quintette, sans toutefois
vouloir ici raconter les opéras de Wagner, encore que ce soit souvent très
simple : il y a eu, du point de vue philosophique qui précisément nous
intéresse, au second acte des Maîtres Chanteurs, un terrible tumulte,
une scène de division incessante, où les intrigues des uns et des autres ont
entraîné progressivement une sorte de chamboulement carnavalesque dans la ville
de Nuremberg tout entière. Tout le monde est sorti dans la rue, criant, aboyant
en tous sens, les intrigues s’enchevêtrent, on ne sait plus très bien où elles
en sont et en leçon, ou en bilan de ce tumulte, le personnage central de Hans
Sachs, le maître chanteur par excellence, a acheminé deux choses. Premièrement,
il renonce à la souveraineté artistique qu’il va confier au jeune Walther qui
est le porteur de l’art nouveau. On a donc une figure de
renoncement/transmission, où le vieux maître va abdiquer sa souveraineté
artistique et la transmettre. Bien entendu, comme c’est lui qui la transmet, il
la garde aussi… Puis il abdique la souveraineté amoureuse : malgré son
amour pour Eva, il la donne également à Walther. En somme, il donne à Walther
la musique et la femme ; il gardera quand même quelque chose, comme on le
verra plus tard.
Le quintette se situe au troisième acte, après la décision
de renoncement de Sachs. Pourquoi y a-t-il donc là un quintette ? À mon
avis, parce que précisément on n’est pas dans les effets de la décision
héroïque, mais dans ceux du renoncement : Sachs vient réellement de
décider de renoncer à ces deux choses-là, et une sorte de paix nouvelle
s’instaure où l’on a le couple d’amoureux d’Eva et de Walther, les deux jeunes,
ainsi que celui de David et de Magdalene, comme contrepoint amoureux lui aussi
réconcilié avec, au centre, la position du renoncement de Sachs. On va voir
l’unique quintette de toute l’entreprise de Wagner, lié à cette instabilité de
la paix première lorsqu’elle est dictée non pas par l’affirmation mais par le
renoncement.
Écoute
du quintette (scène 4 de l’acte III) des Maîtres Chanteurs
Cela va nous permettre de pivoter sur la figure de Hans
Sachs pour examiner en contrepoint le premier procès.
1 —
Musique et unification
Le premier grand procès fait à Wagner lui reproche d’avoir
accordé une fonction paradigmatique au vécu émotif dans la construction du flux
musical. Cette thèse revient à dire — car c’est aussi une conception théâtrale
et pas seulement musicale — que l’identité subjective chez Wagner est quelque
chose comme l’invariant du flux et que c’est possible parce que le paradigme de
ce flux est l’émotion, le vécu émotif de la subjectivité.
Je voudrais examiner ce point dans une épreuve réelle qui
est — nous enchaînons sur les personnages — le monologue de Sachs au début de
l’acte III des Maîtres Chanteurs.
On a vu qu’à la fin Sachs est isolé, si je puis dire,
tendrement et ironiquement entre les deux couples et je voudrais montrer
comment se passe, musicalement, le moment où Sachs prend cette décision :
là, nous avons une épreuve réelle de ce que c’est que le rapport entre flux
musical et subjectivité.
Je l’ai déjà dit, la décision que va prendre Sachs est celle
d’un double renoncement : renoncement à la place établie de la
souveraineté artistique et renoncement à la place de la maîtrise amoureuse.
J’ai dit aussi que l’horizon acquis au deuxième acte est celui d’un tumulte
anarchique : les manigances des uns et des autres, les intrigues, le désordre
de l’apparaître, le désordre total du site… Le monologue de Sachs que nous
allons entendre va traverser les conditions de la décision.
Cela me paraît très important parce que c’est à l’encontre
de l’idée que le flux a simplement l’émotion subjective comme paradigme. En
réalité, le monologue traverse les conditions de la décision et va organiser le
passage du tournant de la division et du déchirement à une sorte de paix
provisoire. Donc le flux musical va être un flux de métamorphose et non pas
d’identité, par lequel un tourment très vigoureusement affirmé au début va se
transformer en une paix provisoire et cela va être la matière de la décision
sans que celle-ci soit explicitement mentionnée. Elle est prise dans le devenir
de cette transformation.
Au fond, je voudrais soutenir que l’on traverse là quelque
chose qui n’est pas du tout le dépliement d’une identité mais bien plutôt la
plastique d’une métamorphose. Et à tout prendre, c’est plus deleuzien qu’autre
chose en ce sens-là, puisque ce qui tient lieu de sujet, ce n’est pas le
dépliement des conséquences de l’identité, comme on l’a dit très souvent,
notamment à cause des leitmotive. À l’écoute du leitmotiv de Siegfried porteur
de l’épée, on entendrait Siegfried : or n’est pas du tout le cas, comme on
le voit. Il y a une extraordinaire plastique de la métamorphose qui fait que la
tonalité affective est absolument mouvante et que la musique organise ce
mouvement et non pas du tout une prescription identitaire.
Écoute
du monologue de Sachs, au début de l’acte III des Maîtres Chanteurs.
C’est là une scène typique de ce que l’on peut appeler chez
Wagner la scène du monologue de décision, c’est-à-dire un monologue où quelque
chose est en vérité tranché sans que l’on voie le caractère explicite de cette
décision. En vérité, la décision est entièrement charriée par la transformation
interne, ou par ce que l’on pourrait appeler l’inflexion immanente des motifs.
À ce propos, je voudrais dire que les motifs wagnériens — on
le verra tout à l’heure plus analytiquement — tels que vous les entendez là,
dans leur enchevêtrement et dans leur succession, ont deux fonctions
simultanées et que c’est cette double fonction qui en réalité fait l’invention
singulière du motif.
— Ils sont quelquefois en effet en position de structurer
la narration : je pense par exemple au moment de l’évocation de la nuit de
la Saint-Jean dans le second acte, où effectivement le thème du printemps
apparaît.
— On en trouve également un autre usage, bien plus
fondamental, en ce qu’il porte en réalité l’enchaînement subjectif. Ce qui va
faire qu’un sujet n’est plus le même au terme par exemple d’un tel monologue,
est entièrement armaturé non pas simplement par une fonction indicative des
motifs, mais autrement plus fondamentalement par leur fonction de métamorphose.
Boulez a d’ailleurs toujours beaucoup insisté là-dessus : l’essence du
motif est de pouvoir se transformer, et cette transformation est ce qui
réellement porte la métamorphose subjective, faisant ainsi apparaître la
décision de façon immanente dans un élément qui n’est pas de type « avant
j’étais comme ça, maintenant je suis autrement », mais qui est un élément
de passage de l’un à l’autre, dans la discursivité elle-même.
Je voudrais dire qu’au fond, si l’on cherche la profondeur
du lien chez Wagner entre la musicalité et le drame – c’est-à-dire la question
fondamentale du nouvel opéra tel qu’il le conçoit -, le plus important tient à
ce qu’il y a chez lui création musicale de possibles dramatiques. Ce n’est pas
un renforcement ou un soutien musical à une dramatisation déjà établie, même
si, en effet, le texte est toujours déjà là, mais le possible dramatique
proprement dit, c’est-à-dire l’instance subjective de la décision ou la figure
de l’émotion. Nous verrons tout à l’heure comment, immédiatement, la figure de
la souffrance comme possibilité dramatique est instituée musicalement.
Je pense que l’on a là un exemple très clair où on voit bien
que la nouvelle possibilité d’action de Sachs, lorsqu’il demande à la fin
comment on va pouvoir diriger de nouveau tout cela, indique que l’on est
véritablement en présence d’un autre Sachs. Mais ce devenir autre, cette
nouvelle possibilité dramatique qui va influer sur la continuité de l’action a
été en réalité une création musicale, et non pas réellement une création
textuelle ou dramatique, car le texte ne dit pas grand-chose sur cette
métamorphose, bien qu’elle soit effectuée.
Donc la musique effectue le drame, et c’est là une vérité
essentielle chez Wagner : elle n’est pas ce qui vient du dehors illustrer
le devenir, mais elle est vraiment son impulsion aléatoire.
J’insiste sur ce caractère aléatoire : ce n’est pas la
création ou l’illustration d’une nécessité, c’est réellement la création d’une
possibilité, c’est d’abord la création aléatoire d’une possibilité dramatique
qui pourrait musicalement s’orienter tout à fait différemment.
Par exemple, il est ici absolument clair que la possibilité
du quintette est contenue dans ce que l’on vient de voir, parce que la
possibilité subjective que Sachs puisse être celui qui est au centre de ce
quintette n’existe pas avant qu’il y ait ce flot musical du monologue. C’est
donc réellement non seulement une possibilité dramatique mais c’est la
possibilité musicalement construite de situations dramatiques nouvelles :
le nouveau Sachs va être celui de la nouvelle paix et, peut-on dire d’ailleurs,
de la nouvelle alliance. On y reviendra, puisque l’on passera aussi la fin des Maîtres
Chanteurs, c’est la possibilité d’une nouvelle alliance entre l’art et le
peuple qui est finalement le contenu véritable de tout ce processus.
2 —
Musique et déchirement/souffrance.
Cela nous donne une entrée tout à fait intéressante dans le
deuxième point, à savoir l’hypothèse selon laquelle Wagner aurait instrumenté
la souffrance dans une rhétorique de la pitié et qu’il n’aurait jamais restitué
son présent.
Je soutiens vraiment la thèse contraire : la souffrance
est, non pas toujours, mais très souvent absolument au présent chez Wagner, et
peut-être même tout particulièrement chez lui. Dans l’histoire de l’opéra, je
ne lui vois qu’un successeur véritable, à savoir Berg. Il y a certainement
quelque chose de très wagnérien chez Berg, non pas dans la technicité des
choses, mais dans la conception du lien entre musique et drame, et je suis
persuadé qu’il est le successeur de Wagner. Il y a aussi un présent de la
souffrance.
Pourquoi Wagner peut-il inventer ce présent de la souffrance ?
C’est parce qu’il a inventé le présent musical de la division subjective comme
telle. C’est un point que je voudrais illustrer : dans l’opéra antérieur,
l’identité subjective est souvent en quelque manière typée ou combinatoire,
c’est-à-dire qu’il y a une réception des identités à l’intérieur de
combinaisons de différentes typifications subjectives. Même chez Mozart, la
typification est certainement beaucoup plus assurée que chez Wagner, mais elle
est mobile dans la combinatoire de l’intrigue et des personnages. C’est
d’ailleurs pour cela que les ensembles sont très importants : chez Mozart,
le finale des actes est crucial, parce que c’est là où se donnent les instances
de la subjectivité par combinaison.
Chez Wagner, cela ne fonctionne pas de cette façon, car le
personnage ne reçoit pas sa subjectivité essentiellement de la combinatoire ni
même de l’intrigue en vérité, mais bien plutôt de son clivage, c’est-à-dire de
sa division immanente. C’est un ébranlement radical de l’identité subjective
comme combinatoire, qui à mon avis prévalait pour l’essentiel dans l’opéra
juste avant Wagner, et je dirais que, pour celui-ci, le sujet de la souffrance
n’est autre qu’une division non dialectisable, sans réconciliation. C’est un
clivage du sujet instituant réellement une hétérogénéité interne sans
résolution véritable.
Ce n’est pas parce qu’il y a des épisodes de réconciliation
dans les opéras de Wagner que cette division n’est pas donnée au présent comme
telle : elle n’est pas donnée au présent dans la séquence où elle est
donnée, mais elle est donnée au présent comme présent de souffrance absolue et,
au fond, les grands personnages de souffrants wagnériens sont réellement des
donations nouvelles et inventées de leur souffrance au présent, même si
l’histoire peut ensuite subir telle ou telle péripétie. Qu’il s’agisse de
Tannhäuser, de Tristan, de Siegmund ou d’Amfortas, tous ces personnages
instruisent une division radicale, non dialectisable, non réconciliable, et la
présentation de cette division est portée par ce que j’appellerai une musique
du déchirement.
Il y a réellement chez Wagner l’invention d’une musique du
déchirement qui est donnée dans la construction musicale elle-même par le fait
que, utilisant l’hétérogénéité éventuelle des motifs, il exhibe et porte
musicalement une division d’une intensité extraordinaire qui est réellement une
division du sujet comme souffrance irréconciliée.
L’exemple que nous allons prendre, paradigmatique sur ce
point, est Tannhäuser : il est traversé, constitué par trois divisions qui
s’enchevêtrent et qui en même temps s’identifient.
• D’abord, il est le personnage d’une division intime
sur ce que c’est que l’amour. C’est un personnage écartelé entre deux
conceptions de l’amour et il reste dans l’incapacité de renoncer à aucune des
deux, bien qu’elles soient en apparence et socialement inconciliables.
On observe la constitution immédiate de ces deux conceptions
de l’amour qui n’a rien d’original : d’une part, l’amour sensuel, païen,
symbolisé par sa relation au Venusberg et à Venus, et d’autre part l’amour
courtois, sacralisé, de l’univers des chevaliers médiévaux. On est ici entre
l’Antiquité et le Moyen Âge en réalité, entre la conception païenne et la
conception pré-chrétienne de l’amour. Mais Tannhäuser est déchiré parce qu’il a
expérimenté de façon radicale et jusqu’au bout les deux instances de l’amour.
En outre, dans ces deux instances de l’amour, opère le fait
que c’est un grand poète, un grand musicien que Tannhäuser, dont le chant est
ce qui a aussi bien séduit Élisabeth, personnage dévoué à Marie de la chasteté
chrétienne, que Vénus, personnage de la débauche païenne.
Entre nous, c’est un peu comme si Wagner disait qu’en tant
que grand musicien, il a droit à toutes les femmes, à tous les amours.
Tannhäuser est le grand chanteur qui, grâce à son chant, a séduit à la fois
Vénus et Marie. Si on le prend du côté de Wagner, c’est une revendication
intéressante quant à ce à quoi sert finalement d’être un grand musicien… Mais
si on le prend du point de vue de la construction du personnage, c’est vraiment
exhibé comme une division absolument intolérable et telle est la première
grande division du sujet.
• Deuxièmement, il s’agit d’une division historique, je
l’ai dit, c’est-à-dire d’une division entre l’univers réglé de la chevalerie et
l’univers anarchique de l’errance personnelle : comment peuvent en effet
s’accorder le désir et l’ordre des chevaliers ?
• Puis, c’est une division symbolique, fondamentale,
entre les dieux. Cela pose un problème d’importance chez Wagner, pris entre les
dieux païens — à travers Vénus et le Venusberg — et le dieu de la religion
chrétienne.
Finalement, est posée la question de la féminité distribuée
entre Vénus et Marie comme emblème à la fois de deux types d’amours et de deux
contextes culturels ou symboliques entièrement hétérogènes. Or la division
passe par Tannhäuser ; celui-ci n’est rien d’autre en somme que cette
division et la conséquence en est son absolue impossibilité de rester quelque
part.
C’est là un thème très intéressant chez Wagner, que ce thème
du personnage qui ne peut pas rester. On le trouve dès le Vaisseau fantôme.
Mais il faut bien remarquer que même Wotan, le grand dieu de la Tétralogie,
termine comme « Wanderer », comme errant. Lui non plus ne peut
plus rester : à la fin, il est là, avec son grand chapeau, errant dans le
monde, regardant ce qui se passe, assistant en réalité au devenir complexe de
son désastre final. Tel est le personnage wagnérien typique.
Là aussi, il faut absorber cette complexité : Wagner
est également le grand poète du personnage qui ne peut pas rester quelque part,
qui est dans son errance. Lui-même a été un personnage tout à fait
errant : on sait qu’il a été proscrit d’un certain nombre d’États
allemands pour se faire révolutionnaire pendant de longues années.
Il existe à ce sujet un texte de Zizek, publié dans un livre
qui n’a paru qu’en anglais, intitulé « La mort de l’opéra ». Je
trouve ses considérations sur Wagner, de type herméneutique lacanienne, très
intéressantes. Il est remarquable qu’à propos de l’antisémitisme wagnérien, il
pose cette question : « Qui est le Juif dans l’œuvre de Wagner ?
Qui est le Juif errant en somme ? » et non pas seulement « Qui
est le Juif ? » à l’aune des proclamations souvent stupides et tout à
fait désastreuses de Wagner sur le rôle social des Juifs. Le Juif errant est un
personnage auquel Wagner S’est profondément identifié en réalité : c’est
finalement Tannhäuser, c’est Wotan lui-même…
Wagner, qui est en un certain sens le chantre du saint
Empire allemand, de notre chère cité de Nuremberg, qui ne désire rien d’autre
que d’être installé quelque part, qui a construit son propre temple musical à
Bayreuth, est en réalité affublé d’une subjectivité sous-jacente qui est une
errance, une incapacité en réalité de rester, et qu’il a absolument projetée
dans toute une galerie de personnages qui sont des errants crucifiés, que la
division subjective rend inaptes à toute sédentarité.
Cela donne des scènes extrêmement frappantes et violentes
dans Tannhäuser : par exemple, alors qu’il est bien installé dans
le Venusberg avec voluptés à gogo, plaisirs sexuels à longueur de journée,
etc., il y a une scène où il supplie Venus de le laisser partir, seuls les
dieux pouvant selon lui jouir autant. Cette scène, à l’acte I, est d’ailleurs
magnifique, absolument violente et déchirante ; mais à l’acte II, où en
effet finalement elle le laisse partir en le mettant sur ses gardes, cela
tourne immédiatement au vinaigre parce qu’à peine est-il convoqué par les
chevaliers à un tournoi de chant où l’on doit célébrer l’amour idéal, l’amour
de Marie, la chasteté, etc., qu’il demande ce que c’est que cette foutaise,
clamant que lui sait bien ce que c’est que l’amour et qu’il entonne le grand
chant de l’amour érotique… Alors, tout le monde veut le tuer, et il n’est sauvé
que parce qu’Élisabeth, qui l’aime profondément – précisément parce qu’il
est capable de dire cela, contrairement à tous les autres qui sont de parfaits
seigneurs courtois un peu castrés – le sauve. Et de nouveau le voilà
reparti dans son errance.
Au fond, il s’agit vraiment de la dramaturgie de
l’incapacité d’être dans un site, donc de l’entre-deux mondes qui constitue la
subjectivité comme clivage, et l’on trouve cela constamment dans l’expression
d’une souffrance constituée. Or, comme quiconque est dans une division
exténuante, Tannhäuser va chercher un terme transcendant. On lui conseille le
Pape — aujourd’hui, ça fait écho — et le voilà parti en pèlerinage à Rome pour
aller demander son pardon au Pape.
C’est d’ailleurs très curieux, cette histoire du Pape :
ce n’est pas de la part de Wagner un rapport au catholicisme, ni à la papauté.
Or il s’avère que ce pape est nul : il lui garantit l’enfer sans aucune
rédemption possible. Voilà un pape dogmatique, en somme, qui le plonge en même
temps dans une déréliction totale puisque le seul recours transcendant qu’on
lui a proposé par rapport à sa division ne fonctionne pas. Il revient donc de
ce pèlerinage à Rome entièrement défait, renvoyé à sa division par la décision
du Pape et tenté, naturellement, de retourner dans le Venusberg alors qu’au
début, il suppliait désespérément Vénus de pouvoir s’en aller, ne pouvant pas
non plus, comme on l’a vu, y rester.
On en est donc là, et cela constitue absolument un présent
de souffrance sans rémission. Le passage que nous allons entendre est le récit
par Tannhäuser de son expédition à Rome, qu’on nomme récit du pèlerinage,
où il raconte tout cela à l’un des chevaliers, Wolfram, qui est le chevalier
sympathique, celui qui aime depuis toujours Élisabeth chastement,
silencieusement ; évidemment, il a vu Tannhäuser lui passer dessus mais il
est quand même gentil, prêt à accueillir ses souffrances.
Vous allez l’entendre : c’est une extraordinaire
expression présente, publique, de ce que c’est qu’un anéantissement dans la
division et l’inconciliable. Ce sont des questions de goût, mais je ne crois
pas qu’il y ait tant d’exemples aussi puissants de ce que c’est que
l’anéantissement de quelqu’un qui a expérimenté absolument, jusqu’au bout, une
division irréconciliable et qui par conséquent est condamné à n’être nulle
part.
Écoute
du récit du voyage à Rome au troisième acte (scène 3) de Tannhäuser
Voilà donc le terrible Tannhäuser…
Vous avez vu qu’il est mis en scène dans une Allemagne
dévastée : « Germana nostra » est en miettes, avec un
Wolfram qui ressemble en vérité un peu à Brecht, et qui est là comme
représentant de l’Allemagne de l’Est pour voir les souffrances de Tannhäuser.
C’est l’un des très grands rôles de René Kollo, à la fois
ici à l’apogée et à la fin de sa carrière ; il est tout de même dans Tannhäuser
tout à fait impressionnant.
Ce que je voulais simplement noter, comme on l’a fait tout à
l’heure à propos du monologue de Sachs, c’est qu’il y a chez Wagner quelque
chose de très reconnaissable dans la constitution musicale de la division du
sujet : dans la conduite du texte lui-même, le récit peu à peu toujours se
défait, c’est-à-dire que s’il est au début tout à fait narratif, il se défait
progressivement comme s’il se subjectivait sous la poussée de la musique.
Cette division du sujet est donnée par un enchevêtrement que
je crois être typique de la procédure wagnérienne lorsqu’on y regarde de près,
à savoir l’enchevêtrement de quatre termes, de quatre techniques.
— Il y a d’abord généralement un récitatif très proche
de la parole, qui en vérité n’est pas plié à un schéma mélodique déterminé, et
qui va revenir à d’autres moments.
— Il y a des séquences lyriques extrêmement violentes,
qui sont des espèces de poussée en crescendo de la voix et qui tendent la
musique plutôt autour de quelques mots que de quelques phrases : on a là
plutôt une dynamique du mot que de la phrase, et alors advient une
orchestration.
Là, je ne peux être que descriptif et non pas technique sur
ce rapport entre deux éléments dans l’orchestration proprement dite,
indépendamment même de la thématique.
— Il y a une sorte de nappage souterrain, souvent donné
aux cuivres graves ou aux cordes graves, avec des espèces d’ascensions brisées,
un côté océanique si l’on veut, placé sur le fond grave de la musique et en
revanche, on a des trémolos aigus ou des hautbois. C’est là quelque chose
d’absolument typique, que le rapport entre les deux, l’enchevêtrement des deux
étant presque toujours le signe d’une division subjective, d’une crucifixion ou
d’une présence de la souffrance.
— À la fin, on a de longues phrases médiatrices, plus
thématiques, plus mélodiques, dont on pourrait montrer comment elles échouent
en réalité, c’est-à-dire comment elles viennent pour ainsi dire se briser sur
l’océan souterrain du mouvement de l’orchestration grave.
Cet ensemble-là est reconnaissable et il indique, une fois
de plus, que, ce que je crois vraiment, c’est la musique qui est alors
constructrice de la division du sujet. Bien sûr, la situation est donnée comme
telle, mais ce qui la rend présente, ce qui fait que la souffrance de
Tannhäuser nous est restituée, si je puis dire, au présent de la scène, et pas
du tout uniquement dans sa dissolution dans le devenir, ce sont ces
opérateurs-là et non pas l’histoire générale que Tannhäuser raconte.
Il me semble que quand on entend cela, on a un sentiment
très curieux à la fois de massivité — il y a un côté massif subjectif qui
s’impose — et, en même temps, de quelque chose de détotalisé et de fissuré,
comme un monument fissuré. C’est une analogie mais je crois que les moyens mis
en œuvre convergent vers ce sentiment de massivité détotalisé ou de monument
sonore fissuré, dont on voit bien qu’il ne peut se résoudre que par la
destruction : le monument est certes là, mais sa fissure est si visible
qu’on le sait condamné.
C’est pourquoi je trouve le décor de ce monument ruiné
adéquat, métaphorique de ce que l’on voit alors vraiment et qui est que
Tannhäuser est lui-même un monument en ruines qui va devant nous se scinder et
s’abolir. Tout cela conduit à l’évanouissement et à la mort de Tannhäuser.
Je pense que chez Wagner, dans ce sens-là, la souffrance est
bien un être-là, qu’elle n’est pas une résorption des récits avec une
définition très précise : ils sont au fond une exploration des issues
destructrices de la division non dialectique.
C’est la définition abstraite que j’en donnerai : une
construction textuelle et musicale des issues destructrices de la division non
dialectique. Il est tout fait inexact de dire que l’on serait simplement en
face d’un instrument rusé de la réconciliation ; je ne crois pas du tout
que ce soit l’effet produit. En revanche, cet effet de monumentalité est
indiscutable et je crois que c’est l’un des rares exemples où l’affect de la souffrance
est présent sous une forme monumentale. Je pense que c’est là que résidait la
fausse idée que c’était un écrasement ou une rédemption alors qu’au contraire,
c’est le monument de la souffrance elle-même. La souffrance est monumentale en
un certain sens pour le sujet ; il est lui-même comme un monument déchiré,
fissuré, et c’est bien ce qui est montré.
Il y a d’autres versions possibles de la souffrance mais la
présence de cette dernière chez Wagner est vraiment la présentation des issues
destructrices de la division non dialectique.
3 —
Musique et résolution des différences.
Est-ce que la différence chez Wagner est dialectique au sens
où elle serait entièrement subordonnée à une figure terminale de réconciliation
et où la péroraison viendrait à la fois relever et unifier toutes les
différences construites à l’intérieur de l’opéra ?
C’est effectivement là le reproche qui a été souvent fait à
Wagner, selon lequel l’apparence de la différenciation, très frappante dans la
texture de son texte et de sa musique, est finalement résorbée dans la
péroraison. Il y a des exemples absolument canoniques : le plus connu,
dans Tristan et Isolde, est directement harmonique, le système général
des dissonances théoriques ne faisant que différer le fait qu’ultimement, on
obtient quand même l’accord. Le rétablissement de la tonalité de la bémol
à la fin de Parsifal en est comme la révélation : finalement, la
rédemption du rédempteur serait peu ou proue le la bémol…
Une fois de plus, nous constatons que, derrière ces griefs
qui feraient partiellement de Wagner un imposteur de la différence ou, en fin
de compte, un hégélien tardif, soit quelqu’un qui conclurait de manière
résolutive et qui n’ouvrirait pas de nouvelle porte, il y a des arguments
techniques indubitables à faire valoir.
Ceci étant, j’ai le sentiment — je vais tenter de le
défendre, tout en gardant présents à l’esprit ces faits indubitables — que
chaque opéra de Wagner est en réalité l’exploration d’un possible, c’est-à-dire
l’exploration d’une possibilité conclusive au sens de ce qu’a eu de prospectif
le XIX° siècle, qui s’est en effet proposé, non seulement avec Wagner, mais
aussi bien avec Marx, Darwin, ou d’autres, de grandes visions, de grandes hypothèses
sur le devenir des espèces, celui de l’histoire ou de l’humanité, dans une
contemporanéité entre ces grands dispositifs de pensée et une sorte
d’eschatologie politique, une théorie du progrès ou des choses de cet ordre.
Wagner est contemporain de tout cela et l’opéra est pour
lui, à mon sens, l’organon de l’exploration de possibilités conclusives tout à
fait différentes les unes des autres : il n’y a pas du tout un pôle
unificateur, unique, vers lequel en quelque sorte l’œuvre de Wagner tendrait comme
telle, mais une exploration de possibles disparates.
Aussi est-ce de cette manière que j’interprète un point très
frappant : chaque opéra de Wagner a un coloris musical immédiatement
identifiable. Chacun est différent en un sens intime : la couleur de Parsifal
est reconnaissable immédiatement, elle n’est par exemple absolument pas celle
des Maîtres Chanteurs. Donc il y a toujours un coloris propre qui n’est
pas uniquement une question de modification habile des instrumentations, bien
que naturellement il s’agisse aussi de cela, ni d’appropriation de la
musicalité aux finalités dramatiques.
Le fait est que les hypothèses traitées dans chacun des
opéras ne sont pas les mêmes et que le coloris, la structure thématique, la
rythmique générale, etc., sont au service de cette hypothèse. C’est le premier
point que je voudrais indiquer et défendre.
Le deuxième, c’est que le fait que ce soit une hypothèse
parmi d’autres bien plus qu’un point théoriquement validé ou construit, tient à
ce que l’on sent chez Wagner, non pas du tout une certitude, mais une
difficulté de conclure : parvenir à la péroraison est difficile, marqué
d’hésitation, et il y a chez lui une tendance à laisser ouvertes plusieurs
interprétations ou plusieurs hypothèses. Il y a en réalité une hésitation wagnérienne,
immédiatement co-présente par ce qui pourrait être une espèce de pompe
conclusive superficielle.
Plusieurs interprètes ont bien observé chez Wagner une
difficulté du choix, un peu comme Tannhäuser qui a du mal à choisir entre Venus
et Marie. C’est aussi sa crucifixion. De fait, plus généralement, il y a chez
Wagner une hésitation sur ce que signifie exactement conclure.
Je voudrais traiter cela à partir de trois conclusions dont
on voit tout de suite qu’elles relèvent d’hypothèses tout à fait distinctes :
la conclusion du Crépuscule des Dieux, celle des Maîtres Chanteurs,
et celle de Parsifal.
Conclusion
du Crépuscule des Dieux
Je dirais que la conclusion du Crépuscule des Dieux, qui
est aussi celle de l’ensemble de la Tétralogie, soit d’un devenir
extraordinairement complexe et monumental, se tient dans une hypothèse
post-révolutionnaire, très « XIX° siècle », qui nous rappelle que
Wagner a participé à l’insurrection de Dresde, qu’il a été un ami de Bakounine,
que la formation originelle en 1848 de Wagner est incontestablement d’être dans
le camp des révolutionnaires, et qu’il a été longuement traqué et persécuté
pour cette raison. L’hypothèse testée dans le Crépuscule des Dieux comporte
une hésitation puisqu’une histoire bien connue nous rappelle qu’il a enlevé la
partie du texte final la plus résolument révolutionnaire, sans la traiter
musicalement.
On a dit que c’était bien la preuve que, comme quiconque
vieillit, s’il était révolutionnaire dans sa jeunesse, il en a déjà beaucoup
rabattu lorsqu’il écrit le Crépuscule des Dieux, et il soustrait donc la
séquence.
En réalité, contrairement à ce que l’on dit, cet aspect n’a
pas changé. Là aussi, mon interprétation est que le texte final, à certains
égards, est plus révolutionnaire que le texte prévu : c’est défendable.
Cela ne change rien à l’affaire, parce que l’hypothèse reste tout de même
qu’après les dieux, vient l’humanité : on aura beau tourner la chose dans
tous les sens, c’est quand même ainsi que tout se termine et que la charge du
monde autrefois régi par Wotan, les dieux, les pactes, les contrats, etc.,
incombe désormais aux hommes représentés par la foule, sans qu’il soit dit en
quoi consiste cette charge.
Vous verrez qu’à cet égard la mise en scène de Chéreau est
superbe puisqu’elle opère comme une conclusion interrogative. Je dirais
volontiers que cette conclusion consiste à confier le destin du monde à
l’humanité générique parce qu’en outre ceci n’a aucune assignation nationale :
il n’est pas question dans cette affaire de l’Allemagne ou de quoi que ce soit
de ce genre, et c’est bien l’humanité dessaisie de toute transcendance,
renvoyée à elle-même, qui doit prendre en charge son propre destin.
C’est une hypothèse qui est proposée dans le Crépuscule
des Dieux après bien des tâtonnements et bien des demi-repentirs et
finalement cela fonctionne ainsi : après les dieux, vient l’homme, pris en
un sens révolutionnaire, c’est-à-dire absolument générique et non
particularisé.
Conclusion
des Maîtres Chanteurs
Dans les Maîtres Chanteurs, nous avons une hypothèse
tout à fait différente, qui concerne l’essence de l’Allemagne.
Là, au contraire, nous passons de l’humanité générique à
quelque chose de tout à fait particulier qui demande en quoi consiste
l’Allemagne : qu’est-ce que c’est que l’Allemagne ? Vieille question
des Allemands, comme vous savez… On peut définir les Allemands comme les gens
pour qui est décisive la question de l’Allemagne. Ce n’est pas du tout le cas
des Français, qui ne se posent aucune question sur la France… On peut définir
les Français comme ceux qui savent ce que c’est que la France, tandis que les
Allemands sont définis comme ceux qui ne savent pas ce que c’est que
l’Allemagne. C’est pour cela que les grands philosophes allemands sont tous des
philosophes qui nous expliquent que ce qui compte, c’est en fin de compte la
question allemande. Wagner est aussi à cette école-là : on ne peut pas
être allemand sans en être, sauf à dire qu’il n’y a qu’à supprimer l’Allemagne,
ce qui était la position de Thomas Mann après la guerre. L’Europe est une
hypothèse de ce genre, envisageant s’il est possible d’y noyer l’Allemagne.
Mais noyer l’Allemagne, ce n’est pas si facile que cela.
Wagner se pose cette question à la fin des Maîtres
Chanteurs dont le titre, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, est
allemand : il faut prendre cela au sérieux, car Wagner va tester
l’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas véritablement, de façon destinale,
d’essence politique possible de l’Allemagne.
C’est une chose qui doit être prise au pied de la
lettre : l’essence de l’Allemagne, c’est l’art allemand, et non pas une
esthétisation de la politique. C’est l’idée qu’il n’y a pas d’identification
politique possible de l’Allemagne à proprement parler. Le texte le dit :
même quand il n’y aura plus d’empire romain germanique, même s’il ne devait ne
plus y avoir d’État allemand, il y aurait l’art allemand. Et l’art n’est pas
destiné à configurer une politique, mais à identifier l’Allemagne.
On peut dire que, dans le Crépuscule des Dieux,
l’hypothèse sur la fonction de l’art est qu’il sert l’advenue de l’humanité
générique, celle qui est saisie de son propre destin, tandis que dans les
Maîtres Chanteurs, l’hypothèse est que l’art peut être une essence particulière,
comme c’est le cas de l’Allemagne, dont en fin de compte l’universalité n’a
aucune chance de se réaliser politiquement ou impérialement, puisqu’elle réside
et subsiste dans l’art allemand. C’est là une hypothèse entièrement différente
soutenue, comme on le verra, dans la musique.
Conclusion
de Parsifal
Enfin, dans Parsifal, nous avons une hypothèse plus
directement métaphysique ou ontologique qui demande s’il y a un au-delà du
christianisme.
— La question du Crépuscule des Dieux est :
qu’est-ce qui se passe quand les dieux sont morts ? Il arrive qu’advient
l’humanité.
— La question des Maîtres Chanteurs est :
quelle est l’essence de l’Allemagne étant donné qu’elle ne peut pas être
historique et politique ?
— Et la troisième, celle de Parsifal est :
y a-t-il un au-delà du christianisme ?
C’est une question qui, comme vous le savez, était aussi la
question nietzschéenne. Il y a partage sur ce point : est-ce qu’on peut
vraiment rompre avec le christianisme ? Je dirais volontiers que la
réponse wagnérienne consiste à dire que l’au-delà du christianisme est en
réalité l’affirmation intégrale du christianisme lui-même, mais il faut bien
comprendre ce que cela veut dire : cela ne signifie pas un
néo-christianisme ou une hérésie particulière, mais cela veut dire que le
matériau figural chrétien peut être ressaisi et réaffirmé comme une matrice qui
constitue finalement un monde ou un univers, lequel est au-delà du
christianisme qu’il va, d’une certaine manière, relever tout en le relisant,
parce que toutes les données constitutives du christianisme vont disparaître
dans cette opération affirmative pour être remplacées par une affirmation
synthétique dont la maxime est « rédemption au rédempteur ».
Cela dit bien ce que cela veut dire : le christianisme
a cessé d’être une doctrine du salut et ce n’est que dans la réaffirmation
figurale ou esthétique de la totalité chrétienne qui la désidéalise et la
déchristianise en un certain sens, que l’on peut trouver un au-delà du
christianisme. Autrement dit, c’est un très bizarre traitement, somme toute
nietzschéen, du christianisme : là où Nietzsche prône une rupture absolue
(le mot d’ordre final de Nietzsche est tout de même « casser en deux
l’histoire du monde »), là où finalement Nietzsche s’est abîmé, a disparu
lui-même dans le projet d’une fracture absolue de l’histoire du monde, Wagner
propose un traitement affirmatif. Parsifal, c’est le retour éternel
appliqué au christianisme : si celui-ci revient, il le fait dans une
modalité affirmée esthétiquement, celle de la « rédemption au
rédempteur », comme s’il avait à revenir autre que lui-même, à partir de
lui-même.
Si l’on traite les trois exemples dans leur particularité,
on est confronté au problème de déterminer ce que tout ceci implique quant à la
musique, quant aux moyens mis en œuvre par Wagner pour ces réaffirmations.
Le Crépuscule des Dieux se termine dans la
combinaison d’une gigantesque déclaration et d’une catastrophe. Le montage est
assez compliqué à la fois à réaliser et à comprendre, car il s’agit d’une
déclaration sur fond de désastre : après la mort de Siegfried, Brünnhilde
vient annoncer la grande déclaration, à savoir que l’univers des dieux est
fini. Elle raconte aussi certains éléments de l’histoire — Wagner ne rate pas
une occasion de reraconter une histoire que tout le monde connaît, en quoi il
est, j’y reviendrai, le disciple d’Eschyle –. Raconter est essentiel, et
reraconter ne l’est pas moins : il n’a jamais assez raconté cette même
histoire… Mais en réalité, il s’agit là d’une déclaration — je reviendrai sur
cette question essentielle du personnage de Wagner comme un personnage
déclaratoire.
On a donc là une grande déclaration qui annonce le désastre
et qui confie l’avenir de ce désastre à ceux-là seuls qui subsistent, à savoir
les hommes. Dans le démêlé furieux des dieux d’en haut et des dieux d’en bas
autour de l’or, l’humanité doit apprendre à vivre si possible sans or. L’or du
Rhin est restitué au Rhin : c’est une humanité non commerciale qui doit
naître sur le fond du crépuscule des dieux. C’est la promesse et c’est le
désastre des dieux. Le tramé de ce finale est tout à fait étonnant et je pense
que c’est intéressant d’en avoir quelques indications analytiques.
Présentation
de la fin du Crépuscule des Dieux par François Nicolas
Voici « l’enveloppe » motivique de ce finale,
composée par les Grundthema :

[A. B.] Merci, vraiment… Je voudrais juste indiquer un
point : vous allez voir la représentation Boulez/Chéreau/Regnault, dont la
grande force est précisément de montrer le relayage des dieux par l’incertitude
humaine. On va voir qu’un geste fait en sorte que la question soit adressée au
public lui-même.
Écoute
de la fin du Crépuscule des Dieux
Je voudrais revenir sur la signification de ce finale du
point de vue de la construction musicale. Comme vous l’avez vu, l’humanité
contemple le désastre et surtout les termes qui lui sont étrangers : on va
voir successivement l’anneau retourner aux filles du Rhin, donc retourner à son
élément naturel, on va voir Hagen, qui est le dernier représentant des dieux
d’en bas, si je puis dire, c’est-à-dire des dieux sombres, se jeter à l’eau
pour rattraper cet anneau en vain, on va voir le Walhalla lui-même brûler et
disparaître. La totalité des termes étrangers à l’humanité est donc anéantie ou
restituée à sa naturalité première et il ne reste plus que l’humanité qui, dans
un geste absolument stupéfiant au théâtre, se redresse peu à peu, se retourne
vers le public en lui posant au fond la question : « Et
vous-mêmes ? Nous en sommes là, vous et nous ». C’est un geste d’une
force tout à fait extraordinaire, qui implique cette abnégation du chef
d’orchestre de n’avoir pas le dernier mot, puisque l’image se poursuit assez
longtemps après la péroraison musicale.
Cela ne raconte pas du tout la création d’une nouvelle
mythologie, mais bien plutôt le désastre des mythologies car y compris les
tentatives de Wotan, sur lequel on reviendra, de créer un héros libre qui
viendrait relever la mythologie, échouent complètement. La fin du Crépuscule
des Dieux est réellement le crépuscule des dieux, la mort des dieux :
la mythologie n’est plus la solution. Reste alors le regard sur le désastre,
sur la mythologie : il va falloir tout refaire à partir de ce regard.
C’est ainsi que j’interprète le fait que le seul thème
subsistant est effectivement celui qui a été appelé rédemption par l’amour
— mais franchement, on ne voit pas du tout quelle est la figure de la
rédemption en cette affaire : il y a simplement la solitude humaine, et
rien d’autre. Donc c’est en réalité le thème de l’amour, appelons-le ainsi, qui
est la seule piste, la seule injonction.
Il y a l’humanité qui subsiste et la possibilité de l’amour
qui flotte au-dessus d’elle. Je signale que ce thème n’a été utilisé dans le
reste de la Tétralogie qu’une seule fois, à l’acte III de la Walkyrie,
où il est chanté par Sieglinde comme une espèce d’annonce. Pour autant, ce
n’est pas du tout un thème inclus dans la construction des thèmes, il est en
quelque sorte surnuméraire : il a été simplement cité une fois et il
advient là comme thème de la péroraison dont on voit alors bien qu’elle n’est
pas du tout une synthèse des matériaux antérieurs. Elle flotte au-dessus et ce
thème est réellement pris, y compris orchestralement, comme flottant au-dessus
d’un matériau qui, quant à lui, atteste le désastre mythologique, à savoir le
thème du Walhalla (le château des dieux est brûlé), le thème des filles du
Rhin. La nature et l’or en partie se sont rejoints et donc on n’a plus que ce
thème. C’est pour cela que je pense qu’Adorno a tout à fait tort : en
effet, ce thème est un thème flottant, venu d’une certaine manière de nulle
part, qui atteste que cet élément de regard sans contenu déterminé est en
situation de flottaison au-dessus du désastre de tout.
J’insiste sur le fait que c’est là une conclusion qui n’en
est pas une dans cette énorme construction qu’est la Tétralogie, ce
récit implacable du caractère obsolète des mythologies, y compris la
mythologie-relais que pourrait être ce brave Siegfried sur lequel nous
reviendrons, qui n’a elle-même conduit qu’à un désastre misérable — disons les
choses comme elles sont… D’ailleurs, dans les thèmes-débris — je les appelle
débris parce qu’il sont à l’état de mort et de débris — on trouve aussi le
thème de Siegfried porteur de l’épée, traité comme le thème du Walhalla,
c’est-à-dire traité comme Hagen. Or tout cela est terminé. Les mythologies et
les héros, c’est fini. Il n’y a plus que le peuple livré à lui-même.
Cela permet d’entrer dans les Maîtres Chanteurs,
notre deuxième exemple, puisque sa péroraison est aussi une péroraison
collective car le chœur, comme dans le Crépuscule des Dieux, joue un
rôle décisif. Mais je pense qu’il s’agit de tout à fait autre chose, parce que
là, exactement à mon avis en sens contraire de ce que l’on voit dans le Crépuscule
des Dieux dont la conclusion est en somme qu’il n’y a pas de synthèse, la
conclusion se fait sur la nécessité d’une synthèse. Tout est détruit et il y a
une flottaison énigmatique au-dessus de cette destruction.
Les Maîtres Chanteurs constitue la seule comédie de
Wagner, qui a un coloris tout à fait particulier avec une péroraison
apparaissant comme la nécessité d’une synthèse, synthèse au fond entre la
rupture et la règle. Se pose le classique problème de l’art : quelle est
la situation de l’art, entre le génie créateur, la rupture formelle, etc., et
la tradition réglée ? À l’opéra, la tradition réglée est incarnée par des
maîtres chanteurs qui ont d’une certaine façon leur droite et leur
gauche : ils sont plus ou moins ouverts à la nouveauté, et d’autre part,
comme il s’agit tout de même d’une académie, ils incarnent la tradition.
La nouveauté, c’est ici Walther avec son chant libre, lié à
l’affirmation de l’existence. Ce qui est sûr, c’est que ce qui va amorcer la
conclusion, c’est cette question qu’il y a la nécessité d’une synthèse.
L’anecdote est toute simple : Walther remporte à
l’acclamation unanime du public le prix de chant — il y a toujours des concours
de chant chez Wagner, et naturellement il est tout le temps en train de se
mettre en scène et de gagner le concours, c’est la naïveté merveilleuse des
grands auteurs… Vitez disait toujours que cette gigantesque construction qu’est
le Soulier de Satin de Claudel consiste uniquement à justifier la
manière dont Claudel s’est fait avoir et dont il s’est comporté à l’égard d’une
petite hystérique polonaise sur un bateau en 1900 : il en fait tout un
foin, et si le résultat est génial, le point de départ est tout de même
celui-là… Chez Wagner, il y a de cela : il est toujours en train de se
présenter lui aussi au concours de chant… — Walther a gagné le concours de
chant, et Sachs propose qu’il devienne maître, donc que celui qui a gagné sur
la base de nouvelles institutions, de nouvelles créations artistiques, intègre
quand même l’académie de la tradition. Les maîtres lui courent après de façon
détestable, et Walther refuse.
La péroraison est une proclamation de Sachs expliquant qu’il
faut qu’il accepte d’être maître, qu’il ne méprise pas les maîtres, plaidant
par là pour une synthèse dans l’ordre esthétique entre la novation et la
tradition, entre l’installation et la rupture.
Pourquoi faut-il cette synthèse ? La péroraison est la
raison de cette dernière qui est nécessaire parce que c’est elle qui identifie
historiquement la puissance de l’art, car historiquement la puissance de l’art
doit toujours reposer sur une incorporation du passé. Elle ne peut pas être
uniquement une anarchie de la rupture des formes. Walther a un talent
extraordinaire, son chant est magnifique, mais il faut qu’il ait le courage de
déclarer lui-même que la puissance historique de l’art exige aussi autre chose
que cette capacité de pur développement.
C’est une discussion intéressante pour aujourd’hui :
l’art peut-il reposer entièrement sur la soustraction formelle, c’est-à-dire
sur la rupture, la création radicale, l’originalité irréductible ? Les
maîtres chanteurs de l’opéra sont très profonds parce qu’ils saluent
cela : Walther est effectivement le novateur, en contradiction avec les
traditionalismes. Mais l’art est aussi une historicité, il ne saurait être
seulement la rupture d’avec elle : comment peut-il incorporer cette
historicité ? Il ne peut le faire qu’en acceptant de reconnaître que la
nouveauté est nouveauté sur fond de quelque chose qui n’est pas nouveau et que
c’est cette dialectique-là qui doit être scellée par l’art, qui crée la
puissance de l’art. Si celui-ci est capable de cette puissance, s’il est
capable d’incorporer l’historicité à la novation, non pas par une synthèse
éclectique, mais par une reconnaissance immanente, alors il peut signifier un
peuple ou une nation.
C’est ici que l’on entre dans des thèmes allemands : le
saint art allemand est un art qui a réalisé cette synthèse et qui, à ce titre,
fait de l’Allemagne une puissance indépendante des péripéties
historico-politiques. Et même s’il n’y a plus d’empire, l’art allemand
demeurera comme la capacité universelle dont les Allemands se sont avérés
capables en produisant cette synthèse.
Écoute
du monologue final de Sachs dans Les Maîtres Chanteurs
On voit à la fin le maître totalement épuisé après quatre
heures de direction…
On relève toujours ce thème très important chez Wagner que
ce qu’il faut penser, c’est ce qui subsiste dans l’hypothèse de la destruction.
Ce qui flotte là encore dans le grand chœur final, qui reste en quelque manière
au-dessus de la destruction, comme on l’a vu pour le Crépuscule des Dieux,
c’est cette même idée : que meure l’empire romain et germanique !, le
saint-royaume d’art allemand, quant à lui, subsistera, et c’est pour cette
raison que Walther doit accepter de se voir décoré des insignes de maître.
Mais on distingue aussi une autre idée : celui qui
renonce au profit de la vie synthétique, c’est tout de même Sachs, qui continue
à être filmé comme celui qui renonce, qui se sacrifie en quelque sorte pour que
cette même synthèse dont nous parlions s’opère. En réalité, il est le
maître : dans ce renoncement il devient le maître. La conclusion ultime de
l’opéra est bel et bien « Vive notre nouveau maître Sachs ! »,
avec un Sachs en position quasi monarchique sur le peuple.
C’est là un point intéressant : il est le maître parce
qu’il est le maître de l’art. C’est pour cela que le titre des Maîtres
Chanteurs est vraiment polysémique : celui qui accomplit véritablement
la maîtrise dans l’ordre de l’art, c’est celui qui est apte à se sacrifier à la
synthèse de l’ancien et du nouveau. Ce n’est pas Walther qui devient le maître
— peut-être le sera-t-il bien plus tard, quand il saura se sacrifier à son tour
— mais c’est Sachs parce qu’il est l’intercesseur de la synthèse nouvelle qui
donne puissance historique à l’art et qu’il est celui qui, de l’intérieur de
l’ancien, a su reconnaître le nouveau. C’est là une doctrine de la souveraineté
intra-artistique, et ce n’est pas la doctrine de Carl Schmidt. Ce n’est pas
« est souverain celui qui décide en temps d’exception », mais c’est
une autre doctrine, allemande sans doute aussi : est le maître de l’art
celui qui sait se sacrifier à temps pour que le nouveau s’incorpore à l’ancien,
pour que la nouveauté artistique soit en position de synthèse avec l’ancien.
C’est donc lui qui devient le maître du peuple parce qu’il est le maître de
l’art.
Cette doctrine est intéressante, car elle joue sur le fait
que la maîtrise artistique n’est pas réductible au génie : c’est une
dialectique du génie et de la maîtrise dans l’ordre de l’art.
Il y a trois types dans les Maîtres Chanteurs :
— le génie, Walther, qui fait passer dans le chant
quelque chose de nouveau,
— le réactionnaire canonique, Beckmesser — c’est le
Juif, finalement, c’est-à-dire en vérité Meyerbeer ; il y a une haine de
Wagner contre Meyerbeer qui a beaucoup contribué à gauchir ses jugements —
— et enfin le maître, qui occupe une position
singulière qui n’est pas de coïncidence avec le génie mais d’acceptation, de
reconnaissance de celui-ci et d’incorporation de ce génie à la puissance
synthétique de l’art.
Souvent, on résume la chose en disant que tout cela n’est
qu’un chant à la gloire de l’Allemagne, mais c’est infiniment plus compliqué,
bien que le signifiant Allemagne demeure tout à fait présent et central
— au passage, il est très mauvais que dans cette vidéo le sous-titre déclare
son absentement, c’est une pudeur ridicule qui voudrait faire passer Wagner
pour autre chose qu’un Allemand.
Cette question du renoncement va nous faire pivoter vers le
troisième exemple, celui de Parsifal, où la question est aussi celle
d’une passation des pouvoirs ou de l’advenue d’un nouveau type de maîtrise.
Je situe la péroraison de Parsifal et le moment où
nous allons la prendre : au point de départ, l’ancien christianisme est
moribond, sous la forme du vieux Titurel qui est, lui, carrément mort, et de
son fils Amfortas qui ne vaut guère mieux.
Amfortas a une blessure mortelle suppurante et répugnante,
due au fait qu’il n’a pas su résister aux tentations. Laissons de côté ces
affaires sexuelles, très importantes chez Wagner, mais pas forcément décisives.
Pourquoi l’ancien christianisme est-il moribond ? Parce
qu’il s’est ordonné à une survivance. Car en réalité, le mot d’ordre de ce
vieux christianisme est « nous devons survivre et nous devons faire
survivre le christianisme » dans un enfermement grandissant, avec un côté
défensif et négatif grandissant. Cela peut nous dire aussi bien des
choses : le christianisme n’a plus comme destin que de survivre autant
qu’il est possible. Or, lorsqu’on est dans la survivance, on est sans défense
contre la pulsion désirante. On est ravagé par son réel et on est sans défense
contre cette jouissance qui est symbolisée, ici, par l’obscénité absolue de la
blessure d’Amfortas que Syberberg filme avec pertinence comme un vagin dans une
obscénité effrayante : lorsqu’on est dans la survivance, on est sans
défense contre l’obscène — on peut par exemple se demander si l’église
d’aujourd’hui est obscène : il y a eu quelque chose de ce genre récemment…
Parsifal, qui met fin à ce christianisme moribond, va alors
devoir proposer une visée nouvelle, que j’ai appelée la réaffirmation du
christianisme ou la rédemption du rédempteur et qui doit proposer autre chose
qu’une survivance ou qu’une maintenance et, par conséquent, autre chose qu’un
souci de soi-même.
En effet, toute survivance est un souci de soi-même, ce qui
explique que cela ne nous mette pas à l’abri de l’obscénité de la jouissance.
Titurel, le vieux patriarche de cette affaire, demande constamment qu’on montre
le Graal uniquement pour continuer à survivre, sous peine d’expirer sur le champ…
Guère brillant, le voilà dans un tombeau, à exhorter son fils à faire la
cérémonie. Si la présentation des saintes espèces ne sert qu’à ce que Titurel
continue à vivre un bout de temps, on comprend bien que réduit à cela, le
christianisme est terriblement moribond. Quand à Amfortas, au contraire, il
voudrait mourir : il ne veut donc pas faire la cérémonie.
On a finalement une symétrie tout à fait intéressante :
l’un veut survivre à tout prix et pour cela il faut que la cérémonie ait lieu,
tandis que l’autre ne veut pas la célébrer parce qu’il voudrait, quant à lui,
mourir. Tout cela relève de l’intérêt de soi. Donc nécessairement la relève
affirmative sera celle d’une abnégation : le couple pitié/abnégation ou
pitié/désintéressement que va incarner Parsifal, c’est-à-dire du souci absolu
de l’autre et du désintéressement de soi va être proposé non pas, à mon sens,
comme une espèce de formule éthique passe-partout, en tout à cas à l’époque,
mais parce que si le christianisme n’est plus que survivance, c’est cela qui
peut lui être proposé en relève pour assurer la rédemption du christianisme
lui-même.
Musicalement ces couples pitié/abnégation et
christianisme/survivance sont présentés d’un côté par le couple du motif
d’Amfortas et de sa blessure, et de l’autre par le thème de Parsifal qui est
quasiment réservé, à peine ponctué aux cuivres, un peu insaisissable, alors
qu’il est le héros en principe central. Ce couplage du thème lyrique et
terrible de la souffrance d’Amfortas et le thème très réservé de Parsifal représente
véritablement le couple du christianisme moribond à la fois luxurieux, obscène
et mortifère, et de son hypothèse de relève ou de rédemption.
Musicalement, je dirais que l’ensemble de cette péroraison
qui va traiter la substitution au christianisme moribond, narcissique et
mortifère d’un christianisme réaffirmé autour d’une abnégation innocente
centrale, va tenter de représenter ce que j’appellerais l’évaporation de la
souveraineté en douceur, c’est-à-dire la transmutation de la souveraineté en douceur.
C’est là l’enjeu véritablement musical, à mon avis, de cette péroraison. La
question de savoir si elle y réussit est en partie une question d’analyse et de
goût. Boulez est un peu réticent sur le côté sucré de cette fin de Parsifal
et on peut s’accorder avec lui, mais il ne faut pas perdre de vue l’enjeu qui
est le suivant : si ce que je suis en train de dire là est réellement la
signification de cette fin, où Parsifal arrive avec la lance, guérit Amfortas
et lui succède, en réalité cette guérison est une mort, comme l’indique la mise
en scène. Le nouveau christianisme ne doit plus être dans cette souveraineté
consommatrice et survivante qu’Amfortas et Titurel symbolisaient mais doit au
contraire être dans cette abnégation douce et innocente qui est la rédemption
du rédempteur. La musique doit donc transformer la puissance en douceur, et je
pense que c’est cette métamorphose qu’elle tente une fois de plus dans la
péroraison de Parsifal.
Je donne simplement quelques indications sur la mise en
scène de Syberberg.
D’abord, ce n’est pas une représentation mais un film
absolument extraordinaire avec ainsi tous les moyens du cinéma, et je vous le
conseille comme approche de Parsifal.
Le décor général est en réalité une gigantesque maquette du
masque mortuaire de Wagner et Parsifal se joue dans la tête de ce
dernier comme un drame crânien, si je puis dire. Il y a une surcharge baroque
délibérée pour montrer à quel point cet univers est crépusculaire et, en effet,
livré à une obscénité.
Quant à l’interprète de Parsifal, il est dédoublé,
c’est-à-dire que c’est à la fois un jeune homme et une jeune fille, comme si
seule soit l’addition des sexes soit l’indifférenciation ou l’hésitation des
sexes pouvait représenter la relève de la luxure mortifère et de l’obscène jouissance
dans lesquelles s’est anéanti le christianisme ancien.
Il y a une scène magnifique, au deuxième acte, que nous ne
verrons pas aujourd’hui, où Parsifal doit faire la preuve de son abnégation en
résistant à une tentation — il n’y a pas d’autre moyen dramaturgique de montrer
qu’on est réellement dans l’abnégation que de résister à la tentation — et
cette tentation prend la forme d’une séductrice, Kundry, qui a déjà séduit
Amfortas comme tout le monde depuis longtemps, et qui va le manipuler au plus intime
en faisant surgir d’une façon quasi incestueuse le personnage de la mère de
Parsifal. Elle va lui annoncer la mort de sa mère, et être en partie comme le
fantôme sensuel de cette mère : on a alors une scène œdipienne absolue qui
est la séduction de ce fils innocent par une espèce de mère décalée, à la fois
morte et vivante, une sorte de vampire sensuel. Parsifal va aller assez loin,
puisqu’il s’abandonne au baiser de Kundry ; puis au milieu du baiser, il
va sentir la blessure d’Amfortas. Alors il interrompt cette affaire puis il va
fuir et errer de nouveau interminablement, comme tous les héros de Wagner,
avant de retrouver le chemin perdu de la cité chrétienne où Amfortas est en
train de mourir.
Ce qui est fascinant dans la mise en scène de Syberberg, c’est
que c’est au moment même du baiser, c’est-à-dire au moment à la fois où le
baiser a lieu et où il est interrompu, qu’il y a ce dédoublement de Parsifal
comme adolescent remplacé par une adolescente, comme si, d’une certaine façon,
on avait là l’annonce d’une sexuation nouvelle : le renouvellement du
christianisme est aussi une sexuation sur laquelle il n’est dit que cette chose
stupéfiante et absolument convaincante, tout à fait extraordinaire, à savoir la
substitution d’une jeune fille au jeune homme dans l’épreuve de la sensualité
elle-même.
Dans le dénouement, les deux ne vont plus faire qu’un :
dans un premier temps, il s’agit d’une substitution puis, à la fin, d’une
addition, car on a réellement le couplage d’un adolescent et d’une adolescente.
Prenons la séquence au moment de l’arrivée de Parsifal et de
sa déclaration du fait qu’il prend le pouvoir des métamorphoses finales et de
l’énoncé « rédemption au rédempteur ».
Écoute
de la péroraison de Parsifal
Juste deux remarques à présent : Syberberg a jugé
nécessaire de terminer lui aussi par un regard énigmatique, comme si d’une
certaine façon toutes ces conclusions, qui sont des conclusions sur un avenir
indistinct, qu’il s’agisse de l’avenir de l’humanité ou de celui du
christianisme, avaient été poussées à être traitées visuellement par un regard
interrogatif ou un regard adressé comme une question au public.
Le chœur final est la rédemption du rédempteur, après que
l’on ait vu la prise du pouvoir par Parsifal comme nouveau couple, sorte de
nouvel Adam et Ève dans l’interprétation de Syberberg, de recommencement de
l’humanité dans une innocence renouvelée. C’est la possibilité pour le
christianisme d’être allégorie de l’innocence vitale et non pas de la
perpétuation d’une souveraineté malade : c’est la substitution d’une
souveraineté malade par la possibilité affirmative d’une innocence vitale.
On a vu aussi le crâne du Pape pour indiquer que c’est en
effet vraiment fini, vraiment mort. Il y a un thème qui est cher à Jean-Luc
Nancy : celui de la déconstruction du christianisme qui est selon lui
l’une de nos tâches essentielles, non encore abouties. Quant à moi, je vois
volontiers Parsifal comme une tentative de déconstruction du
christianisme. Qu’elle soit réussie ou avortée, c’est une autre affaire, mais
il s’agit réellement d’une tentative de déconstruction, si l’on entend par déconstruction
quelque chose qui réaffirme autrement ce qui a eu lieu, et non pas simplement
une critique du christianisme, la réaffirmation étant bien plus radicale que la
simple critique.
La question est de savoir si le christianisme n’est pas plus
résistant que cela. Dans la préface qu’il a donnée à Parsifal, Marcel
Beaufils, en qualité de traducteur, soutient qu’en fin de compte, Wagner s’est
imaginé à tort qu’on pouvait traiter le christianisme comme on traite les dieux
païens, mais que la démonstration était faite par Parsifal qu’au fond
c’était lui qui s’était fait avoir par le christianisme non et pas l’inverse.
En somme, sa rédemption au rédempteur ne fonctionnerait pas parce que le moment
n’était pas encore venu d’une pure et simple mythologisation du christianisme
et que la déconstruction du christianisme ne se laissait pas encore engager
car, à titre même de matériau mythologique, le christianisme était encore trop souverainement
présent dans la composition générale de notre monde mental pour que l’on puisse
le manipuler de cette manière. Or je crois que l’intention de Wagner était
vraiment de faire sur le christianisme la même opération que sur les dieux de
la mythologie germanique, et de montrer que l’on pouvait aller au-delà du
christianisme par une réaffirmation singulière de sa disponibilité.
Peut-être n’était-ce pas si évident, peut-être n’aurait-il
pas fallu appeler cela un drame sacré puisqu’évidement, on est en présence du
sacré au-delà du sacré, peut-être était-ce une imprudence : voilà les
débats que l’on peut avoir sur ce point.
4
— Musique et théâtralisation
Nous en venons à présent au quatrième point, concernant la
question de la construction analytique et de la soumission au texte,
c’est-à-dire le fait que derrière la continuité musicale apparente, il y aurait
une espèce de chimie wagnérienne qui, en fin de compte, accorderait le primat à
la narration, et subordonnerait les finalités musicales à ce primat.
Un argument assez curieux et assez frappant va dans ce
sens : Wagner écrivait le texte d’abord et en général il n’en changeait
pas une ligne. La musique devait suivre. C’est là un fait incontestable :
s’il y avait une bonne partie de texte, il fallait faire une tartine musicale,
comme si, d’une certaine façon, Wagner s’était donné l’impératif du texte que
la musique devait suivre.
Mais un autre élément tout à fait différent et à mon avis
capital contrebalance cette idée : il y a chez Wagner la conviction d’une
essence déclaratoire du sujet scénique et c’est cette essence déclaratoire qui
crée la procédure de son agrandissement. C’est parce que le sujet s’explique
indéfiniment sur les tenants et les aboutissants de sa situation, de ce qu’il
va faire, de ce qu’il va décider, des obstacles qu’il rencontre, etc., qu’il se
trouve agrandi, c’est-à-dire porté à la dimension de la scène. Sur ce point, je
considère que Wagner est un disciple authentique d’Eschyle, car finalement
Agamemnon ou Clytemnestre ne procèdent pas autrement.
On sait que c’est une hantise de tous les Allemands du XIX°
que de se mesurer à la tragédie grecque, Nietzsche le premier, mais ma thèse
est que Wagner a relativement réussi en ce qu’il est un disciple effectif
d’Eschyle, contemporain, puisqu’il parvient à un agrandissement spectaculaire
de la physionomie subjective par des procédures qui sont au final des
procédures de la déclaration. L’action chez Wagner est sporadique et la plupart
du temps très brève : entre des déclarations infinies, trois personnes
sont tuées en deux minutes, et la péripétie est terminée. Plus généralement, il
faut bien dire que les séquences d’action ne sont jamais musicalement les plus
géniales. Il a toujours été problématique à l’opéra de mettre en musique les
duels. Il y en a beaucoup pourtant, les gens s’embrochent en grande quantité,
chez Wagner aussi naturellement, mais la tâche est difficile et Wagner a
peut-être eu raison de l’expédier le plus vite possible. En effet, ce n’est pas
cela qui est intéressant, mais c’est plutôt la déclaration, c’est-à-dire ce qui
crée la possibilité subjective : c’est la possibilité de la nouvelle
subjectivité dont les péripéties ne sont que la conséquence ou l’ornement.
C’est ce qui est déclaré à propos de l’action qui est essentiel, et non pas
l’action elle-même. C’est le subjectif de l’action qui est décisif, et non pas
la péripétie. C’est là un point très important.
Cette essence déclaratoire du sujet est toujours une
proposition sur le sens générique de l’existence, c’est-à-dire c’est une vaste
proposition déclaratoire sur « qui suis-je dans la situation générale du
monde, dans le sens qu’elle peut avoir pour moi et pour tout le
monde ? » ; ce n’est jamais une simple expression de soi et
encore moins une expression combinatoire, comme je le disais à propos des
ensembles de l’opéra. C’est véritablement une proposition ou une hypothèse dont
un personnage est porteur sur la signification générale de la situation et sur
le projet qui est le sien dans cette situation, sur ses chances et ses échecs
possibles.
C’est la raison pour laquelle, tout comme chez Eschyle à mon
avis, il y a une propension à toujours reraconter la fable, dont on s’est
beaucoup moqué. Wagner ne se lasse pas de reraconter ce qui s’est passé avant,
il le fait sans cesse sous des tas de formes : un personnage pose des
questions auxquelles l’autre répond en reracontant ce qui s’est passé… Mais je
soutiens que ce n’est pas du tout une facilité : d’ailleurs, où serait la
facilité ? Wagner savait très bien que ces récits répétés de la fable
étaient un peu encombrants, mais raconter la fable fait partie de la
déclaration : on n’a de position subjective explicitable qu’en traversée
du récit de la fable, et chacun de ces récits est un récit singulier qui
éclaire à nouveau cette fable d’un point de vue subjectif renouvelé. Ce n’est
donc pas une vraie répétition. Bien sûr, on entend quelque chose que l’on
connaît déjà, on nous raconte une fois de plus qu’il y avait les Nibelungen et
les dieux, qu’ils se disputaient pour l’or, que les géants sont venus etc.
Certes, mais le point n’est pas là : cette réitération de la fable à
l’intérieur de la fable est constitutive de l’essence déclaratoire du sujet car
un sujet ne déclare pas sur lui-même ou sur sa ressource intime, mais sur la
fable et sur le rôle qu’il entend y jouer. Il la raconte donc de nouveau de ce
point de vue, et ce sont là à mon sens des passages non pas faibles mais forts,
qu’à mon avis il faut entendre musicalement et dramatiquement comme tels.
Dès ce moment-là, la musique va être, comme nous l’avons
déjà dit, la musique de la métamorphose, où l’on voit comment, à travers le
récit de la fable, un sujet métamorphose sa position ou déclare et transforme
sa position. On peut dire que la musique est ce qui change la fable du monde en
l’impasse du sujet. Particulièrement dans ce que nous allons voir, la musique a
très souvent pour fonction de changer la fable du monde en l’impasse du sujet.
Il va donc y avoir une narration de la fable du monde qui va être musicalement
organisée de telle sorte, dans sa temporalité propre, qu’elle va se
métamorphoser elle-même en impasse du sujet. Ce n’est pas un récit
supplémentaire, c’est tout à fait autre chose.
On a déjà vu cela en partie dans le monologue de Sachs, et
on en a un exemple type dans celui que nous allons écouter maintenant, à savoir
le monologue de Wotan au deuxième acte de la Walkyrie.
Un mot de situation, d’abord : c’est un point
absolument nodal dans l’ensemble de la Tétralogie, parce que c’est le
moment où Wotan prend conscience qu’il va échouer, que finalement son seul
désir véritable est le désir de la fin. Cela prend la forme d’un récit qu’il va
faire de tout ce qui s’est passé à sa fille Brünnhilde. L’un des vrais sujets
de la Walkyrie est l’amour père-fille, et cela se conclut d’ailleurs par
une scène déchirante d’adieux du père à la fille, où il fait à cette dernière
le récit de toute l’histoire depuis le début.
C’est d’ailleurs assez étrange ; on a beaucoup de
raisons de supposer que sa fille la connaît, elle aussi, cette histoire ;
elle est en quelque manière notre représentante auprès du récit de Wotan. Tout
le monde connaît l’histoire, mais il ne faut pas en rester là.
Il va dire en substance deux choses sur cet échec : la
première, c’est qu’en réalité, il n’est pas libre, étant lié par les pactes. Il
est l’homme de la loi, et en tant que tel il ne peut pas faire ce qu’il veut.
En particulier, il ne peut pas suivre réellement et jusqu’au bout son désir.
Pensons à la scène précédente, lorsque son épouse Fricka vient lui dire qu’il
est l’homme de la loi, que par suite il ne peut pas bafouer ainsi les pactes
conjugaux, ni faire des histoires avec des fils incestueux. La fonction de
l’épouse est de lui rappeler qu’il n’est pas libre. Alors on s’avise d’un point
très important dans toute la Tétralogie : la critique de la loi. La
loi, en ce sens-là, c’est-à-dire le pacte ou le contrat, c’est l’univers de
l’asservissement, dans lequel le désir n’a pas de puissance créatrice
véritable.
Il exprime cela, et il déclare que sa machination pour
contourner ce point, consistant à créer un héros absolument libre, délié de la
loi, qui, quant à lui, pourra traiter le problème et conquérir l’anneau en son
nom mais détaché de lui, ne fonctionne pas parce que la loi le lui interdit.
Elle lui interdit de pratiquer cette ruse grossière de créer de la liberté pour
se débarrasser de la loi. Créer un héros absolument libre qui fasse le boulot
que lui ne peut pas faire à cause de la loi, c’est là une ruse grossière que
Fricka a tout de suite flairée : elle est d’ailleurs venue, escortée de
béliers, lui faire une scène épouvantable, en somme la scène conjugale la plus
longue de l’opéra, suite à quoi, voyant qu’il avait été démasqué, il lui avoue
les faits.
Ce thème de l’impossibilité du dieu à créer un héros libre
sans que la création de ce héros libre contredise ou vienne nier sa propre
divinité a beaucoup d’avenir : c’est par exemple le thème des Mouches
de Sartre, où l’homme libre finit par dire à Zeus qui se plaint qu’il n’avait
qu’à ne pas le créer libre. Là, cela se passe de manière analogue, puisque le
héros libre va lui casser sa lance : le père Wotan n’aura plus qu’à aller
attendre mélancoliquement dans son Walhalla la catastrophe finale, comme nous
l’avons vu tout à l’heure.
Tels vont être les deux thèmes philosophiques de
Wotan : dans l’univers de la loi, le désir est inassumable quant à la
variation de son objet, et la création de la liberté n’est pas une véritable
possibilité. Il n’y a donc plus qu’à attendre la fin, l’échec, et c’est cette
parabole de la fin, ce devenir de l’instance de la fin, qui est racontée dans
ce que nous allons voir maintenant.
Je signale que de nouveau, il s’agit de la mise en scène de
Chéreau : le cadre général de la scène est l’existence d’un gigantesque
pendule, une sorte de pendule de Foucault qui symbolise en fait le devenir du
temps. Il y a un grand miroir qui symbolise le narcissisme subjectif dans
lequel Wotan est aussi compromis. Est ainsi donné à voir l’écart entre la loi
objective donnée par la circulation du temps et la réflexion narcissique dans
le miroir. La scène se dispose entre les deux, et à l’extrême fin, au moment où
l’on est véritablement dans l’assomption du temps, Wotan va arrêter le temps.
Écoute
du grand monologue de Wotan au second acte (scène 2) de la Walkyrie
On voit bien comment cela se construit : c’est presque
au départ une confidence à soi-même avec l’idée tout à fait géniale de Chéreau
de la représenter comme une discussion avec l’image dans le miroir, puis la montée
vers le thème de la déréliction de la fin est, à y regarder de près, comme une
poussée orchestrale extrêmement lente et calibrée, tout à fait extraordinaire,
qui va jusqu’au paroxysme par des étapes successives très difficiles à repérer
mais qui constituent vraiment un art musical tout à fait étonnant. Cela nous
raconte une histoire très importante pour Wagner, à savoir les moments où il y
a égalité de la puissance et de l’impuissance, c’est-à-dire où ces dernières
sont réciproquables.
La phrase est explicitement présente : « J’étais
le maître par les pactes, maintenant je suis l’esclave par les mêmes
pactes. » Wagner est très intéressé par ces points dont on pourrait donner
d’autres exemples et qui sont toujours pour lui des points de stimulation artistique
où il est avéré que, au même point, la puissance est la même chose que
l’impuissance. C’est là-dessus que nous pouvons esquisser une transition vers
la question de l’attente.
5
— Musique et attente vaine
Il y a un grief adressé par Adorno à Wagner : à ses
yeux, l’attente est, chez Wagner, une attente truquée parce qu’elle est
entièrement commandée par sa résolution, c’est-à-dire par la satisfaction de
l’attente. Adorno prend comme exemple un passage du Wozzeck de Berg où
il y a un crescendo très célèbre qui incarne absolument l’attente vaine. Il
oppose aussi sur ce point Wagner à Beckett, ce denier étant, je l’ai déjà dit,
le modèle par excellence, parce qu’il est celui qui est en état de représenter
au-delà de la forme l’attente qui est vaine en tant que telle, c’est-à-dire
l’attente comme pure attente, qui ne sera pas satisfaite par un terme, et il
impute à Wagner de ne pas être en état, à cause de sa téléologie et de son
hégélianisme dialectique latent, de traiter l’attente de cette manière.
On peut objecter que certainement la plus gigantesque
attente de toute l’histoire de l’art est celle de Tristan au troisième acte de Tristan
et Isolde. On pourra objecter que le gigantisme n’est pas toujours une
preuve, mais c’est tout de même incontestablement le matériau de l’attente le
plus extravagant, car là aussi, les choses vont être assez vite expédiées à la
fin : Isolde va arriver, Tristan va aussitôt mourir, le roi Marc va
arriver, puis Isolde va mourir d’amour et cela va finir. Mais les trois quarts
de l’acte ne sont pas autre chose que l’attente : c’est Tristan blessé,
attendant l’arrivée d’Isolde.
L’objection, c’est qu’Isolde arrive. Vous allez en juger,
mais je soutiens que le fait qu’Isolde arrive n’organise d’aucune façon le
régime musical, opératique et dramatique de l’attente, laquelle est réellement
une présentation de l’attente comme telle. J’argumenterai sur ce point un peu
comme je l’ai fait pour la souffrance : ce n’est pas parce que l’on a, à
un moment donné, une guérison ou une rédemption que l’actualité de la chose
dans sa présentation artistique est démentie, d’autant que si Isolde arrive,
elle arrive en quelque manière hors attente parce que la seule chose que
Tristan puisse alors faire, c’est mourir. La seule chose qu’il dit c’est :
« Isolde », et il meurt aussitôt. C’est un peu comme dans une
supplémentation à l’attente, mais ça n’en n’est pas la relève, ce n’est
absolument pas le commencement d’autre chose, mais c’est simplement le fait que
hors attente, et comme en excès sur elle, il y a effectivement cette figure
ultime de la mort dans les bras d’Isolde. Mais l’attente comme telle est une
structuration qui est présentée pour sa valeur propre.
Il serait intéressant, du point de vue analytique, de
montrer comment cette attente est construite tout au long de l’acte : si
on avait le temps, on ferait de la macro-structure, mais il nous faudrait
beaucoup du temps…
En réalité, il y a trois séquences successives, trois
renaissances qui sont toutes terminées par l’évanouissement de Tristan, qui
ensuite recommencent cette attente et la vacuité de celle-ci est montrée par le
fait que l’exaltation qui l’anime est à chaque fois présentée comme absolument
vaine.
On va regarder tout de suite le fragment de l’acte III de Tristan
représentant l’une de ces séquences, celle de la deuxième naissance de Tristan
à sa propre attente, si je puis dire.
Cette fois, la vidéo, contrairement au DVD, ne nous offre
aucun sous-titre, mais nous avons quand même tiré le texte. C’est une mise en
scène faite à Bayreuth par le grand écrivain dramatique allemand Heiner Müller.
Celui-ci avait lu Adorno et savait qu’il opposait l’attente selon Wagner à
l’attente selon Beckett, alors que l’attente pour l’interprète c’était
l’attente vaine de Beckett ; du coup, il a mis en scène ce troisième acte
de Tristan exactement comme du Beckett.
C’est un décor de fin du monde, de poussière, les
personnages sont cendreux comme chez Beckett et même le berger, qui joue une
flûte nostalgique très triste, est absolument un personnage de Beckett :
il est aveugle, il porte des lunettes noires, il reste assis… Une des ironies
de Heiner Müller était de montrer que, mis en scène comme du Beckett, cela
tenait tout à fait le coup et qu’en réalité il y avait une appropriation
beckettienne possible de cette attente de Tristan.
Au passage, le ténor qui chante Tristan et que l’on va voir
a un nom absolument stupéfiant pour un chanteur wagnérien : il s’appelle
Siegfried Jérusalem…
Écoute
du second monologue de Tristan du début de l’acte III
Je ne pense pas que l’on puisse dire que de l’intérieur,
cette affaire est travaillée par une rédemption sous-jacente : c’est la
déréliction de l’attente, et chacune des séquences ne se laisse solder que par
la disparition ou l’évanouissement du sujet. Il n’y a pas d’autre péroraison
possible, parce que précisément ce qui se construit à l’intérieur est
simplement l’amplification, l’exagération de son caractère insupportable.
Je dois dire qu’il a dû falloir beaucoup d’attention et de
talent à Heiner Müller pour arriver à tirer cela d’un ténor d’opéra : il y
a une énergie dramatique, un déchirement assez exceptionnel que l’on peut
attendre au théâtre, mais c’est un grand travail que de l’obtenir à l’opéra.
6
— Musique et transition
On en vient pour finir, si tant est qu’on le puisse, à la
question qui à certains égards est la plus importante, c’est-à-dire l’essence
de la construction musicale wagnérienne mesurée à la capacité de créer un
temps, à partir du moment où Wagner déclare qu’il se soustrait à l’air formel
mais où aussi l’on admet qu’il se soustrait à la simple obéissance au flot
continu saturé, qu’il s’est aligné au flux du vécu comme tel. L’idée est de
savoir quelle est la capacité temporelle wagnérienne.
L’objection qui est faite, c’est que faute de ce qu’Adorno
rêvait comme une forme qui ne soit rien d’autre que la déformation, il imputait
à Wagner de ne vouloir pas constituer la possibilité d’un nouveau temps.
Je proposerai de dire qu’il existe chez Wagner non seulement
une création temporelle originale, mais la création de trois types de temps qui
lui sont propres, qui sont réellement des créations de sa part et qui sont
paradigmatiques chez lui.
— J’appellerai le premier, le temps du disparate des
mondes, c’est-à-dire le temps du passage d’un monde à un autre, qui se crée par
espacement des mondes, on pourrait dire le temps du transit ou temps de
l’errance, si importante chez Wagner.
— Un deuxième temps, dérivé mais tout à fait différent,
serait le temps de l’intervalle incertain : là, il s’agit plutôt de la
décision, de l’épisode, de la subjectivité, du temps intervallaire où en
réalité la création n’est pas encore dessinée, et où par conséquent quelque
chose tourne sur lui-même dans sa propre incertitude.
— Enfin, je distinguerai le temps du paradoxe tragique.
Je pense que ces trois temps, ainsi que leur enchevêtrement,
sont des propositions wagnériennes exemplaires qui n’ont rien à voir avec les
imputations concernant la durée. Il est absolument vrai que, eu égard au fait
qu’il crée ce type de temps-là, long ou court, cela a toujours lieu toujours
dans cette institution temporelle : je ne crois donc pas que l’on puisse
recevoir l’objection selon laquelle, puisque Wagner est long et qu’il l’est
intrinsèquement, il n’y aurait pas réellement de proposition non artificielle
concernant le temps.
Disons juste un mot sur ces trois temps :
— Le temps du disparate des mondes est le temps du
passage, je vais y revenir.
— Le temps de l’intervalle incertain, c’est le moment
où Wagner admet que la musique elle-même puisse créer un temps qui est d’une
certaine façon clairement délimité à l’intérieur des incertitudes de la
péripétie et du possible.
— Enfin, le temps du paradoxe tragique, j’y reviendrai,
est le temps où l’apparence de la fable est contredite par un temps plus vaste
qui la sature, c’est-à-dire où l’épisode de la fable convoque un temps plus
vaste qui, intervenant à l’intérieur de la fable, la sature.
On va tenter de donner un exemple de chacun d’entre eux.
Le
temps du passage entre les mondes
Le premier temps, celui du passage des mondes, fait de la
musique le support du passage d’un site à un autre, d’un monde à un autre, et
c’est une construction musicale.
Wagner procède généralement ainsi : il fait venir, à
l’intérieur d’une construction thématique très affirmative et très dominée, une
autre construction apparemment en dérivation éloignée de la première mais il la
fait venir de l’intérieur de la première. Il y a quelque chose comme une
carrure qui est installée et, de l’intérieur de celle-ci, s’instaure quelque
chose qui crée un sentiment d’éloignement par rapport à cette carrure bien que
l’on ait toujours une espèce d’indécidabilité entre la carrure et ce qui est en
dérive, ou ce qui la travaille ou la déplie de l’intérieur. Cela crée
véritablement un temps qui est un temps de passage.
La figure exemplaire de cela, c’est l’interlude du premier
acte de Parsifal : on y trouve un passage au sens strict lorsque
Parsifal marche d’une marche qui en prépare une autre puisqu’ensuite, viendra
celle des chevaliers. On va de l’extérieur vers l’intérieur, du récit à la
célébration, de la vie possible à la mort imminente, et l’on a réellement toute
une série de passages d’un monde symbolique à un autre : on passe d’un
thème articulé qui inaugure cette marche à, pour finir, une sorte de saint
appel de cloches, qui en fait prépare une autre marche, celle de l’entrée des
chevaliers. Si vous écoutez ce passage, vous aurez le sentiment puissant d’une
création temporelle qui est immédiatement donnée dans la figure sonore.
On va de nouveau voir le film de Syberberg ; tout y est
très ornemental, et Syberberg interprète en partie cette temporalité comme un
voyage lent à travers l’Allemagne, qui va être symbolisée par une collection de
drapeaux provinciaux et nationaux. On verra d’ailleurs le drapeau nazi non pas
à la fin mais au début, comme un envoi, parce que c’est en réalité une marche
crépusculaire, telle que ce christianisme moribond est aussi pris par Syberberg
comme le sentiment d’une Allemagne malade, décomposée. Gurnemanz, qui est le
chevalier, l’honnête homme si je puis dire et l’initiateur de Parsifal, emmène
ce dernier à la cérémonie, et cette marche se fait dans une espèce de couloir
qui est au fond le couloir de l’Allemagne allant vers son crépuscule.
Présentation
de la « scène de la transformation » dans Parsifal par
François Nicolas
Leitmotiv de la « plainte » ou de la
« douleur » :
sous sa forme
canonique :

dans la
scène –première apparition – (ce leitmotiv est composé de cinq voix
entrelacées) :

Écoute
de la scène de la transformation dans l’acte I de Parsifal
Vous avez entendu cette temporalité musicalement constituée,
dont d’ailleurs la basse opératoire est effectivement une marche symbolique de
la transition d’un monde à un autre.
Le sujet de ce passage est Parsifal, puisqu’à la fois dans
la musique et dans les personnages, ce n’est pas vraiment pour lui que c’est
une temporalité, parce que c’est lui-même qui supporte la métamorphose, c’est
lui qui découvre ce couloir allemand entre un extérieur naturel et une
intériorité malade.
Le
temps de l’intervalle incertain
J’ai appelé le second temps un temps intervallaire ou
incertain : c’est au fond le temps des possibles non encore advenus, c’est
le temps où la création du possible est suspendue, où elle est à l’ordre du
jour sans être effectuée. Une situation d’ailleurs sur cette temporalité est
intéressante puisqu’elle est peut-être proche de la nôtre aujourd’hui :
c’est une temporalité où quelque chose a eu lieu qui n’est plus praticable et
où ce qui doit venir n’a pas encore lieu.
Une telle situation est absolument décrite dans la pièce de
Ibsen Empereur et Galiléen : l’empereur Julien, le personnage
central, est celui qui a voulu restaurer le paganisme dans l’empire chrétien.
La position de Julien est précisément celle de celui qui formule le fait que
l’ancienne beauté est morte tandis que la nouvelle vérité n’est pas encore
née : on est suspendu entre le monde ou l’énigme de la beauté et le monde
chrétien de la vérité. Il pense que l’un est aboli et que l’autre n’est pas
encore arrivé. C’est une situation temporelle que l’on pourrait peut-être
comparer à cette articulation du XX° et du XXI° siècle dans laquelle nous
sommes.
On trouve cette procédure musicale dans ces nombreux
passages assez ramassés de Wagner qui sont des créations temporelles
intervallaires. Le moyen musical en est une sorte d’incertitude thématique
combinée à une dispersion, à une légèreté dispersée instrumentale, c’est-à-dire
qu’on ne sait pas exactement quel est ou quel va être le thème dominant, et au
lieu que l’instrumentation converge vers une affirmation organique, elle est un
peu errante. Ce sont là des passages de Wagner que je trouve personnellement
très intéressants et très novateurs : n’exagérons pas les analogies, mais
ils ont quelquefois un petit côté Debussy. Ce sont des moments debussystes de
Wagner qui sont justement dans des intervalles, qui ne s’établissent pas.
Je peux en donner un exemple qui n’en est qu’une
approximation mais qui comporte cet élément-là : c’est le prélude de l’acte
III de Tannhäuser. À l’acte II, Tannhäuser est parti voir le Pape, et à
l’acte III, on l’a vu revenir dévasté. Entre les deux, on ne sait pas très bien
ce qui se passe, car l’opéra n’a pas de nouvelles de Tannhäuser qui n’est pas
revenu. Élisabeth est en prière constante, elle ne sait pas si finalement
Tannhäuser a été réconcilié ou non. On est donc dans une temporalité
intervallaire quant au destin de Tannhäuser lui-même, suspendu entre son départ
et son retour. C’est ce que nous décrit le prélude de l’acte III, et c’est pour
cette raison qu’il est ambigu, lorsque se prépare un grand monologue, à savoir
la grande prière d’Élisabeth. C’est aussi purement orchestral.
Écoute
de l’ouverture de l’acte III de Tannhäuser
On a là un temps compris par une espèce d’enchevêtrement
motivique tout à fait particulier dont la rythmique n’est ni ascensionnelle, ni
quoi que ce soit de ce genre, qui est comme une temporalité installée sur
elle-même parce que l’on est dans une autre figure de l’attente : on est
réellement dans la figure de l’incertitude de ce qui est advenu.
Le
temps du paradoxe logique
Le troisième temps, celui du paradoxe tragique, est un temps
qui au fond écarte l’apparence du déroulement des faits, c’est-à-dire qui fait
comme un écart dans cette apparence pour découvrir, en-dessous, une durée plus
vaste qui contrarie cette apparence.
Le tragique, vous le savez, c’est cette contrariété
elle-même : le tragique, c’est toujours la contrariété entre une apparence
et quelque chose de plus vaste qu’elle qui se découvre dans l’intervalle de
cette apparence et qui a longtemps effectué le destin. Le découvrement de cette
temporalité souterraine plus vaste qui est en emprise sur l’apparence, c’est le
temps du paradoxe tragique.
Quand Wagner veut créer ce type de temporalité, il opère en
affrontant le discours ou le thème explicite, quelquefois même la mélodie, à
des sortes de nappes musicales profondes, généralement orchestrées dans le
registre de la puissance sourde. Telle est la nature propre des inventions
orchestrales et rythmiques de Wagner, à savoir la capacité à créer, en
contrariété avec un discours mélodique institué, cette espèce de poussée de la
nappe musicale profonde qui est comme une sorte d’océan immanent que l’on va
découvrir dans un écart.
L’exemple que je propose, notre dernier du jour, sera, dans
l’acte I du Crépuscule des Dieux, le monologue de Hagen, fils du dieu d’en-bas.
Tous ces dieux ont la manie de faire des fils et de se battre par fils
interposés ; après tout, cela se passe ainsi dans une guerre, ce sont les
fils que l’on envoie au front. Là, c’est pareil. L’un fabrique Siegfried et
l’autre fabrique Hagen. Ainsi le Crépuscule des Dieux consiste en
partie, au dernier acte, en un affrontement entre les deux fils. Aucun des deux
d’ailleurs n’aime beaucoup son père. Il y a une scène terrible entre Hagen et
Alberich, de même qu’il y a dans Siegfried une scène d’affrontement
direct entre Wotan et ce dernier, qui casse la lance du premier. Évidemment,
puisque ce sont des fils plus ou moins libérés de l’empreinte du père, cela se
manifeste par le fait qu’ils ont des problèmes avec lui. Ils s’affrontent, et
Hagen, ce fils noir, livide et lugubre, manigance des intrigues terribles pour
s’emparer de l’anneau, car c’est Siegfried qui l’a donné à Brünnhilde après
l’avoir pris au dragon Fafner. Cet anneau est l’anneau de la toute-puissance et
en même temps il est le symbole de la société commerciale absolument organisée
par l’or.
Le monologue que nous allons voir est celui où Hagen décrit
lui-même la temporalité tragique en même temps qu’il en est l’instrument,
conformément au côté déclaratoire des personnages. Hagen est laid, méprisé, le
brillant Siegfried le considère comme une larve mais c’est lui pourtant qui est
en train de créer véritablement le destin aveugle de Siegfried, c’est lui qui
va finalement s’emparer de l’anneau et qui va vaincre. Le destin victorieux du
gnome abominable est récité par Hagen en intervalle précisément de ce qui par
ailleurs est le voyage sur le Rhin de Siegfried, c’est-à-dire le devenir
lumineux du héros. C’est précisément ce que l’on va entendre, de nouveau dans
la mise en scène de Chéreau.
Pour l’anecdote, j’indique que le personnage qui chante
Hagen était lui-même une sorte de néo-nazi : il avait beaucoup de
problèmes parce qu’il méprisait profondément tous ces interprètes français, ne
comprenant pas ce qu’il venaient faire à Bayreuth ! Il a fait suer tout le
monde ; il était grognon et furieux, absolument comme Hagen et cela a
peut-être contribué à la puissance toute particulière de son interprétation…
Vous allez voir, cela se termine sur un gros plan absolument effroyable de ce bonhomme.
Écoutez comment la construction du récit sombre de Hagen se
fait, en découvrement petit à petit des nappes thématiques de l’océan du
destin.
Écoute
du monologue de Hagen (acte I, scène 2) du Crépuscule des Dieux
Voilà le terrible Hagen…
Vous aurez entendu un procédé de Wagner très important que
je signale au passage : je l’appellerai l’asservissement d’un thème par un
autre, parce qu’à la fin du monologue de Hagen, on entend le thème de Siegfried
porteur de l’épée et celui du pouvoir de Wotan, mais cette fois entièrement
pris dans l’orchestration pour ainsi dire imposée par la figure destinale de
Hagen. Le motif ne fonctionne donc plus du tout comme identification des
personnages auxquels il est généralement lié, mais il fonctionne directement comme
expression du destin machiné par Hagen.
C’est là une ressource absolument étonnante qui est liée à
la virtuosité harmonique et orchestrale de Wagner, que cette possibilité qu’un
thème soit non seulement dans sa fonction narrative et subjective, mais qu’il
puisse aussi servir de matériau pour un autre, comme s’il était précisément un
autre. On entend cela véritablement aux cuivres graves, notamment le thème de
Siegfried porteur de l’épée qui est généralement dans le registre aigu ;
on l’entend dans un registre absolument sinistre, alors qu’en principe c’est un
thème héroïque, en sorte que nous entrons vraiment dans la subjectivité de
Hagen qui, comme il le dit, sait qu’il machine tout cela contre ce joyeux
compagnon qu’est le héros. Cela est donné dans la musique, car le thème
héroïque de Siegfried prend cette couleur sombre et cette espèce de nappe
clapotante qui supporte tout ceci, et qui est véritablement le signe de Hagen.
François
Nicolas : Remarque
À ce propos, l’image sonore souvent employée est celle de
la modulation de fréquence : on a deux fréquences, l’une est porteuse et
l’autre est modulée. Selon cette métaphore, un thème devient
« porteur » de l’affirmation de l’autre.
Conclusion
Je voudrais conclure sur un thème dont j’ai parlé au début,
c’est-à-dire sur le motif du grand art, puisque tout cela était placé sous le
signe de ce que Wagner pouvait nous enseigner quant à cette question du grand
art, non pas dans la nostalgie de sa péremption mais peut-être dans la
possibilité de sa présence à notre horizon.
Je crois qu’il faut dissocier ce que Wagner croit être sa
propre grandeur — il y a toute une série de déclarations et d’intentions
explicites — de là où elle réside véritablement, c’est-à-dire dans les
opérations que nous pouvons discerner aujourd’hui.
Je signale que c’est un travail qui est parfaitement
d’actualité à propos de quelqu’un de tout à fait différent de Wagner, à savoir
son rival français, Mallarmé, qui lui aussi, à mon avis, exige un travail très
complexe de mise à jour de ce qui est son propos sur la grandeur poétique, un
peu à l’écart de ce que lui-même a pu penser être cette grandeur, à savoir en
réalité la création d’une nouvelle religion. Cette idée est omniprésente dans
le siècle : il faut certainement séparer ce qui a été réellement réalisé
dans les poèmes de Mallarmé ou dans les opéras de Wagner de ce type de
saturation idéologique.
Autrement dit, ce n’est pas de l’affirmation mythologique
dans la volonté de créer un nouveau mythe, bien qu’elle soit présente, ce n’est
pas de la configuration renouvelée du peuple allemand, ce n’est pas non plus de
la totalisation des arts dont il s’agit : tout cela existe dans les propos
explicites de Wagner mais n’est plus actif pour nous, car cela ne nous donne
plus les matériaux possibles d’une grande œuvre.
Je pense en revanche que l’on peut extraire de Wagner cinq
règles — je ne sais comment les appeler — ou cinq orientations, ou cinq indices
de ce que peut être la grandeur à l’écart de la totalité, ou à l’écart de la
volonté messianique.
1.
La création d’impossible
D’abord, il s’agit du sens de ce que c’est que la création
d’impossible : il y a un sens wagnérien exemplaire de la disposition sur
laquelle l’art peut s’appuyer pour rendre visible ce que c’est que la création
d’impossible.
Nous en avons de nombreux exemples. Il y a une stratégie
wagnérienne sur ce point, mais qui n’est pas du tout une stratégie hégélienne
ou dialectique : c’est de montrer en processus ce que c’est que
l’apparition d’une nouvelle possibilité subjective, et j’ai montré, du moins je
le crois, que c’était une procédure musicale et non pas une narration ou un
récit.
2.
La multiplicité des hypothèses
La deuxième, c’est qu’il y a toujours multiplicité des
hypothèses acceptées dans l’œuvre de l’art et dans la conception de
Wagner : celui-ci n’est pas à la recherche de l’hypothèse ultime, de
l’hypothèse unificatrice, de l’hypothèse dernière ou de la finalité qui résume
toutes les autres et que l’on peut accepter jusqu’à l’hésitation de cette
multiplicité. Un art en effet ne doit pas reculer pour installer sa grandeur
jusqu’aux lisières de l’hésitation devant la multiplicité des possibles dont il
rend compte, ou qu’il fait exister.
3.
L’acceptation au présent de la division
La troisième serait la division du sujet comme constituant
son essence au présent : le sujet est pris ici non pas comme une structure
qui s’actualise, ni comme un épisode singulier mais comme l’essence au présent
du sujet — chez Wagner, souffrance comprise — et par conséquent, pour autant
que l’art a à voir avec la question du sujet de manière non illustrative, est
posée la question de ce que c’est que l’effectivité de la présentation d’une
division irréconciliable, qui n’est pas présentée pour qu’on apporte sa
résolution. C’est la question de l’acceptation de la division, et plus
généralement, de l’acception de l’hétérogène, à condition d’en trouver la
forme. Nous avons vu comment la division du sujet, dans le monologue de
Tannhäuser, est aussi la proposition d’une forme chez Wagner.
4.
La non-dialecticité des résolutions
La quatrième serait la non-dialecticité des résolutions,
c’est-à-dire la possibilité qu’une résolution ne soit pas nécessairement la
reprise, la relève, la condensation ou la solution des différences instituées
dans la procédure artistique elle-même, ce qui revient à accepter que des
résolutions puissent être non dialectiques sans être nécessairement ou
obligatoirement de pure coupes. C’est là le grand problème, très contemporain,
de la tentation, pour éviter toute apparence de résolution dialectique, de
substituer à la résolution une interruption. Je pense que le chemin de Wagner —
encore une fois, je ne dis pas que tout est réussi, ce n’est pas mon propos —
est de trouver des figures de résolution qui ne soient pas des interruptions
mais qui ne soient pas non plus nécessairement l’imposition d’un possible
unilatéral ou d’une idée unique. Il y a quelque chose qui est travaillé par
l’hésitation.
5.
La métamorphose sans finalité
La dernière serait la métamorphose sans finalité comme
principe du devenir, en ce sens que la mise en forme du devenir se trouve dans
les ressources de la métamorphose.
*
Je crois qu’en vertu de ces cinq thèmes — on peut en trouver
d’autres — Wagner a inventé des ressources qu’il nous propose non pas pour
qu’on les imite ou qu’on les répète, et au cœur desquelles je pense qu’il y a
une maîtrise incomparable des transformations par lesquelles des cellules
locales sont aptes à configurer une situation globale.
À la fin des fins, je dirais que l’enseignement fondamental
de Wagner reste en ce sens-là topologique : il demeure dans le rapport du
local au global, sur lequel il a, je crois, réellement fait des propositions
significatives et novatrices, d’autant qu’il sait les échelonner depuis le drame
en tant qu’il est écrit jusqu’à, précisément, une mesure d’orchestration. Il
sait les échelonner, il n’a pas un unique registre de composition du point de
vue de ce que c’est qu’une transformation de ce type.
C’est pourquoi j’ai toujours considéré que le fait qu’il ait
accepté que la configuration générale de son œuvre soit liée aux
transformations des cellules locales, même s’il y a quelques trucages de temps
en temps — c’est un homme rusé, c’est vrai — faisait de lui nécessairement le
fondateur de quelque chose et pas simplement une clôture.
Je pense de ce point de vue à quelqu’un dont on peut penser
que le rapprochement avec Wagner serait paradoxal, à savoir Haydn, chez qui en
effet l’utilisation systématique de la plasticité de cellules brèves est en fin
de compte plus importante que l’organisation mécanique à proprement parler. Il
y a quelque chose comme cela chez Wagner, qui serait à une échelle toujours un
peu macroscopique, le Haydn de l’opéra romantique. Comme vous le savez, Haydn
est à beaucoup d’égards un fondateur du point de vue du style classique, et je
suis persuadé qu’il y a quelque chose chez Wagner comme une création qui est
restée en rade.
J’ai été sensible à un texte que François Nicolas a lu,
selon lequel Wagner est resté une aventure solitaire — je ne sais plus quelle
était l’expression exacte de ce passage qui, je crois, était de Barraqué. C’est
un paradoxe, car l’influence de Wagner a été considérable — tout le monde s’en
est nourri — mais en un autre sens, je pense qu’il est resté sur certains
points essentiels sans descendance, parce qu’en effet il a fallu traverser une
grande période où il était intéressant, voire nécessaire, de le mettre de côté.
Ce n’est pas une nostalgie de ce qui aurait pu se passer
dans une autre histoire. Ce que je voulais vous raconter aujourd’hui, c’était
cette hypothèse selon laquelle, contrairement à toute évidence, Wagner pourrait
être encore une musique de l’avenir.
Je dirai alors, pour en revenir à des choses très simples,
que l’articulation wagnérienne entre leitmotive et totalité, entre leitmotive
et mélodie continue, puisqu’on résume souvent, par une description qui n’est
pas entièrement fausse, l’enseignement de Wagner à d’abord remplacer les
morceaux opératiques par la mélodie continue avant de tramer tout cela par des
leitmotive, est quand même sur la voie d’une grandeur sans totalité. Le plus
important pour nous serait ce chemin-là, à savoir la possibilité d’être le
dernier qui prétende à la grandeur dans ce qu’il a cependant de plus fort, soit
dans l’économie de la totalité.
C’est peut-être cela qui serait encore en suspens du point
de vue de la leçon que nous pouvons tirer de Wagner.
*
Ce grand opéra wagnérien se termine ici.
–––––––