Les morphologies au présent
Francis Courtot
L’enseignement de la composition, peut-être plus que tout autre, est un mélange de collectif et d’individuel. La composition ne s’apprend pas dans les livres, et elle résulte d’une transmission orale : un cours de composition, c’est surtout un endroit où l’on parle. Ceci pourrait bien montrer la nécessité, ancienne, d’une pensée collective de la composition, mais cela ne forme guère qu’une réponse un peu insatisfaisante à la question du pourquoi « penser collectivement »; en effet, il y a bien d’autres arts dont la transmission est principalement orale, quoiqu’étayée par un texte, je pense au théâtre.
I) Quel effort collectif ?
Si l’ambition d’un présent de la musique contemporaine collectif a encore une actualité, peut-elle s’établir selon les directions que Pierre Boulez, dans ses textes de présentation[1] du tout début de l’Ircam, avait envisagées ? On se souvient que ce dernier pensait l’effort collectif des années soixante-dix selon une quadruple orientation : la relation scientifiques-musiciens (avec un « langage commun » à définir), la transmission, la synthèse sonore, et enfin le langage musical[2].
De ces quatre problématiques, je retiendrais essentiellement la dernière, puisqu’il me semble qu’il y a là une urgence du présent de la musique composée. Néanmoins, je me permets de tenter une mise en perspective des trois premières directions. Je tenterais de prendre appui sur les travaux de mes collègues compositeurs, moins pour tenter une approche musicologique que pour montrer une inscription collective, pour donner à entendre une permanence d’utopie plurielle.
I.A) Qui requérir pour penser le présent musical ?
Dire qu’il faut passer par une réflexion collective pour « renouveler la musique », c’est admettre qu’elle ne peut pas le faire par un seul ; ce qui est licite, si on regarde un peu en arrière. Historiquement, les grands efforts déployés pour apprivoiser les hauteurs (des tons psalmodiques aux modes de l’octoéchos…), les rythmes (des modes aux mesures…), pour penser une notation musicale permettant une libre invention (avec tous les avatars qu’une telle idée a subi), ces grands efforts, donc, sont le fruit d’une collectivité. Aujourd’hui, pourtant, la question se pose différemment : il s’agit de savoir si on doit y mêler une pluridisciplinarité ou pas. Dans la quête d’une interface, d’un langage commun entre musiciens et non-musiciens, il s’agissait donc d’une revendication originale : il était rare, à l’époque, de voir un musicien convoquer d’autres disciplines intellectuelles tout en les liant intimement à la recherche.
Des « petites collectivités » des années cinquante, seul l’Ircam première mouture (qui pris fin en 1980, avec la réorganisation des départements) avait pour ambition une telle pluridisciplinarité. À ma connaissance, l’Ircam deuxième manière, les Tempo Reale, Cemamu, ou autres Grm n’ont convoqués des non-musiciens que pour leur faire jouer le rôle d’ingénieur ; il s’agissait donc principalement de scientifiques, informaticiens pour la plupart. Implicite était donc la pensée que le renouvellement de la musique se devait d’être fait d’abord par des musiciens, éventuellement assistés de scientifiques — on sait l’importance des calculs dans la pratique musicale, mais nullement par des poètes, des peintres, des philosophes ou des psychanalystes…
Or, ceci singularise beaucoup la musique en ces années. En littérature ou en philosophie, les paradigmes qui ont visé à une refonte des idées venaient soit de la linguistique, soit de la politique, soit de la psychanalyse, soit des trois en même temps, qu’on pense à Tel Quel, ou aux premiers ouvrages de Julia Kristeva. D’une certaine façon, ces trois axes constituent une signature de la modernité.
Mais ceci est encore plus étonnant si l’on considère, comme je le pense, que la « musique pure » est une sorte de fiction (utile). Elle naît tout entière dans la forme-sonate[3], forme à schéma, dont la découpe est fortement calquée sur le drame (exposition, péripétie, réconciliation). Le quatuor à cordes ? Le genre comprend autant la Grande Fugue que la Cavatine, dont l’évocation produisait toujours une larme au coin de l’œil du grand Ludwig Van. Au total, malgré l’Art de la fugue ou le Clavier bien tempéré, rares sont les œuvres qui ne se réfèrent pas toujours à un autre art. Et ce n’est pas Boulez, qui a bien repéré le recours aux textes chantés dans les périodes les plus prospectives de Webern qui me contredira, d’autant plus que les œuvres des années cinquante, période si emprunte de « recherches maintenant » spécifiquement musicales, se sont elles-mêmes fondées beaucoup dans une poésie « mise en musique » (ainsi du Marteau sans maître). On pourrait rajouter le Messiaen du Livre d’orgue, qui n’abandonne pas ses titres bibliques, Stockhausen ou Grisey, tout autant que Ferneyhough ou Lachenmann, pour exemplifier ce fait. Il y a sans doute une raison historique à cela, et elle est reliée à la deuxième problématique que Boulez mentionnait.
I.B) La « transmission »
Par transmission, Pierre Boulez pensait essentiellement au rapport entre compositeurs et musiciens professionnels. Il prenait son propre choix d’une carrière de chef d’orchestre pour argumenter la nécessité de « transformer la vie instrumentale dans ses principes mêmes »[4]. Certes, une telle ambition était louable, et elle l’est sans doute encore aujourd’hui, même après les brillantes interprétations de Webern que l’on a encore en mémoire. Reste que l’impression d’un combat perdu ne cesse d’accabler les compositeurs qui ont choisi d’écrire pour orchestre. Philippe Hurel me confiait, au sortir de la conférence que nous avons donné, que sa pièce pour orchestre divisé en trois groupes, Mémoire vive, serait sans doute plus correctement interprétée par trois ensembles de musique contemporaine que par un orchestre (par 3) constitué en tant que tel, et je ne peux qu’être d’accord ; la dernière version de Pli selon pli, interprété plus par un ensemble « grossi » que par un orchestre, forme un autre exemple de cette prise de conscience.
Du reste, si Boulez observait une dérive dans le recours à des ensemble restreints, spécialisés, ouverts à toutes les expériences (type, on le sent visé, le groupe de Stockhausen), force est de constater que cette dérive a été précédée, et suivie, par un foisonnement de pièces pour orchestre ; or, cela ne semble plus le cas aujourd’hui. Il reconnaissait, assez benoîtement, que sa génération avait « trouvé une conjoncture relativement favorable » : c’est le moins que l’on puisse dire ! Le jeune Stockhausen pouvait bien réclamer et obtenir trois orchestres et trois chefs, trouver une salle adéquate — aujourd’hui, mutatis mutandis, Jean-Luc Hervé a eu quelques difficultés pour faire interpréter une œuvre pour quatuor à cordes, deux bois, et un orgue positif. C’est dire à quel point la « conjoncture » a changé, et quels efforts restent encore à déployer pour la contredire.
Mais c’est sans doute aussi oublier un peu vite les solutions que l’école de Vienne avait expérimentées. Effort collectif, sans doute, les transcriptions de symphonies de Mahler pour piano à 6 mains ; mais volonté d’échapper, dans un microcosme préservé, à l’absence de moyens, certainement.
On discerne alors quels procédés sont les plus à même de changer les habitudes : refuser une personnalisation excessive, sans doute. S’appuyer sur des groupes dédiés, sans aucun doute. Favoriser la rencontre entre le public et de tels instrumentistes, par des concerts en appartement, des répétitions publiques (toujours quelque peu biaisées) relève encore de la même stratégie : influencer par capillarité la culture de nos contemporains. On est assez loin, il faut le reconnaître, des maisons d’opéra en feu, tout autant que du siège de citadelles orchestrales.
Alors, ne reste-t-il qu’à éviter l’orchestre ? La synthèse des sons peut parfois sembler une solution à ce dilemme : après tout, même au temps héroïque précédant les systèmes personnels, attendre des heures qu’un son soit synthétisé prenait moins de temps que de trouver un orchestre pour être interprété. Cependant, clairement, la synthèse pose à son tour d’autres problèmes.
I.C) La synthèse
La thématique de la synthèse sonore est sans doute toujours d’actualité, mais d’un point de vue plus ancré dans la composition proprement dite. L’idée étant, ce me semble, que la façon de synthétiser un son est plus dépendante d’une vision globale de la composition qu’orientée sur une technique propre de calcul d’échantillons. Le projet de « synthèse virtuelle », qui proposerait un langage reposant sur des algorithmes diversifiés, tel le système Croma de Marco Stroppa, ou les recherches de l’Acroe (avec de toutes autres prémisses) est sans doute le vrai projet de la synthèse des sons aujourd’hui.
Reste que ce qui ne s’appelait pas encore la musique électroacoustique nous a marqué, de façon indélébile, sur au moins quatre points.
D’une part, les paramètres de base de la musique se découvraient une relativité inconnue dans le domaine instrumental. En particulier, presque toutes les expériences que réalisa Stockhausen en studio se fondent sur la découverte de cette relativité des paramètres musicaux entre eux. Certes, le compositeur Allemand en profita pour donner libre cours à sa pensée du grand tout, médiatisée par sa propre version du sérialisme, dont l’idée de formule sera le couronnement ; mais, pour ce qui est de la génération suivante, peu importe. Peu importe que le fameux glissando[5] de Kontakte soit pensé comme une illustration d’un continuum sériel entre tous les paramètres, puisque c’est plutôt cette série de métamorphoses d’un paramètre en un autre qui l’a bouleversé. Il y avait là comme un défi à l’idée de note, notion séminale (quoique confuse) de tous les musiciens, une subversion qui touchait à un bien plus profond qu’un langage, à ses racines mêmes, à une division que les théoriciens n’avaient jamais eu idée de remettre en cause.
D’autre part, la proximité entre son et bruit, par ces mêmes expériences électroacoustiques, ouvrait à des perspectives légèrement courbées : qu’est-ce qu’une hauteur pour un son dont le bruit est la composante principale ? Certes, cette question avait été largement préparée sur un terrain strictement instrumental : Ionisation, d’Edgar Varèse date de 1931. Mais le son électroacoustique posait là encore le problème dans sa nudité[6]. Stockhausen reliait ainsi la coupure de l’espace des hauteurs à une largeur spectrale[7]. Marco Stroppa en profitera pour faire dialoguer percussions synthétiques, sons électroniques, et piano, en sauvegardant une cohérence grâce à une conception proche.
De ces deux points naît le troisième : si les paramètres de base pouvaient se penser dans une relativité absolue, si le bruit pouvait favoriser une telle corrélation, la porte était ouverte pour penser la projection d’un champ d’écriture dans un autre. Sur ce point, Stockhausen (encore lui) a montré la voie, et Grisey y a vécu[8].
De même, la musique électroacoustique n’a cessé de jouer sur une distinction affaiblie entre continuité et discontinuité. D’un point de vue instrumental, il y a d’ailleurs eu convergence avec ces idées, si l’on observe les œuvres de Ligeti, Murail et Grisey.
Carl Dalhaus posait dans un paradoxe fameux que c’est la musique sérielle, dans son affranchissement de quelques-unes des conceptions tonales, qui a rendu possible de telles interrogations. Mais il faut alors préciser : moins celle des années cinquante que celles des années vingt ; en fait, moins le sérialisme que le dodécaphonisme. Et même, que ces pensées sont en germe dans la période atonale de l’école de Vienne, quelque vingt années avant le dodécaphonisme. Il faut donc préciser encore : s’il y a intuition, et cela me semble difficilement contestable (l’opus 5 de Webern en serait une claire démonstration[9]), les propositions qui en ont été la réalisation sont venues principalement du domaine électroacoustique. Pour autant, cette musique a-t-elle pleinement réalisée ce qu’elle a posé en pleine lumière ? La notion d’objet proposée par Pierre Schaeffer, aurait sans doute pu effectuer un saut dans l’inconnu, en corroborant l’athématisme des années 1910.
En effet, l’athématisme est étonnamment plutôt le fait des années atonales que dodécaphoniques[10]. Il y a là un autre paradoxe : il semble que l’abandon du thème comme structure ne se soit pas fondé sur la dissolution de la tonalité.
C’est qu’il semble qu’il y ait eu mutation du thème en objet. L’opus 5 de Webern, mais aussi Erwartung[11] nous en apprennent beaucoup sur l’isolement fragmentaire, à la fois fruit d’une condensation de l’œuvre et source de transformation : le premier mouvement de l’opus 5 de Webern, par exemple, expose moins deux thèmes que des textures, moins des harmonies que des gestes idiomatiques pour le quatuor à cordes, moins des motifs que des catégories de timbre.
C’est en prenant appui sur la notion d’objet que Pierre Schaeffer a eu quelques-unes de ses intuitions les plus riches. S’il y a un échec dans la tentative de Schaeffer d’articuler objet et langage, il ne me semble pas que cela vienne de la notion d’objet, mais plutôt de sa volonté de classer, de catégoriser sans réelle prise en compte d’une dynamique de composition. Penser les éléments musicaux comme des objets, c’est sans doute éviter un peu le mouvement : un objet pensé comme temps zéro d’un processus, qui, lui, serait une vision cinétique d’un objet. Néanmoins, la morpho-typologie de l’objet sonore[12] reste une tentative d’une grande portée pour appréhender un élément musical « par le dessus », en faisant abstraction des procédures de génération sous-cutanées. Aujourd’hui, il me semble qu’une telle catégorisation est à la fois au-delà et en-deçà de nos besoins : en ne proposant pas une écriture, elle ouvrait la voie à une écoute autre, sans pour autant la fonder dans un artisanat de composition[13].
II) La problématique du langage…
Un langage est toujours le fait d’une collectivité. En ce sens, s’interroger sur la pertinence de cette question aujourd’hui trace effectivement les contours d’un présent. La création d’un autre langage musical, et tout aussi la découverte que l’on pouvait en créer, date des années 20[14] du siècle dernier. Or, à peine proposée une hypothèse de nouveau langage, relayée par le désir de l’école de Darmstadt de donner à ce langage sa complétude[15], que d’autres découvertes, non moins importantes, bousculaient les impératifs que l’on dirait impulsés par Schoenberg.
II.A) Découvertes
Outre les prises de conscience que nous a offert la musique électroacoustique, les successeurs de Darmstadt nous ont légués d’autres problématiques modernes. J’en liste quatre.
· La prise en compte du geste instrumental. L’idiomatisme d’une écriture est la condition sine qua non d’un réalisme dans la composition, ce n’est pas un fait nouveau. Mais partir du geste instrumental pour remonter jusqu’aux méthodes de composition, comme Lachenmann, Ferneyhough, ou Stroppa le réalisent, est une conquête qui ne doit pas grand chose au sérialisme. Sans doute, la responsabilité donnée à l’interprète dans les « formes ouvertes » a tracé le chemin, mais il s’agissait soit d’ordonner un travail de composition indépendant, soit de généraliser les ossias, pour reprendre une expression de Pierre Boulez. Aujourd’hui, le geste instrumental est une source, pas une procédure de décision. Et cela influe la façon que l’on peut avoir de concevoir un langage musical.
· La possibilité d’articuler des quarts de ton. Il est un fait que l’apprentissage des quarts de ton a été rendu possible, pour les interprètes, grâce à l’harmonie spectrale. Boulez n’a cessé, et de gommer l’ouverture de ses formes (qu’on en juge par la dernière version de Don) et de se passer des quarts de ton (voir Le visage nuptial) tandis que Stockhausen déclarait que « le demi-ton est très bien ». En France, en tout cas, seule la musique spectrale nous a permis d’écrire des quarts de ton, avec quelques précautions, certes ; et il faut bien constater quelle richesse sonore en est la conséquence.
· La relation entre notation musicale et notation du processus de composition. La place me manque pour développer plus avant cette idée, je me bornerais donc à citer deux démarches : dans PlusMinus, de Stockhausen, on sait que la musique n’est pas notée, mais que ce sont les processus de composition qui forment la partition. Il s’agit, en somme, d’une musique conceptuelle. Le peu de pérennité d’une telle œuvre ne permet pas d’en saisir le prolongement dans les notations hyper-complexes de Ferneyhough, qu’il compare à des « exercices spirituels »[16]. De fait, la notation doit aujourd’hui s’entendre comme suffisante pour qu’un instrumentiste perçoive quelques traces des processus de composition. En effet, si dans, une pièce tonale, la découpe d’une période est assez transparente, par le jeu (langagier) des cadences, il est difficile, aujourd’hui, pour beaucoup d’interprètes bien intentionnés de comprendre ne serait-ce que l’articulation d’une phrase musicale, à supposer qu’une telle notion ait encore un sens. Si l’on veut mettre l’interprète en position de compréhension tout autant que d’appropriation sensible, la notation doit sans doute constituer une lecture propre des propositions que recèle l’œuvre.
· Plus récemment, l’émergence de catégories jusque-là tenues comme subalternes s’avérait comme moteur dans la conception tant du timbre que du matériau. Mantra est tout entier fondé sur des « caractéristiques mantriques », comprenant autant une façon d’articuler les durées (répétition régulière, irrégulière…) que des trilles ou arpèges. Les hauteurs et les durées proprement dites, dans cette œuvre, n’étant responsable que d’une matérialisation de données beaucoup plus morphologiques que syntaxiques[17]. Personnellement, je trouve dans cette œuvre, sérielle d’une façon plus qu’oblique, la source d’une refonte des éléments de base du langage musical. Si un trille a, dans la pré-composition, plus d’importance que la note qui sera effectivement trillée, il y a tout un monde à découvrir qui se fonde sur la définition des morphologies. En suivant l’idée (comme disait Webern), comment puis-je mettre en relation des allures de mélodies, sans prendre en compte les hauteurs qui vont effectivement les incarner ? Si mes mélodies ont le même nombre de hauteurs, il n’y a aucun problème, mais dans le cas contraire, aucun modèle simple ne semble s’imposer. Là, comme dans les points mentionnés précédemment, il y a urgence pour confronter les méthodes : l’artisanat doit toujours sa dette au collectif.
II.B) Thèse :
En ce sens, la clôture de la modernité que représente notre génération ne s’arrête donc pas au sérialisme, qu’on peut en caricaturant allègrement présenter comme la formalisation d’une proposition dont le sens l’excède : si on peut formaliser un langage, alors on peut en formaliser autant que l’on veut ; corollaire : ce n’est pas cette constitution du langage qui définit notre présent.
Dit autrement, il me semble la « prise de distance avec le mètre, le ton, le thème », mais aussi sinon plus les paramètres, les catégories trop fixes dans lesquelles l’artisanat de la composition et d’interprétation était posé, est une résultante d’un phénomène plus fondamental, dont la prise de conscience s’effectue sous nos yeux. Pour la première fois sans doute dans l’histoire de la musique, un jeune compositeur peut créer son propre langage. Ce qui ne signifie pas que l’on peut s’en remettre à utiliser un langage donné (néo-tonal ou autres), pas plus que tous les langages se valent ou que seul importe le « message créateur », régression post-moderne connue, car si l’on peut créer son langage, on doit le faire.
D’où, deux conséquences :
· Il faut concevoir que la quête du langage est close. Pour moi, cela signifie que cette partie de la modernité, qui a débuté avec Schoenberg est achevée ; dans les deux sens, de fin et de réussite.
· Si le langage n’est plus le vecteur principal de la composition, quel est-il ? En suivant la structure du langage, il me semble que l’on peut repérer, dans bien des musiques différentes, un fondement dans la morphologie.
II.C) Définir les morphologies ?(1)
Il est nécessaire de préciser cette notion de morphologie. Une définition exacte n’est guère aisée, tout au plus peut-on esquisser, pour le moment, l’idée suivante : on sait que Pierre Schaeffer distinguait trois niveaux dans un langage : du phonologique au syntaxique en passant par le lexical. En musique, le niveau lexical est autant à créer que le niveau syntaxique, et le niveau phonologique, dans la musique instrumentale en tout cas, est le plus constant (mais nullement figé). Mais il y a un niveau de plus avant l’énoncé (la proposition) : ce niveau concerne et la façon dont différents paramètres sont agencés et la hiérarchie qui fixe les rapports entre engendrement de ces paramètres et forme globale de leur agencement. Soit, un peu plus formellement :
Si on appelle langage musical la double structure suivante :
· La structuration, plus ou moins consciente et/ou formalisée des différentes entités musicales, du plus petit niveau au plus grand ; soit, dit autrement, le lexique.
· Les procédures de génération visant à produire des ensembles de paramètres musicaux, nécessaire à une définition et du son et de l’interprétation d’un élément musical, à un niveau relativement bas dans la hiérarchie (implicite, explicite, fixe ou variable) des éléments lexicaux ; soit, dit autrement, la syntaxe, ou le matériau au sens de Schoenberg (et d’Adorno).
On appellera alors morphologie, toute entité musicale d’un suffisamment haut niveau d’abstraction par rapport au matériau pour que :
1) les
paramètres qui apparaissent dans la forme esquissée de cette
identité soient moins importants qu’une appartenance à
telle ou telle catégorie. Si un triolet de croches apparaît dans
une esquisse, ce sera moins la valeur de croche de triolet qui sera importante
que le fait qu’une durée moyennement longue (une noire) a
été divisée régulièrement (avec,
éventuellement, une définition d’articulation
donnée : legato, staccato…).
D’une certaine façon, cela implique qu’il existe, à
ce niveau de conception, des classes d’équivalence entre
entités musicales qui ne sont reliées aux paramètres que
d’une façon générique.
2) L’identité
et l’énergie de cette entité musicale dépendent de
la façon dont les catégories qui le définissent sont
agencées, et non son déploiement paramétrique, si on définit
l’énergie comme ce qui permet à cette entité de
perdurer dans le temps musical (sa nécessité au sein de la
forme), et l’identité comme ce qui permet (ou non) de
repérer cette entité dans le temps musical (sa responsabilité
au sein de la forme).
En d’autres termes, le langage musical est contraint par la
définition morphologique des entités, qui, pour qu’elles
deviennent concrètes, devront imposer une certaine allure aux ensembles
paramétriques, qui demeurent nécessaires.
Dans une telle approche, ce sont plus les relations entre engendrement de paramètre que les méthodes d’engendrements spécifiques qui sont prégnantes. De même, ce sont des catégories moins fondées sur les paramètres que sur d’autres catégories, plus récentes, qui sont utiles, j’en montrerais un exemple plus loin.
Certes, il y a une relative disjonction entre le niveau syntaxique et le niveau morphologique : une morphologie se doit d’utiliser des paramètres pour exister musicalement, alors que l’on peut, le sérialisme des années cinquante nous l’a montré, avec les limites que l’on sait, faire jouer différentes couches paramétriques sans trop se soucier de morphologie. C’est qu’il y a une dialectique entre la syntaxe et les morphologies : les déductions paramétriques assurent une variation de l’entité, amorphe du point de vue énergétique et identitaire, mais il y a un point où le libre jeu paramétrique peut faire exploser la cohérence morphologique ; on se retrouve alors avec des monades décontextualisées, libres de se recombiner au sein d’autres morphologies.
La morphologie, en ce sens, fait clairement référence à Brian Ferneyhough, à son triple point de vue sur une entité musicale : la figure, le geste, la texture.
Selon lui, la figure est conçue comme un redéploiement paramétrique des valeurs contenues dans un geste, qui est un élément premier, et dont la cohérence interne correspond à ce que nous avons dit plus haut des paramètres au sein d’une morphologie : en s’exposant, il fait exploser les paramètres qui, intégrés, le forment. La figure est fondée sur la notion de mise en perspective des gestes premiers, c’est ce qui assure sa pérennité dans la forme (ce que j’ai appelé l’énergie). Enfin, elle a aussi une qualité de perception globale, la texture (l’image sonore de la morphologie, son identité).
Pour autant, le déploiement figural d’un geste est effectué, chez Ferneyhough, en observant les tendances paramétriques des gestes qui en tracent la dérive (même si, par « paramètre », il faille ici entendre plus que les quatre paramètres de la musique sérielle). S’il y a des raisons propres à cela dans les conceptions de composition de Ferneyhough, il me semble néanmoins qu’un présent possible de la composition réside dans une définition proprement figurale de la forme (ou inversement, une définition formelle de la figure). Je prendrais dans la suite comme exemple des rapports entre langage et morphologie, entre morphologie et forme, mon cycle actuellement en cours de composition, Rivages, pour 5 instruments (trio à cordes, piano, percussion).
II.D) Après la modernité
La prise de distance me semble donc être fondamentalement dans la hiérarchie des paramètres les uns par rapport aux autres, dans la liberté d’un langage, et en conséquence, dans des catégories qui coiffent les paramètres, les morphologies comme lien entre langage et forme, comme le geste chez Ferneyhough ou les organismes de Marco Stroppa (avec des différences de conception claires).
On a coutume aujourd’hui de dire que, cette possibilité de création de langage personnel étant constatée, on a affaire à un chaos de langage, de positions toutes plus individuelles les unes que les autres. Il me semble pourtant qu’en considérant l’état actuel du langage musical à l’ordre deux, en quelque sorte, certaines lignes de forces émergent :
· S’il y a pléthore de langages musicaux, il y a pour autant peu de types de langages musicaux. On peut, en première approximation, en dessiner trois, et constater les langages multiples, qui jouent de plusieurs de ces catégories :
- les langages principalement numériques (type calcul de spectre, voire calcul de mesures selon la série de Fibonacci…) — typiques de ces langages sont les projections d’un domaine « arithmétique » dans la musique, ainsi de l’acoustique ou des transformations par des appareils donnés ;
- les langages principalement symboliques, dans lesquels la notion de paramètres (en particulier de hauteur) garde une structuration proche de la tradition — typiques de ces langages sont la permanence d’une combinatoire comme base de composition « sous la surface » (un exemple rapide : lé sérialisme) ;
- enfin, un troisième type de langage s’attache à une projection du geste instrumental dans la notation musicale, avec tous les problèmes (passionnants) de cohérence que cela pose (on peut citer comme exemple Lachenmann, bien sûr, mais aussi les recherches de Claude Cadoz).
·
D’une certaine façon, comme la plupart des
compositeurs passent de l’un à l’autre, il est plus
important de considérer a) le(s) type(s) de langage non utilisé(s) que ceux qui le sont effectivement
et b) les relations qu’entretiennent ces langages entre eux :
coexistence pacifique, traduction de l’un dans l’autre, tensions
internes…
Ainsi, un compositeur comme Jean-Luc Hervé passe du premier type au
second et réciproquement, sans que ce type de
« traduction » soit considéré comme un
vecteur de la forme : il y a coexistence pacifique. Ferneyhough
utiliserait autant chacun des trois, en jouant de l’écart entre
les notations pour rendre « palpable » ces changements
langagiers. Philippe Hurel a montré que l’on pouvait utiliser un
langage en le faisant passer pour l’autre dans ses Miniatures
en trompe l’œil, dont les
agrégats qui « sonnent » le plus
« spectral » sont aussi ceux qui sont engendrés de
façon la plus combinatoire.
· Si le morphologique prend le pas sur le syntaxique, reste à concevoir de quelle façon. De ce point de vue, les recherches sont en pleine effervescence, et il est difficile de distinguer aussi nettement plusieurs approches. Néanmoins :
- une approche non formaliste (Stockhausen, Ferneyhough, Hervé, Giner, Blondeau…), dans laquelle les morphologies sont utilisés soit comme décalque d’un élément naturel (chants d’oiseaux…), soit comme un « objet trouvé », dont le déploiement viendra plus de ses rapports de tension au langage que de ses propres qualités internes (Ferneyhough, Grisey…), soit encore comme résultantes d’un geste donné (les multiphoniques de clarinette chez Blondeau, par exemple) ;
- une approche plus formalisée, qui peut comprendre autant mes travaux sur la figure définie par des descriptions (articulations, modes, de jeu, modulation, amplitude, allure, cf. infra) que la conception des organismes de Marco Stroppa…
On distingue alors la nécessité d’une recherche collective de solutions pour ce problème relativement inédit. Les jeunes compositeurs échangent pas mal d’idées autour de cela, autour du point technique, mais aussi esthétique de la clôture de la modernité.
III) Rivages
Pour finir, et pour présenter concrètement un exemple de traitement de ce problème du langage musical subsumé par les morphologies, je me permets de prendre pour exemple mon cycle Rivages, une commande d’état actuellement en cours d’écriture pour l’ensemble S:IC[18].
III.A) Contexte :
Cet ensemble de compositions, Rivages, est sous-titré neuf études figurales, j’aurais pu écrire neuf études morphologiques.
III.A.1) Musique de chambre
Ces études sont de la musique de chambre, c’est-à-dire, non dirigée, et destinées à un ensemble particulier, en l’occurrence l’ensemble S:IC, avec qui je poursuis une relation musicale depuis 1993. Penser à des instrumentistes singuliers pour de la musique de chambre est une situation fréquente, voire indispensable, mais l’engagement de cet ensemble dans la volonté d’interpréter, de comprendre, et de diffuser la musique des jeunes compositeurs, est dans ce cas particulièrement exceptionnel. Ainsi, envisager d’écrire neuf compositions pour les instrumentistes de S:I,C correspond autant à une volonté de travail en commun qu’à un hommage…
Mais il y a une autre raison, esquissée plus haut : trouver un orchestre dont la totalité des membres est impliqués dans la musique de notre temps est suffisamment difficile pour que l’on soit obligé, dans ce contexte, soit de simplifier de façon drastique ses choix, soit de s’en remettre à des interprétations gâchées. On ne devrait écrire pour orchestre que lorsque ses choix de composition sont suffisamment « rodés » pour qu’ils soient, si ce n’est connus, au moins assimilés par un ensemble assez grand d’interprètes ; ou s’en remettre au charisme de quelques chefs… Pour qui pense que la musique d’aujourd’hui se doit d’être toujours au-delà d’un tel « fonctionnement », la musique de chambre reste l’outil indépassable[19].
Pour être tout-à-fait honnête, il y va sans doute aussi d’un manque de combativité de ma part…
III.A.2) Musique « pure »
Les études figurales sont, d’une certaine façon, mon premier essai de « musique pure ». Cependant, je l’ai souligné plus haut, un tel concept reste encore largement indéterminé, à la fois historiquement (cf. supra), et esthétiquement (dans la mesure où d’autres concepts, comme celui d’une éventuelle sémantique musicale, restent d’actualité). En fait, c’est peut-être l’idée d’étude qui décrit le mieux le projet sous-jacent : « étude » étant pris ici dans le sens de quête de potentialités alternatives d’une idée centrale de composition.
III.A.3) Œuvre « longue » - œuvre non sublime.
L’ensemble du cycle totalisera une durée avoisinant les soixante minutes de musique. Certes, il s’agit donc d’une œuvre longue. Néanmoins, il ne rentre pas dans mes intentions de tenter d’écrire un « chef d’œuvre monumental ». On sait qu’Adorno[20], comme Messiaen plus tard, déniait à Webern le statut de grand compositeur en raison précisément de la brièveté de ses œuvres. J’aurais presque tendance à renverser la critique : Webern nous a montré à quel point la recherche d’une œuvre « sublime » était vouée à l’échec, si l’on considère que la musique d’aujourd’hui tourne le dos non seulement à certaines techniques, mais aussi à cette esthétique particulière qui vise au gigantisme, aux « grands contenus ». Loin de payer un tribut à la « mort de l’art », précisément quand il renonce à cette catégorie esthétique de sublime, j’aimerais qu’une œuvre soit peut-être plus simplement le reflet d’une prise de conscience de notre finitude, sans pour autant la vouer aux magies et puissances du romantisme[21].
III.A.4) Cycle et pièces indépendantes
Les neuf études peuvent aussi être jouées seules, en nombre indéfini, ou en totalité. La seule règle à respecter est de suivre l’ordre des morceaux, même lorsqu’ils ne sont pas tous présents. Cette règle très simple a eu une conséquence importante sur la composition : chaque mouvement peut être autonome, et son éventuel enchaînement est en partie indéterminé. Au niveau du cycle entier, il en résulte des tensions plus ou moins grandes, selon le nombre de pièces jouées. S’il était donc impossible de penser à une courbe instituant quelques climax[22], un parcours, une histoire du cycle entier, était pourtant nécessaire. Je m’en suis tiré de quatre façons :
1 Une relation informelle entre la durée des pièces et leur « degré d’expression ». Soit, dit autrement, la prise en compte locale de climax à l’intérieur de chaque pièce, et leur répercussion possible sur les pièces qui peuvent suivre.
2 Une direction, éventuellement incomplète, donc, sur l’ensemble du cycle, et qui est articulée selon deux axes :
§ D’une composition plutôt régie selon le langage vers une forme entièrement définie par l’évolution morphologique. Ainsi, le premier mouvement est tout entier conçu comme l’interaction entre une entité musicale assez libre mais dont le déploiement — effectué selon une « multiplication morphologique » — est sans cesse avorté, et l’utilisation formalisée de différentes caractéristiques structurelles d’un langage paramétrique, en l’occurrence les hauteurs — les durées sont entièrement dérivées des hauteurs dans cette pièce — qui est le véritable moteur formel de la pièce. Le huitième mouvement, par exemple, est au contraire entièrement conçu comme la dérive d’une seule morphologie.
§ D’une forme fragmentée vers une forme continue. Le second mouvement, par exemple, fractionne et réordonne une suite de morphologies qui apparaît de façon linéaire dans la huitième pièce.
3 Des points de contacts harmoniques assez précisément réglés. Le schéma ci-dessous représente le premier et le dernier agrégat de chaque mouvement.
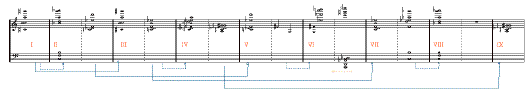
Comme on peut le voir, deux processus définissent conjointement la relation entre les agrégats de début et de fin d’une pièce à l’autre :
a) L’agrégat final des mouvements impairs se prolonge dans l’agrégat débutant le mouvement suivant, sous forme littérale ou modifiée (accord avec notes communes, hauteurs proches…). De cette façon, si un mouvement pair est omis, sa disparition sera en quelque sorte « compensée » par la proximité harmonique de l’enchaînement (les deux pièces semblant alors beaucoup plus liées de ce point de vue).
b) Les agrégats de fin se retrouvent littéralement de plus en plus loin dans le cycle (le I àà III, le II ààà V, IIIààààà VII, IVààààààIX), et toujours sur des mouvements impairs. Une sorte de perspective harmonique est ainsi approchée qui, idéalement, se poursuit au-delà de la double barre…
Selon le nombre de pièces jouées, l’importance de chacun de ces deux processus sera plus ou moins forte. Si on joue les pièces I, II, III, V, VII, par exemple, le second processus sera beaucoup plus prégnant que dans la version complète.
4 Un répertoire « d’espaces de description » proche pour toutes les pièces. Comme on le verra par la suite, ce sont des espaces de description qui régissent la définition et la déformation des morphologies dans le temps. Ces espaces sont tous structurés différemment au long des différents mouvements, mais partagent en commun beaucoup de « valeurs ».
III.A.5) Instrumentarium
Les instruments utilisés sont au nombre de cinq : trois cordes (violon, alto, violoncelle), piano et percussions. Un tel instrumentarium a été choisi de façon à pouvoir évoquer des formations connues (comme le quatuor avec piano) tout en pouvant donner lieu à des sonorités plus originales (duo cloches-tubes violoncelle de la première pièce, quatuor alto, violoncelle, piano, percussion de la troisième…).
Évidemment, la présence de la percussion est essentielle pour pouvoir équilibrer les deux points de vue, tandis que la richesse de timbre des cordes me semble une caractéristique importante dans la composition des morphologies.
Enfin, il est nécessaire de préciser que chaque pièce utilise une combinaison différente des instruments, du solo au tutti.
Au total on peut résumer ainsi le parcours du cycle (la neuvième pièce est volontairement laissée dans l’ombre, car elle est encore à composer…).
|
I |
Violoncelle
/ Percussion (cloches, marimba) |
|
|
|
Matériau
paramétrique composé indépendamment des morphologies,
absentes ou en opposition. |
|
|
|
Trio
à cordes |
Continuité fragmentée |
|
|
Continuité
sous-jacente des morphologies, mais réorganisées par fragments.
Lien encore fort avec le matériau. |
|
|
III |
Alto
Violoncelle Piano Percussion |
Fragments plus développés |
|
tuilage |
Une suite de morphologies qui
se déforment, greffée sur une « trame »,
définissant le rapport entre les figures de fond et celles de
surface… Tension entre paramètre et morphologie ; coda sous
forme d’induction laissant béante l’ambiguïté
entre langage et morphologie. |
|
|
IV |
Solo de violon |
|
|
Tuilage |
Regroupement
des morphologies obtenues par dérivations divergentes, pour former des
« phrases ». Deux types de déploiement
morphologique : linéaire et simple versus complexe et comme un palimpseste. |
|
|
V |
Solo de piano |
Grandes parties continues, juxtaposées |
|
|
Une
suite de morphologies comme une phrase, dont chaque élément
représente le noyau d’une constellation : la forme comme
voyage d’une constellation à une autre, obtenu par
« aimantations » successives… |
|
|
VI |
Variable, du solo d’alto au tutti |
Fragment dans une spirale continue |
|
|
La spirale des mouvements II
et VIII, mais dont les valeurs sont appliquées aux types de
morphologies, et non aux morphologies elles-mêmes. C’est un
tutti, mais la percussion (non obligée) n’a qu’un
rôle annexe, celui d’indiquer les figures qui
« meurent » prématurément. Mise en abyme
du cycle entier. |
|
|
VII |
Violon
alto piano percussion |
Continuité par mixage |
|
|
Mouvement morphologique
basé sur la notion de contamination et de mutation de fonction (les
« ponctuations » deviennent une morphologie à
part entière, interférant avec le processus premier). |
|
|
VIII |
Tutti en deux groupes (cordes/pno-perc) |
|
|
|
La
spirale du mouvement II (même matériau que II), traitée
polyphoniquement et linéairement, avec des morphologies à peine
différentes du mouvements VIII ; néanmoins, chaque
morphologie étant divisée en deux, le mouvement II les
juxtapose, le VIII° les superpose. |
|
|
IX |
Solo de percussion accompagné (tutti) |
Quod libet. |
III.B) Définir les morphologies (2)
Ma vision de la figure implique une identité (quoique cette identité soit plus souvent à découvrir qu’à imposer), et une trajectoire, un sens (dans toutes les acceptions de ce mot, direction, sensibilité, sémantique). Trajectoire voulant ici dire, un ensemble de déformations d’une figure initiale (ou de plusieurs), obtenue par l’érosion des caractéristiques propres à cette figure, et non par une déconstruction paramétrique (au contraire de Brian Ferneyhough). C’est une figure singulière, qui, une fois formalisée par le compositeur, semble réclamer d’elle-même une direction, un sens. Composer, dans ces conditions, veut moins dire imposer une forme de l’extérieur qu’être attentif à une immanence des figures premières, « rêvées » (l’attention serait le maître-mot dans une telle conception — encore Webern ?).
Ou, pour le dire autrement, si une figure est placée dans un réseau de potentialités pré définies, la composition se doit alors de montrer comment son identité permet de résister aux torsions de pré-composition ; sinon, elle doit définir son espace au fur et à mesure de son propre déploiement. Dans le premier cas, le langage est la contrainte, dans le second, il est contraint. Entre ces deux extrêmes, il existe de nombreuses façons d’envisager la vie d’une figure, et neuf études ne sont pas de trop pour en composer quelques-unes.
III.B.1) Espaces de description, catégorisations du matériau
Pour formaliser une figure, qui, dans les esquisses ne se présente que sans matériau paramétrique, j’établis le tableau suivant, qui formalise[24] les différentes catégories syntaxiques nécessaires à l’écriture d’une morphologie :
|
Hauteurs |
Durées |
Intensités |
« Timbre » |
|
|
Modulations |
Articulations |
« Dynamiques » |
Modes
de jeu |
ß espaces de descriptions |
|
Catégorisation
des hauteurs : ProcHaut |
Catégorisation
des durées : ProcRythm |
(matériau) |
(matériau) |
|
|
Matériau
harmonique / mélodique |
Matériau
métrique / Matériau
rythmique |
|
|
|
|
Relations : lien ou absence entre engendrement,
entre espaces de description… |
|
|||
Par exemple, voici l’esquisse calculée des premières morphologies qui apparaissent dans le second mouvement ; la première ligne et la seconde montrent respectivement leur début (alpha) et leur fin (beta). Les rythmes (et les hauteurs !) qui apparaissent dans ce « dessin » ne sont qu’une indication des procédures utilisées pour calculer effectivement ces paramètres : ceux-ci ne sont pas encore définis à ce stade. Toute liberté est laissé à une tension entre un niveau paramétrique et un niveau morphologique, tout autant qu’il est possible de définir les paramètres exclusivement en fonction des besoins morphologiques.
Les espaces de description utilisés sont les suivants[25] :
Pour alpha :
Modulations : gliss, demiGliss, Port, NonVib, « Sruti », Trille, Trille au quart de ton, Variations micro tonales non glissés.
Articulations : detache, legato, loure, quasi legato, loure staccato, accent, staccato, accent staccato, staccatissimo.
Modes de jeu : Harmonique, Chorus (double corde sur la même note), Position naturelle, Pont, Pizz, Col legno battuto, Tremolo sec, Tremolo ordinaire, Trille de timbre ;
ProcHaut (cf. infra) : Inflex, Fmf, CilFlou, GilFlou, Ascent, Inflex2, Fixe.
Pour beta :
ProcHaut : CilFlou, Fixe, Fmf, Inflex2, Ascent, DentsDeScie, GilFlou ;
Articulations : legato, staccato, staccatissimo, accent staccato, accent, quasi legato, loure staccato, loure, détache ;
Modes de jeu : Position naturelle, Pont, Molto Pont, Col legno battuto, Pizz Bartòk, Pizz, Pizz+Arco, Flautando, Chorus, Tremolo.
Tous ces espaces sont conçus comme « circulaire », c’est-à-dire que la dernière description s’enchaîne avec la première…
À côté des noms de morphologies, apparaissent les procédures utilisées pour calculer les hauteurs : Fixe correspond à une seule hauteur, Inflex est une simple inflexion libre autour d’une hauteur, Inflex2 une inflexion plus grande, Fmf représente une forme intervallique micro tonale, CilFLou une forme intervallique avec des « intervalles moyens », GilFLou une forme intervallique avec de « grands intervalles » (ces deux dernières procédures dépendent évidemment du contexte harmonique). Je ne peux décrire en détail, dans le cadre de cet article, comment ces procédures fonctionnent effectivement. Leur définition est de toutes façons suffisamment lâche pour qu’un ensemble, toujours évolutif, de contraintes soit indispensable pour les calculs musicaux. Le point important est que ces contraintes, hors certaines qui ne sont que contextuelles, sont définies en fonction des morphologies : en d’autres termes, elles représentent une sorte d’interface entre la définition morphologique et la définition en termes de langage musical, au sens défini plus haut.
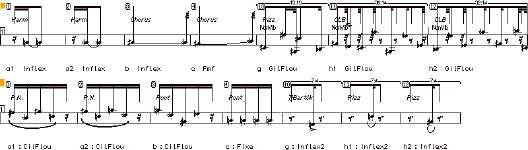
La réalisation des deux premières (a, b1, b2) répartit alpha aux violon et alto, tandis que pour g, h1 et h2, alpha et beta sont utilisés par les trois instruments ; c est à mi-chemin.
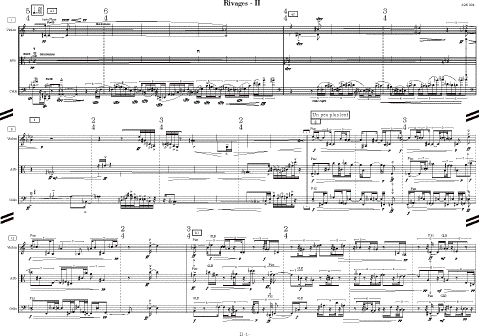
Pour un exemple d’espace de description dont la structure est assez différente, je propose ceux utilisés pour la quatrième étude. Plusieurs espaces de description sont définis conjointement pour un seul paramètre, chaque morphologie étant associé à l’un ou à l’autre. Ces espaces sont conçus en fonction autour de caractéristiques communes et de « points de contacts » qui permettent de passer d’un espace à un autre (comme une sorte de mutation[26]) :
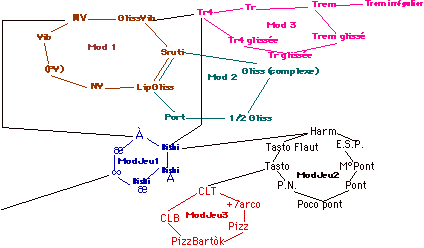
III.B.2) Forme et morphologie
Concernant le rapport entre les mouvements II et VIII, qui partagent le même matériau, la forme est conçue comme fragmentaire dans le second mouvement, et continue dans le huitième. Tous deux sont basés sur la même suite de morphologies (obtenue par la « spirale »[27] du mouvement VI), mais enchaînées différemment. Dans le schéma ci-dessous, les flèches rouges montrent le parcours linéaire du mouvement VIII, de a vers w, suivi de fB conformément au principe de « spirale ». Ces vingt-quatre types de morphologie différents ont été placés six par six avec un décalage d’un type, avant de donner lieu à une lecture (flèches violettes) qui confrontent d’abord assez brutalement différents états du processus continu (des colonnes), avant de reconstruire des fragments linéaires de plus en plus longs (des lignes). Pour souligner ce principe, des points d’arrêts sont intégrés, assez systématiquement, à chaque « descente » dans le parcours violet. Mentionnons que le parcours harmonique prend en compte les deux possibilités d’enchaînement, le cas échéant — les agrégats des morphologies du même type et des « descentes » partagent un maximum de notes communes, les enchaînements linéaires, le minimum. Une sorte de polysémie formelle virtuelle est créée de la sorte, dont la perception sera dépendante et du degré de proximité de ces mouvements et du nombre de pièce jouées ; néanmoins, l’instrumentation (trio à cordes dans le II, trio à cordes contre piano-percussion dans le VIII) permet sans doute un « repérage » plus aisé, dans la mesure où aucune de ces sous-formations n’est utilisée ailleurs (excepté, la neuvième, quod libet du cycle entier).
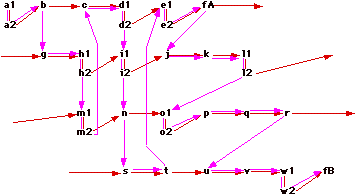
La succession linéaire des morphologies étant assez directionnelle, l’aspect fragmentaire de la forme du second mouvement acquiert une physionomie différente au fur et à mesure de l’écoute ; en effet, si les morphologies du début semblent toutes différentes et sans lien, la suite du mouvement permet de tenter une reconstruction de la trajectoire complète, sans toutefois qu’elle soit absolument possible et sûre. À tout le moins, les différents fragments apparaissent sans doute de plus en cohérents à mesure que les fragments se font plus longs, et que les différentes instances de la morphologie du début démontrent la relation de dérivation utilisée.
IV) Conclusion
Il y a un artisanat de la composition, il y a une recherche sur la fonction (sociale, culturelle…) de cet artisanat, et il y a aussi une réflexion, d’ordre plus esthétique, sur les conditions et le résultat de cet artisanat. Toutes ces questions sont aussi importantes les unes que les autres, mais il me semble difficile de laisser un compositeur seul en face d’une tâche aussi protéiforme. D’où l’urgence d’une réflexion un tant soit peu collective.
Je ne crois guère en la synthèse des arts, mais au dialogue, entre eux, beaucoup plus sûrement. Ainsi, certains textes d’Yves Bonnefoy constituent pour moi une visage proche d’une volonté en composition :
« Et quand à la poésie, je tends à en proposer une conception dialectique, où dans un premier mouvement rêveur elle se donnerait à l’image, mais pour critiquer celle-ci ensuite, au nom de l’incarnation, pour la simplifier, l’universaliser, pour finir par l’identifier aux données simples de l’existence, perçues elles aussi infinies mais par l’intérieur, cette fois, par la résonance - qu’aucune nostalgie ne vient plus troubler - de leur suffisance à chacune… »[28]
Mais je trouve aussi chez Philippe Lacoue-Labarthe (L’imitation des Modernes, Musica ficta…) de quoi alimenter un dialogue entre philosophes et musiciens.
Par ailleurs, l’écriture est sans doute le fait d’un individu, mais à destination d’une collectivité, et les différents avatars de la notion de mode, de l’octoéchos jusqu’aux modes à transposition limitée montrent assez clairement la difficulté d’une prise de position théorique qui soit indépendante d’un passé, forcément le fruit d’une proximité originelle entre différentes disciplines intellectuelles, artistiques ou non.
Je ne crois pas non plus que la solution sorte d’une « force » émanant d’un seul individu[29] : les relations entre individuel et collectif ne s’établissent pas toujours selon un modèle de domination. Les idées, en composition, ne suivent pas la loi de la gravitation, et remontent bien souvent des disciples au maître révéré, l’école de Vienne constituant un exemple de choix. En ce sens, il est bon qu’il y ait des disciples, qu’un Salieri ait existé en même temps qu’un Mozart : l’essentiel n’étant pas de participer, mais de contribuer au mouvement en lequel on a foi. En cela, notre présent collectif de la composition, si incertain en ces temps de détresse, reste de la nécessité la plus urgente.
––––