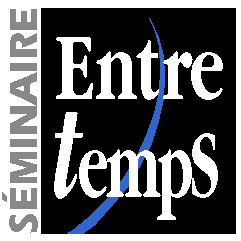 Musique,
mathématiques et philosophie
Musique,
mathématiques et philosophie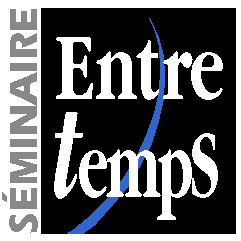 Musique,
mathématiques et philosophie
Musique,
mathématiques et philosophie
François Nicolas
· Il m'a semblé que ton intervention visait
à montrer comment l'informatique musicale cherchait aujourd'hui
à ramener des problèmes d'ordre NP à des
problèmes d'ordre P. Les compositeurs ne sauraient qu'être
redevables aux informaticiens de cette conversion car c'est elle
qui permet de leur fournir des réponses effectivement applicables
!
J'ai pris mesure, sur cette base, de l'apport que la recherche
musicale des structures en temps pouvait continuer de fournir
à la logique mathématique et je me réjouis
avec toi de ce qu'« il peut encore arriver que la musique
soit utile aux mathématiques », sauf que je me
demande, précisément en ce point, s'il est vrai
que logique et mathématiques sont une seule et même
discipline.
Les exemples que tu fournis opèrent sur la base du rapprochement
que tu prônes entre discours musical et langage formel,
et l'on se retrouve alors, en effet, de plein pied dans le monde
des questions logiques. Mais ceci ne suffit pas à s'inscrire
dans les mathématiques si l'on veut bien convenir que les
mathématiques se séparent de la logique lorsqu'il
est posé un axiome quelconque d'existence (ne serait-ce
que celui de l'ensemble vide). De ce point de vue, il me semble
que la musique et la mathématique sont moins proches que
ne peuvent l'être grammaire musicale et logique formelle
et que donc la preuve de la fécondité proprement
mathématique (et non plus seulement logique) de la musique
reste aujourd'hui encore à faire.
· Ceci touche à un second point : le temps dont
il est question dans ton exposé ne me semble pas si aisément
logicisable, j'entends par là qu'on ne peut si facilement
l'inscrire dans le champ de problèmes logiques. Il me semble
que le temps musical (pour peu qu'on ne le réduise pas
ici à un simple problème d'ordre mais qu'on lui
inclut a minima la dimension de la durée, qui n'est
pas qu'un simple ordre) n'est pas appréhendable sur le
seul terrain de la logique mais requiert la mathématique.
J'avais par exemple, dans le premier numéro de la revue
Entretemps (1985 !), proposé cette formulation,
que je renouvelle volontiers aujourd'hui : « le temps
n'existe pas, étant plutôt une opération sur
des existences » . Si cela est vrai (je ne te demande
pas de signer ce dernier énoncé, mais seulement
de le prendre un temps pour hypothèse de travail), alors
a minima le temps présupposerait des existences
à partir desquelles opérer.
Tu me diras que la logique admet parfaitement de calculer à
partir d'existences présupposées et que le temps
musical pourrait donc parfaitement être caractérisé
comme opérations sur des possibilités d'existence.
Sauf que je pense précisément que le temps musical
est (et ne peut être) qu'une opération effective
sur des existences effectives. Dit autrement : tant que les existences
musicales dont il s'agit restent hypothétiques et non pas
effectives, le temps ne saurait être caractérisé
que comme logique c'est-à-dire comme une possibilité,
non comme une effectivité.
Dit autrement, s'il y a bien une dimension logique au temps (en
particulier musical), il lui faut cependant une dimension ontologique
(il faut donc une position d'existence) pour que le temps soit
réellement saisissable comme opération qui n'est
pas que logique. Albert Lautman a tenté de penser cela
, me semble-t-il, avant-guerre et son travail n'a curieusement
(à mes yeux en tous les cas) guère été
pris en compte.
Peut-être qu'une partie des tentatives pour rattacher la
musique à la physique et non plus aux mathématiques
a également à voir avec cela : c'est comme si les
aristotéliciens (pour nommer sous ce nom, comme tu nous
y invites, tous ceux qui penchent dans ce sens, et la place de
l'acoustique dans l'Ircam nous y rattache fortement) rabattaient
la mathématique à la pure et simple logique et allaient
alors chercher ailleurs, dans la physique en l'occurrence, une
position d'existence suffisamment assurée pour que le temps
musical puisse s'y constituer réellement.
· Pour en revenir au calcul, l'informatique musicale n'a-t-elle pas aussi à apprendre aux compositeurs que leurs calculs musiciens n'en sont pas vraiment, que leurs logiques musicales n'en sont pas vraiment (si l'on veut bien prendre pour paradigme du calcul et de la logique leurs versions mathématiques, ce qui n'est pas de mauvais aloi, tu me l'accorderas). Et cependant il y a bien calcul et logique musicaux. Ce n'est pas, comme Xénakis le fait croire, que la logique musicale serait une logique mathématique tordue en un point, ou, pire encore, que le calcul musical serait celui du mauvais élève de mathématique, bref que le musicien serait d'autant plus musicien qu'il ferait des calculs mathématiques mais en se trompant dans ses opérations (si quelqu'un veut le nombre 5, quel besoin a-t-il, comme ce pauvre Xénakis, d'aller se couvrir de l'autorité mathématique en posant ingénument que 2+2 = 5 ?), c'est plutôt que la logique musicale n'est pas du même ordre que la logique mathématique, et que le calcul musical de même (voir les échanges, il va y avoir bientôt un an, lors du forum Diderot ).
· Deux questions locales maintenant, pour te demander
quelques compléments.
1. Petite réserve : peut-on dire que le nombre est «
par essence discret » alors que le nombre est précisément
ce qui permet de penser le continu (nombres réels, puis
nombres surréels) ?
2. Ce que tu appelles inconscient de la partition, c'est-à-dire
ces modèles de séquentialité qui sont déjà-là
à l'oeuvre dans la partition sans y être ni explicites,
ni discutés, ne faudrait-il pas les nommer plutôt
transcendantaux (en reprenant le terme kantien de transcendantal
qui désigne ce qui structure a priori une expérience
sans être soi-même l'objet d'une expérience
préalable) ?
Frédéric Voisin
Dans l'introduction de la présentation de Gérard
Assayag, un fait (historique) me semble assez représentatif
du problème du contexte : comment se fait-il que, jusqu'au
XXe siècle et à part quelques rares exceptions (Rameau...),
les théoriciens de la musique ne soient pas des musiciens
professionnels ? Ni Mersenne, ni Leibniz, ni Kepler, ni Pythagore,
ni Helmholtz ne sont musiciens professionnels ou reconnus comme
tels : les musiciens (professionnel) seraient-ils donc de mauvais
mathématiciens ou de médiocres physiciens ? Ou bien
plutôt les musiciens ont-ils une théorie implicite
? N'y aurait-il pas lieu de faire une disjonction entre théorie
explicite (logique, mathématisante, physique, rationalisante...)
et théorie implicite ? Autrement dit, le faire ne relèverait-il
pas d'une théorie implicite ou d'un autre sous-ensemble
cognitif que celui qui est explicité ? Les théories
explicites n'auraient-elles pas pour fonction d'inscrire un savoir-faire
dans un contexte culturellement déterminé ?
Comme l'a relevé Gérard Assayag, il a été
question du critère de l'incommensurabilité qui
a dû être abandonné. Mais qu'est-ce que l'incommensurabilité
? N'est-ce pas un calcul qui n'est pas possible dans une certaine
logique (mais qui serait calculable dans une autre logique) ?
Ou n'est-ce pas quelque chose qui échappe à la mesure,
c'est-à-dire aux outils (de mesure) qui sont le produit
d'une technologie et donc le produit d'une théorie, d'une
culture, donc d'un certain univers cognitif ? Et plutôt
que de distinguer, comme Kepler, consonances et dissonances sur
le critère de l'incommensurabilité, ne pourrait-on
pas partir de l'hypothèse que certaines consonances sont
incommensurables ? Cela nous amènerait à mettre
en doute le critère sur lequel est fondée la mesure,
mais aussi à trouver une autre logique où il serait
éventuellement question de redéfinir le critère
d'égalité : en quoi deux phénomènes
sont-ils identiques ? Sur quel critère réside l'équivalence
?
J'ai été personnellement confronté à
ce problème lors de l'étude des échelles
musicales centrafricaines et indonésiennes : l'absence
de battement a une connotation négative et ne peut être
prise comme critère de consonance. La consonance, ou mieux
encore l'intervalle musical, n'a pas ici de grandeur établie
; elle dépend du système entier qui se stabilise
idéalement sur un ensemble d'intervalles égaux entre
eux (indépendamment de leur grandeur) : cela constitue
un système dynamique qui n'implique ni division, ni addition,
mais seulement une sensation (laquelle est apprise et se trouve
donc susceptible d'évoluer dans le temps).
J'ai dirigé il y a quelques années un étudiant
en Sorbonne sur la question de l'accord des pianos : aucune des
méthodes d'accord de piano enseignées à Paris
n'est rationnelle ni ramenable à un système de rapports
prédéterminés des battements ou d'autre chose.
Aucun accordeur ne compte les battements, ni même n'a appris
à les compter : il a seulement appris à les sentir.
Ce sentir n'est-il pas alors un consensus autour d'une norme implicite
et incommensurable ?
François Nicolas
Frédéric Voisin s'étonne que «
ni Mersenne, ni Leibniz, ni Kepler, ni Pythagore, ni Helmholtz
ne sont musiciens professionnels ou reconnus comme tels : les
musiciens (professionnel) seraient-ils de mauvais mathématiciens
ou physiciens ? ». Cela pourtant me semble aller de
soi : qui aurait jamais été bon musicien (créatif,
pas seulement instrumentiste correct) et bon mathématicien
(working mathematician) ?
Sylvand Thomas
Il ne nous reste que bien peu de traces de ce qu'aurait
pu être dans l'antiquité (Pythagore) une conjonction
entre une préoccupation pour la mathématique et
une préoccupation pour la musique, mais notons que depuis
ce temps c'est la conjonction entre ce que nous considérons
comme une activité moderne (créatrice) de composition
et une activité moderne de mathématicien qui est
impossible. Ce n'est pas qu'un mathématicien ne saurait
être créateur, mais c'est qu'il est amené
à faire des choix pour imposer son travail. Mais ces contraintes
sont relativement contingentes ; elles ne sont pas nécessairement
la preuve qu'il faille passer par une troisième catégorie
médiatrice (la philosophie) pour passer d'un domaine à
l'autre. Ainsi, on considère souvent que Schumann, également
doué pour la littérature et la musique, a finalement
choisi cette dernière. De même il existe des compositeurs
qui ont tergiversé entre une voie scientifique et une voie
musicale. On s'étonne alors qu'ils n'aient pas plus contribué
à une synthèse des deux domaines, mais notons :
1) avancer dans le musical / la mathématique ne correspond
pas nécessairement à découvrir une (l') essence
privilégiée de tout le musical / la mathématique
; on se demande donc pourquoi la considération des deux
domaines devrait aboutir à une relation univoque entre
les deux domaines ;
2) si la mathématique et la musique sont deux centres d'intérêt
équivalents, choisir l'une des deux voies poussée
aussi loin que possible est bien plus gratifiant que de se contraindre
à les mener de concert pour mieux les rapporter l'une à
l'autre. Et estimer qu'une telle mise en rapport serait utile
à l'humanité avant de l'être pour soi serait
une attitude singulièrement ambitieuse. Sur ces questions
de choix, il me semble que Paganini est un exemple de personnages
fasciné par les nombres premiers et qui s'est finalement
consacré à une carrière musicale. Notons
d'ailleurs qu'un amateur de résultats sur les nombres premiers
n'est pas forcément un mathématicien et que Paganini
n'est pas non plus un compositeur (ce n'était pas l'avis
de Berlioz...). Mais c'est alors qu'il y a peu de mathématiciens
et peu de musiciens, ce qui rend naturellement la probabilité
de conjonction des deux ensembles fortement improbable.
Nicolas Meeùs
La question récemment posée par Frédéric
Voisin :
Comment se fait-il en effet que, jusqu'au XXe siècle
et à part quelques rares exceptions (Rameau...), les théoriciens
de la musique ne soient pas musiciens professionnels ?
me paraît faire écho à une autre que François
Nicolas posait dans son introduction au séminaire :
Remarquons d'abord que c'est un dialogue [celui entre musique
et mathématique] dont la musique prend l'initiative, guère
la mathématique. Si quelqu'un connaît des exemples
démentant cette assertion, je serais très intéressé
d'en prendre connaissance.
Il me semble que, jusqu'au début du XVIIe siècle
au moins, l'initiative est nettement du côté des
mathématiques. Le rôle prêté par certains
à Aristoxène est trop beau pour être vrai...
En tout état de cause, d'abord, s'il s'est trouvé
dans l'obligation d'insister sur l'importance de l'audition pour
l'appréciation des phénomènes musicaux, c'est
bien qu'il n'en avait pas été tenu compte jusque-là,
ce qui indique clairement que les premiers instants du «
moment grec » sont régis en premier lieu par les
considérations mathématiques. Ensuite, il faut reconnaître
à tout le moins qu'Aristoxène n'a pas obtenu gain
de cause et que la pensée occidentale reste pythagoricienne,
tant en philosophie qu'en musique, jusqu'au début de la
période baroque, sinon jusqu'à nos jours.
La grande césure, dans le domaine qui nous occupe, c'est
celle de l'avènement de la physique qui, par un heureux
concours de circonstances, est contemporain de l'invention des
logarithmes. Les grandes avancées de ce moment de la physique,
ce sont la mesure de la fréquence, la découverte
des sons harmoniques, la création de l'acoustique, la théorie
du tempérament (égal ou non). C'est à ce
moment que la musique prend pour un temps l'initiative (l'acoustique
de Sauveur est musicale avant que d'être mathématique),
mais le combat est perdu d'avance.
L'un des produits les plus brillants de ce moment, l'un des derniers
aussi, c'est « Tonempfindungen » de Helmholtz,
qui complète le point de vue physique par des considérations
physiologiques et psycho-physiologiques. Cette période,
qui en fin de compte aura été brève à
l'échelle de l'histoire de l'Occident, me paraît
significativement liée au moment de la tonalité.
Je reviens à la question de Frédéric Voisin
: les théoriciens de la musique, en réalité,
ont pour la plupart été des musiciens professionnels,
presque trop même. Je pense à Schlick, Zarlino, Banchieri,
Praetorius, Nivers, John Blow, Werckmeister, d'Anglebert, Playford,
Brossard, Saint-Lambert, François Campion, Mattheson, Fux,
Heinichen, Marpurg, Carl Philip Emanuel Bach, Kirnberger, Vogler,
Bemetzrieder, Albrechtsberger, Reicha, Fétis et tant de
leurs collègues du Conservatoire, Sechter, Bruckner, Schoenberg,
Schenker, Chailley, etc., etc., etc.
Et si, comme le note avec raison Sylvand Thomas, il faut bien
se choisir une profession, force est de reconnaître qu'à
de rares exceptions près tous les théoriciens, professionnels
ou non, étaient musiciens.
Gérard Assayag
François Nicolas m'interprétait en disant
qu « l'informatique musicale cherchait à ramener
des problèmes NP a des problèmes P ».
Ce n'est cependant pas son activité principale. Comme mon
intervention était centrée sur la calculabilité,
j'ai évoqué des problèmes « aux limites
». Et j'ai choisi à dessein un cas dans lequel un
problème réputé n'intéresser que les
spécialistes de la complexité, ou les gens qui conçoivent
le réseau téléphonique cellulaire, révélait
tout à coup un potentiel musical indéniable (le
voyageur de commerce).
Que peut-on en tirer ? Qu'il existe deux approches de la formalisation
musicale. Une qui se détermine entièrement à
partir de problématiques purement musicales et qui cherche
l'outil mathématique qui collera le mieux, et une autre
qui opère par transfert de connaissances de domaine à
domaine, « pour voir ». Je ne fais pas l'apologie
de cette dernière, qui peut être assez catastrophique
(voir les phénomènes de modes, fractales, chaos
etc. qui donnent des constructions musicales relativement insignifiantes).
Mais cela marche quelque fois, et je suppose que de telles expériences
ont dû se produire en physique (je veux dire dans la manière
dont la physique appréhende et se sert des mathématiques).
Au demeurant, l'exemple du voyageur de commerce est ambigu, car
je suis tombé dessus par transfert, « pour voir »,
mais j'aurais parfaitement pu tomber dessus dans le cadre de la
première démarche, en me demandant quel est le meilleur
modèle pour généraliser le problème
du parcours harmonique dans un matériau arbitraire. En
définitive on parle là de stratégies différentes
qui concourent au même but, c'est-à-dire à
définir quelle est la bonne modélisation (le concept
de modélisation en musique pourrait être un thème
pour le séminaire, d'ailleurs beaucoup plus intéressant
que le problème de la complexité, dont nous sommes
maintenant, je crois, débarrassés).
François Nicolas : « musique et mathématique
sont moins proches que grammaires musicales et logiques formelles
».
Tu instaures la différence logique - mathématiques
par les axiomes d'existence, et je ne discuterai pas ce point
: il y a certes une différence, dans l'ordre de la pensée
et de son efficace dans le monde, entre un système logique
pur et le même système utilisé conjointement
à des axiomes qui lui donnent un « contenu »
ou une « sémantique ». Mais je ne sais pas
si cette différence est une différence qui oppose
mathématique et logique.
Je veux seulement préciser que lorsque je parle de logique,
ou de système formel, dans le cadre de la musique, et notamment
dans celui des grammaires musicales, il y a toujours des axiomes
qui associent des objets externes (par exemple des notes, c'est-à-dire
des nombres entiers) aux termes primitifs du système (pour
accroître la confusion, ces termes primitifs sont appelés
eux-mêmes axiomes dans la terminologie des grammaires
formelles). Un système formel, comme le lambda-calcul,
consiste en un ensemble de règles de récritures
qui permettent de déployer la totalité des expressions
bien formées, et d'autre part d'axiomes qui déterminent
les objets de départs. C'est ainsi que le lambda-calcul
permet notamment de reconstruire l'ensemble des entiers.
De manière générale, dans l'informatique
musicale on est constamment en train de construire des systèmes
formels arbitraires dotés d'axiomes qui délimitent
le domaine des objets manipulés. Je ne sais pas si de tels
axiomes sont des axiomes « d'existence » à
tes yeux, mais ils relient indubitablement le formalisme à
un contenu musical d'une part, aux constructions fondamentales
des mathématiques d'autre part (en général
les nombres entiers et les structures afférentes). Par
conséquent il m'est difficile d'y voir une « logique
pure » à l'oeuvre, et j'ai vraiment l'impression
qu'il s'agit là d'une démarche mathématique
à forte composante logique.
Par exemple, au niveau où je me situe, le concept de relation
est plus significatif que celui de dérivée
ou d'intégrale. Or les relations sont à la
fois au coeur de l'algèbre (où elles déterminent
des structures d'une grande importance en musique : par exemple
le treillis indispensable pour comprendre ce qu'est une structure
temporelle juste avant qu'elle ne s'aplatisse dans le temps
chronologique), et en même temps au coeur de la logique
par leur équivalence avec les prédicats [aRb &
P (a, b) même combat, fonction caractéristique &
table de vérité idem]. J'avoue que ce qui
est pour moi important est de reconnaître, à la suite
de Wittgenstein (« les choses sont reliées par
des relations dans les états de choses, relations qui forment
l'armature logique du monde et définissent le point de
rencontre entre le langage et le monde »), la valeur
fondamentale de ce concept pour représenter le monde
(musical) ; cela définit le cadre de mon activité.
Mais quant à savoir si les relations ressortent de la logique
ou des mathématiques, j'ai peur de ne pouvoir y apporter
la moindre lumière.
François Nicolas : « s'il y a bien une dimension
logique du temps, il lui faut cependant une dimension ontologique
».
Je crois qu'on est bien d'accord là dessus. Tu admets
qu'il existe une dimension logique du temps, et j'ai tenté
de la caractériser un petit peu. Il semblerait que c'est
un aspect de la théorie musicale (ou de l'intellectualité
musicale) qui est historiquement des plus délaissés,
et c'est pourquoi je m'y intéresse. Il est merveilleux
que Xenakis (dont je ne méprise pas la pensée musicale,
loin de là), alors qu'il est en train de théoriser
la relation de ce qui, dans la musique, ressort ou ne ressort
pas du temps, ne voit pas cette instance de la structure logique
du temps, et que dans l'exemple qu'il donne à l'appui de
sa théorie, il produit une construction, qui précisément
ne peut se penser que dans la catégorie du temps
logique (et pas encore ontologique). Ceci montre qu'il y a (du
moins au moment où il écrit) une sorte de tabou
sur le temps, qui ne peut se penser comme structure mais
seulement comme le temps des physiciens, comme une flèche.
Depuis lors, tous les travaux en logique temporelle (voir les
travaux d'Allen), qui, finalement opèrent la rencontre
entre logique prédicative, structures algébriques
(relations d'ordre partiel, treillis) et catégories du
temps (le simultané, l'avant, l'après) ont un peu
changé la donne, mais n'ont pas encore été
exploités suffisamment dans le cadre musical.
Sur le passage du logique à l'ontologique, cela mériterait
une étude beaucoup plus approfondie. Comme tu l'as noté
pendant ma conférence, cela ne peut se tenir simplement
à la distribution de dates absolues sur un schéma
en temps logique.
Une remarque, toutefois : le temps ontologique, c'est à
la fois le temps effectif de l'oeuvre, en puissance dans la partition
et en acte dans le concert, mais aussi dans l'esprit de l'auditeur.
Or que repérons-nous ? Que le thème qui revient
avec ses variations s'était déjà donné
à entendre il y a une minute 13 secondes 12 dixièmes
et qu'il avait alors duré 15 secondes ? Certainement pas.
Nous agençons des représentations appuyées
sur la simultanéité, le « il-y-a-assez-longtemps
», le « ça-vient-de-se-produire-et-déjà-ça-se-transforme
», le « il-y-a-un-certain-temps-mais-moins-longtemps-que-machin
». Ces représentations sont bien plus proches
du temps logique tel que je l'ai proposé et tel qu'il est
décrit dans ces travaux de logique temporelle que de l'idée
de durée.
Je réfute d'ailleurs l'idée que ces représentations
seraient élucidées par je ne sais quelle durée
subjective bergsonienne : mon hypothèse est qu'elles sont
entièrement déterminées par des relations.
Ce qui dure longtemps (disons A), ce n'est pas ce qui dure approximativement
quarante-cinq secondes ; c'est ce qui a commencé alors
que B se finissait, qui a rencontré C et D se produisant
sur d'autres voix de la polyphonie, et se termine alors que E
est en train de se développer. Tu me diras que ce que je
viens de décrire peut être très rapide : oui,
peut-être dans le temps physique, mais peut-être pas
dans l'esprit de l'auditeur ! Dans cette hypothèse, le
temps ontologique aurait à voir avec la complexité
(d'ailleurs c'est bien connu qu'un phénomène trop
statique ou trop répétitif, donc de complexité
minimale, finit par abolir le temps).
Une analogie enfin, pour enrichir la discussion : qu'est ce
que le temps ontologique dans une oeuvre littéraire ? Est-ce
le temps de la lecture (ou de la représentation s'agissant
du théâtre) ? Est-ce le temps de la diégèse
(dans la terminologie de Gérard Genette, la diégèse
est l'espace-temps dont le récit est une mimésis,
n'existant en aucun lieu concret mais fondant la cohérence
du récit) ? Est-ce le temps d'enchaînement littéral
du récit (qui n'est pas la diégèse, puisque
le récit peut procéder par prolepses et analepses
- sauts avant et arrières, pas plus que celui de la lecture
qui a ses propres ralentissements et accélérations).
C'est une question difficile.
Par contre il est, sinon facile, du moins techniquement possible,
et utile, de décrire la logique temporelle du récit,
savoir les relations entre la diégèse et la lettre,
qui relient un ensemble de positions et de trajectoires dans la
première avec un ensemble de modalités discursives
et grammaticales dans la seconde. Qu'on songe à ce qu'un
temps verbal comme le futur antérieur encode comme détermination
temporelle, et la façon dont il projette le lecteur dans
plusieurs positions de la diégèse en même
temps.
On ne peut pas pousser l'analogie trop loin, mais il est clair
que dans la musique comme dans la littérature, cette structure
temporelle a priori peut exister comme schéma quelque
part dans les préliminaires de l'oeuvre, d'où elle
pose alors les conditions et limites de son déploiement
ultime dans l'écriture. Or, si ce type de structure a été
intensivement étudié par les spécialistes
de la narratologie, il n'en va pas de même dans le cas de
la musique.
· Quand j'indiquais que « le nombre est par essence discret », ce n'était pas une prise de position de ma part, mais une restitution du débat d'alors entre référence à l'arithmétique et référence aux quantités « continues » promues par la physique naissante.
François Nicolas : « l'inconscient, n'est ce
pas le transcendantal »
Tout à fait d'accord ! Il y a là un «
idéalisme transcendantal pratique » dans la mesure
où dans l'acte pré-compositionnel le musicien pose
des structures (par exemple un schéma en temps logique)
qui vont ensuite le contraindre lors de la phase « ontologique
» (l'écriture) de la même façon que
nous sommes contraints, selon Kant, à sentir et observer
des phénomènes qui ne sont que des représentations
existant dans le cadre de catégories a priori de
l'esprit comme l'espace et le temps. Il s'agirait là d'une
mimésis subtile, par laquelle nous imiterions non pas les
objets ou les fonctionnements de la nature mais le mécanisme
même par lequel nous les intuitionnons dans l'espace et
le temps.
Bien sûr cela n'est qu'un jeu, parce que le musicien peut
décider de faire voler en éclats le cadre structurel,
de tricher avec, de le refaire etc. Mais si l'on part du principe
qu'il y a une honnêteté intellectuelle derrière
un tel choix de destruction, la raison en est que les représentations
qu'il permettait (et les phénomènes qui auraient
pu en résulter dans la réalité de l'oeuvre)
n'étaient pas assez riches pour configurer un monde «
intéressant ». C'est comme si Dieu procédait
à plusieurs essais avant de fixer une fois pour toutes
les catégories aux fondements de notre intuition et de
notre perception.
Le choix du terme « inconscient » n'était à
cet égard pas innocent : je l'entendais évidemment
dans le sens lacanien, qui reste éminemment kantien : l'inconscient
structuré comme un langage, non pas un simple « lieu
» de résidence des pulsions, mais la condition structurale,
a priori, de toute production de sens et de toute appréhension
du monde. Le réel qui résiste, comme noumène
?
François Nicolas
Pour relancer le débat sur les rapports entre informatique
et mathématiques : il semble établi que l'informatique
ne pratique pas le raisonnement par l'absurde, se privant par
là d'une part importante du calcul disponible pour la rationalité.
Ou encore : l'informatique ne tient pour existence que les existences
constructibles (mieux : les P-constructibles).
Que pensent de cela les informaticiens, en particulier ceux engagés
dans l'informatique musicale ? Qu'est-ce que ceci induit ? Peut-on
dépasser la réponse convenue (quoiqu'exacte) de
délimitation : l'informatique n'est qu'une aide à
la musique ? Bref, les informaticiens se sentent-ils privés
du raisonnement par l'absurde ou en prennent-ils facilement leur
parti ?
Charlotte Truchet
En réponse aux questions de François Nicolas,
n'oublions pas que c'est le tiers exclu qui apporte les fonctions
non-calculables. Plus précisément, le tiers exclu
est indispensable à la définition d'une fonction
non calculable (Kleene). Dès lors, il est naturel que les
informaticiens soient intuitionnistes ; je ne crois pas que l'on
puisse dire que c'est là une « privation »,
ou qu'il faille en prendre son parti. C'est un fait : on sait
exactement ce qu'on peut décrire avec une machine (ou envisager
de décrire, si l'on tient compte du temps de calcul...),
et le tiers exclu n'en fait pas partie, voila tout.
Une opinion personnelle : c'est tout le contraire d'un manque.
Comme pour la logique linéaire, le fait de restreindre
la théorie dans ce cas précis a été
un trait de génie.
Cela ne signifie pas que les théorèmes « avec
tiers-exclu » deviennent faux, mais que l'on sait dans quel
cadre ils sont valides. On sait aussi qu'ils ne seront jamais
des programmes. Pourquoi en irait-il autrement avec la musique
? Une comparaison : certainement, il existe des critères
esthétiques non formalisables (tant mieux !). L'informatique
ne les traite pas. Ce n'est pas un manque, c'est comme ça.
Le fait de connaître les limites théoriques de l'outil
qu'on utilise est au contraire une excellente chose, n'est-ce
pas ?
Gérard Assayag
François Nicolas : « Il semble établi
que l'informatique ne pratique pas le raisonnement par l'absurde,
se privant par là d'une part importante du calcul disponible
pour la rationalité. »
1. Si le raisonnement par l'absurde est effectivement une
part de calcul disponible pour la rationalité, alors il
est accessible à l'informatique. Ou alors il n'est pas
accessible au calcul logique et dans ce cas, il n'est pas un «
calcul disponible pour la rationalité » mais une
stratégie rationnelle.
2. Dans un système de démonstration automatique
de théorèmes, si l'on fixe le but à démontrer,
on peut très bien imaginer que le système applique
une stratégie par l'absurde, en niant le résultat
et en dérivant axiomes et propositions connues jusqu'à
une contradiction (a & non-a).
3. Le problème est alors plus large : il est que l'on n'est
pas assuré en général de la convergence des
dérivations logiques vers le résultat « intéressant
» Le fait qu'on n'est pas assuré en général
n'empêche pas que l'on y arrive dans certains cas : il y
a alors semi-décidabilité (c'est-à-dire :
si on arrive à la contradiction, le théorème
est démontré ; si on n'y arrive pas, on ne sait
pas quoi en dire).
4. Si l'on ne fixe pas le but à démontrer, on a
le problème de la « créativité »
: un ordinateur peut dérouler du calcul logique, mais ne
sait pas faire les choix qui orientent le raisonnement vers quelque
chose d'« intéressant ». Sur cette question,
on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel.
5. La relation à la musique n'est pas claire. Y a-t-il
beaucoup de gens qui utilisent le raisonnement par l'absurde quand
ils composent ? Peut-être dans une phase préalable,
si l'on veut être certain des propriétés d'une
structure musicale qu'on a inventée, mais alors on peut
imaginer l'aide d'un système de démonstration automatique.
Marc Chemillier
François Nicolas : « Il semble établi
que l'informatique ne pratique pas le raisonnement par l'absurde,
se privant par là d'une part importante du calcul disponible
pour la rationalité. »
On ne peut pas dire ça. Le raisonnement par l'absurde
est constamment utilisé en informatique. Un « cliché
» de la théorie des automates consiste à utiliser
le « lemme d'itération » (caractéristique
des langages rationnels) pour montrer a contrario qu'un
langage n'est pas rationnel.
Gerard Assayag
Je reviens sur la remarque de François Nicolas
concernant l'accessibilité (par l'informatique) de la démonstration
par l'absurde, en indiquant des pistes sur quelques avancées
récentes.
Attention : on ne se demande pas ici si le raisonnement par l'absurde
est utilisé en informatique, Marc Chemillier a rappelé
qu'il l'est évidemment. On se demande si un programme informatique
peut être une modélisation d'un raisonnement par
l'absurde, ce qui est différent.
Une preuve mathématique est-elle dans tous les cas équivalente
à un programme informatique ?
Le premier pas est le théorème de complétude
de Gödel (pas celui d'incomplétude !). À partir
de la, toute démonstration peut se réduire à
une suite d'opérations mécanisables. Toutes ? Non
car un petit village résiste encore. On le comprend mieux
en regardant la thèse de Curry et Howard : à toute
démonstration correspond un terme du lambda calcul, donc
un programme, mais seulement dans le cadre du calcul propositionnel
intuitionniste, qui interdit le tiers exclu et récuse donc
le raisonnement par l'absurde (j'imagine que François Nicolas
part de là quand il déclare que ce raisonnement
est inaccessible à l'informatique - la relation de ce point
avec le tiers exclu était déjà indiquée
dans la réponse de Charlotte Truchet). Cette correspondance
est étendue, entre autre par Jean-Yves Girard à
la logique intuitionniste des prédicats, toujours sans
tiers exclu.
En 1990, cependant, Matthias Felleisen, et T. Griffin, cherchant
à typer (par une formule logique) une instruction du langage
Scheme (très proche du lambda-calcul) qui permet
de réifier la notion de contexte de programme et de continuation,
se sont aperçu que le typage qu'ils proposaient permettait
d'établir l'équivalence entre preuves classiques
et programmes typés.
Partant de là, Jean Louis Krivine de Paris VII a récemment
étendu Curry-Howard jusqu'à la théorie des
ensembles (aux axiomes de Zermelo-Fraenkel dans un premier temps,
à cause des difficultés liées à l'axiome
de choix). Krivine prétend que son extension s'applique
maintenant à la quasi-totalité des mathématiques,
ce qui impliquerait qu'à toute démonstration mathématique,
y compris par l'absurde, correspondrait un programme informatique.
François Nicolas
Serait-il possible d'avoir une version « soft »
pour béotiens de ces intéressantes précisions
de Gérard Assayag, pleines de promesses mais un peu «
hard » ?
Gerard Assayag
Précisément, tu as bien compris : ce n'est
là qu'une promesse, à creuser. En tout cas l'enjeu
est clair : s'il y a équivalence entre une preuve et un
programme, générer une preuve par ordinateur revient
à générer un programme (une expression du
lambda-calcul par exemple, directement interprétable dans
des langages comme scheme ou lisp). Le fait de se
dire qu'il y a un espoir d'accéder au raisonnement par
l'absurde (de générer un programme qui fait un raisonnement
par l'absurde) renforce donc la dynamique de la recherche en démonstration
automatique.
Une autre spéculation (personnelle), c'est qu'on peut écrire
de manière constructive des programmes qui construisent
d'autres programmes. C'est courant dans la pratique des langages
de programmation de haut niveau. Par exemple lorsque tu sauves
un patch (un programme visuel) en OpenMusic, tu génères
en fait automatiquement un programme qui saura, lorsque tu rechargeras
le patch, reconstituer les informations.
Mais on peut aussi imaginer des systèmes à «
programmes émergents » dans lesquels des programmes
se construisent tout seuls et dont on ne sait pas ce qu'ils font.
Cela arrive par exemple en informatique génétique,
où tu peux produire un milliard de générations
successives de population, avec processus de mutations et sélections.
Dans ce cas les individus sont des programmes qui se constituent
par combinaisons d'instructions élémentaires et
croisement avec d'autres programmes, et dont la fonction de «
fitness » (le sélecteur évolutionniste)
finit par produire des programmes qui « marchent »
dans le sens où les boucles se terminent, les sauts d'instructions
ne vont pas n'importe ou et reviennent au programme principal,
bref des calculs se font. Sauf qu'on ne sait pas a priori ce qu'ils
font. L'idée serait donc de les examiner sous l'angle de
l'équivalence preuve-programme pour voir si un théorème
intéressant apparaît. Il faudrait au départ
initialiser les populations avec les axiomes, voire laisser ouverte
la possibilité d'émergence d'axiomes, et construire
une fonction de fitness qui favorise l'émergence
de calculs ressemblant a des raisonnements. Mais cela relève
peut-être encore un peu de la science-fiction...