Propositions
pour une kurtágographie analytique
François
Polloli
Il convient de
s’interroger sur le sens de la question que nous soumet Laurent Feneyrou :
« Écrire sur Kurtág ? » Si le projet est d’écrire sur sa
musique, quels buts et quelles méthodes doit ou devrait se donner une
musicographie analytique ?
Introduction
Kurtág se livre peu,
c’est un fait. Mais au fond, cette lacune de textes ou d’entretiens de première
main est-elle tellement gênante ? Ne conduirait-elle pas plutôt le
commentateur à assumer pleinement sa position, puisque le compositeur ne donne
pas de clefs susceptibles d’étayer un discours critique sur sa musique ?
Puisque l’accès à son atelier nous est fermé, comment dès lors rendre compte
d’une de ses pièces minuscules, d’une de ses œuvres, voire de l’ensemble de sa
production à ce jour, et pourquoi pas, de son style ? Parce que l’analyse
musicale a le pouvoir de relever ce défi, elle en a aussi le devoir. Mais une
des difficultés qui se présente d’emblée est que l’analyse en action, intrusive
par nature, aboutit presque toujours à la mise en pièces des œuvres qu’elle
touche. Aussi, travailler sur la musique d’un compositeur exige – par respect
pour la musique mais aussi pour l’homme – que l’on prenne toutes les
précautions.
La question de la
méthodologie se pose car l’usage de telle ou telle méthode accomplit forcément
un filtrage en focalisant l’attention sur un aspect plutôt qu’un autre. Si une
telle réduction du champ d’examen est inévitable – et même parfois souhaitable
– il faudra toutefois que le travail d’analyse ne manque pas son but en
provoquant la perte de quelque chose d’essentiel. Étant donné ce que l’on sait
de la musique de Kurtág, la démarche se définit ainsi : on emploiera des
outils appropriés et le cas échéant, on en forgera certains ;
parallèlement à l’opération de démontage, on se posera toujours la question du
sens ; on veillera aussi à ce que ces outils analytiques soient
suffisamment simples afin de réserver à la musique – véritable objet de l’étude
– le premier plan.
1. Longues & brèves
Dès 1959, à partir
de son Quintette à vent, opus 2, Kurtág utilise par endroits un lexique
rythmique particulier qui repose en tout et pour tout sur cinq signes de
durées. Pour cette raison, cette échelle – faite de longues et de brèves, et
qui n’est rudimentaire qu’en apparence – ressemble donc à l’échelle conventionnelle
des intensités. Et comme Kurtág emploie conjointement des signes d’altérations
(sans toutefois céder à la tentation combinatoire), son lexique complet de
durées contient une vingtaine de valeurs qui ignorent la division binaire.
Plusieurs aspects de cette notation la rendent problématique (je laisserai de
côté l’absence de terminologie associée à ce lexique).

Exemple 1 – Le motif du péché, Pierre de Rosette rythmique.
Un des premiers
problèmes que pose cette notation, c’est que les durées qu’elle exprime ne sont
ni directement quantifiables ni objectivement mesurables. Il est de ce fait
très difficile d’élaborer un discours logique à leur sujet, ce qui explique
probablement le manque de commentaires analytiques abordant ces rythmes. Et
puisque nous sommes à l’Ircam, temple de la rationalité faite musique, la question
se pose de savoir comment on pourrait traiter ces rythmes au moyen d’un
logiciel comme OpenMusic. L’inadéquation de cet outil d’analyse, fût-il
performant dans d’autres situations, constitue un écueil sérieux qu’il convient
de contourner. Il existe une Pierre de Rosette : le motif du péché se
trouve noté de façon traditionnelle au début de la deuxième partie des Dits
de Péter Bornemisza
(cf. ex. 1, portée du haut[1]) ; bien des années
plus tard, on rencontre la même mélodie dans l’avant-dernier des Fragments
d’Attila Jozsef
(cf. ex. 1, portée du bas), mais notée cette fois au moyen du lexique
propre à Kurtág. Il me semble que ce serait une entreprise absurde que de
tenter de « traduire » ces rythmes au moyen de cette Pierre de
Rosette. Son existence tend néanmoins à prouver ceci : quand bien même il
existerait une typologie de la mélodie chez Kurtág, elle ne serait pas
complètement déterminée par le recours à ce lexique.
Une des caractéristiques
de cette notation, c’est qu’elle renvoie à des musiques non mesurées enfouies
dans les profondeurs de l’Histoire, ce qui lui confère un caractère archaïsant.
L’interpréter comme une invitation nostalgique à une restauration quelconque
témoignerait d’une profonde méconnaissance des œuvres de Kurtág. Car c’est au
contraire en convoquant la tradition musicale au sens le plus large du terme,
que la musique de Kurtág parle au présent, peut-être pas au présent de
l’indicatif, mais plutôt au présent du conditionnel ou du subjonctif…
Parallèlement, en
mettant à bonne distance barres de mesures et pulsations, les longues et les
brèves de ce lexique rythmique parviennent à atténuer la sujétion vis-à-vis de
l’héritage des musiques de danses dont découlent la plupart des formules
rythmiques de la tonalité. C’est donc de façon critique mais aussi délibérée,
qu’au moyen de ce lexique, Kurtág enrichit la notation usuelle par autre
matière rythmique, celle de la langue parlée. Ainsi, la vocalité de sa musique,
sans renoncer au chant, se rapproche de la parole.
Il faut enfin interroger
les implications musicales profondes d’une telle notation au regard de
l’interprétation. La liberté rythmique que recèlent potentiellement ces signes
tient plus, selon moi, de l’illusion que de la réalité. En effet, puisque
l’interprète ne peut plus compter les rythmes, il lui faut trouver une solution
agogique dans le mouvement mélodique[2]. De la sorte, et aussi
étonnant que cela puisse paraître, cette notation a pour effet de lier durées
et hauteurs de façon indissoluble. Il revient à l’interprète de tirer toutes
les conséquences de cela avec le plus de lucidité possible ; mais
l’analyste aussi subit cet effet, et il ne peut donc plus ignorer les unes au
profit des autres.
2. Mélodies & harmonies
Il paraît évident que
les hauteurs se prêtent très volontiers à l’étude analytique : Zarlino,
Rameau, Riemann ne sont que quelques uns des nombreux auteurs qui se sont
appliqués à élaborer différents systèmes théoriques au cours des âges. Mon but
n’est ni d’étudier ces théories ni d’en discuter la validité, mais de puiser
dans cet arsenal ce qui paraît pertinent pour notre objet d’étude. Dans cet
ordre d’idées, il semble que la méthode de Lendvai[3] se révèle efficace.
Elle fonctionne, notamment parce que Lendvai l’a développée au contact des
partitions de Bartók et que la musique de Kurtág hérite, en bien des points, de
celle de son compatriote.
|
|
|
Exemple 2 – Deux médaillons déduits des mélodies
« Kásásodik a víz… » dans József Attila - Töredékek ;
la
symétrie la-mi bémol y est
visible.
Lorsqu’on utilise cette
méthode, on est amené à établir une représentation des hauteurs sur un cycle de
quintes, qu’il s’agisse d’une mélodie, d’un agrégat ou de quelque ensemble de
hauteurs que ce soit. On obtient alors des sortes de médaillons qui font
apparaître des propriétés particulières de ces constellations d’intervalles
comme, par exemple, la symétrie[4] (cf. ex. 2). Chaque
fois qu’il y a symétrie, apparaissent des axes et des pôles qui fonctionnent,
selon Lendvai, comme une sorte de substitut aux catégories tonales
traditionnelles.
On peut donc
raisonnablement dire de la musique de Kurtág qu’elle est polarisée, en précisant
toutefois que ces polarisations ne sont pas seulement une conséquence des axes
de Lendvai, mais aussi du poids particulier qu’une note acquiert, du fait de
son intensité, de sa durée, du contexte mélodique, etc. Et comme Kurtág a une
conception tout à fait traditionnelle de la période musicale, une analyse
inspirée de la méthode de Schenker, tissant des liens entre lecture des
hauteurs et étude des formes, devient dès lors concevable.
3. Topologie formelle
Certaines circonstances
autorisent à laisser émerger la méthode analytique de la musique
elle-même : tandis que j’étais aux prises avec un océan de plus de cent
fragments qui m’opposaient une résistance farouche (ceux des quatre cycles
vocaux Bornemisza,
Troussova,
Attila József,
et Kafka),
l’idée m’est venue de les représenter sur des diagrammes, de manière ordonnée,
longitudinale, selon la chronologie de l’œuvre, et proportionnellement au
temps ; j’ai appelé ces diagrammes des cartes. Bien sûr, il faudrait
aussitôt faire la critique de cette méthode, notamment en posant ces deux
questions : celle de l’usage du terme fragment, et celle non moins
cruciale concernant la valeur musicale de la durée chronométrique. Quoi qu’il
en soit, il est possible, au moyen de ces cartes, de décrypter l’organisation
de la forme cyclique chez Kurtág, qu’il s’agisse d’assemblages préparés pour
une circonstance particulière (concerts ou enregistrements) ou de cycles
d’envergure comme l’opus 17.
La carte des Messages
de feu Demoiselle R. V. Troussova permet de mettre en évidence
qu’une accélération globale se produit au fur et à mesure du déroulement de
l’œuvre[5]. Sur cette carte (cf.
ex. 3), on constate en effet que cette accélération se manifeste
conjointement des deux façons suivantes, primo par l’accroissement du
nombre de fragments par partie (2 fragments, puis 4, puis 15), et secundo par le raccourcissement
progressif et presque régulier de leurs durées. Fait essentiel, cette
accélération va aussi de pair avec le propos littéraire de l’œuvre : une chute.
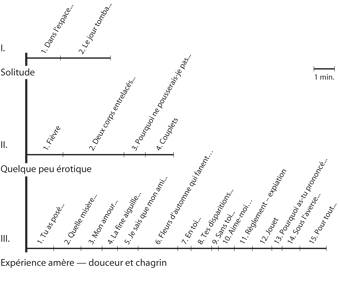
Exemple 3 – Carte des
Messages de feu Demoiselle R. V. Troussova, opus 17
L’œuvre
dure environ une demie heure et chaque ligne horizontale en représente une
partie.
Mais ce n’est pas tout.
En interprétant ces cartes, il devient possible de décrire une évolution dans la
manière dont Kurtág organise les fragments entre eux, car sa conception du
fragment, tout comme l’usage qu’il en fait, ont évolué au fil du temps. On peut
ainsi parcourir sa production, en partant des premiers opus qui ne comportent
que quelques fragments chacun (Quartetto per archi, opus 1 ; Quintetto
per fiati,
opus 2 ; Acht Klavierstücke, opus 3 ; etc.), pour aboutir à des
œuvres de dimensions gigantesques comme les Kafka-Fragmente, opus 24, dont les
quarante fragments organisés en quatre parties offrent une complexité presque
inquiétante.
Une des étapes de cette
évolution est l’émergence d’une continuité qui se développe progressivement.
Parce qu’elle entre en tension avec l’aspect fragmentaire de l’ensemble de
l’œuvre de Kurtág, cette quête de continuité a tendance à pondérer l’aspect
fragmentaire. En effet, les cas de fragments enchaînés sans solution de
continuité (par exemple au moyen de l’indication attaca) sont très rares dans
les six premiers opus ; mais en revanche, à partir de 1963 (Dits
de Péter Bornemisza,
opus 7), c’est le contraire qui advient. Ce souci de la continuité
musicale est récurrent chez Kurtág, et ne s’exprime pas seulement par
l’écriture. Lorsqu’un enregistrement est préparé par exemple, on sait que le
compositeur attache énormément d’importance aux silences qui existent entre les
fragments et qui, de fait, articulent l’ensemble. Ainsi, pour l’enregistrement
de son Officium breve, opus 28 (quinze fragments pour quatuor à cordes), par
le Quatuor Keller, la décision a été prise de ne pas graver quinze plages sur
le CD, mais une seule qui dure plus de dix minutes. Dans l’entretien
« Mots-clefs[6] » on trouve une
confirmation de cette intuition quant à cette problématique de la
continuité ; il s’agit de propos (rapportés par Márta Kurtág) que Péter
Eötvös a tenus lors de la création de cet opus 28 : « Alors, […]
qu’il écrive pour une fois d’une traite, sans doubles barres. »
(p. 96).
Il devient clair que la
distance particulière et le point de vue général fournis par ces cartes
permettent de découvrir des caractéristiques formelles propres à telle ou telle
œuvre. Le second avantage de ces cartes, c’est de révéler des changements
stylistiques au gré des œuvres successives qui, sinon, resteraient cachés.
Toutefois, cette lecture topologique n’exonère pas de l’examen de détail des
partitions. Car s’il est évident que la carte n’est pas le territoire, c’est en
la confrontant au paysage que le visiteur attentif et curieux acquiert
patiemment une vraie connaissance des régions où il voyage.
4. Relations formelles
La grande forme, chez
Kurtág, s’organise volontiers à partir de paires de fragments qui riment entre
eux, la première occurrence étant peut-être celle des deux fragments
« Virág az ember » dans Bornemisza. Cet emprunt à la
taxinomie de la versification semble adéquat puisque la rime est, dans un
poème, ce qui contribue à la réalisation de la forme par le retour périodique
de sonorités semblables, mais non nécessairement identiques. Cet appareil
conceptuel présente deux atouts : il est succinct et presque musical (périodes,
sonorités).
De plus, il est en accord avec la teneur de l’ensemble de la production de
Kurtág dont on connaît les affinités puissantes avec la poésie.
Comment identifier la
rime entre deux fragments ?… Gémination d’un titre, identité du texte
chanté, proximité des sources littéraires, similitude du propos, parenté de
matériau musical, ou durées exceptionnelles sont autant de marques –
littéraires ou musicales – qui légitiment la constitution de ces paires.
Comme exemple, je
donnerai celui des deux fragments de l’opus 24 « Nimmermehr » et « Wiederum, wiederum ». Il existe entre
eux une première relation de proximité des sources littéraires puisque, chez
Kafka, les deux textes ne sont distants que de quelques paragraphes. Mais cette
relation de proximité n’est pas du tout maintenue dans l’œuvre musicale car,
parmi les quarante fragments, ces deux-là sont placés respectivement en sixième
et avant dernière position ; autrement dit, ils sont écartés vers les confins
de l’œuvre. Cela n’est pas anodin car les deux textes de Kafka évoquent
l’exclusion hors d’une communauté ou d’un territoire, condamnant à l’errance
celui qui en est frappé. Par conséquent, au regard de la forme, en étant tous
deux proches de ses frontières, ces fragments du bannissement se trouvent en réalité
au même endroit.
Plus encore, ce procédé
de la rime permet d’identifier une nouvelle étape dans le maniement de la continuité
fragmentée ; cette étape se situe entre la fin des années soixante-dix et
le début des années quatre-vingts, c’est-à-dire à la charnière des Messages
de feu Demoiselle R. V. Troussova (1976-1980) et des József
Attila - Töredékek (1981-1982). La partition de Troussova organise manifestement
les fragments en trois parties successives intitulées « Solitude »,
« Quelque peu érotique », et « Expérience amère, douceur et
chagrin » (cf. ex. 3). À l’inverse, la partition des vingt fragments
d’Attila József
ne comporte aucune indication explicite de parties subdivisant l’œuvre en groupes
de fragments.
Or il se trouve que,
parmi ces Fragments d’Attila József, quatre fragments riment deux à deux ; on
pourrait même parler à leur sujet de rimes embrassées puisqu’il s’agit d’une
part des numéros 1 et 19, « Kásásodik a víz… », et d’autre part des
numéros 6 et 12, « Én ámulok… ».
Par conséquent, trois parties se dessinent, mais cette fois de façon
sous-jacente et non plus évidente comme dans Troussova : elles comptent
respectivement quatre fragments (n° 2‑5), puis cinq (n° 7‑11), puis six (n° 13‑18) ; enfin, un
épilogue (n° 20) vient clore l’œuvre. On constate ici que la musique
elle-même sculpte sa propre forme au moyen de ces rimes ; et l’on voit
donc que la grande forme n’est en aucun cas un artefact plus ou moins extérieur
à la composition, mais qu’il s’agit au contraire d’un élément musical intrinsèque.
Dans les Fragments de
Kafka,
cette recherche des rimes fournit un résultat étonnant. Les exégètes de la
littérature de Kafka l’ont parfois décrite de manière topologique en la
comparant à un labyrinthe. Mais l’œuvre musicale de Kurtág a-t-elle cette
structure de labyrinthe ou plutôt celle – tout aussi complexe quoique
différente – d’un terrier ? Un labyrinthe est par définition une structure
plane, à ciel ouvert, et qui implique la solution d’une énigme (il faut en
sortir…) ; un terrier, quant à lui, est une construction souterraine,
secrète et en volume, dans laquelle un animal trouve la sécurité (il s’y réfugie…).
Au moyen des rimes, il est possible d’apparier des fragments, et en effectuant
ce travail, on assiste de proche en proche à la formation de véritables
chaînes. Et plutôt qu’un labyrinthe, on découvre alors un terrier, dont chaque
pièce musicale serait une niche communiquant avec d’autres par l’intermédiaire
d’un réseau de galeries[7].
Le mimétisme de Kurtág
envers Kafka le pousse d’ailleurs à faire entrer quelques animaux dans le
dernier quart de son opus 24 : ces bêtes peuvent bouger, circuler, se
faufiler, glisser à l’intérieur du terrier. L’analyse entre ici en résonance
avec le propos littéraire essentiel de l’œuvre qui est le mouvement ; en effet, une majorité
des textes de Kafka sélectionnés par Kurtág portent explicitement cette empreinte
du mouvement, depuis le tout premier dont la marche des bons contraste avec la danse
des autres,
jusqu’au dernier avec la reptation des serpents. Il importe aussi de
savoir que la langue hongroise exprime toujours le mouvement d’une manière
extrêmement raffinée et qu’ainsi s’expliquent probablement les choix que Kurtág
a opérés parmi les écrits de Kafka.
5. Limites du sonore
Les manifestations
limites du sonore semblent aussi avoir une importance considérable dans la
musique de Kurtág, à commencer par le silence : dans ce domaine si
particulier, la tâche n’est pas aisée ; il est essentiel qu’elle soit
poursuivie et partagée par la communauté des chercheurs[8].
Comment conceptualiser
d’autres limites du sonore ? Afin d’aborder cette question délicate, le
recours à un modèle fournit un premier appui. Considérons donc le modèle
suivant qui trouve sa justification dans certains écrits de Pascal Quignard.
Admettons d’une part qu’un phénomène sonore quelconque s’entend comme sonorité
du langage articulé
ou bien sonorité musicale, et que d’autre part, à défaut d’appartenir à
l’une ou à l’autre, ce phénomène soit alors considéré comme bruit. Si l’on admet cela, le
sonore s’organise donc selon trois domaines : bruit, langage, musique. Cette tripartition n’a
rien d’un schéma rigide car les frontières délimitant ces régions sont tout à
la fois subjectives, mobiles, poreuses… Faire référence à ce modèle amène à
décrire, de façon générique, la tâche du compositeur comme un travail de
domestication des sons sauvages afin de les incorporer au musical (pour s’en
convaincre, il suffit de se souvenir des difficultés de réception qu’ont
rencontrées le dernier Beethoven ou le premier Stravinski).
Il semble bien que la
musique de Kurtág explore les frontières de ces domaines du sonore, par exemple
en accompagnant de signification musicale des textes qui autrement auraient
tendance à l’évanescence. Une bonne illustration de ceci se produit dans le
fragment des Kafka
intitulé « In memoriam Joannis Pilinszky » dont voici le texte[9] : « Ich kann… nicht eigentlich erzählen, ja fast nicht einmal reden ;
wenn ich erzähle, habe ich meistens ein Gefühl, wie es kleine Kinder haben
könnten, die die ersten Gehversuche machen. » Au début de ce
fragment, un violon incertain égrène tout d’abord quelques notes ; puis
une voix timide imite ce matériau musical réduit à l’extrême ; ensuite, et
à la faveur du déroulement du texte, c’est l’inverse qui se produit,
c’est-à-dire que le violon imite la voix. Dit ainsi, cela a l’air presque trop
banal. Mais, à cet instant précis, jaillit l’extraordinaire : on a
l’impression d’entendre parler ce violon qui énonce ce que le sujet a du mal à
dire. Cette musique réussit donc le prodige de faire entendre du texte comme
s’il s’agissait d’une voix intérieure qui anticipe ce que l’on dit ou qui, au
contraire, réitère ce qu’on vient de dire, ou encore commente ce que l’on dit
pendant qu’on le dit. Par conséquent, dans cette pièce au moins, le tabou des
sonorités instrumentales asémantiques se fissure.
Conclusion
On l’aura compris, la
musique de Kurtág échappe à bien des classifications ; il est de notre
responsabilité de prendre en compte cet aspect même si cela ne doit pas nous
empêcher – bien au contraire – de chercher à détecter de la cohérence par une
lecture sensible des partitions, jointe à une écoute patiente des interprètes
qui jouent cette musique.
Les œuvres de Kurtág
peuvent presque suffire à nous guider sur le chemin de leur exploration, à
condition que nous utilisions des boussoles adéquates afin de nous orienter
dans ces contrées parfois étranges. Il devient alors possible de faire émerger
quelque chose de spécifique et de chaque fois différent : écrire à propos
de la musique de Kurtág est une entreprise passionnante et enrichissante. En
effet, en tant que praticien de l’analyse musicale, il ne me paraît pas vain de
procéder à des allers-retours entre cette musique d’aujourd’hui et celles du
passé. Cette idée entre en résonance avec une manière bien connue du travail
compositionnel de Kurtág qui renouvelle l’essence de la tradition par des
citations et des hommages multiples. C’est ainsi qu’étudier sa musique m’a
conduit à reconsidérer bien des questions sur les catégories traditionnelles de
la musicologie.
La musique de Kurtág,
cet objet merveilleusement beau et vivant, nous entraîne dans un mouvement toujours
plus large, et nous invite finalement à cette ouverture : ce que l’usure
du temps avait réduit à l’inutile pourrait bien retrouver la fraîcheur de
l’intérêt ; et à l’inverse, il se pourrait qu’un discours critique sur des
objets que la culture avait fétichisés voie enfin le jour.
_____

