Qu’appelle-t-on violence ?
Séminaire du Relais Île-de-France
lundi 3 octobre 2011
François Nicolas
I. Pourquoi ce séminaire ?.................................... 1
II. Qu’appelle-t-on violence ?............................... 1
III. Penser-réfléchir la violence ?.......................... 2
IV. Pour une analyse de cas.................................. 3
Annexes................................................................. 4
Discussion............................................................. 6
I. Pourquoi ce séminaire ?
L’idée d’un tel séminaire provient d’une série d’entretiens menés avec des référents l’année dernière …
Voir annexe A
Lier la pensée à une réflexion
Constat : chaque référent pense par lui-même les différentes situations auxquelles il est confronté avec les différents jeunes autistes. Penser une telle situation, c’est l’analyser, décider, agir, tirer les conséquences, voir les résultats des actionsengagées, examiner les réactions, etc.
Ce séminaire va viser en propre moins une telle pensée de chacun que sa propre réflexion.
J’appelle ici « réflexion » un travail méthodique pour mettre des mots sur une pensée.
Réfléchir, c’est toucher à la question des mots mis sur sa pensée. Et c’est sur ce point que le séminaire voudrait agir. Il s’agit donc d’un séminaire de réflexion qui s’adresse à des gens qui ont déjà une pensée à l’œuvre. Et il va de soi qu’un tel type de réflexion (où la pensée se réfléchit dans des mots et dans un discours élaboré) affecte en retour la pensée en question : réfléchir, mettre des mots sur une pensée spontanée affine, déplace, transforme cette pensée.
Il ne s’agit donc pas ici d’un séminaire d’enseignement, ni de recherche de savoirs, moins encore d’un séminaire qui viserait à apprendre à penser telle question dans tel domaine.
Il s’agit d’un séminaire qui encourage la réflexion de chacun en échangeant des réflexions personnelles sur un sujet communs : cette année ce sera la violence…
Travailler collectivement à réfléchir par soi-même
Ce séminaire du Relais veut travailler collectivement à réfléchir par soi-même.
Ce séminaire est celui du Relais non pas au sens où il s’agirait là d’un séminaire qui vise à élaborer une sorte de doctrine du Relais (sur la violence par exemple) mais au sens où c’est le Relais qui propose à ses membres (et à d’autres) un lieu régulier de réflexion.
Les entretiens menés avec les référents le montrent bien : il est important pour la dynamique propre du Relais de ne pas avoir de doctrine précise, de ne pas avoir de « méthode » arrêtée et de favoriser ainsi l’initiative de chaque référent, les essais, les expériences, les tentatives, les échecs…
Cela touche à une vocation centrale du Relais qui est non seulement d’aider les familles ayant des enfants autistes et d’aider les autistes pris en charge mais aussi de donner l’occasion à des « jeunes des Cités » - des jeunes des quartiers populaires, en proie aux difficultés scolaires et aux violences du pays tel qu’il est – de mettre en œuvre leur intelligence et capacités qui ont été déniées et méprisées par l’institution scolaire.
Laisser ouvertes les orientations propres du Relais, c’est aussi une manière de donner à chaque référent l’occasion d’inventer pour son propre compte une relation avec un jeune autiste. C’est une force considérable de notre association. Il s’agit en ce séminaire de la renforcer d’une double manière :
1. en encourageant le passage d’une pensée pratique à une réflexion discursive ;
2. en favorisant l’expression publique de cette réflexion.
L’enjeu des mots…
Un des points difficiles dans cette réflexion est de ne pas être trop prisonnier du langage professionnel (par exemple le langage de l’animation sociale qu’on a pu apprendre au BPJEPS et qu’il faut aussi savoir manier). Penser son travail, c’est aussi penser les mots qu’on utilise.
« On cède d’abord sur les mots et puis peu à peu aussi sur la chose. » Freud (Psychologie des masses et analyse du moi) [1]
Deux périls
1) La langue de bois
Une langue de l’euphémisme. Par exemple :
« Je voulais travailler dans le social et je visais un BEP dans une carrière sanitaire et sociale mais la Principale du collège m’a remise à ma place en me disant : “Vous avez trop d’absences. Je préfère un BEP de secrétaire ou de bio-service.” Je lui ai dit : “Bio-service, ça veut pas dire en fait femme de ménage ?” Elle m’a répondu : “Si vous voulez…”. » Une référente du Relais…
2) Une langue codée qui veut imposer, comme si de rien n’était, des orientations de pensée très spécifiques. Dans ce cas, c’est ici, à la différence de la langue de bois qui parle pour ne rien dire, une langue qui dit quelque chose, qui fait passer subrepticement un point de vue : voir par exemple « la langue médico-sociale », inventée à partir des années 90, faites de sigles et de notions – dont celle de « handicap » - que discute le récent livre d’Yann Diener : On agite un enfant (éd. la fabrique).
Méthode de ce séminaire
Une heure d’exposé (fait de libres réflexions sur un sujet annuel commun) suivie d’une heure d’échanges.
+ un compte rendu ⇒ un polycopié final…
Penser et réfléchir…
Pour orienter ce type de réflexion, trois maximes empruntées au philosophe Emmanuel Kant :
« 1. Penser par soi-même ; 2. Penser en se mettant à la place de tout autre ; 3. Toujours penser en accord avec soi-même. La première maxime est la maxime de la pensée sans préjugés, la seconde maxime est celle de la pensée élargie, la troisième maxime est celle de la pensée conséquente. La première maxime est celle d’une raison qui n’est jamais passive. On appelle préjugé la tendance à la passivité et par conséquent à l’hétéronomie de la raison. […] La seconde maxime de la pensée est celle de l’esprit ouvert qui réfléchit à partir d’un point de vue universel. On appelle esprit étroit (ou esprit borné) le contraire de l’esprit élargi. […] C’est la troisième maxime, celle de la manière de penser conséquente, qui est la plus difficile à mettre en œuvre ; on ne le peut qu’en liant les deux premières maximes. » Emmanuel Kant [2]
Penser par soi-même, sans préjugés
Quels sont les préjugés qui encombrent spécifiquement la question sur laquelle je vais réfléchir ce soir ?
Quels sont les préjugés actuels qui entravent la réflexion par soi-même sur la violence ?
J’examinerai à ce titre deux types de préjugé : le préjugé selon lequel la violence devrait faire l’objet d’un procès systématique (préjugé aujourd’hui dominant : la violence, ce ne serait « pas bien », et il faudrait lutter contre toute forme de violence) comme le préjugé inverse (même si ce préjugé n’a plus guère d’audience aujourd’hui dans notre milieu professionnel) qui procède à un certain type d’éloge systématique de la violence (la violence serait le signe nécessaire de toute libération…).
Penser de manière élargie, universellement
Il s’agit ici de ne pas penser de manière étroite, en fonction de ses intérêts particuliers et immédiats, en restant borné par l’horizon de ce qui se présente comme le plus évident, mais de penser à plus long terme les différents aspects du problème.
D’une certaine façon, le référent est habitué à ce type de pensée élargie car il doit réfléchir les problèmes posés par sa relation avec le jeune autiste du point de ce jeune (et pas seulement de sa position personnelle de « jeune des cités »).
Réfléchir un problème des deux côtés de la relation instaurée, le réfléchir pas seulement en fonction de la situation immédiate mais du point de la vie générale du jeune autiste concerné, avec sa vie manifestement si différente, c’est un réflexe de base du référent. Et si un « jeune des cités » n’arrive pas à l’avoir, cela signe qu’il ne saurait devenir un référent du Relais.
En matière de violence, que voudra dire pour nous « réfléchir de manière élargie les problèmes que pose la violence ? »
J’avancerai l’idée suivante : il s’agit de ne pas penser ces questions de violence du point d’une éventuelle victime. « Victime » va constituer un mot que je vais proposer ici d’éviter – je poserai pour cela la thèse que s’il y a bien des victimes d’agression, il n’a pas à proprement parler de victime des violences (en un sens du mot que je vais m’employer plus loin à préciser).
Je poserai pour cela qu’il faut arriver à penser la question de la violence comme surgissant de l’intérieur d’une relation, non comme une agression venant constituer de l’extérieur une victime.
Penser de manière conséquente
Il s’agit enfin de penser en tirant les conséquences de ce qu’on pense. En ce sens, penser n’est pas affaire d’opinions changeant selon l’humeur.
Là encore, le référent a déjà une certaine pratique spontanée d’un tel type de pensée conséquente : lorsque par exemple il élabore un plan de travail (pour une activité d’animation) sur plusieurs semaines d’affilée. Le référent met ici en œuvre une pensée conséquente, qui a une portée de moyen terme. Il n’est pas simplement dans l’action immédiate, ou la réaction. Il projette, anticipe, élabore des plans, des stratégies, ajuste ses tactiques à ces objectifs stratégiques, etc.
Savoir tirer les conséquences de ce qu’on a pensé n’est pas si facile : on est tenté en effet, devant une difficulté, de changer d’idée (ex. si une difficulté apparaît dans la mise en œuvre d’une idée d’animation, le danger est d’en changer aussitôt comme si une bonne idée d’animation était une idée qui ne posait pas de difficultés, qui ne devait pas rencontrer d’obstacles).
« Pensée conséquente » s’oppose donc à « opinions », à pensée superficielle ou instable…
En matière de violence, quelles conséquences tirer de ce que j’aurai avancé ?
Cela tournera autour de la question suivante : quelles conséquences tirer de l’idée que toute violence est un symptôme, un symptôme qu’il va falloir interpréter pour en tirer des conséquences ?
Ou encore : quels sont les enjeux de considérer que la violence est un symptôme ? Un des enjeux immédiats – une conséquence immédiate - va être que le problème ne sera pas de supprimer ce symptôme, d’éradiquer la violence comme si de rien n’avait été. Il faudra sans doute contenir la violence, l’endiguer certes, la canaliser mais ensuite la comprendre c’est-à-dire comprendre ce qu’elle dit et qui doit être entendu.
II. Qu’appelle-t-on violence ?
Nous avions envisagé plusieurs thèmes : éducation, handicap, violence, sexualité…
Nous avons retenu pour cette première année le thème de la violence.
Expressions diverses
Les mots « violence » (substantif) et « violent » (adjectif) ont énormément d’acceptions. Voici par exemple un petit florilège des expressions françaises dans lesquelles ils interviennent :
— Faire violence à quelqu’un : obtenir quelque chose de quelqu'un contre son gré
— Se faire violence : agir, réagir en maîtrisant ses réactions spontanées.
—
Faire
violence à quelque chose : forcer quelque chose.
— Faire violence à un texte, à une loi : forcer le sens d'un texte, d'une loi.
— Faire une douce violence à quelqu’un : presser quelqu'un de consentir à quelque chose qu'il refuse faiblement, ou pour laquelle il se fait prier.
— Souffrir violence : exiger beaucoup d'efforts.
Étymologie
Pour avancer dans la compréhension de ce mot, de ce qu’il signifie et désigne, faisons un petit détour par son étymologie, donc – comme pour beaucoup de mots du français - par son origine latine.
Analogie de ce point de vue avec la racine (en trois lettres) pour les mots arabes…
Le mot vient du latin vis = 1. vigueur (d’un vent, d’un courant, d’une tempête, d’un poison, d’un animal…) ; 2. force (de la conscience, de la parole, des circonstances politiques…) ; 3. emploi de la force ⇒ « par force », violence ; 4. force des armes, assaut…
La violence relève donc d’un usage de la force (d’une force qui n’est pas nécessairement physique)…
Premier point : quelque chose qui est réalisé avec violence, violemment, c’est quelque chose qui est réalisé de force, qui est réalisé par un passage en force.
La violence est liée à l’apparition, l’émergence, l’irruption d’un passage à la force.
Distinction Nature / relations humaines
Distinguons plus avant.
On dit qu’il y a des vents violents, des tempêtes violentes, des poisons violents, des chocs et des accidents violents.
Je propose ici de ne pas parler pour autant de « violence de la nature » et de réserver le mot « violence » aux rapports qui concernent les être humains.
En ce sens, la violence relèvera d’un emploi humain de la force, et ce vis-à-vis de quelque humain, non vis-à-vis d’un bout de bois, d’une porte…
Je propose donc de soutenir ici qu’il n’y a pas à proprement parler de violence naturelle, de violence de la Nature. On ne parlera donc pas ici de la violence d’une fenêtre qui claque sous la force du vent. Ce type de « violence » n’entrera pas dans notre champ - elle n’appelle d’ailleurs guère de pensée propre.
La violence sera pour nous liée à l’exercice de la force dans une relation humaine (interindividuelle ou sociale ou institutionnelle).
Deux autres distinctions
Introduisons maintenant deux distinctions supplémentaires pour cerner notre question propre : violence n’est pas agression (ou agressivité) pas plus que violence n’est brutalité.
Agressivité
Le mot agression vient du latin gressio = la marche, ou gressus = le pas (de la marche).
Cf. progression / régression / digression / transgression = marcher (ou faire un pas) en avant / en arrière / à côté / à travers.
⇒ ad-gressio = marcher (ou faire un pas) vers…
L’agression implique donc quelque chose qui va vers, s’avance vers…
L’agression vient ainsi de l’extérieur du point où elle s’applique.
Pour nous, l’agression sera exogène (et non pas, comme la violence, endogène à une relation).
L’agression ne relève donc pas vraiment d’une relation déjà existante. Un acte d’agression peut venir de quelqu’un qu’on ignorait jusqu’à présent et qui disparaîtra à jamais une fois son agression perpétrée (quelqu’un que je connais vient dans la rue vers moi et m’agresse, par exemple pour me voler mon portefeuille). Et si l’agression vient de quelqu’un que vous connaissez (une connaissance m’agresse lors d’une réunion), elle est agression dans la mesure exacte où elle survient de l’extérieur d’une situation donnée : si je dis à une connaissance « tu m’agresses », c’est parce que je considère que son propos ne découle aucunement de ce que nous nous disions (ou nous ne nous disions pas) et instaure une rupture de ton et un changement de situation.
On parlera ainsi, dans l’expérience du Relais d’agression lorsqu’un jeune frappe ou griffe un référent qui passe : même s’ils se connaissent déjà, qu’ils ont déjà eu une relation d’animation, on parlera d’agression si l’action survient alors qu’ils ne sont pas en train de travailler ensemble…
Brutalité
Je propose également (à la suite de Jean Genet – voir citation ultérieure) de distinguer la violence de la brutalité.
Le mot brutalité vient du latin brutalis = sans raison (cf. l’animal comme être sans raison) ⇒ (s’)abrutir : devenir animal sans raison…
La brutalité est une suppression de la raison (cette raison qui fonde une liberté de pensée et d’action)…
Brutaliser une relation, c’est détruire son caractère raisonné, c’est détruire dans cette relation cette liberté proprement humaine.
La liberté humaine n’est pas la liberté de l’électron libre (cette « liberté » simplement vue comme absence de contraintes). Elle est la liberté vue comme possibilité de choisir ses propres contraintes, comme responsabilité par rapport à des contraintes assumées.
La liberté d’un référent du Relais ne tient pas au fait d’être sans contrainte mais bien plutôt à la possibilité que ses contraintes – arriver à l’heure, faire bien son travail… - soient des contraintes que le référent assume et qu’il s’en tienne responsable.
Tout de même, la liberté d’un parent n’est pas d’être sans contraintes et de pouvoir faire n’importe quoi mais d’assumer les contraintes du parent qu’il se veut être vis-à-vis des enfants qu’il assume.
La violence n’entretient pas le même rapport à la liberté que la brutalité : certes la violence lutte contre une liberté pour obtenir de force que le partenaire fasse ce qu’il n’a pas envie de faire (c’est en cela qu’elle est violence, exercice de la force contre l’autre) mais elle ne vise pas pour autant à écraser, briser, détruire cette liberté de l’autre. La brutalité, au contraire, ne supporte pas de s’affronter par la force à une autre liberté, ne supporte pas qu’une autre liberté lui résiste et entreprend de supprimer cette liberté qu’elle rencontre.
La brutalité vise à effacer le jeu de la raison. La brutalité veut casser la liberté.
« Il faut dire ce qu’est la brutalité : le geste ou la gesticulation théâtraux qui mettent fin à la liberté, et cela sans autre raison que la volonté de nier ou d’interrompre un accomplissement libre. Le geste brutal est le geste qui casse un acte libre. » Jean Genet [3]
Exemple : père/fils pour aller à l’école…
Ainsi par exemple, un père emmène de force – en le traînant par la main – son enfant qui ne veut pas aller à l’école. À ce titre, on dira que le père exerce une (juste) violence contre son fils (violence qui n’implique en l’occurrence aucun coup mais simplement de le tirer de force). Par contre, il laissera à son fils le droit de manifester son désaccord – le droit de protester, de pleurer, de crier. Il ne laissera pas à son fils le choix d’aller ou non à l’école (puisqu’il le forcera à y aller) mais il ne l’obligera pas pour autant à donner son accord à cette mesure de force prise contre lui.
La brutalité, en ce point, consisterait à ce que le père n’accepte pas que son fils proteste et lui interdise par la force jusqu’à la possibilité de manifester son désaccord. Cette brutalité pourra alors prendre la forme de coups (pour faire taire l’enfant) ou de contraintes morales et psychologiques (chantage à l’affection). Dans tous les cas, ce qui signera la brutalité ne tiendra pas à la contrainte exercée par la force (pour emmener l’enfant à l’école) mais à la volonté du père de supprimer la liberté qu’a l’enfant d’avoir sur cette question de ’école un autre point de vue que celui de son père, d’avoir un point de vue d’enfant qui préfère s’amuser à la maison plutôt qu’aller s’embêter à l’école, etc.
La violence paternelle va emmener l’enfant de force (c’est en cela que l’acte du père est violent, d’une violence auto-contrôlée, auto-limitée) mais ne va pas pour autant viser à casser la colère de l’enfant, à casser sa résistance et son désaccord. Elle va reconnaître le droit de désaccord et de résistance de l’enfant alors que la brutalité va vouloir imposer à l’enfant de ne pas s’opposer ( pire encore : de donner son accord à ce qu’il ne veut pas).
Caractérisation générale : violence et relation
On va donc réfléchir dans le cadre d’un dispositif articulant quatre notions :
|
Actions violentes de la Nature… (pas de relation) |
Agression (exogène :
elle instaure une relation [agresseur/victime]) |
|
|
Violence (endogène :
elle est interne à une relation préexistante) |
Brutalité (brise [la libre raison d’]une relation) |
|
Différents types de violence selon les différents types de relations
On peut alors différencier les relations selon la nature particulière des termes qu’elle rapporte. Je distinguerai ainsi, parmi les protagonistes (j’ai indiqué que j’excluais la Nature et les éléments dits naturels : vent, eau…) :
— des personnes,
— des groupes sociaux,
— des institutions.
D’où théoriquement six types de relations : entre personnes (ex. violence dans le couple), entre groupes (ex. violences entre bandes de jeunes), entre institutions (ex. entre États, ou entreprises), entre personnes et groupes (ex. entre une personne et une bande), entre personnes et institutions (ex. entre une personne et une école), entre groupes et institutions (ex. entre une bande et la police).
|
|
individus |
groupes |
institutions |
|
individus |
Jeune/référent Parent/enfant Violences conjugales |
Un habitant et une bande |
Parent ou jeune/hôpital Un jeune et la police… |
|
groupes |
|
Entre bandes de jeunes |
Une bande de jeune et la police |
|
institutions |
|
|
Entre hôpitaux, entreprises, États… |
J’ai souligné dans le tableau précédent deux types de violence qui concernent plus directement l’expérience du Relais :
— les violences entre personnes : entre un jeune autiste et un référent du Relais ;
— les violences entre une personne et une institution : entre un parent d’enfant autiste et une institution.
III. Penser-réfléchir la violence ?
Ceci posé – il ne s’agit pas à proprement parler de définir la violence, seulement de caractériser ce que j’entends par là -, que penser de la violence, de ce que j’appelle ainsi « violence » ?
Reprenons pour cela les trois directives proposées par le philosophe.
Quels préjugés combattre ?
Deux symétriques : procès / éloge
Procès
Le procès systématique fait à toute violence constitue le préjugé aujourd’hui principal : la violence serait pathologique, anormale. Elle serait un « trouble » du comportement qu’il faut systématiquement éradiquer.
Dans ce préjugé, la violence n’est pas distinguée de l’agressivité. La violence créerait un faible face à un fort. La violence créerait une victime. Et il faudrait que des forts viennent de l’extérieur protéger la victime qui serait par définition sans force.
Ce préjugé consiste alors à opposer ici à la violence d’une part la non-violence de la victime et d’autre part un monopole de la force (par la police et plus généralement l’État et ses institutions).
Cette idéologie de la victime vise à entretenir l’idée d’une faiblesse inéluctable chez les gens et à légitimer l’existence d’un monopole de la force (dans l’État, les institutions et les groupes forts…).
Remarque
Je présente en annexe C le point de vue soutenu par une policière concernant le traitement policier des « violences en milieu hospitalier ». On comprend entre les lignes qu’il s’agit là exclusivement des réactions violentes des usagers, vis-à-vis – on l’imagine – de graves troubles du fonctionnement de l’institution hospitalière.
Ces propos, publiés dans le journal d’une mutuelle (destiné à tous ses adhérents), témoignent d’une consternante « pensée » sur la dite violence :
— La violence est systématiquement confondue avec l’agression.
— Les origines des dites violences (dans la nouvelle politique hospitalière) n’est jamais discutée.
— L’institution se trouve ainsi exemptée de toute responsabilité dans la nouvelle relation qu’elle institue avec ses usagers : s’il y a plus de « violences » qu’avant, est-ce parce que la nature des gens aurait soudainement changé ou ne serait-ce pas plutôt parce que la relation que l’hôpital instaure aux patients est en train de considérablement changer ?
— Et la réponse à ces « violences » relève exclusivement d’une logique « sécuritaire » promettant de mieux protéger des victimes.
Éloge
Le préjugé inverse – celui d’un éloge systématique de toute violence - est aujourd’hui plus démodé, du moins dans notre pays, mais cela ne l’a pas toujours été (cf. le culte de la force physique et brute dans de nombreux films).
En un sens, Genet s’est aussi fait l’apôtre d’un tel éloge de la violence, au prix d’une torsion certaine de l’étymologie :
« Violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l’œuf, la fécondation de la femme, la naissance d’un enfant relèvent d’accusation de violence. Et personne ne met en cause l’enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. […] La brutalité vient s’opposer toujours à la violence. La violence seule peut achever la brutalité des hommes. » Jean Genet [4]
Liant violence et vie, il symétrise ici brutalité et violence…
À tout prendre, je préfère de lui cette belle citation :
« Je nomme violence une audace au repos amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire, et c’est en vous qu’elle produit les remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. » Jean Genet [5]
Quels intérêts particuliers menacent une pensée de la violence ?
Aborder les questions de violence sous un angle particulier veut le plus souvent dire les aborder sous l’angle des intérêts d’une supposée victime de cette violence.
Je soutiens ici qu’il faut penser la violence d’un tout autre point : du point qui relie celui qui exerce la violence et celui qui la subit (sans que ce dernier en devienne pour autant une victime), c’est-à-dire du point de la relation (devenue violente) qui relie les deux termes de la relation. Soit l’idée que le passage à la violence de l’intérieur d’une relation dit quelque chose sur ce qu’est cette relation – où l’on retrouve qu’une violence diffère d’une agression.
Soit penser la violence comme une relation, certes dissymétrique (qui l’exerce / qui la subit) mais relation quand même.
Ainsi celui qui subit la violence en question s’avère partie prenante de cette relation d’où a jailli la violence ; il n’y est pas étranger. Cette violence constitue un devenir autre d’une relation qu’il entretient lui-même de l’intérieur.
Ma proposition va être alors la suivante : la violence doit être pensée comme un symptôme de la relation dans laquelle elle apparaît de manière endogène et non pas seulement comme une aberration issue de l’extérieur (selon une pathologie appartenant en propre à l’un des termes de la relation en question).
Quelles inconséquences menacent une pensée de la violence ?
Le problème est alors : de quoi cette violence particulière à tel moment particulier de cette relation particulière est-elle le symptôme ? Ceci engage bien sûr le moment de l’interprétation du symptôme. Puis le moment de déduction : quelles conséquences faudra-t-il tirer de cette interprétation du symptôme ?
Comme Kant nous l’indique, le plus difficile est ce troisième point : celui de la conséquence à tirer de ce type de pensée. Et ce point des conséquences à tirer engage un rapport entre les deux points précédents (entre pensée sans préjugés et pensée élargie) : la pensée sans préjugé nous a mis sur la piste d’une violence conçue comme émergence de la force dans une relation ; la pensée élargie nous a suggéré que cette émergence constituait un symptôme pour cette relation (et pas seulement une aberration de comportement vu exclusivement du côté d’une supposée victime). Il faut maintenant prendre au sérieux ce symptôme du point de ses conséquences, savoir penser ses conséquences de l’intérieur même de la relation mise en jeu par le nouvel acte de violence.
Un symptôme en effet n’est pas à supprimer trop vite. Ce n’est pas une éruption à effacer tout de suite. Car un symptôme dit quelque chose qu’il s’agit de comprendre ; si on se contente de le supprimer, un autre symptôme reviendra dire autrement ce qui n’a pas été entendu et traité.
D’où nécessairement, dans la réflexion sur les situations de violence, d’une analyse de cas : de quoi telle violence est-elle le symptôme ?
Soit la dernière idée que je propose : il y a des violences différentes, et chacune de ces violences doit être analysée cas par cas. Il n’y a guère lieu de théoriser la violence en général. Il faut plutôt penser et réfléchir les situations cas par cas, de manière monographique.
IV. Pour une analyse de cas
Deux types de cas me semblent centraux dans l’expérience interne du Relais (même si l’idée de ce séminaire n’est nullement de se cantonner à l’expérience directe du Relais). Je privilégie donc ce soir ces deux cas pour faciliter l’incorporation de chacun à ce nouveau séminaire, non pour centrer l’ensemble de nos rencontres sur les expériences directes du Relais.
Je vais ce soir examiner le premier, et me contenter d’indiquer le second, le renvoyant à l’exposé – peut-être – de Daoud.
Jeune/référent
L’importance de la violence dans les relations bilatérales jeune/référent sont attestées dans les entretiens précédemment mentionnés. J’ai rappelé quelques considérations sur ce sujet dans l’annexe B.
Annexe B
Trois aspects me semblent en ressortir.
Remarque
Je ne suis pas référent. Je ne connais pas de l’intérieur le travail des référents, et je ne sais d’ailleurs pas si j’en serais moi-même capable. J’ai vu à de nombreuses reprises ce travail mais ne l’ai jamais pratiqué. Je dois donc m’en tenir ici à des constations tirées de ce qu’on m’en a dit ou de ce que j’ai vu, sans pouvoir me situer de l’intérieur d’une telle relation devenant à tel ou tel moment violente.
Disons que j’ai eu moi-même à faire face à des « agressions » de jeunes mais jamais à leurs « violences », faute d’entretenir moi-même de vraies relations avec tel ou telle.
Je ne ferai donc ici qu’esquisser des pistes de réflexion, très modestes.
Importance de la relation
Première idée : le matériel de travail du référent est la relation qu’il instaure avec le jeune.
Ce point n’est pas à sous-estimer : un jeune des Cités devient référent en endossant la constitution d’une telle relation. Et son travail va ensuite porter certes sur le jeune mais sur le jeune en tant que saisi par la relation en question. Disons que la relation va être l’opérateur fondamental du travail avec le jeune (travail avec lui tout autant que sur lui).
La violence introduite par un jeune dans cette relation
Deuxième idée: le référent est amené à savoir opposer une contre-violence (auto-contrôlée, auto-limitée) à telle violence impulsive (parfois incontrôlée) du jeune : par exemple il va devoir le contenir, le plaquer au sol, contrôler ses membres… Tout ceci désigne un exercice de la force (physique et mentale) sur le jeune qu’il convient d’appeler violence (même si bien sûr le référent s’interdit les coups – encore que dans certaines circonstances bien précises une bonne gifle puisse être aussi envisagée).
Où l’on vérifie le principe : la violence appelle la contre-violence.
Remarque sur la non-violence
Lisez la vie de Gandhi ! Vous verrez qu’il a prôné en différentes circonstances la violence, et même la violence brutale (pendant les deux guerres mondiales par exemple).
Et par ailleurs, la dite « non-violence » relève en fait de la constitution explicite d’une force, nullement l’étalage d’une faiblesse qui livrerait les populations au bon vouloir des dominants. La dite « non-violence » n’était pas l’exploitation publique d’un statut de victime… Il s’agissait plutôt, dans le cadre de mon dispositif notionnel, de non-agression et de non-brutalité.
Mais il est vrai qu’il s’agit là d’une situation de type politique, très différente donc des situations jeune-référent…
Remarque sur l’agressivité
Dans cette relation référent-jeune, il est essentiel de distinguer la violence de l’éventuelle agressivité du même jeune contre tel ou tel qui passe.
Et d’ailleurs, les deux phénomènes ne sont pas en pratique traités de la même manière : l’agression est stoppée tout de suite. La violence, par contre, ouvre à un processus, d’abord de contre-violence contrôlée par le référent, puis d’explication, puis de discussion. Elle ouvre à un protocole – échange – entre eux deux, etc.
On voit bien que le référent ne se pose pas ici en victime du jeune, ne se pense pas comme victime – comme faible – mais comme force attaquée par le jeune en tant que telle c’est-à-dire en tant que force.
Il ne s’agit pas pour autant que le référent donne droit au jeune d’exercer contre lui la violence mais simplement qu’il interprète de quoi cette violence est-elle le signe, ce qu’elle signifie pour le jeune, en particulier pour ce jeune en regard de son référent : le référent est-il ici visé pour sa personnalité particulière, au contraire pour ce qu’il représente (l’adulte, le grand frère, le père ou la mère, le personnel d’institution…) ? Se trouve-t-il identifié de manière indue ou à raison ? Etc.
Quel processus viser à partir de l’irruption d’un tel symptôme ? En général, il s’agit d’abord de contenir la violence proprement physique, puis de la limiter au maximum, quitte pour cela à faire usage de la violence symbolique (voir à Top Gan l’interrogation récurrente de ce jeune autiste que tout le monde connaît bien : « Qu’est-ce que tu fais, Daoud, si je tape ? »…)… Il y a ainsi un usage contrôlé, orienté, d’une contre-violence par le référent pour traiter ce dont la violence du jeune est le symptôme.
Ou encore : on travaille la violence irruptive du jeune par une contre-violence contrôlée et réfléchie.
La violence subie par ce jeune dans son institution…
Comme un exemple nous en est rapporté à la fin de l’annexe B, il est important de prendre en compte la violence que l’institution psychiatrique peut par ailleurs faire subir au jeune concerné si l’on veut comprendre ce dont la violence du jeune vis-à-vis du référent est le symptôme.
Ce symptôme est complexe car il est le symptôme d’une situation embrouillée, mettant en jeu de nombreux acteurs.
Parent/institution
Le récent mémoire de Daoud explore un autre type de violence auquel le Relais se trouve indirectement mêlé qui est la violence exercée par les institutions spécialisées contre les parents des jeunes dont nous nous occupons : violence de l’exclusion, souvent dissimulée derrière de faux prétextes dont le moindre n’est pas « que le jeune est violent ! ». Cela reste quand même un singulier paradoxe qu’une institution, en charge de s’occuper des jeunes autistes et psychotiques, susceptibles donc d’avoir des comportements violents, déclarent refuser de s’occuper d’un jeune… parce qu’il est précisément susceptible d’être violent ! Pour le coup, la violence de ce refus adressé au parent du jeune en question est considérable, même et surtout parce que cette violence n’est pas physique.
Mais je laisserai Daoud en parler éventuellement lors de sa prochaine intervention car je n’en connais que ce qu’il en a écrit.
Annexes
A. Pourquoi un séminaire ?
(extraits d’entretiens avec des
« référents » du Relais)
Penser chaque situation
« Quand la situation est compliquée,
c’est parce qu’elle est compliquée pour le jeune : il faut alors trouver
une solution à sa difficulté à lui, et c’est cela que je trouve intéressant. On
sait par exemple qu’un jeune a une capacité mais on va sentir qu’il a
peur : mettons ainsi qu’il a peur du vertige dans l’accrobranches mais
qu’il a envie d’en faire. C’est là que la situation devient compliquée :
il sait pas comment s’en sortir. On va alors passer une heure, deux heures, ou
deux semaines pour trouver un outil (par la parole, ou par du matériel) pour
débloquer le jeune. Pour un autre, ce qui sera compliqué, ce sera de rester
avec un groupe. Il m’arrive même des nuits de me prendre la tête pour me
dire : comment faire avec tel jeune pour le débloquer, pour qu’il arrive à
faire ceci ? Quand cela concerne des jeunes, je peux regarder le soir la
télé mais en fait je ne regarde rien, je me prends la tête pour eux, et le
matin, je me réveille, j’ai mal dormi parce que je n’ai pas trouvé la
solution ! Alors, dès que je revoie le jeune, j’essaie un truc et, si cela
marche, je suis super content ! En plus, comme on est un groupe, on parle
entre nous, et j’aime bien les échanges avec les référents. »
Parler (de) ce qu'on fait, réfléchir…
« La difficulté, c'était de parler de ce
qu'on fait sur le terrain. C'est dans ce sens-là que j'avais du mal. Du coup,
la formation m'a fait beaucoup avancer. J'arrive mieux à parler de ce que je
fais. »
« Au début, quand j’ai commencé avec le
Relais, je n’ai quasiment pas parlé en réunion. À cette époque, il y avait tous
les soirs à Top Gan une réunion avec un tour de table où chacun parlait de sa
journée, de son jeune. Moi, je ne disais que trois mots, toujours les
mêmes : “W., c’est W.!”.
Pendant trois ans, je n’ai dit que cela, et même à la fin, c’est les autres qui
le disaient pour moi ! »
« Mettre des mots, cela m’a permis de me
rendre compte de la complexité du travail, de choses que je faisais pourtant
naturellement. Je me suis rendu compte qu’il y a des gens qui ont écrit des
bouquins pour expliquer cela. Je me suis rendu compte que c’était complexe.
Quand j’ai commencé à apprendre sur l’autisme et sur le handicap, quand j’ai su
mettre des mots sur mon travail, je me suis rendu compte de tout cela. Cela
s’est fait dès mon premier séjour à Top Gan avec les bilans qu’il fallait
écrire tous les soirs. Quand j’écrivais mon bilan, je le faisais
sérieusement. »
« Je ne sais trop expliquer ce qui
m’attire dans ce public. Je ne trouve pas les mots. Ce n’est même pas que je ne
trouve pas les mots ; c’est qu’il n’y a pas les mots pour l’expliquer. En
réalité quand je parle de mon travail dans mon quartier à mes amis, que
j’explique que mon travail, c’est avec des autistes, quand je parle des
situations dans lesquelles on se trouve, qu’on est mordu, tapé, qu’on doit les
changer, que lorsqu’on se promène dans la rue avec eux, tout le monde nous dévisage,
etc., mes amis me disent : “Mais pourquoi tu fais ce travail ? Tu
es un fou ! Je ne pourrai pas travailler là-dedans !” Ils ne comprennent pas, et je n’arrive pas à
leur expliquer pourquoi je reste. Quand on a fini le BPJEPS, cela a été pareil.
Les formateurs m’ont demandé : “Qu’est-ce que cela a changé chez
vous ?”. Je ne suis pas
arrivé à expliquer. J’ai l’impression que cela m’est resté : quand je pense
à un truc, des fois, je n’arrive pas à l’expliquer. »
« Le travail avec les autistes demande
beaucoup de réflexion. Cela commence par l’observation. Ensuite, il faut se
demander : qu’est-ce qu’il a comme acquis ? Qu’est-ce qu’on peut
faire ? Comment se projeter avec lui ? Et c’est là tout un travail en
équipe, et en réseau. Tout cela, ce sont des choses que je ne connaissais pas
du tout avant. Avant, je n’avais pas tout cela : pas de réunions, pas
d’études. Dans l’autisme, il faut étudier le cas du jeune. »
Étudier, apprendre, se former…
« Ce qui m’a donné envie de continuer les
études après le BPJEPS, c’est l’envie d’apprendre plus. Je refais des études,
car à nouvelle méthode, nouvelle théorie. Au Relais, on a beaucoup de terrain,
mais on n’a pas beaucoup de théorie. Là où l’on peut “gratter” de la théorie,
on va pouvoir apprendre. »
« Mon métier me permet de toujours
apprendre. Et, sur l’autisme, sur le handicap, on en apprend tous les
jours ! Pour moi, chaque chose qui peut me permettre d’avancer dans mon
travail, je le prends. »
« Pour moi, c’est vraiment le jeune qui
apprend au référent comment faire. Mais, à côté, il faut que le référent soit
intelligent, attentif aux réactions, pas fermé sur lui. C’est à partir de là
qu’il y a l’envie de théorie. La théorie, c’est pour avoir de nouvelles
méthodes, pour savoir ce qui marche, pour être en accord avec l’équipe. Dans le
travail en lui-même avec le jeune, ce n’est pas la théorie qui va faire la
différence. Je dirai : à 80%, c’est la personne du référent, et à 20% la
théorie… »
« Pour moi, dans ce domaine, on est
toujours novice ; on en apprend de jour en jour. »
« Penser par soi-même »…
« Dans le Relais, on a une équipe mais on
n'a pas une seule méthode. C'est chacun sa pratique, chacun sa méthode ;
c'est toutes les méthodes. Chacun, même le nouveau, a sa méthode. À partir de
là, on s'appuie sur tout. On fait un mélange pour inventer sa propre méthode. »
« Au Relais, il n'y a pas une
méthode-type. Du coup, on voit les méthodes que les anciens mettent en place,
on rajoute notre grain de sel et on voit si cela marche ou pas. C'est ce qui
fait qu'au Relais, on favorise les nouveautés. Et ça, c’est très
intéressant : on voit chaque personne apporter une méthode qu’on peut
mettre en place avec notre entourage. »
« À l’école, on apprend des choses, mais
c’est plutôt du formatage : tu apprends une leçon, tu répètes, il n’y a
pas vraiment de place où la personne se sent réfléchir par elle-même, si ce
n’est en philosophie… Alors que là, si j’avais commencé ce travail et qu’on
m’avait dit : “c’est comme ça, c’est pas comme ça” sans me demander “pourquoi tu fais comme
ça ?”, ça
aurait été plus compliqué pour moi, je n’aurais pas pu m’épanouir, découvrir
les jeunes et en même temps me découvrir. »
« Ce travail m’a appris à analyser les
situations qui peuvent se passer, à analyser les jeunes et les référents, à
parler avec les gens (je parlais peu avant cela). »
« Penser contre les préjugés et a priori »…
« J’étais
partie avec une image à la limite dégradante des autistes, avec des
préjugés : “ils ne comprennent pas, il est impossible d’entrer en
contact avec eux…” Quand on voit ensuite que c’est erroné,
c’est alors doublement enrichissant : ce sont des personnes normales, et
en plus elles sont autistes. Ce ne sont pas des personnes à part, mais des
personnes à part entière, avec une pathologie en plus… »
« Au
début, je n’étais pas autant impliquée, car j’avais toujours dans mon esprit
l’image qu’on pouvait percevoir des autistes au travers des préjugés qui sont
loin d’être des vérités absolues. »
« Avec
un enfant, on n’a pas le temps dans un Centre de créer des relations durables
alors que dans une colonie, il y a le temps, et les relations ne sont pas
pareilles, et on ne part pas avec les mêmes préjugés : si on découvre que
tous les préjugés tombent à l’eau, cela nous étonne de jour en jour et on a
plus envie d’aller vers le jeune vu qu’on peut découvrir ce qu’il ressent, ce
dont il est capable. »
« Le
premier jour passé au Relais a été pour moi super bizarre : j’étais un peu
dégoûtée car je n’avais pas l’habitude de voir des jeunes autistes. Je me suis
dit : “dans quoi je me suis embarquée ?” En
rentrant chez moi, je trouvais tout cela bizarre mais je voulais aller au-delà
de mes a priori et voir ce que c’était réellement. J’ai donc contacté Daoud
pour lui dire que je voulais bien rester. Et finalement j’ai eu raison de
relever le défi que je m’étais fixé quand je m’étais demandé après le premier
jour : “je fais quoi là ?” et que je m’étais
répondu : “Si tu pars maintenant, t’es trop bête ! Reste au moins
pour voir ce que cela va donner. Partir le premier jour, cela la fout
mal !”. En effet, si j’étais partie, je serais
restée sur des a priori qui finalement ont été faux. »
Élargir l’espace de pensée et de réflexion…
« Beaucoup de référents ne se voient
travailler qu’au Relais. Au Relais, il y a des gens qui restent trop rapidement
dans le seul travail avec les autistes, qui sont vite absorbés par la dynamique
de groupe ce qui fait, qu’en-dehors du groupe, ils ne font pas long feu. Il y a
ainsi pas mal d’exemples de référents qui travaillent bien, qui sont disponibles
et motivés, mais dès qu’ils quittent le Relais pour aller dans une autre
structure, au bout d’un an, ils vont arrêter. »
B. Quand la violence intervient dans une relation jeune/référent…
(extraits d’entretiens avec des
« référents » du Relais)
La matière du travail, c’est une relation…
« À la base, avec un autiste, cela commence par une relation. »
« C’est en fait le jeune qui forme
le référent, parce que, quand on propose à un jeune de faire quelque chose, de
faire une activité, le référent doit être capable de s’adapter à lui. Comme
tous les jeunes sont différents, on s’adapte forcément et cela entraîne un
travail sur nous. Par exemple cela apprend à parler avec un jeune de façon
posée, ou avec des gestes, ou en le regardant bien dans les yeux, ou au
contraire en ne le regardant pas dans les yeux. Tout cela est formateur ;
à chaque fois, il faut s’adapter. Pour moi, ce sont les jeunes qui forment les
référents. »
« Moi, je pense vraiment que
le seul formateur, c’est le jeune. Pour voir si un référent travaille bien, si
le jeune va bien, je le vois dans la relation avec le jeune : si
cela lui a plu. Et cela se voit dans tout le travail, et pas seulement au début
ou à la fin. L’activité n’est jamais linéaire : c’est comme si toutes les
trois secondes, il fallait remettre à jour le programme tout en gardant la
ligne conductrice où l’on veut emmener le jeune. »
« Je me suis occupée cette
fois de M. et j’ai eu avec elle une relation fusionnelle, très basée sur
l’affection, les câlins. […] Régulièrement, je voyais le fruit de mon travail,
de notre travail. C’est dû à la relation de confiance. »
« S’occuper des petits enfants,
c’est une chose, mais là, dans le Relais, ce sont des personnes, et ce n’est
pas le même retour : ce n’est pas la même joie, celle d’un petit enfant et
celle d’un autiste. Cela fait des relations différentes. Avec le petit,
on n’a pas le temps dans un Centre de créer des relations durables alors
que dans une colonie, il y a le temps, et les relations ne sont pas
pareilles. »
« Pour le côté humain de la relation,
il n’y a pas grand changement entre être avec ou sans formation, mais cela joue
par contre dans le côté professionnel : comment mettre en place une
séance, comment rédiger un projet, etc. »
« J’ai approché ce jeune sans appréhension car je ne me faisais
plus peur pour rien ; je me suis jetée dans cette relation alors
que celle-ci était vraiment dangereuse. Mais il y a eu un déclic chez ce
jeune : il a dû sentir que je ne le rejetais pas. Je lui ai montré que
j’étais avec lui malgré les hauts et les bas et que je ne le lâcherai pas.
Après cela, j’ai continué de le voir. J’ai fait des remplacements et je
m’occupais de lui. Notre relation a continué. Il avait besoin d’avoir
confiance dans la personne en face de lui et je lui ai donnée cette confiance
car j’étais alors plus solide. »
« C’était valorisant de voir
que ce jeune posait d’énormes difficultés et que moi, sur trois semaines,
j’avais pu créer une relation avec lui. »
« Dans le travail avec les
autistes, ce qui m’intrigue le plus, c’est leur mutisme. Ils sont toujours dans
le silence, recroquevillés sur eux-mêmes, et je me demandais comment créer avec
eux une relation autrement que par la parole. Comment comprendre
autrement que par le langage ? C’est intriguant, c’est un mystère et ce
genre de mystère m’a bien plu : c’est dur, mais c’est attachant. »
Violence introduite par un jeune
« Les nouveaux référents,
quand ils rentrent dans le bain, ils pensent qu’être un vrai référent, c’est
savoir gérer une crise ; donc ils vont faire le maximum pour savoir gérer
une crise lourde, et ils vont se penser comme référent à partir du moment où ils
savent gérer ce genre de situation – quand ils savent encaisser les coups,
contenir le jeune… L’inconvénient, c’est qu’ils vont alors penser qu’ils n’ont
plus rien à apprendre à partir de là ! L’avantage, par contre, c’est
qu’ils n’ont plus peur de travailler avec des jeunes violents. »
« Au début on avait des cas
très compliqués : des jeunes venant des hôpitaux psychiatriques ou sans
structures (avec des familles débordées), des jeunes très violents… Moi
qui ne me laisse pas faire, qui aime revendiquer, avec eux c’était
différent : ils pouvaient me mettre des claques, je ne disais rien alors
que dans un autre contexte, j’aurais réagi au quart de tour. Ils m’ont appris
la patience. Il fallait que je leur donne quelque chose et, eux, ils me l’ont
rendu mais sans me le dire. Ils m’ont rendu la possibilité de mûrir, de voir la
vie différemment, de prendre du recul – sinon, je fonçais tête baissée. J’ai
appris à prendre sur moi. »
« J’ai vu un jeune sur la
terrasse. Il était avec l’homme de maison qu’il griffait, tapait, mordait. Je
me suis dit : “C’est quoi ça ?”. Je n’ai pas eu peur. C’était pourtant le plus violent
de tous. J’essayais de comprendre ce jeune. À un moment, j’ai décidé d’y aller.
On m’a dit : “N’y va pas ! Il va te taper. Il faut les laisser.” Je ne comprenais pas : dans ma
philosophie, quand il y a des difficultés, on va aider son collègue, c’est un
devoir. Mais surtout, au-delà du devoir, j’étais attirée. On me l’a interdit,
et j’étais frustrée. Pendant toute la journée, je ne faisais que le regarder.
Il y avait autour de lui comme un périmètre de sécurité. Il est resté énervé
toute la journée. J’avais envie de le comprendre. Le lendemain, quand je suis
arrivée, j’ai été directement vers lui. L’homme de maison qui continuait de
s’en occuper – les éducateurs étaient débordés – m’expliquait les difficultés
mais lui ne me disait pas : “Ne viens pas !”. C’est comme cela que j’ai pu le découvrir.
Ensuite, je l’ai amené à Top Gan et là, il m’a beaucoup marqué. Il était trop violent.
On sentait une vraie souffrance. Il tapait tout le monde tout le temps. On
était deux à s’en occuper et les gens de la colonie nous appelait la BAC
(Brigade anti-criminalité) car on formait comme un bouclier pour protéger les
autres et pour prendre, nous, les coups. Bientôt mon collège a craqué et m’a
abandonnée. J’ai dû m’en occuper toute seule, mais ce qu’il y a eu de
magnifique dans cette rencontre, c’est que la première semaine, il frappait
tout le monde, la deuxième il ne me frappait plus mais continuait de frapper
les autres, y compris mon collège, et la troisième semaine, il ne frappait plus
personne ! Au total, j’ai adoré : je pouvais désormais être assise à
côté de lui sans être en mode panique. »
« Ces jeunes avaient beaucoup
de capacités, et avec ces capacités, ils pouvaient faire beaucoup de choses.
Ils pouvaient par exemple sortir devant beaucoup de monde sans se mettre à
toucher tout le monde – les rapports qu’on lisait sur eux disaient pourtant
qu’ils étaient violents, qu’il fallait faire attention aux personnes qui
les approchaient… - et, finalement, quand on était avec eux dans un lieu
public, cela ne se passait pas comme cela. C’est peut-être aussi que lorsqu’on
est avec eux, on les protège. »
« Avec M., je me suis
dit : “elle peut me taper, s’énerver”. Et au final, j’ai vu qu’elle pouvait taper mais que
c’était pour des raisons et pas pour rien : c’était par exemple parce
qu’elle voulait s’accaparer un objet, et surtout au-delà de ça, il y avait
tellement de côtés positifs que cela effaçait les autres. »
« Au début, j’avais beaucoup
d’appréhension car, avant même le séjour, on m’avait prévenue que la jeune dont
j’allais m’occuper était un cas très lourd. J’avais de plus, venant de
différents référents, des échos sur elle qui étaient positifs mais aussi
négatifs : elle pouvait être très violente quand elle faisait des
crises, et il fallait être alors plusieurs en cas de violence. Tout ceci
me faisait peur. Il m’a fallu me préparer psychologiquement. Quand je suis
arrivée au séjour, tout s’est finalement très bien passé. Il y a eu quand même
des crises dont l’une a été très violente. Cela m’a choquée et j’ai dû
être aidée de deux référents hommes. C'était la première crise violente
que j'ai dû essayer de gérer. Je me souviens avoir eu besoin après cela d’une
heure pour reprendre mes esprits et me préparer à d’autres crises similaires.
Mais finalement le séjour s’est bien terminé. Par contre, chez elle, elle a
fait une fois une crise qui m’a vraiment surprise. J’étais alors seule à son
domicile avec elle. Sa crise est partie sur une histoire de douche. Elle est
devenue très violente, a tenté de m’étrangler, a jeté toutes les
affaires de mon sac. On s’est retrouvé un moment dans la cuisine où il y avait
plein de couteaux et je me suis sentie très faible face à cet évènement, déboussolée.
J’ai tout de même réussi à l’isoler et à appeler son père. »
« J’étais à Top Gan avec C.
C’était bien. Il faut dire que l’autisme, c’est différent pour chacun. Avec C.,
à la fin, on croyait qu’on était frère et sœur. C’était un jeune qui aimait
mordre. Il fallait donc le maîtriser. Et j’étais sa référente, pas son amie. Il
fallait avec lui constamment recadrer les choses car il essayait d’aller
au-delà des limites. Il fallait le canaliser, trouver des subterfuges, des
astuces. Je craignais de mal travailler. C’était tout le temps avec lui un
corps à corps : j’aimais pas trop ! J’avais peur d’abuser, j’avais
peur de la violence, et il y avait avec lui une différence de gabarit…
Mais finalement, cela a été tout le contraire : Bidou a trouvé que je
faisais un bon travail – le précédent référent n’arrivait pas à gérer C. Ce Top
Gan a été très gratifiant : ce n’était pas un effort vain. Et le jeune
était aussi attachant. »
« Dans les situations de
crise et de violence, je ne savais pas comment faire. C’était
hyper-compliqué, mais cela vient avec le temps… Heureusement le premier jour,
j’ai commencé avec un jeune qui n’était pas violent, et cela a
été. »
Violence à l’égard d’un jeune
« A., quand on va le
chercher, il est enfermé à l’hôpital psychiatrique ; il est dans une
chambre d’isolement ; il a un seau et un lit. Il ne sort pas de sa
chambre. Il prend ses repas dans cette chambre. Un jour, je suis parti le chercher.
Il faisait chaud. Sa chambre était un vrai sauna : on ne pouvait pas y
rester cinq minutes ! Il y a plein d’épisodes comme cela. C’est aussi pour
cela que je me suis intéressé de plus en plus à ce travail. Quand on ramène le
jeune, ce n’est pas facile de le laisser là. On dit : “C’est la galère,
mais au moins, cette journée, tu en as bien profité” et on sait qu’on reviendra le samedi d’après. C’est
particulièrement dur pour un jeune comme M. Il parle, il n’est pas autiste, il
est psychotique. Il a beaucoup de soucis. Il vit enfermé à clef dans sa chambre
et des fois il faut être brutal pour le faire rentrer dans cette chambre… Ce
qui est plus compliqué encore, c’est le retour de Top Gan car là, la sortie a
duré deux à trois semaines. Pour les cas les plus lourds, ce sont les
infirmiers qui viennent les récupérer à la gare. Par exemple pour A., il y a
deux ambulanciers. Ils ne discutent même pas avec lui. Ils l’attachent sur le
siège arrière et c’est parti pour l’hôpital… Cela, c’est plus difficile à
accepter que le retour du samedi. »
C. Exemple de préjugé ordinaire en matière de violence :
le procès fait aux « violences à l’hôpital »
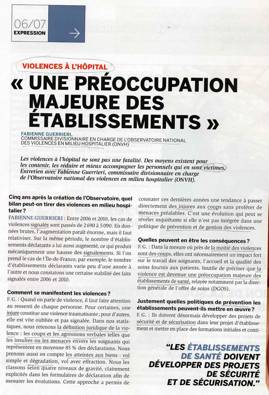

*
Discussion
Comment caractériser le point de vue spécifique de qui subit la violence (sans pour autant se constituer en victime) ?
Bien sûr, le premier temps de la réaction va être occupé à contenir, avec les moyens du bord (c’est-à-dire les moyens disponibles dans la situation en question), la violence apparue.
Le second temps va s’attacher au fait que cette irruption de la violence donne quelque chose à penser à qui l’a subie : de quoi cette violence subie est-elle le symptôme, dans une relation entretenue, volontairement ou non, à cette personne (ou à ce groupe ou à cette institution), et quelle conséquence alors en tirer : donner un nouveau tour à cette relation, ou l’interrompre provisoirement/définitivement… ?
Mais alors, si j’ai bien compris, il y a de la violence partout, et il y a aussi une bonne violence ?
Oui. L’exercice de la force est bien omniprésent. Il faut donc l’aborder avec lucidité, sans se payer de faux semblants…
Quand un ou plusieurs référents contiennent de force la violence d’un jeune, le point essentiel est de donner un « contenant » à cet usage réactif de la force : d’expliquer ainsi au jeune qu’on fait cela pour son bien. Il ne s’agit pas là « d’une violence pour la violence »…
Oui, mais existe-t-il vraiment de la « violence pour la violence » ? Ce n’est pas sûr, et l’hypothèse suivie dans l’exposé est plutôt que l’irruption de la violence de l’intérieur d’une relation signifie quelque chose, dit (ou tente de dire) quelque chose (sur cette relation ou sur autre chose) et qu’elle n’est donc pas purement « gratuite ».
Ce qui est frappant, c’est que les référents abordent spontanément les accès de violence des jeunes précisément comme des symptômes. D’où leur vient cette capacité (que par exemple certains policiers, inopinément confrontés à nos jeunes et les traitant parfois comme s’ils étaient des délinquants banaux, ne semblent pas avoir) ?
On peut penser d’abord que les référents ont plus l’intelligence des situations concrètes que les policiers en question (il s’agit là bien sûr d’une intelligence formée par les histoires personnelles et non pas innée : de ce point de vue la formation de la rue en matière d’intelligence des situations interpersonnelles est sans doute meilleure que la formation dispensée par la police aux policiers…).
De plus, le référent sait pourquoi il se retrouve en face d’un jeune. Il n’aurait peut-être pas eu la même réaction s’il avait inopinément croisé le même jeune autiste dans sa cité et reçu de lui le même coup.
Tout ceci rejoint ce point frappant : la relation jeune-référent est une relation qui invente le référent, une relation où le référent s’invente comme référent ; le référent devient référent en devenant partie prenante d’une relation personnelle avec un jeune autiste (de ce point de vue, la relation est évidemment dissymétrique car le jeune autiste ne devient pas autiste à l’occasion de cette relation au référent).
Si l’irruption de la violence de l’intérieur d’une relation existante doit bien être prise comme un symptôme, il ne faut pas réduire ce symptôme à n’être le symptôme que de cette relation mais il faut prendre aussi en compte ce qu’il peut y avoir là de symptôme concernant chaque personne séparément. En particulier, ce pourra être aussi le symptôme de la situation personnelle propre au jeune autiste concerné…
En effet.
Ceci rejoint le point précédent : pour le référent, la relation au jeune est constituante (elle le constitue comme référent puisqu’il n’est pas référent avant d’avoir noué cette relation) alors que pour le jeune autiste, la relation au référent est constituée (le jeune existe comme autiste avant même cette relation et c’est bien à ce titre de jeune autiste qu’on lui affecte de l’extérieur un référent).
Donc, ce dont la violence exercée par le jeune autiste (dans le cadre de cette relation pour lui constituée) est le symptôme renvoie assez logiquement à ce qu’il vit ou a vécu en-dehors de cette relation plus encore qu’à ce qu’il vit dans le cadre de cette relation.
Autant dire qu’interpréter le symptôme en question, démêler l’écheveau de ce qu’il signifie, ne va guère de soi et mobilise une polyphonie de sens.
On peut avoir quelque réticence à dire des jeunes autistes qu’ils sont violents à partir du moment où leur usage de la force semble dépourvu d’intention explicite de faire violence. De ce point de vue, leur « violence » ne correspond pas tout à fait à l’idée de violence telle qu’on peut l’avoir dans la vie courante.
Et d’ailleurs lorsque des référents contiennent par la force un autiste devenu « violent », c’est qu’ils se font violence (pour supporter les coups sans broncher) plus encore qu’ils ne font contre-violence au jeune.
Il est vrai que l’usage ici proposé du mot violence (qui l’associe à toutes formes d’exercice de la force) reste peut-être trop lâche et ne serre pas d’aussi prêt qu’il le faudrait ce qui mérite de s’appeler violence, surtout dans cette relation jeune-référent.
De toutes les façons, l’idée même de ce séminaire est de mettre au travail différentes acceptions du mot « violence », non pour arriver à se mettre tous d’accord sur un sens commun faisant doctrine pour le Relais mais pour encourager chacun à réfléchir son propre usage de ce mot.
D’où, peut-être, cet impératif de méthode dans nos futurs échanges que chaque intervenant fasse l’effort de dire, pour son propre compte : « j’appelle violence ceci ou cela et voici les conséquences que j’en tire… »
La violence, est-ce que ce n’est pas une sorte de langage si bien que le passage à la violence doit être alors pris comme une porte ouverte, qu’il faut savoir exploiter ?
Oui.
*