De l’instance
de la lettre dans la musique [1]
Quarto, N° 65

1. Intellectualité musicale
Le propos de cet exposé ne sera pas philosophique mais musical. Il relèvera de ce que je propose d’appeler une intellectualité musicale. Qu’est-ce à dire ?
Si la musique est bien une pensée, s’il y a une
pensée musicale (dont le terrain d’épreuve ultime est
l’œuvre musicale), la pensée musicale met en jeu une triple
instance : le son, l’écriture, le langage. Pas de
pensée musicale qui ne circule là-dedans. En ce sens il existe un
régime d’utilisation du langage qui touche à ce que
j’appelle intellectualité musicale et qui n’est pas externe à la pensée musicale.
a) Approches négatives.
Cette intellectualité n’est pas :
* Une
position démiurgique. Elle n’est ni une
« pensée de la pensée » (cf. Aristote
posant que « la pensée qui se pense elle-même est cela
même qui est Dieu » [2])
ni une figure de la conscience de soi (cf. Marx posant que « le
sujet qui se connaît lui-même comme la conscience de soi absolue
est Dieu, l’Esprit absolu » [3]).
Ce n’est pas une prise de conscience de ce que l’on fait quand on
fait de la musique. S’il y a peut-être là
réflexivité, en tous les cas la figure philosophique de la
conscience n’est pas ici adéquate.
* Une
position esthétique où la pensée musicale serait un
objet pour une pensée seconde.
* Une
logique musicale qui serait par rapport à la pensée
musicale comme la logique mathématique l’est par rapport aux
mathématiques, c’est-à-dire une réflexion qui se
situerait malgré tout en dehors des mathématiques.
Je sais que je m’écarte ce faisant d’une
position qui tient que la logique appartient à la mathématique,
ainsi de Pierre Damphouse posant que la logique est « mathématique car il [y] s’agit d’un travail de
mathématiques » [4]
— d’où découle alors un rapport de torsion interne entre
mathématiques et logique —. Je préfère, comme
musicien, laisser ouverte la possibilité d’une plus radicale
extériorité entre logique et mathématiques et ne pas
parler ici de logique musicale, ne serait-ce que pour ne pas concentrer la
réflexion musicale sur certains types d’opérations
présumées « logiques » : combinatoire,
développement…
* Une
théorie de la musique. Ce terme renvoie trop, comme le terme esthétique, à l’idée que la musique
fonctionnerait comme un référent extérieur objectivable
pour une théorie, comme une pratique qu’il s’agirait de
ressaisir abstraitement (les manuels de solfège sont souvent
intitulés « Théorie de la musique » !).
Il ne s’agit donc pas de prendre la musique en
extériorité.
On sait ainsi qu’il y a deux sortes d’analyse
musicale qui se rapportent différemment à
l’œuvre : la première, académique, prend
l’œuvre pour objet et tente d’en produire une analyse exacte
et fidèle. La seconde, musicale, orientée vers la production de
musique — qu’elle soit celle de l’interprète qui
doit jouer l’œuvre, celle de l’auditeur qui tente de rapporter
une perception et une lecture, celle du compositeur qui s’approprie le travail
de ses prédécesseurs — n’a pas de souci
d’exactitude en sorte que, comme le dit Boulez, « peu
m’importe que l’analyse soit fausse si elle est
productive » [5].
b) J’appelle intellectualité musicale le rapport de la musique à la pensée
qu’elle est.
Cette question me semble « moderne ».
Elle apparaît sans doute moins avec Rameau et Rousseau qu’avec le
romantisme musical qui voit se succéder Schumann, Wagner, Schoenberg. Il
est intéressant de noter que cette nouvelle figure va de pair avec une
figure militante, avec l’idée de défendre ou de promouvoir
la musique comme pensée, en la nommant dans ce mouvement comme
« musique de l’avenir » (Schoenberg avait bien
conscience de succéder à Schumann dont le « journal
combattait pour la musique de l’avenir » [6]).
Ceci touche à cette séparation, apparue
à la fin de l’ère classique et très
précisément autour de l’opus 106 de Beethoven, entre
musique savante et musique populaire, mais aussi entre instrumentistes
professionnels et amateurs. On peut tenir que cette séparation est
contemporaine de la conscience des compositeurs d’avoir à poser
des décisions musicales qui ne relèvent plus de la seule nature
musicale, en particulier de son état tonal, mais d’exercer une
volonté qui fait violence aux résolutions « naturelles »
(le partage classicisme/romantisme se dessine entre Beethoven/Schubert dans le
rapport à la résolution harmonique…).
Tout un pan de cette question porte sur l’identification
par la musique de la pensée qu’elle est.
L’auto-identification de la musique comme pensée se fait en deux
points :
1) dans
le rapport de la pensée musicale à son matériau, au
son : la musique ne se pense pas comme « art du
son » et, si elle avait à se nommer comme art de quelque
chose — ce qui n’est pas en fait son souci -, elle se
concevrait plutôt comme « art du temps » car temps, ici, ne saurait être objectivé.
Cette question a une grande acuité contemporaine,
à l’époque où des transformations
considérables affectent le matériau sonore. Sans
m’étendre ici sur les problèmes de périodisation que
cela ouvre, on peut relever que cette condition moderne de la
musique — assurer un minimum d’identification
d’elle-même comme lieu de pensée — s’est
manifestée dans l’ère contemporaine par une tendance
positiviste, la conscience de soi romantique d’être un art se
renversant en l’idée que la musique serait en retard par rapport
à la pensée scientifique de son temps et devrait donc
s’employer pour se porter à son niveau. Ceci s’est
donné spontanément dans une problématique du
matériau, les transformations techniques du matériau sonore, vues
comme résultats du progrès scientifique, étant alors
constituées pour la pensée musicale comme occasion d’un
défi de pensée.
Tenir que la musique n’est pas l’art des sons
mais plutôt l’art du temps — s’il est vrai que le
temps n’existe pas alors même que les sons existent bien -,
c’est dire que ce dont la musique est art n’est nullement un
donné empirico-existant mais le produit de sa propre opération :
sans musique il n’y aurait pas ce temps dont elle est l’art
quoiqu’il y ait bien ces sons dont elle fait son matériau. La
musique en fin de compte se prend pour son propre préalable (K. Marx :
« C’est d’abord la musique qui éveille le sens
musical de l’homme » [7])
sans avoir à s’autodéfinir, moins encore à se
définir par un matériau.
Ou encore : pour la musique identifier de l’intérieur d’elle-même
la pensée qu’elle est ne consiste nullement à se définir.
2) dans
le rapport de la pensée musicale à l’écriture.
La musique comme pensée s’identifie par le déploiement
d’une écriture qui lui est propre. Avant de développer ce
point, quelques remarques complémentaires et préalables.
La pensée musicale se déploie dans une triple
instance : la note, le son et le mot. Je veux mettre provisoirement
l’accent sur l’importance du langage dans la musique puisque
c’est bien là où se manifeste malgré tout
l’intellectualité musicale : dans un certain régime de
parole plus que dans l’acte de composition ou
d’interprétation.
* Il y a une grande importance des catégories
nominales pour faire de la musique. La pensée musicale, si elle bien
sans concepts, n’est pas sans catégories (telles celles-ci :
mélodie, harmonie, rythme, voix, contrepoint, polyphonie,
dominante…)
* L’intellectualité musicale est une
manière de reprendre ces catégories à distance de soi, non
comme de pures et simples catégories opératoires et techniques
mais en excès par rapport aux problèmes qu’elles traitent.
D’où découle un certain redoublement, interne à la
pensée musicale, de ces catégories, redoublement un peu analogue
à ce qu’Alain Badiou relevait comme triple nomination à
propos des rapports entre philosophie et mathématiques et surtout comme
double nomination interne aux mathématiques (dont la seconde est en excès
sur ce que la première résout comme problème singulier).
Par exemple, et avant d’y revenir en détail, la
catégorie de note de musique peut être :
- prise
comme catégorie opératoire pour faire de la musique ;
c’est alors celle du solfège ;
- reprise
en distance par rapport à la musique ; soit la question :
comment faire de la musique avec des notes ?
D’où un rapport de torsion interne/externe de
cette catégorie dans la musique : à la fois la note est ce
qui est dans la musique et en même temps la musique est ce qui est
entre les notes ; soit : comment la musique
opère-t-elle avec des notes qui sont à la fois son
intérieur et son bord externe ? Note est alors pensé de deux façons : c’est ce qui
structure la musique mais aussi ce qui atteste que la musique ne
s’écrit pas (ce qui ne veut pas dire que la musique ne soit pas
écrite : la musique est écrite sans s’écrire,
tel est l’écart à penser qu’ouvre la catégorie
de note).
En ce sens, l’intellectualité musicale serait
le travail interne à la pensée musicale pour opérer ce
dédoublement des catégories musicales. Ce dédoublement ne
va pas de soi. Par exemple, il n’est pas fait à mon sens chez
Messiaen par rapport aux catégories qu’il introduit (celles de
rythmes non rétrogradables, de modes à transpositions
limitées…) comme catégories purement techniques ; et
il n’est pas ici indifférent qu’il les introduise dans un
ouvrage intitulé : « Techniques de mon langage
musical ». A contrario il est
engagé par Boulez sur ses propres catégories musicales
(structure, série, espace, mutations…) dans un livre qu’il a
nommé « Penser la musique aujourd’hui ». Passer de techniques à penser, tout est précisément là.
Ces catégories ont donc un double statut possible
dans la musique, qu’on pourrait peut-être nommer selon la
dualité de Benveniste : « catégories de
pensée et catégories de langue » [8].
Ceci touche au triangle philosophie —
mathématiques — musique puisque des catégories
apparemment communes circulent entre ces trois termes.
Il
y a des catégories musicales qui ont, ou ont eu, un destin philosophique :
par exemple la catégorie d’harmonie.
Il
y a des catégories musicales qui ont, ou ont eu, un destin
mathématique : par exemple celle d’intervalle (diastema [9]).
Il
y a des catégories philosophiques qui ont, ou ont eu, un destin
musical : par exemple des catégories dialectiques
(développement, résolution…)
Il
y a des catégories mathématiques qui ont, ou ont eu, un destin
philosophique : par exemple celles de groupes, d’ensembles, sans
compter bien sûr des catégories physiques (spectre, enveloppe…).
Il
y a aussi des catégories théologiques qui ont, ou ont eu, un
destin musical : par exemple celle de Trinité qui a joué un
rôle significatif dans le débat lors de l’Ars Nova sur les divisions rythmiques (parfaite —
en trois — ou imparfaites…).
On constate donc une grande circulation des
catégories entre domaines de pensée disjoints et l’on est
facilement soumis à la nostalgie du temps où musique,
mathématiques et philosophie étaient nouées ensemble, ce
temps présocratique dont traite A. Szabo et que Rousseau
étend à toute l’ère grecque, prenant pour
modèle le moment où ces trois disciplines
s’écrivaient dans le même alphabet, où les
mêmes lettres permettaient d’écrire la langue,
d’inscrire les chiffres et de noter la mélodie.
Quels rapports y a-t-il ou peut-il y avoir aujourd’hui
entre ces domaines de pensée, et en particulier entre
mathématiques et musique ?
La musique n’est pas conditionnée par la
mathématique comme peut l’être la philosophie. Mais la
musique est sous l’effet du savoir mathématique en tant
qu’il s’est sédimenté en technique dans le
matériau sonore (ceci a un poids singulier dans l’ère
contemporaine avec le développement du travail informatique).
Il me semble que les catégories musicales sont pour
partie arrachées aux autres domaines de pensée. L’intellectualité
musicale serait alors ce qui cicatrise cet arrachement. D’où
une double caractéristique de la catégorie musicale :
- elle
est en torsion d’elle-même, en excès par rapport à
son pouvoir opératoire. Ainsi de la note qui pointe l’impossible
d’une écriture ;
- elle
porte trace d’une cicatrice, de l’endroit où la
pensée musicale a décidé, en arrachant.
On va examiner cela à propos de la catégorie
de note de musique. La note est une sorte de mot formé de
différentes lettres. Il apparaît que la lettre primordiale est en
musique celle de durée, qui n’est ni une lettre
mathématique (elle n’est pas, contrairement à ce que
propose J.-J. Rousseau [10],
le zéro ni l’ensemble vide), ni une lettre ayant un
référent philosophique (quelque chose par exemple comme ce qui
inscrirait la durée bergsonnienne). La cicatrice dans la note du fait
qu’il y a pensée musicale est alors la lettre de silence ; ce
qui conduit à dire que la cicatrice de la note est un soupir (Œ) plus encore qu’une pause (Ó).
Il y a aujourd’hui une grande prégnance des
positions reliant musique et mathématiques. Il y eut dans
l’histoire plusieurs moments dans ces rapports : le moment
pythagoricien (cf A. Szabo), le moment de l’Ars Nova (marqué
par les spéculations combinatoires en matière de rythme), le
moment baroque (avec la théorie de l’harmonie tonale), puis le
moment contemporain, avec son double déploiement : en
matière de matériau (numérisation, fonctionnalisation…)
et en matière de lettre (combinatoire d’écriture que le
sérialisme a généralisée).
Ma position est ici que les mathématiques ne
sauraient s’appliquer. Il faut donc en passer par la philosophie si
l’on veut nouer mathématiques et musique autrement que
métaphoriquement — c’est indiquer au passage que ce nouage
n’est pas, en tant que tel, une tâche de
l’intellectualité musicale -. Je crois d’ailleurs que cette
médiation par la philosophie a toujours été plus ou moins
pratiquée : l’autorité des mathématiques sur la
musique s’est toujours exercée me semble-t-il au nom de
catégories qui s’avèrent en fin de compte moins
mathématiques que philosophiques. En général cela
s’est donné et continue de se donner via le concept philosophique
de Nature ou plutôt de naturel. Il y a en particulier la
thèse — philosophique et non pas
mathématique — que les nombres et par là les chiffres,
ayant un statut naturel, ont droit sur la musique. Ceci se trouve par exemple
assez explicitement chez J.-J. Rousseau : « Rien
n’est si naturel que l’expression des divers sons par les chiffres
de l’arithmétique » [11],
« La musique naturelle c’est-à-dire la musique par
chiffres » [12].
Ma thèse serait celle-ci : la parenté
entre mathématiques et musique doit être cherchée moins
dans le nombre que dans l’usage de la lettre. Mathématiques et
musique sont en partage d’écritures.
S’il y a bien une grande importance du Nombre en art, ceci ne singularise pas
nécessairement la musique. Ce qui la singularise plus fortement serait
le fait que c’est bien le seul art qui, stricto sensu,
s’écrive. D’où des questions sur
l’identité-différence entre écriture
mathématique et écriture musicale, entre lettre
mathématique et lettre musicale.
2. Quelques thèses sur
l’écriture musicale.
La pensée musicale met en jeu une écriture.
Elle nécessite en effet une mise à distance du matériau
sonore ; composer s’avère ainsi un acte intransitif : ce
n’est pas composer le son, comme on le dit trop facilement dans
l’ère contemporaine. Ceci touche à une particularité
significative du matériau musical, du son : son caractère
à la fois évanescent et reproductible.
Le caractère non durable du son implique que composer
ne revient pas à produire du son, comme peut le faire
l’improvisation. Composer revient à prescrire, d’une
manière ou d’une autre, une manière de vibrer pour un corps
physique qui engendrera ce faisant des ondes sonores. Ce corps s’appelle
en musique l’instrument et
l’existence de ce corps perdure jusqu’à
l’intérieur de la musique électroacoustique : non
seulement parce que le son n’existe qu’engendré par des
haut-parleurs mais, plus profondément, parce que le musical n’est pas le sonore. Je tiendrai même cette thèse que le
phénomène musical naît avec le sentiment de
causalités mécaniques associées aux sons perçus
(causes virtuelles ou non, peu importe), et c’est d’ailleurs ce qui
donne aujourd’hui tout son attrait aux méthodes de synthèse
dites « par modèles physiques ».
Le lien entre évanescence et reproductibilité
est étroit : c’est parce que le son a une cause en dehors de
lui, parce que le son est émis, qu’il a à la fois
l’évanescence et la reproductibilité de l’effet.
D’où cette double caractéristique : le son est une
trace (d’un corps), et en tant que trace il est intégralement
reproductible. Ainsi de la voix humaine : elle est trace du corps humain
qui l’émet en même temps qu’elle peut être
parfaitement reproduite en l’absence de ce corps. La voix en ce sens
n’est pas comparable à une image : l’image visuelle
d’un corps, si elle en est bien aussi une sorte de trace, résulte
cependant de la réflexion sur ce corps d’une projection de
lumière. Une image n’est donc pas l’effet immédiat de
la présence du corps : les corps ne sont pas lumineux et
n’irradient pas (dans le spectre visible tout au moins). La voix, par
contre, est une modalité de présence qui est en théorie
parfaitement reproductible ; ainsi la voix reproduite reste bien la
voix et non pas l’image de cette voix, et ce même en
l’absence du corps qui l’a initialement engendrée.
L’acte même de composer est marqué de
cette caractéristique : il ne produit pas le son lui-même (la
trace, l’effet) mais la cause ou plus exactement la structure d’une
cause possible. Il est de l’essence du matériau sonore qu’on
ne puisse le stocker et qu’on doive plutôt en stocker les causes.
D’où plusieurs voies possibles en
matière d’écriture musicale :
1°)
l’écriture sera conçue comme écriture du son (de
même que composer est souvent posé, dans son horizon contemporain,
comme composer du son).
Écrire serait alors l’acte de stockage des
causes en vue d’une reproduction ultérieure. C’est là
la position empirique dominante sur l’écriture musicale. Il y a
alors trois manières de procéder :
- enregistrer des sons existants. La qualité de
la reproduction dépend des seuls paramètres techniques.
L’écriture est ici conçue comme une fonction.
- décomposer — analyser —
le son selon des catégories physiques puis le resynthétiser. Ici
l’écriture est conçue comme une mimétique de
l’effet.
- inscrire directement les causes instrumentales qui
engendrent les sons (logique de la tablature). Ici l’écriture est conçue comme une mimétique
de la cause.
2°)
L’écriture sera conçue comme une structuration musicale ex
nihilo, partant du vide de la partition et non pas de l’infini du
matériau sensible. L’écriture est alors ce qui tire du vide
un espace de pensée musicale et non pas ce qui transcrit une
réalité sonore préexistante.
Dans ce cas l’écriture n’est plus une
fonction et le rapport partition/résultat sonore n’est plus
fonctionnel (en tous les sens du terme).
L’écriture n’est de même plus une mimétique
(de l’effet ou de la cause), comme elle l’est dans les notations
graphiques (les dessins : des neumes grégoriens aux partitions
graphiques des années soixante-dix) ou dans les notations en tablature
(des tablatures pour luths aux « tablatures pour
ordinateurs » que sont les programmes informatiques actuels). En ce
sens la partition n’est pas exactement une carte (ce que soutiennent
certains compositeurs contemporains, tel Gérard Grisey) : il
n’y a pas d’homéomorphisme entre son espace et celui des sons.
Au total l’écriture n’est ni nombre ni
figure.
Il est vrai cependant que l’écriture musicale
(au sens large : soit l’espace complexe de la partition) doit aussi
assumer les conditions d’engendrement effectif du son. Ceci va aboutir
à une hétérogénéité de toute
partition dont on peut poser l’écart entre :
- d’un côté une écriture stricto sensu constituant l’instance de la
lettre proprement dite ;
- d’un autre coté les notations disposées en une triple occurrence :
* notations
graphiques de résultats (ex. : crescendo)
* notations
en tablature (ex. : portamento)
* notations
à interpréter (ex. : tempo, phrasé…)
La thèse est alors qu’il n’y a pas
d’écriture musicale sans lettre musicale et ce, quoique
l’écriture musicale ne s’y réduise pas.
Ceci revient à formuler cette autre
thèse : il est de l’essence de l’écriture
musicale qu’elle soit hétérogène et ne
s’identifie pas à l’instance de la lettre. Rousseau
relève comme un obstacle cette
hétérogénéité, l’appelant la
« foule », « le tout fort
embrouillé » ou la « multitude » des
signes musicaux « inutilement diversifiés », ou
encore « le fatras le plus ennuyeux qu’on puisse
imaginer ».
Deux tentations pèsent sur cette
hétérogénéité dans la musique contemporaine,
deux tentations d’homogénéiser ce
« fatras » :
- par
le bas ; il s’agit alors de
rabattre la partition sur son versant graphique. La lettre musicale est ici
abandonnée et tout se donne en notations plus ou moins dessinées.
- par
le haut ; il s’agit
d’étendre l’ordre de la lettre et de traiter tout signe de
la partition à ce régime. C’est ce à quoi
procédera le sérialisme naissant, en une séquence qui fut
cependant très brève (généralisation de la
combinatoire à tous les paramètres au début des
années cinquante…).
Écriture nomme
donc ce qui institue la musique comme une pensée à la mesure de
ce que écriture nomme que
la musique part du vide (du silence) et non pas du son.
Écriture vient
alors nommer un rapport en torsion interne, dans un redoublement
intérieur. J’oppose en effet écriture (instance de la lettre) et notations ; or l’impossibilité de
réduire l’une aux autres est ce qui fait l’écriture
musicale elle-même : l’écriture est ce qui tient
ensemble (dans un même espace : celui de la partition) ce qui ne
saurait se réduire : écrire et noter.
Ou encore : écriture est ce qui tient-en-un un
écart non fusionnable entre vide et infini, entre silence et son.
Écart non fusionnable non seulement parce que composer ne consiste pas
à transcrire du sensible (une improvisation par exemple) et
qu’écouter ne revient pas à percevoir un matériau
sonore entièrement tiré du vide (cet idéal, qui fut celui
de Stockhausen dans les années cinquante, est réfuté dans
la plupart des situations par le fait qu’on fait toujours de la musique
avec des corps préconstitués : des instruments qui
préexistent à l’œuvre…), mais plus
fondamentalement parce qu’il y a impossibilité de rabattre
écriture et perception. Très brièvement il y a :
Ce
qui ne se perçoit pas de l’écriture et de la lettre,
soit :
* les
différences entre rythme et tempo,
* les
composantes élémentaires du tempo,
* les
calculs de l’écriture.
Ce
qui ne s’écrit pas du sensible comme tel, soit :
* le
tempo et l’agogique,
* la
fusion du timbre,
* la
continuité de la durée et de la Forme musicale (on
n’écrit pas l’attente inhabituelle de la dominante au
début du madrigal « Hor che’l Ciel e la Terra » de Monteverdi).
Thèse : la lettre musicale se constitue par
la lettre de durée.
La lettre de durée supporte un double marquage
(algébrique et géométrique) qui concentre en ce point tout
l’écart global de la partition, l’écart entre
écriture et notations, entre vide de la lettre et infini de
l’espace.
On a ainsi suivi jusqu’ici
l’enchaînement : pensée Þ
écriture Þ lettre Þ durée, succession qu’on
interrompra en ce point, refusant la déduction supplémentaire
durée Þ nombre-chiffre qui
est cependant abondamment suggérés depuis Aristote
(« le temps comme nombre du mouvement »). Soit :
pensée Þ écriture Þ lettre Þ durée
mais pas :
durée Þ nombre-chiffre
3. La lettre de durée
Quelques brefs rappels historiques sur « la
lettre de durée ».
* Les durées n’étaient pas
écrites du temps des Grecs ; le rythme du poème suffisait
à les prescrire.
* L’écriture des hauteurs a
devancé, au Moyen Âge, l’écriture des durées
(à partir du XI° siècle transformation des neumes en points
situés sur une échelle verticale : Guy
d’Arezzo…)
* L’écriture des durées a
véritablement été instituée à partir du
XIII° siècle ce qui conduisit à l’explosion
combinatoire des rythmes lors de l’Ars Nova (XIV°) suivie au XV°
d’une sévère restriction (entraînant
l’institution de la mesure…).
Il apparaît donc que l’invention de la lettre
musicale de durée est une invention tardive et exclusive de la musique
occidentale. C’est bien en ce point que se concentre la complexité
de l’écriture musicale.
Plusieurs remarques à ce propos.
La durée de silence (qui
s’écrit q ou Œ) est sans aucun
référent, ni sonore (puisqu’elle n’est pas
associée à une hauteur), ni physique (puisqu’elle
nécessite l’existence d’un tempo pour être convertible
en secondes). Poser qu’il existe, en un point au moins, un signe qui noue
à la fois le son (comme matériau musical), le temps (comme
enjeu propre de la musique) et l’écriture (comme matière
singulière du travail de la pensée musicale) dispose un ordre
écrit en rupture radicale par rapport à l’ordre sonore, un
espace de la partition nullement coextensif aux lois perceptives. En ce sens,
cette lettre, ce signe, concentre une coupure fondatrice de l’ordre scriptural
et par là de la pensée musicale.
Étant un signifiant sans
signifié auquel tout signifiant se réfère, cette lettre va
être en position phallique au regard de l’écriture musicale.
On peut à partir de là interpréter les positions sexuelles
telles que Lacan les a définies au regard du signifiant phallique.
La
position masculine articulerait :
"x
F(x) soit : tout signe écrit, en tant
qu’il est disjoint de la réalité perceptible, relève
du signifiant de silence ; ou encore : tout signe écrit est
marqué de la castration au regard du matériau sonore
puisqu’il n’est pas en puissance du sonore et du sensible.
$x
~F(x) soit : il existe au moins un point (de notation) qui
désigne ce qui du sonore ne saurait s’écrire.
La
position féminine articulerait :
~$x ~F(x) soit : il n’y a rien qui ne
s’écrive (ceci barre le fantasme graphique et improvisatoire qui
s’auto-justifie du non-littéralisable)
~"x F(x) soit :
tout ne peut s’écrire (ceci barre le fantasme sériel
d’écriture totale).
On voit alors se dessiner une
dissymétrie : la position masculine s’établit dans
l’écriture (du point du silence) comme espace propre dont la
consistance (à la fois comme ordre spécifique et comme ordre
visant le sensible) est en dernière instance avérée du
point minimal d’une notation (qui peut être celle du tempo, ou
celle de l’agogique…). Cette position institue
l’hétérogène de la partition comme champ
d’écriture borné par des notations, ces notations fonctionnant
comme la limite qui fait consistance de l’écriture.
La position féminine par
contre est dans une position plus incertaine au regard de l’acte
même d’écrire puisqu’elle est prise en battement entre
deux énoncés dont aucun ne fait coupure par rapport à l’ordre
sensible immédiat du monde sonore, monde sonore qui est (faut-il le
rappeler ?) l’espace de prédilection du musicien et du
compositeur. La position féminine s’installe dans le
« pas-tout » de la partition puisque cette
dernière n’est homogène ni du point de
l’écriture ni du point des notations.
La durée est prise dans un système
hiérarchique (un « feuilleté ») de mesure
et de tempo : la mesure, le tactus, l’impulsion. D’où
découlent des inscriptions qui s’avèrent redondantes comme
J.-J. Rousseau nous le révèle en proposant de remplacer le
dispositif d’inscription traditionnel suivant :
3/4| q q q | par celui-ci : 3/4|do, ré, mi| soit, avec les
chiffres qu’il propose :
3/4|1,
2, 3|
Dans ce dispositif il apparaît que l’espace
mesuré (par les barres de mesure, et les virgules chez Rousseau…)
suffit à lui seul pour inscrire les durées.
Mais la lettre de durée inscrit en fait la
complexité de trois notions simultanées :
1) un
point d’attaque (soit un instant).
Ceci est spécifié par la localisation de la
lettre dans l’espace mesuré de la partition. Cette inscription
peut être réalisée, séparément des deux
autres notions, par la « petite note » sans durée
[…].
2) un
voisinage de ce point.
- C’est
un voisinage approximatif : il faut attaquer la note plus ou moins
tôt selon la durée propre des transitoires d’attaque
prescrits par la nature de l’instrument utilisé (si l’on
joue d’un tuba, on attaquera plus tôt que si l’on joue
d’une clarinette). De même la fin de la durée est imprécise ;
par exemple elle n’est pas identique selon qu’elle est suivie ou
non d’un silence :
| q Œ | ≠ | q q |
- C’est
un voisinage qui est modelé par autre chose que par la seule lettre de
durée (qui en approxime la mesure) : par les notations de phrasé,
par le tempo…
3) un
second point (terminal) et par là un intervalle (entre les deux
points) ; on inscrit ici une durée d’intervalle et non
plus, comme dans le voisinage, une durée de déroulement.
Soit le schéma suivant qui rapporte la
« courbe » acoustique
(attaque-résonance-extinction) à son inscription musicale :
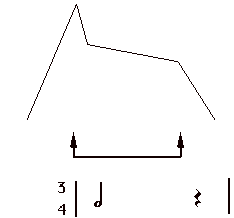
La lettre h (ou q) ramasse ces trois déterminations
en un seul point sans intériorité, point appartenant à
l’espace de la partition, point qui n’est pas un instant
(l’instant est un point dans la temporalité), point qui sera
situé le long d’un axe horizontal tracé
géométriquement.
D’où découle un surcroît de
clarté — tenant précisément à la
redondance (la lettre renomme algébriquement l’espace
mesuré où elle est située) — mais aussi une possibilité
de calcul qui n’existe pas dans le système de Rousseau.
Brièvement, Rousseau renverse la notation
traditionnelle.
- Dans
la notation traditionnelle, les hauteurs sont inscrites par spatialisation
verticale (il n’y a pas, au sens strict, de lettre de hauteur) alors que
les durées sont inscrites par des lettres spécifiques (les
noires, blanches, soupirs…).
- La
notation de J.-J. Rousseau littéralise les hauteurs en les
inscrivant par des chiffres alors que les durées deviennent inscrites
par un simple découpage (de la spatialisation horizontale)
dépourvu de lettres (on n’a plus que les barres de mesure et des
virgules pour visualiser ce découpage mesuré), sans
désormais recourir à des lettres de durée et, en
particulier, à des lettres de silence (lequel n’est inscrit que
comme 0, soit comme zéro de son, comme absence de hauteur).
On dispose ce faisant de bouts d’espace
localisés et non combinables. Des calculs comme ceux-ci :
h = q + q = q + Œ q e ® e q q e ® h q……
soit les opérations de concaténation,
division, rétrogradation, superposition, augmentation-diminution…,
ensemble d’opérations qui ont proliféré à
l’époque de l’Ars Nova puis au XX° siècle, sont
inaccessibles par le système de notation de J.-J. Rousseau. On
perçoit bien l’obscurité musicale que génère
ce système en s’écartant des trois aspects concrets
qu’inscrit la lettre de durée : l’instant
d’attaque, son voisinage et l’intervalle entre deux instants.
Thèse : la lettre musicale est clair-obscure.
Elle est claire par sa redondance (algébrique) au
regard d’une schématisation (géométrique) qui la
rendrait théoriquement inutile.
Elle est obscure par le calcul aveugle qu’elle ouvre
sur des signes qui inscrivent en vérité la gerbe de trois
déterminations simultanées.
En ce sens, la lettre musicale diffère de la lettre
mathématique, en particulier du x de l’algèbre lequel ne
supporte pas de telles redondances ni de semblables multivocités.
Peut-être que la lettre de durée se
rapprocherait plutôt de « lettres »
mathématiques telles ∑ ou ∫ et,
plus adéquatement encore, de la lettre l
(telle qu’elle signifie dans le lambda-calcul), soit de lettres pointant
l’existence d’un opérateur, opérateur de sommation ou d’intégrale,
opérateur d’abstraction…
La musique contemporaine est aujourd’hui soumise
à la tentation de déplier cette gerbe de déterminations
d’au moins deux manières :
1) en
se proposant de tout géométriser, ou de tout figurer dans
l’espace de la partition :
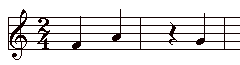 ®
®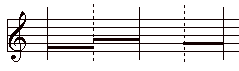
Dans ce cas, on perd la puissance de la lettre, en particulier
sa puissance de calcul.
2) en
tentant de tout algébriser.
Par exemple :
![]() sera
précisé en :
sera
précisé en : 
Ceci conduit à une complexification de
l’écriture musicale traditionnelle qui tend à distinguer,
au moyen de lettres différentes, des fonctions précédemment
fusionnées en une seule marque.
On voit sur l’exemple suivant ce que peut donner le
simple déplacement d’un petit motif rythmique :
![]() ®
®
Le décalage à l’intérieur de la
mesure de l’instant initial rend plus difficilement lisible le geste
rythmique élémentaire.
On pourrait comparer cela
à la transformation de l’intégrale qu’instaure
Lebesgue, dépliant différentes tâches assumées
conjointement par la même inscription x dans l’intégrale de
Riemann :
![]() ®
® ![]()
Dans la seconde expression, x
n’intervient plus directement :
Le
domaine d’intégration est défini par les extremums
de ƒ
Le
point est défini directement comme y
L’élément
d’intégration dµ ne procède plus directement de x
et n’est plus constant.
Comme on a en fait un partage
entre le « pas » dy et sa mesure dµ, on a au total
un partage en quatre des fonctions assumées par x dans
l’intégrale de Riemann :
- domaine
- point
- élément
d’intégration ®
- pas
- mesure
Cette complexification de l’écriture musicale
va aller de pair avec une crise de confiance musicale dans la note.
4. Crise de confiance dans la note de musique
La note était un peu comme un mot, ou plutôt
comme une expression mathématique au sens où l’on
parle d’expression mathématique pour des ensembles de lettres tels
que ceux-ci :
lx. (axn + byp + c)

On remarque que ces expressions, à la
différence de mots, ont un statut non linéaire : elles sont
marquées d’indices ou d’exposants, de pluralité des
niveaux qui ne cantonnent pas l’expression à un déchiffrage
univoque de gauche à droite. De même la note de musique est
l’accrochage, autour d’une lettre de durée, d’autres
paramètres qui sont succinctement :
- la
hauteur (par localisation verticale de la durée sur une
échelle mesurée et figurée
géométriquement) ;
- l’intensité
(par des notations dans la langue usuelle — piano,
abrégé en p,…
— ou figurée graphiquement — le crescendo -) ;
- le
timbre (par différentes notations :
« hautbois », modes de jeux…)
C’est en ce sens que la durée musicale est un
peu comme le signe d’une intégrale ; d’où
qu’à continuer de la noter par une simple lettre, on n’en
contrôle plus les opérations avec suffisamment de
précision.
A quoi tenait la confiance dans la note ?
1) Étant
donné le caractère non fonctionnel des notes, il existait une
bonne entente musicale entre compositeurs et interprètes sur
l’usage à en faire. Il existait en particulier des styles
qui prescrivaient comment les interpréter.
Le problème est en effet : comment relier les
points de la partition en des lignes sonores continues (en phrases, en
gestes…) ? Le point, qu’est la note, algébrise une
sorte d’arête de l’espace sonore mais chacun sait que la
musique existe dans les infimes courbures du phrasé, dans les
« nuances ». La confiance dans la note était une
confiance dans le fait qu’on pouvait immerger la structure
algébrique de la partition dans un espace souple, muni d’une
topologie car doté d’un style. Le style musical était
l’existence inexplicite d’une telle topologie. Cette topologie
n’était pas écrite mais elle était sue : on
inscrivait Mazurka ou andante et ceci suffisait à se faire comprendre.
2) Il
y avait une relative lisibilité — adéquation,
recouvrement — entre les structures écrites et les structures
perçues. Les phrases, gestes, motifs, thèmes…
étaient des entités à la fois visuelles et audibles. Ceci
tenait — entre autre — au fait que la note était
une gerbe relativement stable de paramètres :
- les hauteurs s’enchaînaient de
manière en général peu distantes les unes des
autres ;
- les durées étaient assez stables et se
répétaient fréquemment ;
- les intensités variaient peu ;
- les modes de jeu également…
Il y avait donc une
« continuité » des inscriptions discrètes
dans lesquelles les coupures (sauts de registres, précipitations des
durées, sforzandi…) se
détachaient nettement.
La très grande mobilité des paramètres
et la multiplication des notes (moins pour noter précisément des
effets désirés que pour inscrire un discours musical plus fluide)
vont alors créer une très grande instabilité.
D’où un approfondissement de l’écart entre
écriture et perception, entre structures écrites et structures
perçues.
On peut également dire qu’il s’agit
là d’un déplacement de la dialectique entre le local et le
global : la durée fixait en effet à la fois un point muni
d’un voisinage (données locales) et une région (un
intervalle, soit déjà une donnée globale) en sorte que la
région supérieure, faite de plusieurs notes — soit la
« voix » musicale — était gagée
par une stabilité antérieure de la note.
Aujourd’hui on assiste à la fois à un
enfoncement à l’intérieur du voisinage et à une
fragilisation de ce qui corrèle entre eux les voisinages et qui
n’est plus lisible : le régional devient obscur, ce qui est
relié au fait que la catégorie musicale de voix est
elle-même devenue problématique, entraînant avec elle la
problématisation de la catégorie de polyphonie.
La confiance dans la note, en ce qu’elle fixait une
intériorité corrélée à
l’enchaînement extrinsèque des notes (dans une voix), est
ainsi atteinte.
D’où deux tendances :
* Le
pointillisme qui correspond au fait d’isoler la note et de perdre
ses qualités extrinsèques. Cette tendance part de Webern et
culmine dans certaines œuvres sérielles des années cinquante
(comme le premier Livre de Structures de
Boulez).
* Le
gestuel ou forçage exogène : le lien entre les notes
est assuré par des gestes extrinsèques, qu’ils soient des
gestes instrumentaux (on rencontre là ce penchant de la musique
contemporaine à établir une nouvelle virtuosité : cf.
Berio) ou qu’ils soient empruntés à une esthétique
antérieure (cf. le cas du Schoenberg dodécaphoniste où la
gestique est encore romantique alors même que la structure des hauteurs
ne l’est plus).
Il y a aujourd’hui un éclatement de ces
modalités d’écriture qui peut conduire jusqu’à
une forme de schizophrénie de la partition lorsque celle-ci est
partagé en deux mondes, l’un dévolu à
l’écriture traditionnelle, l’autre à la figuration
d’une partie électroacoustique ou informatique dont on ne sait
plus que dessiner certains effets ou noter — en tablature —
certaines actions mécaniques.
Cet éclatement se retrouve à
l’intérieur de l’écriture musicale traditionnelle qui
se découvre de moins en moins linéaire : il suffit de
parcourir du regard une partition de Ferneyhough pour s’apercevoir que
l’épaississement de la note ne permet plus de lire de
manière univoque les différentes strates simultanées. Sans
doute cette multivocité des parcours existait-elle déjà de
manière embryonnaire dans la musique classique — le
déchiffrage, par exemple, impliquait bien qu’on ne lise pas une
partition de manière linéaire, de gauche à droite, mais en
circulant de biais, tantôt saisissant d’un coup tel
enchaînement harmonique, tantôt additionnant les voix… —
mais on pouvait cependant en droit arriver à linéariser ce qui somme
toute restait conçu comme superposition, qu’elle soit
d’ordre polyphonique ou qu’elle soit d’ordre harmonique
(superposition d’une mélodie et d’un accompagnement). Ces
catégories s’effaçant dans la musique contemporaine,
l’éclatement devient prééminent.
On perçoit donc la concomitance entre la perte de
confiance dans la catégorie de note et celle dans la catégorie de
voix. La corrélation des deux est manifeste chez
J.-J. Rousseau : il ne s’attaquait pas à la
catégorie de note (il ne voulait que réformer son mode
d’inscription) en même temps qu’il souscrivait à la
catégorie de voix, laquelle reste bien sa catégorie musicale
prééminente.
5. Perception et « figuratif »
Si la note fonctionnait, c’est aussi parce
qu’elle était élément d’une voix musicale ;
ceci assurait une stabilité de la perception si l’on entend par
perception la construction d’objets musicaux, de gestalt par « intégration » des
différentes composantes de la note.
En effet la perception, pour poursuivre la métaphore
de l’intégration mathématique, n’opère pas
comme l’intégrale de Riemann au fil du temps, par prolongements
locaux successifs mais plus globalement, par saisie de l’objet dans son
ensemble, par prise en compte des récurrences affectant les hauteurs,
par mesure de ce qui compte pour l’oreille (à partir des effets
sur l’axe des y du paramétrage temporel). En ce sens,
l’intégrale de Lebesgue constituerait une bonne métaphore
de la perception. La perception, qui est toujours une opération
d’ordre global, est perception d’une région et non
d’un point ; elle consiste à constituer cette région
en objet musical par intégration des évolutions du biais de
paramètres autres que le paramétrage temporel.
On touche là en passant à la question du
figuratif et du non-figuratif, question sur laquelle je voudrais faire quelques
remarques conclusives.
On pourrait définir la perception comme la
part figurative de l’activité d’audition, comme son
opération de discernement et de construction d’objets musicaux, de
gestalt.
Notons que le terme figuratif a un grand usage dans le discours musical contemporain :
- dans
le rapport figuration — formalisation,
- dans
la tension figure — geste,
- dans
la problématique de la figure rhétorique.
C’est dire l’ampleur de l’usage actuel du
terme figuratif. En nous limitant ici un peu, on pourrait dire qu’il y a
au moins deux aspects de la question du figuratif en musique :
a) Dans
le rapport entre partition et audition.
On poserait ici la question : ce qui est inscrit dans
la partition figure-t-il ce qui s’entend ? Figuratif signifierait ici quelque chose de
transitif — ce qui transite de la partition vers l’audition -.
Selon la distinction proposée, l’écriture musicale serait
alors non figurative alors que les notations seraient figuratives, figuratives
soit du son-effet, soit du geste-cause.
b) Dans
l’audition même.
On poserait alors la distinction entre perception et
audition en tenant que la perception serait la dimension figurative de
l’audition, celle qui y organise des objets, non pas que nécessairement
elle signifie (qu’elle implique des référents
extérieurs à la musique, qu’elle narre…) mais
seulement qu’elle crée des figures sonores identifiables comme
telles. La perception, part figurative de l’audition,
s’opposerait alors à l’écoute, laquelle
opérerait sur les entailles du son, sur ses transitoires, sur ces mille
nuances indiscernables les unes des autres qui font au bout du compte
qu’il y aura eu ou qu’il n’y aura pas eu de musique.
Ici figuratif fonctionne
en un principe intransitif puisqu’il ne s’agit plus de figurer
quelque chose mais seulement d’instaurer un régime de figuration.
*
Le courage d’écrire la musique, plus encore que
d’écrire de la musique, le courage somme toute de la lettre musicale,
s’avère requis, aujourd’hui plus que jamais, pour
qu’existe une pensée musicale.
***