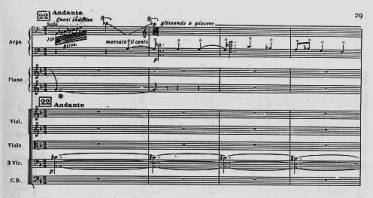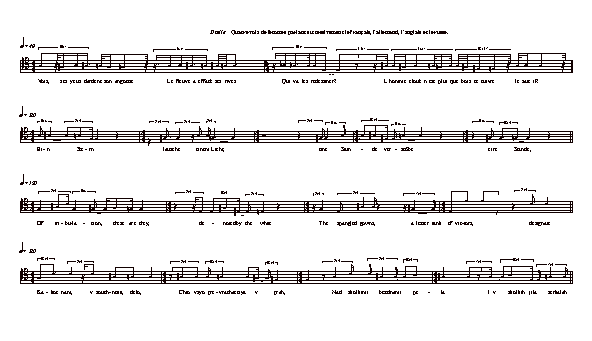Commençons par une petite description
phénoménologique.
Je me mets au piano.
J’improvise. Je convoque spontanément mes savoirs : savoirs
théoriques (gammes, accords, rythmes…) —
« Allons-y pour une petite valse, pourquoi pas en si bémol majeur… »
— savoirs pianistiques (doigtés, déliés, division
main droite / main gauche…). Je varie ma valse, puis je la quitte,
et abandonne du même coup sa tonalité. J’improvise
désormais plus librement : je jette sur le clavier un geste
ébouriffé ; il sonne comme un appel. Je le reprends, le
répète, le distends, lui fournit une réponse. Mon corps
s’échauffe, mes gestes deviennent plus rapides, mes doigts courent
sur les touches, projettent de brusques griffures sur le damier noir et
blanc ; je m’exalte, m’emporte ; l’allure se
précipite. Je joue désormais free
(comme diraient les jazzmen) en alternant repos et tornades ; je saute
sans transition d’un extrême l’autre — il me suffit
pour cela d’une infime durée — en sorte que coexistent
désormais la neige et le feu, le siroco et le ciel bas et lourd…
De nouvelles possibilités s’ouvrent à mes doigts, à
mes bras, à mon buste, à mon corps et je m’y jette, les exploitant
sans souci de cohérence — je ne compose pas, j’explore
—. Je m’échauffe toujours davantage : mon cerveau calcule
les harmonies déployées en travers du piano. De nouveaux rythmes
se pressent pour voir le jour ; je les laisse percer mais d’autres
aussitôt se bousculent pour les remplacer.
L’instrument vibre
désormais de toute sa masse ; je garde enfoncée la
pédale sostenuto et le vaste corps mécanique garde mémoire
de mes frappes. Le son enfle, épais ; je l’interromps
brusquement puis, aussi subitement, le relance. J’engendre ainsi de
larges rythmes faits de coulées sonores entrecoupées de silences
impromptus, plus ou moins longs. Je me tourne maintenant vers la droite du clavier ;
mes doigts font grelotter les aigus. Puis voici à
l’extrême-gauche les graves profonds, les basses les plus noires
qui ébranlent la table d’harmonie et réquisitionnent
l’épaisseur de mes avant-bras. Je suis emporté par ce torrent
sonore que je ne cesse pourtant de déclencher. Je ne peux
m’arrêter : il y a tant à explorer… Je reviens au
médium du clavier puis soudainement écarte les bras dans toute
leur envergure pour embrasser simultanément l’ultra-aigu et
l’ultra-grave, et la chevauchée endiablée repart de plus
belle. Je suis le piano qui
gronde. Mon corps l’enserre, l’épouse, vibre avec lui, le caresse
et le frappe, éprouve ses vibrations, le fait chanter. Je suis la voix qui monte et les rugissements
qui sourdent. Je suis les accords
et motifs qui s’enchevêtrent, se bousculent, s’interrogent et
se répondent. Je suis le
flux capricieux qui tantôt hésite, tantôt jaillit
après un bref appui sur une cellule ou une formule comme un ruisseau
retrouve de l’énergie à buter sur une pierre ou un
détour de son lit.
Jouer et penser sont
identiques : il y a bien sûr les limitations qu’apporte
à mon jeu une technique pianistique rouillée, mais je tire parti
de ces imprécisions : je les intègre au flot sonore car ces
incertitudes et difficultés corporelles participent de ce qui se
déploie là ; il ne s’agit pas
d’interpréter un texte fixé à l’avance mais de
faire exister quelque musique qui n’en brillera pas moins
d’être d’un toucher rugueux, d’une démarche
claudicante, et mes bafouillements, me renvoyant à Thelonius Monk, relancent
la verve du discours. J’opère avec ce que j’ai, sans me
soucier d’éventuels auditeurs : je joue pour moi, je suis
dans la musique échevelée et elle me requiert,
m’enlève et me ravit. J’esquisse un blues mais repars aussi
vite hors de toute structure convenue : ce qui compte, c’est
l’idée brève qui passe, qui vient m’atteindre et
qu’il me faut laisser paraître. Le suspens résonnant
d’un geste appelle une plus vaste pause. Le flot s’immobilise, le
piano laisse vibrer toutes ses cordes, l’écho
s’éteint doucement.
Soudain une petite main me
tire par la manche : « Papa, tu peux m’attacher les
cheveux ? » « Ma fille, laisse-moi. Je ne suis pas
là ! » « Mais Papa, tu es ici, à
côté ! » « Non, petite, je suis
ailleurs, dans la musique. Ne me parle pas, ne me touche pas,
laisse-moi ! »
Pourquoi cette petite histoire que chacun a sans doute
expérimentée, sous cette forme ou sous une autre ?
Pour cette évidence d’abord, évidence
quasi-physiologique : les affects qui sont les miens quand je joue de la
musique sont des affects singuliers, mes gestes physiques également, et
même mon corps n’est plus le même. Mon corps
s’éprouve dans des gestes qu’il ne produit nulle part ailleurs :
mes doigts ne bougent jamais comme ils bougent là sur le clavier, ni mes
avant-bras, et mon équilibre assis sur le tabouret ne ressemble à
aucune autre posture de ma vie ordinaire. Ces gestes sans égal et cette
configuration singulière du corps accompagnent des affects non moins
singuliers : ce que j’éprouve là n’est ni la
joie du travail intellectuel, ni la volupté amoureuse, ni le plaisir de
l’effort sportif, ni la tourmente des angoisses ordinaires. Je pourrais
certes dire qu’il s’agit là de joie, de plaisir, de volupté,
d’angoisse mais à condition d’ajouter aussitôt :
oui mais de joie musicale, de plaisir musical, de volupté musicale, et d’angoisse musicale en faisant alors porter tout le poids sur le terme musical pour indiquer que la différence
marquée par l’épithète l’emporte ici sur le
partage du nom commun, pour suggérer que les syntagmes « joie
musicale » et « plaisir musical » sont devenus
des noms propres et non plus l’appropriation particulière
d’un sentiment général. Tous ces affects qui m’ont
emporté, traversé, que j’ai vécu aussi intensément
qu’il est possible de vivre des passions, sont une création, non
une traduction d’affects que je connaîtrais ailleurs et qui
viendraient simplement se concrétiser au piano. Le jeu instrumental
m’a fourni une panoplie d’affects, une palette de sentiments que
l’on ne saurait connaître si l’on ne joue pas soi-même
de la musique. La musique a agrandi l’espace, ajouté des
sensations sans égal, prodigué un nouveau champ
d’expérience.
Corollairement, tout ce que j’ai vécu
là, je ne saurais le traduire dans le vocabulaire des affects
ordinaires. Je peux toujours indiquer, une fois le couvercle du piano
refermé : « j’étais vraiment content de
jouer ! » ; je n’aurais ainsi rien dit qui permette
à quelqu’un d’éprouver ce qui s’est
passé là. Je peux, comme je viens de le faire, raconter ma petite
histoire mais je ne ferai ainsi que pointer une singularité plutôt
que de transmettre cette expérience originale.
À mon enfant qui me sollicitait car il me voyait en
train de jouer — et j’étais bien en effet dans le salon
familial, dans l’espace domestique, donc sollicitable — je ne
pouvais donc que répondre : « Je suis ailleurs ! Tu
me crois dans ce lieu partagé, mais je suis parti ailleurs. Je suis dans
un autre monde, un monde parallèle au tien, à celui des
activités communes, et peu m’importe qu’il soit
l’heure de passer à table ou de te peigner ou de te raconter une
histoire avant de te conduire au lit car là où je suis, ces mots table, peigne
et lit n’ont rigoureusement
aucun sens ».
*
Je vous ai raconté cette petite histoire pour
introduire à ce mot de monde,
pour ancrer cette catégorie de monde de la musique dans une expérience connue de tout
musicien : il y a en effet une évidence pratique, concrète,
expérimentable de ce que la musique — particulièrement
quand on la joue et qu’on l’épouse physiquement au plus
près de ses infimes tours et détours — compose à
elle seule un monde, un monde détaché des situations ordinaires,
un monde peuplé de ses propres êtres (harmonies, mélodies,
rythmes, timbres, gestes, instruments, corps…), un monde où
apparaissent des existences n’ayant aucun équivalent exact dans
les situations courantes.
Ce fond phénoménologique ainsi brossé,
passons à un examen plus théorique de la notion de monde de la
musique.
I. Pourquoi soutenir que la musique, à elle seule, forme un monde à part entière ?
La thèse radicale que je voudrais soutenir devant
vous est donc celle-ci : la musique forme un monde à part
entière qu’on appellera le monde de la musique.
Mais pourquoi cette thèse ? À quelles
préoccupations veut-elle répondre ? Quels en sont les
enjeux ?
I.1 À quoi cette thèse s’oppose-t-elle ?
D’abord de quoi cette thèse veut-elle se
distinguer ?
I.1.a. Distinguer le monde de la musique de la société des musiciens
Il s’agit essentiellement de controverser
l’idée qu’une sociologie de la musique pourrait suffire
à rendre compte de ce monde de la musique, de ces opérations
singulières que sont les opérations musicales, de
l’existence des pièces et œuvres musicales, etc. La
sociologie de la musique étudie la société et ses musiciens,
éventuellement la société des musiciens et les
différentes « sociétés musicales ».
Les opérations proprement musicales sont ici considérées
comme transitives à d’autres opérations socialement
constituées ; elles sont saisies dans leur
extériorité fonctionnelle, non dans leur capacité
immanente d’instituer des univers cohérents. La sociologie ne
dispose d’ailleurs pas d’un concept de monde, dissolvant toute
identité de ce type au profit de la notion de société, pire encore : au profit de la catégorie
substantialisante de social…
I.1.b. Quelques
exemples
I.1.b1. Pas de contextualisation possible d’un monde
Pour procéder à cette dissolution, l’un
des outils privilégiés de la sociologie est
l’opération de contextualisation. Mais s’il existe bien
quelque chose comme un monde, cette opération n’a alors
guère de sens à son endroit car un monde ne saurait avoir de
contexte [1] :
en effet la conviction moderne — cantorienne — est qu’il
n’y a pas de méta-situation, de Situation pour les
différentes situations, ou encore qu’il n’y a pas de
méta-monde, de Monde des mondes, de Grand Univers, ou encore qu’il
n’y a pas de Tout apte à situer et contextualiser chaque
situation.
La sociologie ne semble d’ailleurs pas disposer de concept
de totalité ; elle
procède par découpage d’entités partielles
prélevées dans un vaste tissu conjonctif. Pour la sociologie, pas
de tout fermé sur soi mais seulement des entités poreuses, prises
dans une incessante circulation les traversant de part en part.
Face à cette sociologie de la musique, on soutiendra
que si la société des musiciens existe bien, il s’agit ici
de penser la musique en y mettant au centre les œuvres et non plus les
musiciens, et, pour cela, il faut pouvoir penser la musique comme monde.
Ou encore : là où la doxa articule « le musicien et ses
œuvres » (voir le plan convenu des monographies
musicologiques), il s’agit de renverser le propos et d’examiner
« l’œuvre et ses musiciens ».
I.2 Les questions en travail
Quelles sont les questions qu’il s’agit de faire
travailler à la lumière de cette thèse d’un monde de
la musique ?
I.2.a. L’œuvre et son musicien…
Il s’agit d’abord de remettre l’œuvre
musicale au centre de notre dispositif de pensée et, corollairement, de
relocaliser le musicien comme subordonné à la musique. Tant que
la musique n’est qu’une région intégrée
à un univers plus vaste, qu’un champ parmi d’autres, tant
qu’elle est saisie en son extériorité relationnelle
plutôt qu’en son intériorité opératoire, la
consistance intrinsèque de la musique, sa logique propre ne sauraient
être dégagées.
I.2.b. L’autonomie musicale
Plus généralement, il s’agit
d’examiner dans quelle mesure la musique sait être autonome,
c’est-à-dire norme d’elle-même.
La musique ne sait-elle que demeurer sous la subordination
d’autres normes de pensée ? Thomas d’Aquin le
pensait : pour lui la musique était subalternée à
l’arithmétique et il prenait cette disposition en bonne
part : comme modèle de la docilité requise pour la
pensée, non comme défaut ou défaillance. Il écrivait
ainsi, au départ de sa Somme théologique : « La musique s’en remet aux
principes qui lui sont livrés par
l’arithmétique. » [2]
La subordination de la musique à des lois
exogènes est thématisée, depuis les Grecs, selon une
triple modalité : alternativement, la musique serait
essentiellement sous tutelle
·
des mathématiques,
·
de la physique,
·
de la psychologie.
Il faudrait compléter cette liste d’une autre
subordination, plus récente : celle de la musique aux sciences
sociales (sociologie, économie, etc.).
Contre ces positions, il s’agit, en soutenant la
consistance propre d’un monde de la musique, d’affirmer la
capacité de la musique à se doter de ses propres lois, de sa
propre logique, de son propre régime d’existence — nous
allons voir comment —.
I.2.c. Un faux dilemme : art formel ou fonctionnel…
Il s’agit également de sortir d’un faux
dilemme : la musique devrait choisir entre être un art formel (un
jeu sans enjeu, un art pour l’art sans vérité possible) ou
un art fonctionnel (la musique au service d’un x qui ne serait pas elle). Pour échapper
à cette alternative, il nous faut penser une « musique pour
la musique » — et pour rien d’autre —, mais
cependant une musique en puissance immanente de beauté, autant dire de
vérité proprement artistique. En tendant les énoncés,
je dirais que de la capacité de la musique de « faire
monde » dépend sa capacité de faire beauté du
sonore et non pas d’être simplement l’expression neuve
d’une réalité qui lui préexisterait. Il en va donc
de sa capacité à échapper à l’alternative de
la joliesse décorative (cas du formalisme) ou de la séduction
propagandiste (cas du fonctionnalisme).
I.2.d. Législation de l’existence
En proposant de penser la musique comme monde, nous nous
attaquons également à ces autres questions : comment
légiférer sur ce qui existe ou n’existe pas musicalement ? Qu’est-ce qui est ou n’est pas de la
musique ? Qu’est-ce qui compte vraiment en musique, qu’est-ce
qui importe un peu, beaucoup… ?
Ces questions sont récurrentes dans tous les
débats sur la musique : par exemple les 4’ 32” de
silence de Cage sont-elles ou non une pièce de musique ? Il
n’y a aucune réponse évidente à cette
question… Autre exemple : selon quel protocole rationnel trancher de
l’influence ou non de la différence de sexes des musiciens sur les
œuvres ? [3]
Va-t-on légiférer sur ces questions de
l’intérieur du monde de la musique ou en extériorité
(par exemple à partir de distinctions sociales) ?
Nous allons voir que la thèse de la musique comme
monde conduit à lui reconnaître cette capacité immanente de
normer ce qui existe ou non musicalement,
plus encore à autodéfinir une intensité proprement
musicale d’existence : qu’est-ce qui, en musique, existe un
peu, beaucoup, absolument, pas du tout ? Nous verrons comment la musique
s’est dotée d’une telle capacité…
I.2.e. De l’axiomatique sociologisante
Vous comprenez que notre démarche ne peut être
ici qu’axiomatique, c’est-à-dire procéder de
décisions de pensée (explicitement exposées au principe de
la démarche) à leurs conséquences (normées selon
une logique elle-même explicitement présentée).
Si l’on examine la sociologie de la musique sous cet
angle axiomatique, on peut voir qu’un de ses axiomes serait le suivant :
c’est l’artiste qui fait l’art, c’est le musicien qui
fait la musique et si un musicien fait quelque chose qu’il décide
d’appeler « musique », il s’agit ipso facto
de musique. Bref, le musicien serait le souverain de la musique.
Variante de cet axiome : c’est le contexte
musicien qui fait la musique, non plus cette fois l’artiste individuellement
mais la société des musiciens, ce qui va se dire ainsi : si
quelque chose est programmé dans un concert (transposition : si un
objet est installé dans un musée) alors cette chose est ipso
facto une pièce de musique (respectivement cet objet est une œuvre
d’art).
La question immédiate qu’introduit cet axiome
est alors : mais qui est déclaré musicien quand cette identité
ne procède plus d’un faire de la musique mais détermine au
contraire ce que veut dire qu’en faire ?
Deux voies ici pour répondre :
— Sera considéré comme musicien celui
qui est dit tel par la société (en général par la
société des musiciens). On bute alors sur l’usage de ce mot
par la société (pourquoi celle-ci déclare-t-elle certains
individus musiciens et d’autres chefs de gare ?) ou sur la consistance
propre de ce qu’est « une société
musicale » par opposition, par exemple, à « une
société par actions »…
— Sera considéré comme musicien qui
se déclare tel. Cette voie bute alors sur le statut ainsi donné
à la parole, sur son adéquation supposée à
l’identité réelle de la personne (que pense-t-on alors des
gens qui se déclarent Napoléon, Jésus… ou
Beethoven ? Leur déclaration doit-elle être également
prise au pied de la lettre ?).
Ce mouvement de report répété des
déterminations sur une cause première fait penser aux discours
théologiques mobilisant, pour expliquer le monde, un deus ex machina, un dieu
« bouche-trou » : car si toute origine inconnue
d’un phénomène est renvoyée à une même
cause-Dieu, il faut bien ensuite se demander quelle est la consistance interne
d’une telle origine fourre-tout, d’un tel asile d’ignorance
qui se trouve alors surdéterminé par les caractéristiques
les plus hétérogènes. D’où les interrogations
traditionnelles pour comprendre comment un Dieu aimant peut-il être
également un Dieu créateur, et juste, et tout-puissant, et vengeur,
et attentif à chacun, et respectueux des lois naturelles qu’il a
instaurées, etc.
I.2.f. Pas de définition de la musique mais une axiomatisation
À tout cela, j’opposerai l’axiome inverse
que c’est la musique qui fait le musicien, que c’est
l’œuvre qui fait ses musiciens, que n’est musicien que celui
qui fait de la musique et qu’il faut donc bien avoir une
détermination intrinsèque de la musique : non point une
définition mais une caractérisation de son monde.
En ce point se dessine l’originalité de mon
propos : éviter la voie de la définition de la musique [4]
pour emprunter la voie d’une caractérisation intrinsèque de
ce que veut dire « faire de la musique », bref, de la
consistance propre d’un monde de la musique.
Venons-en à la caractérisation de ce
qu’est le monde de la musique et pour cela, caractérisons
d’abord ce qu’est un monde — à quelles conditions
peut-on parler d’un monde ? — pour examiner ensuite comment
cette catégorie de monde peut
valoir pour la musique.
II. Qu’est-ce qu’un monde ?
Le point capital est que nous disposons aujourd’hui de
concepts de monde contemporains des pensées les plus aiguës et
actives.
On dispose en fait d’un double concept de monde :
un concept mathématique et un concept philosophique, et — avantage
supplémentaire — le second s’articule explicitement au premier.
On dispose donc d’un système coordonné de deux concepts de
monde qui constitue, pour nous musiciens pensifs, une donation à partir
de quoi il va nous être possible de travailler pour notre propre compte.
• Le concept mathématique est celui de Topos : il a été déployé
à partir de la topologie algébrique la plus récente, dans
le cadre de la théorie des catégories (née dans les
années 1940). Le concept de topos a été introduit à
la fin des années 60 par le mathématicien français
Alexandre Grothendieck et fait depuis partie intégrante du corpus
mathématique usuel [5].
• Le concept philosophique est celui de situation-univers ; il se déploie depuis les années 1990
dans la philosophie d’Alain Badiou. Il s’agit là de la
création d’un concept, non d’un propos académique.
Trait supplémentaire : le concept de situation ainsi
philosophiquement construit par Alain Badiou l’a été selon
un protocole minutieux et inventif de dialogue avec le concept
mathématique de topos.
Examinons rapidement ces deux concepts.
II.1 Le concept mathématique de topos
Indiquons, le plus simplement, possible, les
ingrédients de ce qui constitue un topos.
• Un topos est
composé d’objets reliés par des flèches. On
définit sur ce réseau orienté d’objets un certain
nombre d’opérations aux noms plus ou moins clairs (cônes,
limites, égalisateurs, produits, sommes, exponentiation…).
• Avec ce
matériau, on construit d’abord des diagrammes (des ensembles empiriques de quelques objets
reliés par quelques flèches), puis des catégories c’est-à-dire des ensembles dotés
d’un minimum de consistance interne (en gros la composition associative
de flèches d’une catégorie est une autre flèche de
la catégorie : on ne sort donc pas de cet ensemble par
associativité des flèches).
• On définit
ensuite un concept de grande catégorie (techniquement dit : catégorie à clôture cartésienne [6])
telle qu’on ne puisse en sortir par combinaison des opérations
définies précédemment. [7]
• On définira
alors un topos comme étant une telle grande catégorie
dotée en sus d’une logique interne (techniquement dit : un
topos est une catégorie à clôture cartésienne
dotée d’un classifieur de sous-objet [8]).
Au total, un topos est donc un ensemble vaste (infini, a minima) d’objets reliés par
des relations orientées, ensemble clos (dans lequel on opère sans jamais en sortir)
et centré autour
d’une logique interne.
II.1.a. « Topos of music »
Les premières tentatives d’appliquer cette
théorie mathématique des topos à la musique commencent
à voir le jour. Il faut citer ici le mathématicien suisse —
également pianiste de jazz — Guerino Mazzola qui vient de sortir
un très épais traité (1 500 pages !) intitulé
précisément Topos of music.
Nous avons dirigé ensemble à l’Ircam un séminaire Entretemps (2000-2001) sur musique et mathématiques et
je profite de cette occasion pour vous indiquer la publication en juin prochain
par l’Ircam d’un fort volume tiré des actes de ce
séminaire. Le travail de Mazzola se situe cependant dans une orientation
très différente de la mienne, je ne m’étends pas ici
sur ce point [9].
*
Pour passer d’un concept mathématique de
topos à une catégorie
musicienne de monde, il est
préférable de transiter par le concept philosophique de
situation-univers — je ne
développe pas sur ce point de méthode qui, à mon sens, est
plus général : la philosophie est la médiation royale
pour penser « en même temps » mathématiques
et musique — [10].
II.2 Le concept philosophique de situation-univers
Depuis plusieurs années, Alain Badiou déploie
une évaluation philosophique de ce qui se pense dans les
mathématiques autour de la théorie des catégories. Ce
travail a pris la forme d’un séminaire à
l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm) sans donner
lieu à d’autres publications que des notes de travail [11].
Mais un vaste livre, Logiques du monde,
est désormais annoncé qui
rendra publique cette élaboration conceptuelle. Je vais
aujourd’hui résumer les quelques conclusions de ce travail
indispensables à mon propos sur la musique.
Badiou reprend philosophiquement le concept
mathématique de topos sous le nom
de situation.
L’idée philosophique de la situation est de
constituer un lieu possible pour l’apparaître, une localisation
pour l’être-là (le Dasein philosophique), une logique pour les phénomènes. La
conviction de départ est bien sûr cantorienne : il n’y
a pas de Tout, d’Ensemble des ensembles, d’Univers des univers, de
Monde des différents mondes possibles. Il faut donc considérer
que n’importe quel être, n’importe quel étant,
n’importe quel apparaître, n’importe quel
phénomène nécessitent une localisation dans une situation
donnée, particulière, non universelle puisqu’il n’y
pas d’Univers où « tout » pourrait prendre
place, être situable…
Le concept philosophique de situation est la donation d’un
tel lieu non global (par définition il y aura toujours une situation, et puis une autre, et encore une autre, sans Méta-Situation
récollectant et contextualisant « toutes » les
situations possibles). Ce lieu est doté d’une consistance propre
en sorte de pouvoir y normer l’apparaître c’est-à-dire
mesurer ce qui y existe ou n’y existe pas, discerner ce qui y
apparaît avec plus ou moins d’intensité, distinguer les
phénomènes à forte prégnance de ceux dont
l’importance est négligeable, etc.
La construction de ce concept philosophique de situation
suit minutieusement l’élaboration mathématique du concept
de topos au prix, bien sûr, d’une importante renomination conceptuelle,
de significatifs changements d’accents et d’un certain nombre de
remaniements dont je vous ferai aujourd’hui grâce. Badiou aboutit
ainsi à la construction d’un concept de situation-univers
doté de propriétés apparentées à celles du
concept mathématique de topos.
Une situation-univers est, comme un topos
mathématique, un ensemble ayant trois importantes
propriétés :
• Il est clos
sur lui-même de telle manière qu’on ne puisse en sortir par
ses opérations immanentes.
• Il est suffisamment vaste pour qu’on puisse embrasser de
l’intérieur de cette situation toute région finie de cette
même situation (il offre un recul tel qu’on n’est pas
obligé d’en sortir pour examiner ce qui se passe dans telle ou
telle de ses régions.
• Une telle situation est enfin dotée
d’une logique interne prenant la forme tout à fait originale
d’un objet particulier de la situation.
II.2.a. Le transcendantal immanent à la situation !
Badiou interprète ici le concept mathématique
de classifieur de sous-objets en mobilisant le concept philosophique de transcendantal. L’idée est la suivante :
là où Kant établissait l’existence de conditions
transcendantales à la possibilité même qu’il y ait
expérience de ceci ou cela [12],
Badiou pense le transcendantal d’une situation comme ayant le même
statut que tout autre entité de la situation et étant donc soumis
au même protocole de validation que tout autre entité. Ainsi le
transcendantal — qui par définition rend possible toute
expérience — rend ici possible, dans les mêmes conditions,
l’expérience de lui-même. Le transcendantal n’est donc
plus transcendant à la situation mais lui est immanent ; en
particulier le transcendantal apparaît dans la situation selon les
mêmes règles d’immanence que celles qu’il fixe
lui-même pour n’importe quelle
« entité » ou « chose » de
la situation.
II.2.b. Trois propriétés essentielles
En résumé, une situation-univers est une
situation vaste, close et normée par un transcendantal immanent.
Je ne saurais ici m’étendre sur cette
philosophie [13].
Mon propos ici n’est pas philosophique mais musical. Pas plus que je ne
pense en mathématicien, je ne pense en philosophe ; je pense en
musicien, très exactement en ce type particulier de musicien que
j’appelle musicien pensif.
Une brève incise sur ce point.
II.3 L’intellectualité musicale
Le musicien pensif se distingue du musicien artisan, par la
pratique de ce que j’appelle l’intellectualité musicale.
L’intellectualité musicale du musicien pensif désigne la manière
dont un musicien pense la musique, manière très différente
de celle dont une œuvre pense cette même musique.
• L’œuvre en effet pense la musique
— c’est ce qui donne matière à son propre
déroulement —. Elle pense également la pensée
musicale qu’elle est — cela se matérialise en ces bifurcations,
inflexions, rebroussements de toute œuvre par rapport à son
contexte musical —. Ainsi une œuvre pense, et pense sa
pensée. Tout cela, qu’on appellera pensée musicale, l’œuvre l’accomplit avec des notes
et des sons, non avec les mots et les phrases de nos langues ordinaires.
• Le musicien, lui, participe bien sûr de
cette pensée de l’œuvre — de cette pensée musicale
à l’œuvre — mais
il y ajoute une activité qui lui est tout à fait
singulière, la pensée qu’on dira cette fois
spécifiquement musicienne et qui consiste à projeter la
pensée musicale dans le langage, dans sa langue de musicien, par exemple
dans la langue française que je suis en train de vous parler. Cette
projection, le musicien peut la faire selon différentes
modalités, plus ou moins théoriques, plus ou moins
métaphoriques (cela produira différents styles d’intellectualité
musicale) mais cette activité de projection reste le propre du
musicien : ce n’est pas là un travail de l’œuvre
(ainsi pensée musicale et
pensée musicienne font
deux), mais ni non plus un travail de philosophe, a fortiori de
mathématicien.
Il y a donc une différence de forme entre pensée
musicienne et pensée musicale. Je tenterai tout à l’heure
d’en relever cette fois une différence de contenu, mais il me
faudra pour cela avoir élaboré la catégorie musicienne de
monde.
Avant d’y venir, encore deux petites remarques.
II.4 Polysémie du mot « musique »
D’abord, il faut bien voir que le mot
« musique » dont j’use et abuse prend, selon le
contexte, différents sens.
Le mot musique a au
moins trois sens enchevêtrés :
·
Il nomme le monde de la musique comme tel. En ce sens
il n’y a qu’un seul monde de la musique, non pas plusieurs.
·
Il nomme les musiques qui s’y jouent, musiques
ici saisies comme diversité culturelle : en ce sens, il y a plusieurs
musiques dans cet unique monde de la musique (le jazz, la musique
tzigane…) comme il peut y avoir plusieurs régions ou continents
dans un même monde.
·
Il nomme enfin l’art musical, ce qu’il y a
d’art dans ce monde et en ce sens, il n’y a qu’un art musical
là où règne par contre la pluralité des cultures
musicales.
En résumé, il y a un seul monde de la musique,
et un seul art musical mais une pluralité de musiques qui n’ont
pas pour ambition cet art musical mais seulement d’exister comme telles
au sein de ce monde.
II.5 Pluralité des mondes sans Univers totalisant
Remarquons ensuite : la musique n’est qu’un
monde, non pas bien sûr Le Monde (qui n’existe pas !). Il y a
donc des mondes, et non pas Un Monde unique ; et ces différents
mondes coexistent. On y entre, on en sort (rien de plus commun pour un musicien
que d’entrer et sortir du monde de la musique) : rien qui relève
là de la science-fiction ! C’est simplement qu’il faut
changer notre conception de ce qu’est un monde. Employons-nous y !
III. La catégorie musicienne de monde
Suivant le fil de pensée du concept
mathématique de topos et du concept philosophique de situation-univers,
je poserai que la musique constitue un monde en tant que la musique dispose
d’une triple propriété :
1.
elle est infiniment vaste ;
2.
elle est close sur elle-même ;
3.
elle dispose d’une logique propre pour
étalonner les existences musicales.
Ces thèses s’opposent trait pour trait aux
thèses suivantes :
·
La musique serait un domaine fini et restreint
prélevé dans un monde plus vaste qui en fournirait le contexte.
·
La musique serait ouverte aux quatre vents ; ses
opérations seraient saturées d’identités sociales et
techniques.
·
La musique serait subordonnée à
d’autres domaines et logiquement soumise à d’autres
disciplines de pensée (la mathématique, la physique, la
psychologie, la sociologie…).
Disons :
— La thèse combinatoire de Barbaud ou Philippot
où la musique est pensée comme musique écrite procédant
d’une combinatoire sur un alphabet fini…
— La thèse marxisante d’Adorno, où
la musique est reflet d’une société et prend position sur
les conflits de cette société.
— La thèse subalternante de Thomas
d’Aquin où la musique est vassale d’une pensée
majeure.
Contre ces thèses, reprenons une à une nos
trois propriétés.
III.1 La musique est infiniment vaste
Il faut d’abord se demander : de quoi exactement
le monde de la musique est-il peuplé ? Qu’y a-t-il dans ce monde
qui justifie de le considérer comme monde ? Quels sont donc les
objets et relations de ce monde ?
III.1.a. Les objets musicaux
Ce sont les sons et les notes, les harmonies et les
mélodies, les timbres et les instruments, les voix et les chœurs,
les pièces et les œuvres…
III.1.b. Les relations musicales
Ce sont les relations musicales de toutes sortes :
entre harmonies, entre mélodies et thèmes, entre voix et timbres,
etc. Une tonalité est une relation musicale, un développement
thématique de même, et une rétrogradation, et une
modulation, et un contraste de timbre, et une forme-rondeau, etc., etc.
III.1.c. Remarque sur les musiciens
Remarque importante : on indexera les musiciens au
registre des opérations musicales ; le musicien est celui qui
prête un instant la matérialité de son corps pour
réaliser une opération musicale comme celle, par exemple, qui va
relier l’objet musical « partition » à cet
autre objet musical qu’est une réalisation sonore de cette
partition. Le musicien est celui qui matérialise un instant un vecteur
musical, rien de plus et rien de moins. C’est dire — on y reviendra
— qu’une fois son opération effectuée, le musicien
disparaît du monde de la musique dans lequel il n’est à dire
vrai apparu que comme une sorte d’ange, peut-être un fantôme,
mais sûrement pas une identité constituée.
III.1.d. Axiome d’infinité
Le point qui pour le moment nous intéresse est que ce
monde peuplé d’objets musicaux et de relations musicales est infiniment
vaste, non pas seulement potentiellement mais actuellement.
Rappelons : on ne saurait démontrer
l’existence de l’infini et il convient de le déclarer,
c’est-à-dire de le décider [14]
Je déciderai donc que la musique ne s’exempte pas de cette
conception galiléenne des situations pour laquelle toute situation est
infinie et poserai comme thèse que le monde de la musique est infini,
c’est-à-dire inépuisable par une série finie
d’opérations.
III.1.d1. Objection
On pourrait objecter : mais le monde de la musique a
été bâti par une série d’opérations
humaines, donc nécessairement finie ! Ce à quoi je
répondrai : certes, cette série d’opérations
est discrète et n’a pu être que finie, mais la musique
édifie un monde qu’elle ne construit pas pierre après
pierre ; pour bâtir son monde, la musique mobilise, investit,
parcourt, explore, découvre un matériau sonore infini. La
matière même du monde de la musique est donc
prélevée dans le chaos ontologique général et non
pas rassemblé, atome par atome, par la musique.
Ou encore : la musique fait monde en prélevant
dans un « il y a » qui la précède. Le
matériau de travail de la musique, celui qui fournit l’humus
même de son monde — le matériau sonore — est bien
infini et la musique peut infiniment l’explorer. C’est
d’ailleurs bien ainsi qu’elle travaille, et progresse de
fait : en découvrant constamment de nouvelles possibilités
d’opérations proprement musicales dans un matériau sonore
jusque-là informe.
Soit : le matériau et par là les objets
de la musique sont en droit infinis. Du même coup, les opérations
elles-mêmes qui relient entre eux ces objets sont elles-mêmes en droit
infinies (même si leurs types actuellement répertoriés ne
le sont pas).
Ou encore : il n’est pas vrai que la musique
procède par combinatoire finie sur un matériau fini (par
l’algèbre restreinte d’un tempérament donné
sur un orchestre délimité) car cette finitude n’est que la
finitude d’un prélèvement sur une base elle-même
infinie.
III.1.d2. Un débat…
Un débat, ce faisant, se loge ici : si le
matériau de la musique, ses objets, sont les notes, alors en effet le
domaine de la musique [15]
est fini. Mais je soutiens que le matériau de la musique, ce sont les
sons, non la note [16]
laquelle relève d’une autre logique — on va voir
laquelle… —.
Résumons : si la musique est ce qui
s’organise pour résister au sonore en donnant forme au son
informe, alors le monde des choses musicales est infini et non pas discret et
dénombrable.
III.1.d3. La vastitude
La vastitude du monde de la musique procède de cette
infinité. Si l’on suit le parallèle proposé avec la
vastitude des topos [17],
il s’agit par exemple de constater que l’on peut ressaisir de
l’intérieur du monde de la musique toute partie finie de ce monde.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Prenons un exemple.
Supposons une pièce de musique existante :
c’est, comme on dit, un morceau de
musique, autant dire une partie finie du monde de la musique.
L’hypothèse de la vastitude est alors qu’il est toujours
possible d’examiner cette pièce de l’intérieur du
monde de la musique et qu’aussi grande soit cette pièce, il y aura
toujours place pour son examen musical endogène.
Que désigne cet examen ? Finalement une
réalité toute simple, phénoménologiquement bien
répertoriée : c’est que toute pièce de musique
est évaluable par une autre pièce de musique ; c’est
qu’une pièce de musique se situe toujours peu ou prou par rapport
à d’autres pièces qu’elle
« évalue ». Ceci est particulièrement
manifeste pour ces pièces singulières qu’on appelle des
œuvres [18].
Une œuvre dialogue toujours avec d’autres œuvres, soit
qu’elle en cite expressément une, soit qu’elle fasse
référence plus discrètement à une autre, soit
qu’elle se situe dans le prolongement implicite de telle autre ; en
ce sens, une œuvre « éclaire » d’autres
œuvres, les écoute, et, respectivement elle est « éclairée »
— autant dire écoutée
— par d’autres. C’est dire que la saisie d’une
pièce de musique peut se faire de l’intérieur du monde de
la musique et qu’il n’y a nul besoin pour cela du discours du
musicien, du regard extérieur du critique — rappelons que la
meilleure critique d’une œuvre musicale, c’est une autre
œuvre musicale, et non pas un texte écrit dans la langue dont
j’use actuellement —.
*
Ainsi la musique est infiniment vaste. Elle remplit donc
notre première condition.
III.2 Clôture
Venons-en à la seconde caractéristique
d’un monde : il est clos c’est-à-dire fermé
à ses opérations internes. Soit : on ne sort pas du monde de
la musique par le jeu indéfiniment répété des
opérations musicales. On a beau poursuivre ces opérations dans
tous les sens, on reste dans ce monde.
Donnons de cela quelques exemples.
III.2.a. Le jazz, une région du monde de la musique
Vous jouez du jazz. Vous improvisez donc. Vous pouvez pour
ce faire utiliser des thèmes d’origine très diverses :
un negro spiritual, un air de Broadway,
une chanson des Beatles, etc. Ce qui importe est de swinguer : vous
êtes immédiatement de plein pied dans l’espace de jazz.
Maintenant, prenez le parti d’abandonner
progressivement le swing : vous allez sans rupture passer au piano bar, ou
à une improvisation de style « classique », ou
encore à une danse latino-américaine ; en tous les cas vous
aurez quitté le domaine du jazz en suivant simplement le fil immanent de
votre improvisation.
Bref, le jazz n’est pas clos sur ses
opérations : une déformation continue du swing
l’annule. Conclusion : le jazz à lui seul ne saurait constituer
un monde ; il est seulement une région ou un continent du monde de
la musique.
III.2.b. Un arrêt extrinsèque
Maintenant, vous improvisez au piano comme je le
décrivais tout à l’heure. Ces opérations, aussi
diverses soient-elles, ne sauraient vous conduire hors de la musique. Elles
peuvent tout au plus amener à suspendre la musique, à
interrompre, à arrêter, le morceau ou l’improvisation
étant finis, mais rien là qui excède la capacité
autonome de la musique de s’arrêter. Par contre si quelqu’un
vous attrape par la manche et vous interromps en cours de jeu, là, vous
sortez bien de la musique mais selon le principe transparent d’une
opération exogène, extrinsèque (dont ce serait trop dire
qu’elle est transcendante à l’immanence musicale). Cette
césure n’infirme donc nullement la thèse d’un monde
de la musique clos sur ses opérations.
III.2.c. Des opérations musicales
Plus généralement toutes les opérations
musicales peuvent être indéfiniment prolongées,
combinées, répétées, récollectées
mêmes : elles ne conduisent pas en dehors de la musique.
La tonalité : une
région du monde de la musique
Prenons comme exemple l’opération harmonique
« modulation ». Il est patent que tout un
développement de la pensée musicale s’est fait par
progressive exploration de l’épaisseur du monde de la musique
lorsqu’il était parcouru sans relâche par cette
opération « modulation ».
L’expérience historique (via Wagner) a montré qu’on
pouvait ainsi tordre et retordre le discours musical, sans en sortir…
L’opération « modulation » a pu ainsi
conduire à sa propre dissolution par saturation sans que pour autant on
ait atteint une sorte de point de butée, une limite ou un horizon, une
frontière du monde. Autant dire que la musique tonale ne saurait
constituer à elle seule un monde puisque, comme pour le jazz, on peut
très facilement en sortir par des opérations immanentes.
*
Nous soutiendrons donc que le monde de la musique est clos
pour les opérations musicales. Voilà notre seconde condition.
III.2.d. Objection : et le musicien ?
Une objection surgit alors : et le musicien ? Ne
sort-il pas, lui, de ce monde sans problème, pour aller par exemple se
restaurer ou dormir, et puis pour y revenir une fois ses forces
reconstituées ?
Il est clair en effet que si le musicien comme individu
faisait partie de la musique, alors la musique ne saurait être un monde
puisqu’une de ses opérations immanentes — le musicien
— ne cesserait d’en sortir.
III.2.d1. Remarque
Il faut bien comprendre un aspect de cette clôture
d’un monde : quand on habite un monde, on ne sait pas qu’il
s’agit là d’un monde parmi d’autres. Le monde dans
lequel on habite — pour peu qu’il s’agisse bien d’un
monde, non d’un pur et simple « il y a » qui peut
rester entièrement chaotique —, ce monde n’a nullement
l’apparence d’un monde mais fournit simplement la
possibilité d’une expérience stable des choses qui
apparaissent. Pour l’habitant d’un monde, il n’y a nulle
frontière de ce monde et l’idée même qu’il
puisse y avoir un en dehors de son champ d’expérience n’a
strictement aucun sens pour lui.
III.2.d2. Le musicien n’habite pas le monde de la musique
Autant dire que l’individu musicien ne saurait
être un réel habitant du monde de la musique. À proprement
parler, il n’est ni objet musical, ni même opération
musicale : comme je l’ai dit, il vient simplement servir de support
matériel temporaire à une opération musicale.
Au total, l’existence de musiciens entrant et sortant
du monde de la musique ne déqualifie donc pas la propriété
de ce monde d’être clos sur lui-même.
III.3 Transcendantal
Venons-en maintenant à notre troisième
caractéristique d’un monde : l’existence d’un
transcendantal normant ce que veut dire y apparaître, étalonnant
l’intensité d’existence dans ce monde.
Quelles sont les propriétés qu’on doit
exiger d’un transcendantal musical pour qu’il soit à
même de prononcer : « musicalement ceci existe et ceci
n’existe pas vraiment, ceci existe un peu et ceci
beaucoup » ?
Il y a en a essentiellement deux :
1) Il doit s’agir d’abord d’un objet
particulier de ce monde. Ce doit donc être un objet
présenté selon les mêmes règles de présentation
que tout autre objet musical [19].
2) Cet objet doit pouvoir mesurer
précisément ce qu’est une intensité
d’apparition en musique. Le transcendantal fixe une sorte de gradation
dans l’intensité d’existence et, sur cette base,
établit la possibilité d’opérations logiques fixant
ce qui compte et ce qui ne compte pas. Techniquement [20],
les mathématiciens associent l’objet précédent (le
classifieur de sous-objets W) à sa capacité d’établir une
relation d’ordre (partielle) à partir de laquelle il devient
possible de classer, d’ordonner ce qui existe dans le topos, autant dire
pour nous dans la situation musicale.
Quel peut donc bien être cet objet dans le monde de la
musique ?
III.3.a. Deux exemples
Pour introduire à la réponse que je vais
proposer, prenons deux petits exemples musicaux.
III.3.a1. Un recours à la partition
J’écoute à la radio une
interprétation du concerto en Sol de Maurice Ravel par Pierre-Laurent
Aymard. Soudain je suis saisi par un détail que je n’avais jamais
entendu comme cela : nous sommes en plein développement du premier
mouvement et le piano soliste s’est brusquement arrêté au
bord du vide, en surplomb instable d’un fragile glissando de harpe. Les
instants qui suivent me laissent sur le qui-vive, puis le piano reprend son
discours mais sa manière souveraine de suspendre son propos et de
laisser place à la frêle harpe m’a fait plonger au cœur
même de la musique déployée par l’œuvre.
J’appelle ce type de moment un moment-faveur ou « moment
favori ».
Quelle a été ma réaction, une fois
l’œuvre achevée ? Comment tenter de répondre aux
questions qui affluaient : « Mais que s’est-il donc
exactement passé là ? Comment se fait-il que je n’aie
jamais entendu ce moment avec cette intensité ? »
Ma réponse, réponse de musicien, a
été de me précipiter sur la partition pour voir ce qui
était écrit là, pour retrouver ce moment dans le texte, et
comprendre ce que Pierre-Laurent Aymard avait fait de la lettre du concerto.
Mon réflexe — tout naturel pour un musicien — était
donc de me reporter au texte écrit pour mieux évaluer la nature
musicale exacte de ce qui s’était passé : comment ce
moment était-il inscrit dans la partition ? Dans la grâce et
la faveur renversante de ce moment, quelle était la part exacte du texte
et celle de l’interprète ? Comment évaluer
précisément l’opération de Pierre-Laurent
Aymard : avait-il relevé un détail inscrit de tout temps
dans la partition ou avait-il ajouté une possibilité
laissée en blanc par le texte ? Dans tous les cas évaluer ce
qui s’était passé là passait par la convocation de
cet instrument de mesure que constitue la partition [21].
III.3.a2. Le trouble de la lettre musicale
Second exemple : un enfant apprend à lire et
écrire la musique. On lui dessine les portées, puis on y situe
les notes en leur donnant un nom et laissant à plus tard la question des
durées. On lui montre comment à chaque grosse tâche noire
sur les portées correspond une touche sur le clavier du piano et on lui
demande de restituer chaque note ainsi inscrite en chantant son nom
propre : « do, ré, mi… ». Si
l’enfant chante un peu faux, on n’insiste pas trop — dans un
premier temps du moins — sur cet écart : l’important
n’est pas ici la qualité vocale mais l’intelligence musicale
du rapport entre notes et sons. On instruit l’enfant d’un code
plutôt qu’on ne l’éduque à la qualité
vocale d’une réalisation musicale.
Très vite cependant, l’enfant bute sur la
logique de ce code, ne serait-ce que parce que ce qui suit
« sol-la-si » c’est à nouveau
« do », mais qu’il faut maintenant chanter ce do autrement que le premier nommé car il est une
octave plus haut. Le rapport entre sons et notes devient ainsi plus complexe,
moins unilatéral. Et si l’on fait durer le do ou si on le joue plus fort, son nom ne change pas
mais par contre si la voix baisse et dérive indûment vers le
grave, alors on quitte le do et
on déclarera à l’enfant que maintenant il chante faux.
Toutes ces opérations qui apparaissent comme une seconde nature pour le
musicien instruit peuvent être aussi, on le sait, un véritable
casse-tête pour l’enfant qui reste souvent perplexe devant ces
rapports entre notes et sons, un peu comme l’écolier à qui
on apprend que B et A fait BA mais que M et A ne font pas
« ÉmA ». Et qui ne se souvient de la
perplexité du collégien confronté pour la première
fois de sa vie au x de l’algèbre, à cette très
curieuse opération consistant à nommer ce qu’on ne
connaît pas, à fixer l’inconnue d’une lettre puis
à calculer sur cet identifiant vide en misant sur un dénouement
heureux permettant enfin de connaître ce qu’il recouvrait ?
Dans ces différents cas, l’intervention de la
lettre, qu’elle soit musicale (la note), littéraire
(alphabétique) ou mathématique va fixer un régime
d’existence. Finalement le do,
comme la lettre A ou la lettre algébrique x, indexe ce qui
structuralement compte dans le phénomène pris en compte et il le
fait par mise en relation ordonnée de ce phénomène par
rapport à d’autres (le do est entre le si et le ré…).
III.3.b. Le solfège, transcendantal musical
Ces deux petits exemples voulaient introduire à mon
hypothèse de travail : le transcendantal musical, c’est le
solfège.
Ma thèse est que le transcendantal du monde de la
musique est constitué par l’ensemble des symboles musicaux
permettant l’écriture, soit par la totalité des signes du
solfège. La structure du solfège — ce qu’un Danhauser
a appelé pour des générations de musiciens en herbe
« Théorie de la musique » [22] — constitue donc la structure
même du transcendantal musical.
En quoi le solfège est-il à même de
remplir cette fonction de transcendantal dans le monde de la musique ?
III.3.b1. Un objet musical
Remarquons d’abord qu’il constitue bien un objet
répertorié du monde de la musique : le solfège
musical n’est pas une chose extérieure à la musique,
appartenant aux domaines de la philosophie, ou de la mathématique, ou de
la littérature. Il constitue une production sui generis de la musique, et chacun sait combien le
solfège fonctionne comme pierre de touche subjective : qui ne
connaît pas le solfège se sentira exclu de la compréhension
profonde du monde de la musique ; il pourra certes s’approprier
telle région (c’est le cas pour les pratiquants de telle musique
traditionnelle) mais il restera handicapé pour s’approprier la
logique générale de la musique.
Le solfège, donc, est une norme du monde de la
musique qui lui est interne.
Au passage, il faut rappeler l’échec de toutes
les tentatives pour remplacer ce solfège musical par une littéralisation
non musicale, par exemple par un chiffrage décalqué de
l’arithmétique. L’examen des propositions de Rousseau [23]
sur ce point est très éclairante… [24]
III.3.b2. Une mise en ordre
Ensuite ce solfège est une mise en ordre des
réalités sonores qui comptent pour la musique, mise en ordre qui
institue une gradation quantifiée des existences musicales. Ainsi le
solfège instaure une échelle ordonnée et mesurée
des hauteurs, une autre des durées, et une troisième des
intensités.
III.3.b2.i Le cas particulier des timbres
Il est vrai que le solfège échoue à
faire de même en matière de timbres. Ce point est pour nous
intéressant : il indique que les timbres, et donc peu ou prou les
instruments de musique constituent une sorte de limite interne au monde de la
musique, une série d’objets qui n’ont pas exactement le
même statut que les autres objets musicaux que sont les hauteurs,
durées et intensités. [25].
III.3.b2.ii Les ordres partiels du solfège
Revenons aux ordres partiels dont est capable le
solfège.
On voit qu’il s’agit grâce au
solfège d’ordonner les durées, les hauteurs et les
intensités (une croche est plus brève qu’une noire, un do plus grave que le ré qui le suit, un pianissimo est plus doux qu’un
piano…) et de fixer une échelle graduée des acuités
d’existence musicale.
III.3.b2.iii L’objet minimal [26]
Point remarquable : cette échelle est
établie à partir d’un minimum d’acuité
d’existence que constitue la lettre de silence : la durée
d’une petite note de silence — différentiel minimal —
fixe ainsi ce que la théorie des topos appelle objet minimal. On trouve dans l’exemple musical suivant la
lettre fixant ce minimum en deuxième position :

III.3.b2.iv La partition comme mise en ordre
Sur cette base, le solfège constitue une mise en
ordre plus générale en classant chronologiquement les événements
sonores : une partition est de ce point de vue la constitution d’un
ordre partiel déterminant avec le plus de précisions possibles ce
qui vient avant, ce qui vient après, et ce qui est synchrone.
Notre solfège est donc bien doté de tous les
attributs attendus d’un classifieur de sous-objets.
III.3.b3. Le fonctionnement du solfège
Voyons maintenant comment les opérations qu’il
autorise lui permettent de fonctionner effectivement comme transcendantal du
monde de la musique.
Reprenons pour cela nos deux petits exemples
précédents : celui de l’écoute du Concerto en
sol de Ravel et celui de l’apprentissage du solfège chez
l’enfant.
III.3.b3.i Le Concerto en Sol
Dans le cas du Concerto en Sol, le solfège constitue
le recueil des signes de différenciation dans lequel la partition a
puisé pour inscrire les existences musicales destinées à
compter. La pratique consistant à se reporter à la partition pour
apprécier ce qui s’était réellement passé
lors de l’interprétation par Pierre-Laurent Aymard du concerto ne
vise pas à limiter l’existence musicale à la seule
exécution des lettres du solfège ; tout au contraire, elle
vise à prendre mesure de l’existence musicale effective, de
l’acuité de ce qui est soudainement apparu en appréciant sa
qualité d’existence par mise en rapport avec les signes
solfégiques de la partition.