Introduction
Ē Les motions en musique Č ?
Mon premier projet tait de mettre un peu dÕordre dans ce qui se prsente comme
un fatras en prenant pour cela modle sur Spinoza, singulirement de son thique. DÕo lÕide dÕune prsentation axiomatique dont un rsum, crit
quelques mois plus tt, donnait le canevas possible. [2]
Mais jÕai finalement abandonn cette
ide : lÕintrt de lÕexposition axiomatique est sa puissance — cf.
Hugo : Ē Ce qui caractrise essentiellement lÕaxiome, ce nÕest pas
dÕtre clair, cÕest dÕtre fcond. Č [3]
—. Or cette fcondit ne saurait sÕattester dans un expos de trente
minutes. DÕo le parti finalement adopt dÕun ordre dÕexposition plus cursif et
inductif, pousant plus souplement lÕexprience musicale immdiate.
Voici alors mon plan :
į
Trois types dÕmotions en musique.
į
Ensuite la varit interne chaque type.
į
On terminera en examinant le cas
particulier du duende.
Trois types dÕmotions en musique
Ē Il
est juste de voir la Musique comme une quation de sentiments. Č
Pierre-Jean
Jouve (II.1056, 1179)
Ē Chose
inoue, cÕest au-dedans de soi quÕil faut regarder le dehors. Č
Victor
Hugo (Critique) (p. 699)
Et dÕabord : quÕentendre par
Ē motion Č en matire de musique ? SÕĒ il est jute de voir
la musique comme une quation de sentiments Č (Jouve), alors tentons de
mettre un peu dÕordre dans cette quation.
Je propose pour cela de distinguer trois types
dÕmotions en matire de musique.
Les sentiments esthsiques
Ē De
la mme faon que le sommeil ou le vin ne font que renvoyer plus tard le
chagrin sans lÕeffacer, en produisant torpeur, langueur et oubli, de mme une
mlodie donne nÕapaise pas une me en proie au chagrin ou la pense agite
violemment par la colre, mais, lÕoccasion, simplement la distrait. Č
Sextus
Empiricus : Contre les musiciens ;
p. 425
Ē Ce
qui est gnant, dans mon pome sur Bach, cÕest quÕil ne parle pas vritablement
de la musique, mais de lÕimage que celle-ci mÕa suggre. [É] Ce quÕil y a dans
les vers, ce nÕest pas la toccata, cÕest mon impression subjective,
lÕassociation dÕides qui mÕest venue lorsque jÕai entendu cette musique. Č
Hermann
Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ; p. 187-8
JÕappellerai en premier lieu sentiments esthsiques (par rfrence la catgorie de rception) les effets les plus
ordinaires de la musique sur les individus qui lÕentendent. Ce sont ces
motions qui vont spontanment sÕindexer dÕnoncs du type : Ē cÕest
beau, cÕest mouvant, cÕest fort, cÕest emballant, cÕest ennuyeux, etc. Č.
Ici la personne affecte par la musique est dispose face la musique ; elle la peroit, lÕauditionne, lÕentend. Elle se
tient en extriorit — cÕest le sens de la disposition Ē face
Č la musique — et apprcie ses propres motions individuelles
comme effets : effets de la musique sur
lÕindividu qui la peroit.
Cette extriorit de lÕauditeur par rapport
la musique peut tre indexe de la diffrence quÕinstaure Descartes
lÕouverture de son Trait des passions entre
passion et action : Ē Tout ce qui [É] arrive de nouveau est appel
une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de
celui qui fait quÕil arrive. Č LÕmotion esthsique a ainsi pour trait
constitutif dÕtre scinde en une action du ct de la musique et une passion
du ct de lÕindividu.
Sujet ?
Il sÕagit ici de lÕanimal humain individuel
pris comme sujet psychologique. CÕest lÕindividu qui tente de rpondre cette
question releve par Theodor Reik dans un article de 1921 dÕune association
amricaine de psychologie : Ē Que me fait la musique ? Č [4]
Corps ?
Le corps physiologique
Les motions musiciennes
JÕappellerai ensuite motions musiciennes essentiellement deux motions particulires : lÕune de ravissement
ou dÕenlvement, lÕautre dÕabandon ou de dlaissement. Ces motions touchent
deux moments charnires : lÕun o lÕauditeur se trouve embarqu, capt,
happ par une musique quÕil entendait jusque-l distance respectueuse,
lÕautre o le mme auditeur se trouve immanquablement dmuni in fine, quand la musique sÕarrte.
Quelques citations pour thmatiser ces
sentiments bien connus des musiciens et amateurs de musiqueÉ
a — LÕenlvement
Ē Plus de public ni de salle, plus
dÕorchestre ni de chef, le monde entier a disparu, ananti, pour se recrer
mes sens sous des formes nouvelles. Č
Hermann
Hesse : Musique (J. Corti, 1997) (37)
Ē Une de ces motions quÕon pourrait
appeler des tremblements de terre intrieurs Č
Victor Hugo
(Les Misrables) (p. 303)
Ē Heureux ceux [É] que la musique Ē prend
comme une mer Č Č.
Franois
Mauriac (MozartÉ) (115)
Ē Vous prenez un livre. [É] Tout coup
vous vous sentez saisi, votre pense semble ne plus tre vous, votre distraction
sÕest dissipe, une sorte dÕabsorption, presque une sujtion, lui succde, vous
nÕtes plus matre de vous lever et vous en aller. Č
Victor
Hugo (Critique) (p. 560)
Ē Il est presque impossible, dans un salon,
de se laisser prendre par la musique. Ce large cercle de visages beaux ou
effacs ou affreux mais tous clos, nous dtourne de rien couter. Č
Franois
Mauriac (MozartÉ) (47)
b — Le dlaissement
Ē Je connais un homme qui, du moins en
surface, devint pratiquement insensible la musique aprs une phase o il fut
trop soumis ses effets. [É] Lorsque la musique sÕarrtait, il prouvait
toujours un sentiment de dception. Il commena se construire un rempart
contre cette trs dsagrable raction de dsillusion, riger des barrires
de dfense contre les effets des impressions musicales parce quÕil dtestait
tre la dupe de ces influences mlodiques. Č
Theodor
Reik : crits sur la musique (Les Belles
lettres, 1984) ; p. 29
Ē Et cÕest la fin. Encore sous le coup de
cette motion grandiose, nous cherchons nous librer par des applaudissements. Č
Hermann
Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ;
p. 38
Ē On voudrait entendre cette musique au
moment de mourir — ou plutt, mourir comme est cette musique. Č
Hermann
Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ;
p. 174
On peut dire que la subjectivit de lÕindividu
musicien se joue en propre dans cette preuve de la dprise, en ce moment o la
musique sÕarrte, car cÕest dans la raction ce moment que le musicien va se
distinguer du non-musicien :
— Pour le musicien, cette motion de la
drliction, de lÕabandon va se donner comme dtermination continuer,
sÕentend continuer de travailler — et continuer, ce nÕest pas
simplement rpter mais la fois tenir le pas gagn et travailler au prochain
pas —.
— LÕamateur de musique, lui, le
mlomane, pour autant quÕil prouvera ce mme abandon, sera tent de simplement
rpter lÕopration (de rejouer le morceau, de remettre le disqueÉ) alors que
le musicien — sÕentend ici celui qui fait de la musique — aura pour
ressort subjectif propre de reprendre son travail de musicien : de se
remettre crire, jouer, travailler son instrument ou la composition, etc.
Ces deux motions proprement musiciennes se
distinguent des motions dites esthsiques par le fait quÕelles ne sont plus en
extriorit mais quÕelles touchent prcisment au franchissement de la barrire
entre extriorit et intriorit, la premire fois dans le sens dÕune incorporation
la musique, la seconde fois comme retour forc lÕextriorit, lÕtat
individuel primitif.
Sujet ?
Il sÕagit ici du dividu musicien (un dividu, partag entre diffrents mondes), pris comme
simple sujet grammatical de lÕinterrogation Ē Qui prouve ces
motions ? Qui est enlev ? Qui est rejet, Ē dchett Č ? Č
Corps ?
Le corps instrumentiste, celui qui entre en
rapport avec le corps physique dÕun instrument de musique.
Les affects musicaux
Ē Pour
que lÕArt [É] demeure ce qui nous merveille, ce qui nous ternise en une
seconde, il faut que notre contact avec lui reste rare. Č
Pierre-Jean
Jouve (II.1171)
Ē Pour
cet instant o cette mlodie vit en toi, elle efface tout ce qui est
contingent. Č
Hermann
Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ; p. 153
Ē Vous prenez un livre. [É] Tout coup
vous vous sentez saisi, votre pense semble ne plus tre vous, votre distraction
sÕest dissipe, une sorte dÕabsorption, presque une sujtion, lui succde, vous
nÕtes plus matre de vous lever et vous en aller. QuelquÕun vous tient. Qui
donc ? ce livre. Un livre est quelquÕun. Ne vous y fiez pas. Un livre est
un engrenage. Č
Victor
Hugo (Critique) (p. 560)
Le troisime type dÕmotions, que jÕappellerai
musicales, concernera les motions en intriorit
du musicien en tant cette fois quÕil pouse les mouvements mme de la musique
quÕil coute. Ces motions musicales ont pour caractristique essentielle
dÕassimiler ce que vit le musicien ce que vit la musique elle-mme ; il
nÕy a plus sens ici distinguer action de la musique et passion du musicien
dans la mesure o lÕmotion musicale ici lÕĻuvre est la fois action et
passion de lÕĻuvre.
Si lÕon se souvient que cette polarit passion/action
nous venait de Descartes, on peut dire que lÕmotion musicale, ne supportant
plus la polarit action-passion mais, tout au contraire la repliant sur
elle-mme, va se trouver en accord spontan avec la conception des affects dÕun
Spinoza qui, rcusant la dualit cartsienne de lÕme et du corps, soutient
quÕil ne sÕagit l que des deux faces de la mme ralit :
Ē LÕEsprit et
le Corps, cÕest une seule et mme chose, qui se conoit sous lÕattribut tantt
de la Pense, tantt de lÕtendue. Č [5]
Je veux suggrer ainsi que la diffrence entre
motions esthsiques et motions musicales a quelque chose voir avec la
problmatique de lÕesprit et du corps, et que lÕmotion esthsique (o action
et passion se disposent en vis--vis) comme lÕmotion musicienne (o un corps
prexistant se trouve mobilis puis dmobilis par un esprit musical extrieur)
trouveront chez Descartes leur philosophie naturelle quand lÕmotion musicale
trouvera plutt chez Spinoza sa philosophie spontane.
Sujet ?
Il sÕagit ici de lÕĻuvre prise comme sujet au
sens cette fois philosophique du terme.
Corps ?
Le corps musical (cf. lÕembrasement sonore dÕun
lieu par le corps corps dÕun instrumentiste et dÕun instrument).
*
Spinoza a dploy sa propre thorie des
motions au cĻur de son livre thique en sa
troisime partie intitule Des affects. Pour marquer
plus prcisment les diffrences entre nos trois types dÕmotions, je proposerai dsormais de parler de sentiments esthtiques, de motions musiciennes et dÕaffects musicaux.
Varit dans chaque catgorie dÕmotions ?
Les sentiments esthsiques
Vous avez sans doute devin que les premires
motions — les sentiments esthsiques — qui intressent avant tout
le psychologue intressent moins le musicien car elles lui semblent par trop
extrinsques : la musique vaut pour le musicien en raison de la singularit
des ides et penses quÕelle dploie, en raison de lÕextrme originalit des
sensations et affects quÕelle organise et non pas pour sa possibilit de communiquer
ou transmettre un message, fut-il Ē sentimental Č. Autant dire que la
musique vaut pour autant quÕelle est coutable et pas seulement perceptible ou
audible.
LÕcoute musicale — celle qui fait le
musicien — est en effet une pratique toute diffrente de la perception
aussi bien que de lÕaudition, lesquelles sont des manires de se rapporter en
extriorit un objet ou une situation sonores.
Pour le dire en deux mots, percevoir musicalement, cÕest essentiellement identifier un objet (reconnatre
un thme, un accord, un rythme, un instrument, une nouvelle situation sonore,
etc.) et auditionner musicalement, cÕest
essentiellement totaliser une pice, intgrer la totalit des lments dÕun morceau
(le paradigme est ici le professeur de conservatoire auditionnant lÕexcution
dÕune pice et vrifiant lÕexactitude de restitution sonore de tous les lments
du morceau musical).
couter musicalement est une tout autre
affaire, plus passionnante, galement plus risque, et plus aventureuse. Je
rsumerai sa singularit par rapport la perception et lÕaudition des traits
suivants : lÕcoute dÕune Ļuvre nÕest pas garantie pour le musicien (l o
la perception dÕun objet et lÕaudition dÕune pice le sont ; lÕattention
du musicien y suffit) car il faut quÕil se passe quelque chose en cours
dÕĻuvre, quelque chose que jÕappelle moment-faveur
et qui est proprement le moment o lÕauditeur va se trouver saisi puis happ
par lÕĻuvre et transform en vritable couteur.
LÕcoute musicale, qui fait accder le
musicien aux affects musicaux, est en intriorit l o perception et audition,
pourvoyeuses dÕmotions esthsiques, sont en extriorit.
Cette diffrence sÕarticule une autre
diffrence : les sentiments esthsiques sont provoqus par la musique mais
ne sont pas proprement musicaux : ils pourraient tre provoqus par
dÕautres causes ou actions que la musique. Les affects musicaux, par contre,
sont musicaux ou ils ne sont pas : ils sont immanents au monde singulier
de la musique et non pas la transposition ou la projection dans la musique
dÕune pratique extrieure. Certes, on peut nommer ces affects musicaux de noms
communs dÕaffects : on peut dire de telle cantate de Jean-Sbastien Bach
quÕelle est joie musicale, de tel Lamento quÕil est tristesse mme de la musique,
de lÕouverture de Tristan quÕil est dsir pour la musique mais il faut alors
concevoir joie musicale, tristesse musicale et dsir musical comme tant de
nouvelles espces de joie, tristesse et dsir et non pas comme ralisation en
musique dÕmotions prexistantes qui ne trouveraient l quÕune teinte un peu spciale,
quÕune nouvelle tonalit.
Le point est l : la vraie joie musicale
nÕest pas concevable comme application la musique dÕune joie
extrinsque ; tout au contraire, lÕexistence de joies proprement musicales
est ce qui tend le genre Ē joie Č si bien que la musique ajoute des
espces entirement nouvelles de joies la panoplie des joies quÕun tre
humain est susceptible dÕprouver dans son existence et non pas habille de sons
des joies prexistantes et donc extrinsques.
Ainsi les affects musicaux sont des
inventions, des singularits, nullement les retrouvailles dans la musique
dÕmotions prouves par ailleurs, comme le sont par contre les motions que
jÕai appeles esthsiques.
Descartes
Pour explorer plus avant la dialectique entre
motions musiciennes et affects musicaux, jÕai propos de mettre en jeu la
distinction de lÕme et du corps telle quÕelle est diffremment traite par
Descartes et Spinoza.
La dualit chez Descartes — je lÕai
indiqu — sÕaccorde spontanment lÕexprience des motions esthsiques
puisquÕon peut lire ces dernires comme une sorte dÕaction de lÕme de la
musique sur les corps physiologiques des auditeurs.
On trouve des formulations sÕaccordant
lÕide que la musique agit le corps individuel dans le Compendium Music¾ que Descartes rdigea en 1618, en prambule sa carrire philosophique :
į
Ē [L]a fin [de la musique] est de
plaire, et dÕmouvoir en nous des passions varies. Č [6]
į
Ē En ce qui concerne la varit des
passions que la musique peut exciter [É], une recherche plus exacte [É] dpend
dÕune excellente connaissance des mouvements de lÕme, et je nÕen dirai pas
davantage. Č [7]
į
Ē Ė la suite de cela, il faudrait
maintenant parler des diverses vertus des consonances exciter les
passions ; mais une recherche plus exacte de cette manire [É] dpasserait
les limites dÕun abrg. Car ces vertus sont si varies et dpendent de
circonstances si lgres quÕun volume entier ne suffirait pas puiser la
question. Č [8]
į
Ē Je devrais traiter maintenant de
chaque mouvement de lÕme qui peut tre excit par la musique [É] mais cela
dpasserait les limites dÕun abrg. Č [9]
Ici la musique agit en sorte dÕexciter la
passion de lÕauditeur, sa fin propre est Ē dÕmouvoir en nous des passions
varies Č. Pour Descartes, la thorie vise dterminer quelles affectiones (proprits) du son produisent des affectus (passions) varies. Le rapport affectio/affectus peut tre vu comme rapportant lÕesprit du son au corps de lÕauditeur.
On sait que Descartes ne ralisera pas le programme quÕil annonce la fin de
son premier livre : Descartes conclura certes son Ļuvre philosophique par
un livre sur les passions mais il nÕy parlera plus de la musique : la musique
qui a t au principe de sa vocation philosophique nÕy sera donc pas
explicitement son terme.
Les affects musicaux
Pour explorer la varit de ces affects, il
faut nous tourner vers Spinoza.
Spinoza et le topos des affects musicaux
Spinoza entreprend, dans la partie centrale de
son thique dÕengendrer tous les affects partir
de trois fondamentaux : le dsir (qui nÕa pas
de contraire), la joie, et son contraire la tristesse.
tonnante algbre dÕun imbroglio affectif
classiquement prsent comme le rgne du fluide, le triomphe de
lÕindiscernable, le lieu par excellence de lÕindmlableÉ
Il faudrait ramasser les corrlations
dmontes par Spinoza qui traduisent lÕengendrement gnralis des affects par
cette base de trois affects primitifs en un vaste schme catgoriel, un topos
des affects dont le point de dpart pourrait tre le suivant :
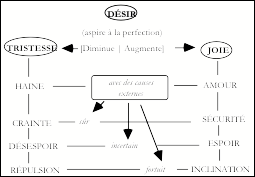
Le point de vue spinoziste suppose, bien sr,
un corps adhrent lÕesprit, ce qui est le cas pour le sujet musical.
Les motions musiciennes
Ce type dÕmotions est plus difficile caractriser
car il est essentiellement impur et mixte. Les ()motions musiciennes sont de
frontire, et Ē frlent le bord dÕun puits Č comme dirait Lorca.
Je propose de mÕen tenir stricto sensu trois
motions musiciennes : celle du corps happ, celle du corps rejet, et
entre les deux celle du corps fondu dans le corps corps.
Ici la conception spinoziste bute sur une
non-congruence du corps et de lÕesprit (puisquÕici la motion nat prcisment
de ce que le corps musicien nÕadhre pas intgralement lÕme musicale) si
bien que le mode de pense cartsien semble mieux adquat caractriser les
motions du dividu musicien comme il lÕtait dj thmatiser celles des
motions esthsiques. Somme toute la dualit cartsienne de lÕme et du corps
trouve son espace de validation dans lÕide du musicien comme dividu cÕest--dire prcisment comme celui qui partage son existence entre
plusieurs mondes sans rapports entre eux : le monde de la musique, la
socit humaine, lÕespace dÕun amour, etc.
On peut alors indexer nos trois motions
musiciennes aux trois passions cartsiennes de base qui constituent lÕenvers
(ou le complment) des trois grands affects spinozistes :
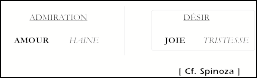
LÕenlvement musicien consonne alors avec
lÕamour cartsien, le dlaissement avec la haine (la fameuse Ē haine de la
musique Č, car cette dernire ne tiendrait pas ses promesses dÕternitÉ),
alors que lÕadmiration (pour la musique) prvaut dans lÕintervalle entre les
deux.
*
Voici un rsum des types distingus :
|
motions : |
Sentiments esthsiques |
Motions musiciennes |
Affects musicaux |
|
Vcues par |
lÕindividu |
le musicien |
lÕĻuvre |
|
Sujet |
psychologique |
grammatical |
philosophique |
|
Corps |
physiologique |
instrumentiste |
corps corps |
|
Varit |
Cf. les passions de Descartes |
enlvement/dlaissement +É |
Cf. les affects de Spinoza |
Remarquons : cette analytique des
motions en musique prvaut quand la musique se trouve commande par une Ļuvre,
quand la musique est Ļuvre, et que le rseau des motions quÕelle gnre est
aimant par les affects musicaux intrinsques lÕĻuvre.
Mais quÕen est-il alors quand la musique nÕest
plus Ļuvre, quand par exemple la musique est improvise, rellement improvise
(et pas Ē faussement Č improvise comme dans beaucoup de pseudo-improvisations
du jazz, ou lÕorgue liturgique) ? QuÕen est-il quand la musique est
dsĻuvre, sans sujet musical proprement dit et donc sans affects spcifiques ?
LÕindividu est-il enferm dans les sentiments esthtiques ?
Je ne le pense pas et je voudrais, en
consquence, complter Ē lÕquation de sentiments Č quÕest la musique
en examinant brivement une nouvelle figure de motion musicienne : le duende.
Le duende
De
quoi sÕagit-il l ? Du climax dans le flamencoÉ
Sorte
dÕinstant de possession, dont Lorca insiste sur le caractre dmoniaque.
Lorca
pour le dcrire, pour nous le faire ressentir, dploie la luxuriance de ses
images.
La venue du duende prsuppose toujours un
bouleversement radical de toutes les formes traditionnelles, procure une
sensation de fracheur tout fait indite, qui a la qualit du miracle et suscite
un enthousiasme quasi religieux.
La Nina de los Peines se leva comme une folle
pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuances, la gorge en feu, maisÉ
avec duende. Elle avait russi jeter bas lÕchafaudage de la chanson, pour
livrer passage un dmon furieux et dvorant, frre des vents chargs de
sable, sous lÕempire de qui le public lacrait ses habits.
La Nina de los Peines dut dchirer sa voix, car
elle se savait coute de connaisseurs difficiles qui rclamaient une musique
pure avec juste assez de corps pour tenir en lÕairÉ Elle dut rduire ses moyens,
ses chances de scurit ; autrement dit, elle dut loigner sa muse et attendre,
sans dfense, que le duende voult bien venir engager avec elle le grand corps
corps. Mais alors comme elle chanta ! Sa voix ne jouait plus ; sa
voix, force de douleur et de sincrit, lanait un jet de sang.
Voici quelques annes, un concours de danse
avait lieu. Eh bien cÕest une vieille de quatre-vingts ans qui enleva le prix
de belles femmes, des jeunes filles la ceinture dÕeau, uniquement parce
quÕelle savait lever les bras, redresser la tte et taper du talon sur
lÕestrade. Sur cette assemble dÕanges et de muses, blouissante de beaut et
de grce, celui qui devait lÕemporter, et qui lÕemportera, fut ce duende
moribond qui tranait ras de terre ses ailes de couteaux rouills.
Le duende opre sur le corps de la danseuse
comme le vent sur le sable. Son pouvoir magique mtamorphose une jeune fille en
paralytique lunaire, donne une rougeur dÕadolescent un vieillard cass qui mendie
dans les tavernes, fait ruisseler dÕune chevelure lÕodeur dÕun port nocturne.
Thorie et jeu du Ē duende Č [10]
Pourquoi le duende
nous intresse-t-il particulirement aujourdÕhui ?
Parce que cÕest une ()motion de musicien, qui
ne relve pas des trois motions prcdemment releves, cette motion advenant
dans le nouveau contexte de la musique improvise.
CÕest une ()motion qui engage le combat du
corps du musicien et dÕune me qui nÕest pas la sienne, la lutte dÕun corps aux
prises avec un esprit prenant la forme dÕun dmon plutt que dÕun ange. CÕest
une ()motion de la possession dÕun corps par une force spirituelle jaillie du
sol, de Ē la plante des pieds Č.
Lorca thmatise la diffrence entre muse, ange
et duende. La muse, cÕest pour nous cet esprit
musical qui agit de lÕextrieur sur lÕauditeur. LÕange, cÕest lÕesprit de la
musique lorsquÕil est indiscernable de son tre corporel, de sa figure dÕĻuvre —
cÕest une chose frappante que lÕanglologie scolastique semble sÕajuster sans
heurt aux Ļuvres musicales, comme si le fait quÕau Paradis les anges jouaient
de la musique faisait que les thologiens entreprenaient en vrit de penser
les Ļuvres musicales quand ils croyaient penser les angesÉ —.
Le duende, cÕest
le dmon — Lorca : prcise : le dmon de Socrate et de
Descartes, le dmon des philosophes doncÉ — et non pas lÕange. CÕest le
pouvoir du dmon, non la puissance de lÕange. Un pouvoir, cÕest une action sur
lÕextrieur de soi : ici le pouvoir de la musique sur le musicien quÕelle
fait chavirer. Une puissance, cÕest une action sur soi, lÕaction de la musique
sur elle-mme en une Ļuvre musicale.
Voici comment Lorca parle de tout cela :
Goethe, propos de Paganini, dfinit le
duende : Ē Pouvoir mystrieux que tous ressentent et que nul
philosophe nÕexplique. Č
Ainsi donc, le duende est pouvoir et non Ļuvre,
combat et non pense. JÕai entendu dire un vieux matre guitariste :
Ē Le duende nÕest pas dans la gorge, le duende vous monte en dedans, depuis
la plante des pieds. Č
Tout homme, tout artiste, dira Nietzsche, ne
gravit de degr dans la tour de sa perfection quÕau prix du combat quÕil soutient
avec le duende et non avec un ange, comme on le prtend, ni avec sa muse.
LÕange guide et comble, comme saint
Raphal ; garde et protge, comme saint Michel ; et il prvient,
comme saint Gabriel.
LÕange blouit, mais il vole sur la tte de
lÕhomme, il est au-dessus de lui, il rpand sa grce, et lÕhomme, sans le
moindre effort, ralise son Ļuvre.
La muse dicte et, lÕoccasion, souffle.
La muse veille lÕintelligence, fournit des
paysages de colonnes et la saveur trompeuse des lauriers.
Ange et muse viennent du dehors. LÕange donne
des lumires. La muse donne des formes. En revanche, le duende, cÕest dans les
ultimes demeures du sang quÕil faut le rveiller.
Chasser lÕange et envoyer promener la muse. Le
vritable combat se livre avec le duende.
Pour chercher le duende, il ne faut ni carte ni
ascse. On sait seulement quÕil brle le sang, quÕil puise, quÕil rejette
toute la douce gomtrie apprise, quÕil brise les styles.
Nulle motion nÕest possible sans la venue du
duende.
Le duende meut la voix et le corps de la
danseuse, vasion relle et potique hors de ce monde.
Lorsque cette vasion sÕaccomplit, tout le
monde en ressent les effets : lÕiniti qui admire comme le style triomphe
dÕune matire pauvre, et le profane qui prouve confusment une motion authentique.
Tous les arts sont susceptibles de duende, mais
l o il se dploie le plus librement, cÕest, naturellement, dans la musique,
dans la danse et dans la posie dclame, parce que ces arts ont besoin dÕun
corps vivant qui les interprte, tant une suite de formes qui dressent leurs
profils sur un prsent exact.
Par lÕide, la voix ou le geste, le duende se
plat frler le bord des puits, en lutte ouverte avec le crateur.
Le duende blesse, et cÕest dans la gurison de
cette blessure qui ne se ferme jamais que rside lÕinsolite originalit dÕune
Ļuvre.
Nous avons dit que le duende aimait les
blessures, le bord des gouffres, et quÕil hantait les lieux o les formes se
fondent dans un lan qui dpasse leur expression visible.
Impossible pour lui de se rpter — il
importe de le souligner. Le duende ne se rpte jamais, pas plus que ne se rptent
les formes de la mer sous la bourrasque.
Dans le travail de la cape, face au taureau
encore intact, et au moment de tuer, il faut le secours du duende pour mettre
le doigt sur la vrit artistique.
Ainsi
le duende blesse car il spare le musicien du dmon
musical, et cette blessure ne saurait se refermer. Le duende prend possession du corps vivant du musicien, lÕenflamme, et chaque
vasion est irrductiblement singulire : pas dÕĻuvre ici pour cumuler les
effets de vrit. Le duende pointe la vrit musicale
mais nÕy Ļuvre pas.
On
retrouve ici lÕide du Ē corps corps Č mais cette fois comme combat
du musicien avec le duende. Et cÕest prcisment
parce que ce corps corps nÕest pas Ļuvrant quÕil est une blessure que
Ē tous ressentent Č, que chacun, initi ou profane, reoit et prouve
(mme si seul le corps de lÕenduend est
lÕpreuve de cette motion).
Cette
motion singulire met lÕpreuve lÕextime du
musicien : ce qui lui fait Ē regarder au dehors le dedans de
soi Č (Victor Hugo).
*
Je terminerai ainsi sur cette motion musicienne
singulire pour rappeler que le monde de la musique est vaste et que si les
Ļuvres musicales en sont la pointe subjective, cette pointe qui travaille produire
une beaut de lÕcoute, ces Ļuvres tirent leur puissance singulire de
parcourir un monde qui ne sÕy rduit pas, un monde de la musique fait de corps
et de sons, de corps musiciens en proie aux possessions sonores, et si lÕange
de lÕĻuvre peut visiter ce monde, cÕest bien parce que ce monde est peupl de
ces diablotins qui font le sel de lÕimprovisation musicale, de ces petits
diables qui, telles les hystriques de Charcot pour Freud, viennent constamment
rappeler au musicien pensif quÕil nÕy aurait pas musique sans ces corps
musiciens inflammables, sans ces voix dchires et inconsoles, sans ces visages
blesss et transfigurs.
Ce duende, nous
dit Lorca, Ē met le doigt sur la vrit Č musicale ; sans doute
sÕagit-il, pour nous musiciens, pour moi compositeur, de faire plus quÕy mettre
le doigt, ce qui nÕest pas dire quÕil y faut tout un corps mais plutt quÕil y
faut un corps et autre chose que lui, un corps visit par lÕide, un corps qui
soit tout aussi bien esprit, et donc pense, et donc projet, et donc labeur et
Ļuvre.
Mais le duende,
plus que toute autre motion, rappelle quÕil peut y en aller en musique de
vrit plutt que simplement de ces petits plaisirs que la gastronomie ou lÕĻnologie
savent nous fournir.
Le duende nous
rappelle que la musique est affaire de feu et de vent, de possession et
dÕenvotement, de saisissement et dÕemports, que la musique dvore ses enfants
et embrase ses acteurs si bien que face lÕĒ quoi bon ? Č
menaant aujourdÕhui tout effort de cration musicale, la musique rpond par le
duende ceci :
Ē Combat avec moi, engage le grand corps
corps avec mes ailes de couteaux rouills et je tÕannoncerai le perptuel baptme
des choses frachement cres, lÕamour libr du temps, lÕlan vers un prsent
exact. Č
––