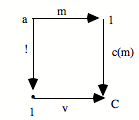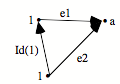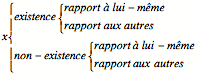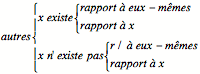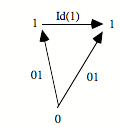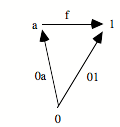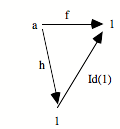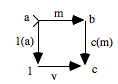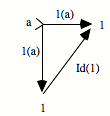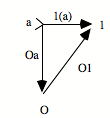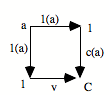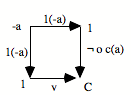Théorie des catégories
Alain Badiou (1993-1994)
Préliminaire 1
I 6
Questions sur le fascicule 6
1) Sur la logique classique :................................................................................................... 6
2) Sur la différence entre l’égalisateur et
l’épimorphisme :.................................................... 7
3) Sur la flèche identique...................................................................................................... 8
II 13
Quelques questions, encore, sur le fascicule 13
1) Sur la négation :.............................................................................................................. 13
2) Sur l’exponentiation :..................................................................................................... 13
Retour sur la question de l’ordre partiel. Sur la motivation
de l’examen de cette structure. 15
Rappels............................................................................................................................... 15
III 17
Ponctuation d’histoire de la philosophie 17
IV 22
V 34
VI 38
I 38
II 41
III 41
IV 42
VII 42
Préliminaire
Aujourd’hui, dans un premier temps, je ferai une mise au point conceptuelle de la stratégie de pensée en jeu dans ce long travail. Dans un deuxième temps, je préparerai ce que nous allons entamer dès que possible, et qui concerne la logique ; l’exploration de ce que veut dire qu’un topos est un univers qui immanentise sa propre logique, en en faisant une singularité de l’univers. La logique, dans cet univers, est une dimension intrinsèque de l’univers, spécifiable de façon singulière, au lieu de lui être extérieure. On va étudier de façon fine cette question-là.
Ensuite, pour l’essentiel, on va s’occuper de la question de l’infini. Qu’est-ce que l’infini dans le mode de pensée singulier qu’est la pensée catégorielle ? Étant entendu que dans les années précédentes, nous avons traité de l’identité et de la différence d’un côté, du vide de l’autre.
Cette année, nous parlerons de la logique comme telle et de l’infini (infini incluant cette chose tout à fait passionnante qu’est la théorie catégorielle du nombre).
Du point de vue des enjeux de la pensée :
Factuellement, on peut penser que la théorie des catégories et des topos s’est présentée, tend à se présenter, comme un dispositif global qui serait une alternative à la théorie des ensembles, c’est-à-dire comme une autre manière de fixer le cadre général dans lequel se déploient les concepts de la mathématique, et par conséquent aussi comme une autre méthode d’exposition de la mathématique. Contradiction qui était au départ mon hypothèse.
Selon la méthode consistant à placer la philosophie sous condition de phénomènes de ce genre, de cette situation, la philosophie doit savoir ce qui est en jeu pour elle-même dans cette situation. Lorsque la philosophie se met sous condition de phénomènes scientifiques de ce type, elle ne se met pas sous condition des discours scientifiques, mais sous condition des événements scientifiques.[1]
La thèse que j’ai été amené à soutenir, c’est qu’il ne s’agit pas de deux dispositifs concurrentiels du fondement de la mathématique. Du point de vue du philosophe, il apparaît qu’en réalité, il n’y a pas d’unité de plans entre les deux entreprises : elles ne sont pas deux stratégies pour fonder ou exposer les mathématiques. La visée propre de ces deux entreprises n’a pas la même assignation.
La théorie des ensembles est de l’ordre de la décision ontologique. C’est une véritable prescription décisoire quant à ce qu’est une pensée de l’être-en-tant-qu’être. La vocation immédiate de la théorie des ensembles est de décider un univers mathématique et de faire se mouvoir la pensée mathématique de l’intérieur de cet univers.
La théorie des topos est en réalité une théorie des possibles. C’est une description de possibilité. Son vecteur essentiel est de décrire ce que c’est qu’un univers possible, en retenant les prescriptions d’existence. La métaphore que j’utilise à cet égard est leibnizienne : l’entendement divin est composé de la totalité des univers possibles qui ne lui ek-sistent pas. Et Dieu crée un univers possible qu’il fulgure, selon la norme du meilleur univers possible (celui qui produit le maximum d’effets avec le minimum de causes). Donc, il y a la totalité virtuelle des univers dans l’entendement divin, et un univers qui existe, le meilleur.
On dira que la théorie des topos est la théorie de l’entendement divin, c’est-à-dire des univers possibles, et même de la classification des univers possibles, tandis que la théorie des ensembles est une décision d’univers. Elle en prescrit un, qu’elle crée, qu’elle fulgure.
En continuant la métaphore, on pourrait dire que la théorie des topos est une investigation du concept d’univers, donc une théorie des univers, tandis que la théorie des ensembles est une création d’univers, ce n’est pas une théorie d’univers -on peut même dire qu’elle n’a pas de concept d’univers -, mais une effectuation d’univers.
Ce point donne lieu à une confusion parce qu’il donne lieu à deux débats, en réalité différents, mais souvent confondus :
1) Est-ce que la mathématique est une théorie des possibles, ou est-ce qu’elle est une création d’univers ? Est-elle une investigation formelle des possibles, ou l’investigation d’un univers constitué ?
Vision logique et formaliste d’un côté, vision réaliste et intuitive de l’autre.
2) La théorie des ensembles est-elle le meilleur univers possible, au sens où Leibniz dit que le monde existant est le meilleur possible. Quelle est la proximité de la mathématique et de la logique ?
Dans les controverses, ces deux questions sont souvent mélangées. La thèse dans laquelle nous sommes est la suivante : il n’y a pas d’unité de plans. Elle se donne dans un critère très simple : la théorie des catégories est une pensée définitionnelle ; elle décrit, par définitions, les traits constitutifs de ce que c’est qu’un univers possible. Une définition ne décide rien, c’est un opérateur d’identification, qui ne décide rien quant à l’existence. La théorie des ensembles repose toute entière sur des axiomes qui, eux, décident quant à des existences.
Quels sont, dans une tentative pour penser l’être en tant qu’être, les rapports entre le possible et l’effectif ? Aussi bien le virtuel et l’actuel. C’est une question essentielle de toute l’histoire de la philosophie. Une des caractéristiques de la théorie des ensembles est qu’elle est entièrement dans l’actuel ; il n’y a pas de virtuel en elle.
La théorie platonicienne des Idées est une doctrine de l’actuel. La pensée est sous condition de l’existence en acte des Idées.
Dans le dispositif aristotélicien, ce qui est, la substance, est dans un rapport de la puissance et de l’acte. Il finit par y avoir un acte pur qui est dieu. Mais ce qu’il y a, c’est la réalisation de son acte immanent existant en puissance.
Deleuze est la plus forte pensée contemporaine de l’être comme actualisation. L’essence de l’être est le virtuel et pas l’actuel, pour Deleuze. Le cahot est la virtualité anarchique pure. Donc, tout est actualisation.
Dans ma pensée, il n’y a pas de virtuel. Le possible est lui-même une projection de l’actuel.
Le rapport théorie des ensembles/théorie des catégories est une matrice de cette discussion. C’est cette discussion sous condition mathématique, discussion qui, du coup, devient contemporaine, placée sous sa condition scientifique : la question de l’être, à l’épreuve du virtuel et de l’actuel.
La théorie des ensembles est une option ontologique. Cette option ontologique, en dépit du fait qu’elle soit souvent appelée platonicienne, est en réalité une option d’un matérialisme absolu, démocritéen, ou lucrétien, ou épicurien. Quels en sont les traits ?
- L’un n’existe pas. Donc, il n’y a pas de principe, pas de transcendance. Il y a un étalement multiple qui n’est jamais subsumable sous une figure canonique de l’un. Le multiple est toujours multiple de multiples. Donc le il y a pur est simplement dans la forme de la multiplicité. C’est un dispositif radicalement soustrait à l’univers appelé l’onto-théologie par Heidegger, dispositif historial de la métaphysique.
- Tout multiple est actuel , il n’y a pas de virtuel. C’est un trait aussi du matérialisme absolu. Ce qu’il y a, c’est du multiple, mais pas du multiple potentiel, mais du multiple actuel.
- Toute différence est assignable localement. Il n’y a pas de différence qui ne serait que globale -qui serait qualitative, non extensionnelle. Si deux ensembles sont différents, cela veut dire qu’il y a un élément qui est dans l’un et pas dans l’autre, et qui, à lui seul, atteste la différence. Il y a toujours un plan d’épreuve élémentaire de la différence.[2]
Ce qui est en jeu, c’est la doctrine des multiplicités. Dans le théorie des ensembles, il n’y a qu’un seul type de multiplicités : des multiplicités composées d’éléments, donc la différence entre deux multiplicités est une différence d’éléments.
Chez Bergson ou Deleuze, il y a des multiplicités qualitatives qui supposent une intuition globale de ce qu’elles sont. La multiplicité qualitative l’emporte sur l’autre, pour eux. La multiplicité ensembliste est une retombée analytique de la multiplicité qualitative.
- Il n’y a pas de fond, en théorie des ensembles. Les multiplicités ne sont pas dépendantes d’un fond, et donc il n’y a pas de fondement qui serait la pensée de ce fond. Il n’y a pas de grand animal, de désordre premier, derrière tout ça. Il n’y a que le vide. Il y a des multiples, et parmi eux, et en eux, il y a le vide. Il n’y a donc aucune dimension qualitative originelle. En deçà du multiple, il y a le vide, et rien d’autre. Ce que disaient les atomistes grecs. Ce vide est unique. Il n’y aurait aucun sens à ce qu’il y ait plusieurs vides. Cette unicité du vide en fait ce qu’on peut appeler un fond sans fond.
- L’infini n’est évidemment pas l’Un. L’infini va se présenter comme lui-même ramifié à l’infini en multiplicités singulières. L’infini c’est une propriété possible pour les multiples.
La théorie des ensembles banalise absolument l’infini, au sens où elle le sépare absolument de l’Un.[3] L’infini n’est en rien principiel, dans la théorie des ensembles.
En quoi consiste la pensée de l’être, si elle est pensée d’un univers ainsi constitué ? La pensée, dans cet univers, c’est la mathématique, en tant qu’elle fonctionne dans son cadre ensembliste. Ce qui est pensé, c’est le pensable de cet univers-là.
La maxime est très simple : la mathématique revient, pour l’essentiel, à désenchevêtrer des multiplicités, de manière à faire apparaître l’identité multiple de ces multiplicités. C’est une résolution au sens chimique. Ce qui crée l’opacité, c’est l’enchevêtrement, la surimposition des multiples. La démonstration est une monstration des multiplicités enchevêtrées.
Quel est le mouvement propre de la mathématique ainsi définie ? Qu’est-ce qu’on appelle couramment un objet mathématique ? Un objet sous prescription ensembliste ? Un objet, c’est une multiplicité complexe.
Ex : qu’est-ce que le nombre 3, sous prescription ensembliste ?
C’est :
![]()
La seule marque constante, c’est le vide. Après, on a des opérations et des ponctuations. En théorie des ensembles, un objet, ultimement, c’est des occurrences du vide, tissées par des opérations et des ponctuations.
Donc, un objet mathématique, c’est une multiplicité dont il y a sens à dire qu’elle est tissée du seul vide. Raison fondamentale pour laquelle les objets sont sans qualité, radicalement.
Si on veut dissoudre le 3, par exemple :
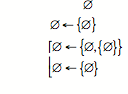
L’analyse des objets ne donne aucuns ingrédients qualitativement différents les uns des autres. On ne trouve rien qui soit différencié. Par voie de conséquence, l’univers mathématique est homogène en ce sens-là. C’est un univers qui est ontologiquement absolument homogène, et par ailleurs, opératoirement complexe.
Que va-t-on appeler une structure ? C’est un type d’enchevêtrement de multiplicités, définissable. Ce n’est pas un existant, c’est un type possible d’enchevêtrements. C’est déjà une possibilité.
Quand on dit que la mathématique pense ces choses-là -les objets et les structures -, à travers quels types de procédures le fait-elle ? On peut en identifier cinq. Appelons cela des théorèmes, au sens de la pensée démonstrative en travail. Il y a :
1) Des théorèmes d’existence : telle multiplicité complexe doit exister, elle est contrainte à l’existence par la prescription d’univers en son entier. C’est de l’ordre de la contrainte. Si cette multiplicité n’existait pas, l’univers serait anéanti : il serait inconsistant. Ce sont des théorèmes qui engagent quelque chose de l’univers en son entier, mais testé en un point. Tout théorème d’existence est un plan d’épreuve local de la modalité de l’univers.
2) Des théorèmes de dimension : un objet se voit assigné une dimension nécessaire. L’univers étant ce qu’il est, l’objet doit avoir telle dimension (être fini, être infini, être de telle infinité ...). Ex : le théorème sur les nombres premiers dans la mathématique grecque : les nombres premiers constituent nécessairement un ensemble infini.
Dans les deux cas, c’est très lié à l’univers dans son ensemble. Il s’agit de démonstrations par l’absurde.
3) Des théorèmes de présentation : tout enchevêtrement d’un type donné est isomorphe à un de ses cas. D’un point de vue structurel, il y a un cas du type qui les exprime tous. Il y a désenchevêtrement de la multiplicité, au sens où le type d’enchevêtrement se laisse présenter dans un cas, dans un objet. On présente la structure dans un cas. Le cas est métonymique, il vaut pour le type.
Ex :
• un groupe quelconque peut être présenté comme un groupe de substitution.
• une algèbre de Boole se laisse présenter comme algèbre des parties d’un ensemble (théorème de Stone).
Le désenchevêtrement se fait par singularisation.
4) Des théorèmes d’identification : des objets, des structures ont en commun une formule, ou un trait, qui les identifie comme étant de la famille en question. Le théorème est la découverte d’une formule d’identification.
En un certain sens, les équations des familles de courbes sont de ce type, ou les groupes, associés à des topologies, par exemple à des nœuds.
Le désenchevêtrement est de caractère formulaire. Trouver la formule du lieu, pour reprendre Rimbaud.
5) Des théorèmes de décomposition : une structure se laisse analyser en combinaisons de structures plus simples.
La mathématique, c’est cet ensemble d’opérations de pensée, en tant qu’elle pense. Elle procède sur une ligne de désenchevêtrement qui s’attaque à des questions d’existence, de dimension, de présentation, d’identification et de décomposition. Contraindre à être, énoncer quelle est la dimension multiple dont il s’agit, présenter le type dans un cas, identifier des réseaux complexes, décomposer des ensembles structuraux : telle est la phénoménologie élémentaire de l’activité pensante mathématicienne sous prescription ensembliste. Tendanciellement, il s’agit de désopacifier l’univers. C’est une éclaircie. Établir des clairières de l’être, par des procédures qui visent à une simplicité typique.
Mais si on désenchevêtre complètement, on voit apparaître le vide, tendanciellement, et parce que c’est homogène. Il y a l’être dans la multiplicité des étants. Il y a l’être : cela fait venir le vide, l’imprésenté.
L’activité mathématicienne est une éclaircie de la présentation sous une norme le plus souvent ineffective, qui est celle de l’imprésenté, à savoir le vide. La pensée mathématique consiste toujours à tirer la complexité vers son vide propre. La mathématique active, sous prescription ensembliste, est polarisée par l’imprésenté, polarisation le plus souvent ineffective.
La théorie des catégories n’est nullement une prescription d’univers. Il faut plutôt la concevoir comme un dispositif expérimental, un montage dont le but est de spectrographier des décisions ontologiques. Ce spectre est constitué du point des contraintes logiques, intérieures à une décision ontologique. A ce point essentiel, que les contraintes logiques en question demeurent en général inaperçues de l’intérieur de la décision. Le dispositif expérimental fait voir ce que la décision ne permet pas de voir et qui lui est cependant intérieur.
Cela a à voir avec la distinction de Wittgenstein entre montrer et dire. Wittgenstein définit la logique comme ce qui se montre dans la proposition, mais ne se laisse pas dire en forme de proposition. Il y a un montrer quelque chose qui est en jeu dans le dire, mais qui n’est pas dicible.
On pourrait dire que la théorie des topos montre ce qu’une décision ontologique ne peut pas à proprement parler dire, bien que ça lui soit immanent. De ce point de vue là, la théorie des catégories n’est pas un dire du dire. Elle n’est pas un langage de la théorie des ensembles -puisque, pour elle, la théorie des ensembles n’est qu’un cas -. Par contre, elle montre quelque chose qui, dans la théorie des ensembles, n’est pas dit, et qui, cependant, la contraint. De ce point de vue là, la théorie des topos est un appareil de monstration, qui montre quelque chose des décisions ontologiques possibles, sans qu’elle le vise au même sens du dire dans la théorie des ensembles.
C’est une des raisons pour lesquelles la théorie des catégories est d’essence géométrique, parce que sa véritable destination est de montrer, et l’espace de cette monstration est d’inspiration géométrique, au sens très large de visant à montrer. «Ce qui est impossible à dire, il faut le taire», mais on peut le montrer, en silence. On pourrait dire : la théorie des catégories, c’est le silence de la théorie des ensembles ; un dispositif où on la montre. Cet indicible propre, c’est sa logique. La théorie des topos est un lieu de monstration, à certains égards silencieux, de l’indicible des décisions ontologiques.
Cela ne construit pas une rivalité, pas plus que chez Wittgenstein, le silence n’est en rivalité avec le dire. La destination du silence, qui est le montrer, est irréductible au dire.[4]
On peut distinguer neuf points qui fixent l’allure générale de cette opération de montage d’un dispositif expérimental de monstration de ce qui ailleurs est démontré :
1- On part des configurations les plus pauvres de tout univers possible : c’est le concept de catégorie où on n’a que des objets et des liaisons entre objets.
2- On spécifie, on définit, les configurations, les opérations qui peuvent donner à un univers une certaine densité et une certaine extension. Donc, toute une série d’opérations possibles, avec un opérateur général très fiable : l’idée de limite d’une configuration finie ; quelques objets, ou quelques liaisons entre objets.
C’est ce qu’on peut appeler l’ensemble des concepts locaux de l’univers.
3- On va fixer la détermination immanente de l’ordre général de l’univers, de son filtrage, de ce qui décide sa logique globale, de ce qui fait que cet univers a un ordre logique immanent. C’est le concept d’objet central, ou de classifieur de sous-objet, et de tout ce qui s’y rattache. C’est le lieu de l’univers où se décide quelque chose quant à son statut global.
4- Avec 1, 2, et 3, on peut disposer d’un concept de ce que c’est qu’un univers pour toute pensée possible de l’être-en-tant-qu’être. C’est le concept de topos.
5- On peut procéder, dès ce moment, à l’analyse -c’est-à-dire à la mise en disposition -des catégories les plus essentielles de toute ontologie possible.
Ex : on va pouvoir examiner à partir du concept de topos :
• le statut de l’identité : identité intrinsèque ou extrinsèque ; identité fixe ou identité fuyante (à un isomorphisme près) ; singularisante ou classifiante,
• le statut de la différence : principalement à travers la question de son assignation locale ou pas. C’est la question du qualitatif qui est en jeu,
• le statut du vide : intrinsèque ou purement positionnel (au regard de ce qui sera défini comme plein) ; unique ou multiple,
• le statut de l’infini : forme thétique -problème de l’existence ou de la non-existence de l’objet nombre dans un topos -, et question de l’infini actif -de l’axiome de choix -.
6- Examiner, penser les caractéristiques logiques des univers possibles, et tenter une classification de ces caractéristiques. Cela passe par la théorie de la machinerie logique dans les topos, étroitement liée à l’objet central. Étude du langage interne d’un topos. Étude puissamment algébrique, dont les clefs sont l’algèbre de Boole, et l’algèbre de Heyting.
7- Traiter les corrélations logico-ontologiques. C’est confronter 5 et 6. Poser des questions comme : si l’univers a telles ou telles caractéristiques ontologiques, quelles sont nécessairement ses caractéristiques logiques ou l’inverse ?
C’est tout le travail d’Aristote dans le livre g de la Métaphysique, sous une forme rigoureuse. C’est une élucidation rétroactive de débats philosophiques considérables.
8- Examiner la confrontation des univers possibles : y a-t-il des hiérarchies d’univers ? des corrélations d’univers ? des univers dont les éléments sont eux-mêmes des univers ? Quel est le régime de la compossibilité des univers possibles ?
Descriptif de l’univers des univers. Cosmologie du possible. Théorie des foncteurs et théorie des transformations naturelles.
9- Mettre à profit le concept de topos pour penser le géométrisme dans la pensée. Qu’est-ce qu’une pensée géométrisante ? Étudier les possibles de la topologie de l’être. L’être comme site. Site est un concept catégoriel. Tenter de penser la géométrie de la logique.
Nous commencerons par des questions. Après, je ferai une
préparation pour le traitement du point proprement logique, par la présentation
du concept d’algèbre de Boole.
I
Questions sur le fascicule
1) Sur la logique classique :
On appelle logique de type classique fondamentalement une
logique qui admet le principe du tiers exclu, c’est-à-dire une logique qui
considère comme universellement vraie la forme générale de l’énoncé ![]() . Ce qui veut plus précisément dire que, étant donné un
énoncé quelconque, susceptible d’avoir une valeur de vérité, la logique
classique admet que ou bien il est vrai, ou bien sa négation est vraie. Ceci de
manière universelle, c’est-à-dire quelle que soit la signification de p, et quelle
que soit la valeur de vérité qu’on attribue à p.
. Ce qui veut plus précisément dire que, étant donné un
énoncé quelconque, susceptible d’avoir une valeur de vérité, la logique
classique admet que ou bien il est vrai, ou bien sa négation est vraie. Ceci de
manière universelle, c’est-à-dire quelle que soit la signification de p, et quelle
que soit la valeur de vérité qu’on attribue à p.
Disons que, de manière générale, on appellera logique non-classique -mais la spécification la plus connue des logiques non-classiques est la logique dite intuitionniste -, les logiques qui n’admettent pas l’universalité du tiers exclu. Des logiques qui admettent qu’il peut exister des énoncés p qui ne sont pas vrais sans que pour autant leur négation soit vraie.
Finalement, une bonne partie de la question porte sur la négation,
c’est-à-dire sur le sens qu’on donne à la négation : le tiers exclu
affirme une certaine sorte de liaison entre p et ![]() ; on est contraint à l’un ou l’autre : disons que
ça sera le sens classique de la négation. Dans les logiques non classiques, la
négation ne dessine pas le même rapport entre l’affirmation et sa négation.
; on est contraint à l’un ou l’autre : disons que
ça sera le sens classique de la négation. Dans les logiques non classiques, la
négation ne dessine pas le même rapport entre l’affirmation et sa négation.
Une conséquence de la plus extrême importance, c’est qu’en
logique classique, on peut raisonner par l’absurde ; démontrer p en
démontrant qu’on n’a pas ![]() .
.
En logique non-classique, le raisonnement par l’absurde n’est pas valide. Ce qui veut dire que vous devez démontrer p directement. C’est pour ça que les logiques non-classiques sont associées très souvent aux preuves constructives. Ceci est une différence considérable.
Ceci a une incidence très importante sur les démonstrations existentielles. En logique classique, on peut démontrer une existence en montrant que la non-existence entraîne une contradiction. Si vous voulez démontrer l’existence d’un énoncé qui a la propriété p, vous montrez qu’il est absurde qu’aucun ne l’ait. On démontre qu’il en existe un, mais sans le montrer. Vous ne savez pas qui c’est. Ce type de démonstration d’existence est très fréquent en logique classique. Il n’est pas admis en logique intuitionniste. Ce qui veut dire qu’en logique intuitionniste, vous ne pouvez démontrer qu’il existe x tel que p(x) qu’en en montrant un qui a la propriété p. Vous devez absolument trouver un terme identifiable à propos duquel vous devez démontrer qu’il a effectivement la propriété p. En logique intuitionniste, la preuve d’existence devra être constructive.
Il est clair que dans un univers intuitionniste, il existe beaucoup moins de choses. Parce que, à proprement parler, ne sont admises à l’existence que celles dont vous avez pu construire un cas d’existence.
2) Sur la différence entre l’égalisateur et l’épimorphisme :
L’épimorphisme :
![]()
Cette situation catégorielle -deux objets, deux flèches parallèles -, c’est une situation fondamentale parce que c’est ce qu’on pourrait appeler l’atome de différence. Pourquoi ? Parce que, dans l’univers catégoriel, ce qui importe, ce sont les flèches, fondamentalement. C’est ça qui est l’élément central de la pensée catégorielle. Les objets, au départ, ne sont que de simples lettres. Et nous savons que nous ne pouvons donner sens aux objets, qu’à partir des flèches qui y arrivent, ou qui en partent. C’est une pensée qu’il faut avoir tout à fait à l’esprit. On peut le dire philosophiquement : la pensée catégorielle c’est une pensée où l’identité est subordonnée à l’action, au rapport. Le rapport est premier, l’identité est seconde -c’est son inspiration essentielle. Ce qui est important, c’est de savoir ce que c’est que deux flèches différentes. Or quelle est la situation élémentaire dans laquelle deux flèches peuvent être appréhendées comme différentes ? C’est quand elles ne diffèrent pas par leurs objets. Or, deux flèches parallèles sont deux flèches qui ont la même source et la même cible. Donc, elles ne se différencient pas par les objets qu’elles impliquent. L’une comme l’autre agit de a vers b.
On sait que la question de la différence est une question ontologique décisive. Donc, disons-le comme ça, l’ontologie catégorielle va reposer sur un certain concept de la différence, comme toute ontologie, et ce concept de la différence c’est la question de la différence entre deux flèches. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nous n’avons pas de moyen de différencier deux flèches sans avoir recours à d’autres flèches. Toute différence, dans l’univers catégoriel, est une différence active. Au sens strict, il n’y a pas au départ de différence objective, de différence par les objets. Comment savoir que f et g sont différentes, puisqu’on ne le sait pas par les objets ? Vous voyez que ça interroge la nature de l’action elle-même : f et g doivent être telles que la nature intime de l’action qu’elles représentent diffère. Et cela comment ça peut s’examiner ? Par la façon dont ces actions s’insèrent dans d’autres actions. La différence doit forcément être rapportée à une action différenciante ; elle se combine avec d’autres de manière différente. C’est toujours dans un mouvement d’action que je peux saisir une différence. C’est là qu’interviennent l’épimorphisme et le monomorphisme comme préservateur et conservateur des différences supposées entre flèches.
Considérons maintenant une flèche e qui part de c vers a. Je dirai que cette flèche est
un épimorphisme si elle ne peut pas, elle, être ce qui introduit une différence
entre f et g. Ce qui veut dire que si ![]() , alors c’est
que f et g étaient déjà différentes. e n’a pas pouvoir de différenciation entre f et g ; et en même
temps, on dira que e préserve la différence, parce que e agit avant.
, alors c’est
que f et g étaient déjà différentes. e n’a pas pouvoir de différenciation entre f et g ; et en même
temps, on dira que e préserve la différence, parce que e agit avant.
Cela est le point conceptuel à retenir : e est un épimorphisme si, à chaque fois que je le combine à deux flèches parallèles, j’obtiens de la différence s’il y en avait déjà. Cela, c’est un premier concept opératoire sur la question de la différence.
Notez que cet énoncé ne me dit pas si, ou non, ![]() , parce que c’est un
énoncé de type si...alors.
, parce que c’est un
énoncé de type si...alors.
Maintenant l’égalisateur.
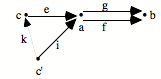
Nous partons, si je puis dire, de la même situation :
deux flèches parallèles. Un égalisateur, c’est d’abord une flèche qui égalise
en effet f et g au sens où ![]() . Supposons que f soit
différent de g, l’égalisateur est ce qui supprime cette différence, en imposant
que
. Supposons que f soit
différent de g, l’égalisateur est ce qui supprime cette différence, en imposant
que ![]() . C’est pour ça
qu’on l’appelle l’égalisateur : il crée de l’égalité là où, peut-être, il
y avait de la différence.
. C’est pour ça
qu’on l’appelle l’égalisateur : il crée de l’égalité là où, peut-être, il
y avait de la différence.
Être un épimorphisme, c’est une propriété intrinsèque de la flèche, c’est la propriété de préserver toute différence qui lui est proposée. Tandis que l’égalisateur n’est l’égalisateur que de deux flèches bien déterminées. Cela ne veut rien dire «égalisateur en soi». Égalisateur est une propriété relative : un égalisateur annule une différence particulière, c’est un peu comme une opération.
Le rapport à la différence n’est pas le même :
l’égalisateur est, globalement, un opérateur de suppression de la différence,
alors que l’épimorphisme est un opérateur de préservation de la différence, et
donc aussi d’investigation de la différence : si ![]() , on peut en déduire
que f et g sont différentes.
, on peut en déduire
que f et g sont différentes.
On ne peut pas trouver un «inégalisateur» ! Ceci indique la dissymétrie fondamentale entre l’identité et la différence. C’est un point philosophique capital. Si c’est identique, toute combinaison va identifier cet identique. Tandis que si c’est différent, il n’est pas vrai que toute combinaison va conserver cette différence. Si vous combinez deux choses identiques à une même troisième, vous retrouvez de l’identique. C’est toute la différence entre Parménide et Hegel, après tout ! Parménide, c’est une ontologie de l’identité, et l’ontologie de l’identité, elle est identifiante sur elle-même. Dès qu’on essaie de combiner l’identique, on ne trouve jamais la différence. Tandis qu’effectivement, à partir de la différence, Hegel se fait fort de construire l’identité. C’est parce que vous pouvez égaliser les différences, par simples combinaisons. Alors que par strictes combinaisons, vous ne pouvez pas différencier de l’identique. Cela c’est une idée très profonde. Si vous voulez différencier de l’identique, il faut que, d’une certaine manière, il ait la différence en lui-même. La différenciation de l’identique suppose une immanence de la différence. C’est précisément cette immanence de la différence que Hegel appelle la négativité. Donc, si vous avez en immanence de la différence, vous allez pouvoir différencier de l’identique, et en réalité toujours, d’une certaine manière, parce que la différence était déjà là. Tandis que si vous n’avez que l’identique -et cela, c’est l’impasse parménidienne -, vous ne pouvez pas le différencier. L’identique s’identifie lui-même. Et il est toujours possible de restituer de l’identité à partir de la différence, mais il n’est pas vrai que l’on puisse toujours restituer de la différence à partir de l’identique.
On le voit là très schématiquement : vous pouvez avoir un égalisateur, mais vous ne pouvez pas avoir le contraire de l’égalisateur. Il ne peut pas y avoir d’«inégalisateur» parce que si on travaille sur de l’identique, en combinatoire, avec un troisième terme, on va retrouver de l’identité.
3) Sur la flèche identique
![]() , on ne sait pas ce que c’est. C’est une simple lettre
au départ. Ça va, petit à petit, si je puis dire, être rempli par les actions
qui le concernent.
, on ne sait pas ce que c’est. C’est une simple lettre
au départ. Ça va, petit à petit, si je puis dire, être rempli par les actions
qui le concernent.
Encore une fois, cela c’est une disposition philosophique,
cette idée qu’une identité n’a pas d’immanence. C’est-à-dire qu’une identité ne
se laisse penser qu’à partir de ce qui l’affecte. C’est l’idée de la priorité
absolue du rapport sur l’identité. Donc, on va petit à petit apprendre des
choses sur un objet exclusivement à partir des flèches qui le concernent. Ce
qui nous intéresse, par conséquent, concernant ![]() , c’est les flèches. Et si nous voulons parler d’une flèche
qui va de
, c’est les flèches. Et si nous voulons parler d’une flèche
qui va de ![]() vers
vers ![]() , une flèche interne, si je puis dire, nous pouvons très bien
marquer
, une flèche interne, si je puis dire, nous pouvons très bien
marquer ![]() deux fois ;
ça n’a pas d’importance, parce que l’identité de
deux fois ;
ça n’a pas d’importance, parce que l’identité de ![]() n’est pas indicative
de quoi que ce soit. Cela, c’est le diagramme géométrique de la pensée, qui
n’est pas exactement la pensée elle-même. Dans le tracé diagrammatique, on peut
créer des écarts commodes, à condition de se souvenir qu’ils n’ont pas de sens
ontologique. Il faut décoller le diagrammatique de l’ontologique.
n’est pas indicative
de quoi que ce soit. Cela, c’est le diagramme géométrique de la pensée, qui
n’est pas exactement la pensée elle-même. Dans le tracé diagrammatique, on peut
créer des écarts commodes, à condition de se souvenir qu’ils n’ont pas de sens
ontologique. Il faut décoller le diagrammatique de l’ontologique.
Vous verrez à quel point, au fur et à mesure qu’on avance dans cette pensée, la question du rapport entre le géométrique et l’ontologique est fondamentale, parce qu’en réalité la question philosophique sous-jacente, comme toujours, c’est la question du rapport entre ontologie et logique, et en réalité le diagrammatique est la géométrie du logique, pas de l’ontologique. On l’a dit la dernière fois, cet ensemble de recherches va culminer dans cette question : quels sont les liens intimes entre géométrie et logique ?
Il peut exister de ![]() vers
vers ![]() , d’autres flèches que l’identité. C’est un point
élémentaire, mais qui est d’une importance considérable. Ce qui est exigé,
c’est qu’il y ait l’identité de
, d’autres flèches que l’identité. C’est un point
élémentaire, mais qui est d’une importance considérable. Ce qui est exigé,
c’est qu’il y ait l’identité de ![]() . Mais il peut exister d’autres flèches de
. Mais il peut exister d’autres flèches de ![]() vers
vers ![]() . Nous avons à nous-mêmes des rapports multiples qui ne sont
pas forcément de type identitaire. Donc, c’est une idée au fond intuitive, qui
est là généralisée.
. Nous avons à nous-mêmes des rapports multiples qui ne sont
pas forcément de type identitaire. Donc, c’est une idée au fond intuitive, qui
est là généralisée.
L’identité est une action nulle. Mais on pourrait réfléchir longtemps sur cette idée d’action nulle. Par exemple : est-ce que le cogito cartésien est une action nulle ? C’est une question très intéressante. Le cogito est bien une flèche de je vers je, donc de a vers a. «Je pense» est une affection de la pensée par elle-même dans la modalité de la représentation de son identité pure. Donc, on pourrait dire que le cogito est la flèche identique de la pensée. La question de savoir si c’est une action nulle, signifierait que quand on pense quelque chose, le combiner au cogito ne donne rien de plus. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence entre «je pense à cette table» et «je pense que je la pense».
Cela a donné lieu à des débats interminables dans l’histoire de la philosophie. Vous trouvez de longs développements chez Sartre, là-dessus ; la question de savoir si la conscience de soi, dans le mode sur lequel elle accompagne la conscience de quelque chose, est une flèche nulle ou pas, pour le dire dans ce langage. La question de la théorie de la conscience, en particulier la théorie de la conscience de soi, c’est largement la question de savoir si c’est en réalité une flèche identitaire ou pas, c’est-à-dire si c’est une action nulle ou pas. On pourra dire : le «je pense» accompagne toutes mes représentations, mais comment ? Comme action nulle justement. Donc ce qui va singulariser dans les rapports, ici, de a à a, mais dans le cas cartésien du rapport de je à je, c’est la question de savoir si c’est une action nulle ou pas. Ça porte sur : quels sont les rapports exacts entre pensée et pensée de la pensée ?
Personnellement, je ne pense pas que le cogito est une action nulle.
On peut considérer la flèche identitaire comme un cas particulier de l’épimorphisme. Elle est d’ailleurs aussi un monomorphisme, ce qui veut dire qu’elle est aussi un isomorphisme... On retrouve cette plasticité de l’action nulle. A partir du moment où une action est nulle, elle a beaucoup de propriétés. Ce n’est pas l’infini qui a beaucoup de propriétés !
La flèche identique a un intérêt tout à fait particulier, c’est qu’elle est la figure de l’arrêt. On dit action nulle, mais on pourrait aussi bien dire : point d’arrêt de l’action. La flèche identique supporte, dans l’univers catégoriel, la théorie de la non-action. Vous ne pouvez pas avoir un univers où ce qui compte ce sont les actions, sans avoir aussi une théorie de la non action. Et comme tout est flèche, cette non-action doit elle-même être flèche : c’est la flèche identique. Donc, chaque fois que ça arrive à une flèche identique, c’est comme si ça s’arrêtait, puisque c’est comme avant. On peut aussi dire que c’est une espèce de ponctuation. On peut aussi dire qu’elle identifie l’objet comme se rapportant à lui-même de façon nulle. Il faut qu’il y ait l’action qui n’agit pas.
On pourrait réfléchir, à partir de cette matrice, sur la corrélation chez Descartes du «je pense» et du doute. Après tout, le doute cartésien c’est la suspension de la validité de toute opération particulière de la pensée. Toute opération particulière de la pensée, je la suspends comme n’ayant pas de garantie de validité. Je suspends tout, jusqu’aux vérités mathématiques. Et qu’est-ce que je vais trouver ? Le résidu inactif, c’est-à-dire non opératoire de la pensée, qui est le «je pense» comme tel. Notez bien que le «je pense» est constitutivement chez Descartes le «je ne pense rien» ; car si c’était la pensée de quelque chose, elle serait frappée par le doute, parce que le quelque chose est frappé par le doute. Donc, le doute cartésien c’est l’opération du «je pense», rendue inactive jusqu’au point où il n’y a plus que le «je pense» comme non-opération en réalité, c’est-à-dire comme simple rapport à soi inactif, ne donnant rien que l’opération qui n’opère pas. Qu’est-ce qui reste à la pensée quand elle ne pense rien ? Il lui reste son identité, mais cette identité est inactive, en même temps. C’est tout le problème du cogito.
Platon, lui, soutient, que si on ne pense rien, on ne pense pas. Et donc, il n’y a pas de «je pense». Platon n’aurait pas admis la conclusion cartésienne. Il aurait dit : si on supprime à la pensée tout le principe d’être qui en soutient l’exercice, il n’y a plus rien. En tout cas il n’y a pas de pensée. Donc, le «je pense» pur n’existe pas. Toute l’astuce cartésienne est d’introduire à l’idée qu’il peut exister une opération qui n’opère pas, une pensée qui ne pense rien.
Catégoriquement, on peut dire : on se donne la possibilité d’une action qui n’agit pas. Mais vous voyez que c’est toujours lié à la question de l’identité, parce que vous sortez du tissu des rapports. Il n’y a pas vraiment rapport à quoi que ce soit. Le «je pense» est une catégorie à un seul objet, à une seule flèche. C’est la plus petite des catégories possibles après la catégorie vide. On pourrait dire que Descartes part d’une catégorie complète, d’un topos, et puis c’est comme si tout ce qui est réseau relationnel était suspendu à partir d’un point. Donc l’univers est en fait suspendu, c’est-à-dire l’ensemble des relations extrinsèques entre objets. Ce que Descartes va dire, et que le catégoricien dira aussi, c’est : il reste quant même une catégorie. Il reste un univers.
C’est cette démarche que Platon n’admettrait pas parce qu’il dirait que quand on en vient à réduire la dernière relation, ceci même s’effondre.
4) Un exercice de pensée qui est un exercice philosophique central est de s’habituer à raisonner en différenciant exactement ce que l’on fait de l’intérieur d’un univers, et ce qui, en fait, est fait de l’extérieur de cet univers. Je sais que les considérations d’immanence et de transcendance sont fondamentales en philosophie. Il y a un moment où il faut les exercer sur des choses effectives ! Si l’on conçoit un topos comme un univers catégoriel, il y a ce qui existe pour un habitant du topos. Il faut s’habituer à devenir un tel habitant.
De très nombreux problèmes, non seulement mathématiques mais ontologiques fondamentaux, résultent de la figure de rapport : comment prendre mesure de ce qui se pense de l’intérieur d’une figure de l’être ? Comment peut-on éclairer cela dans une fiction d’extériorité ? Toute transcendance est une fiction -c’est ma thèse. Lorsque vous opérez en transcendance par rapport à l’univers, vous êtes en train de vous installer dans un point fictif, fiction qui n’a d’intérêt que si elle éclaire l’immanence. Car seule l’immanence est réelle.
Par exemple, la logique d’un topos est classique ou non-classique. Prenons un habitant qui habite un topos dans lequel la logique est non-classique. Il ne sait pas que sa logique est non-classique. Il ne le sait pas parce que c’est sa logique, tout simplement. Donc, il n’a aucun moyen de confronter sa logique à une autre, parce que pour en avoir une autre, il faudrait examiner ce que c’est qu’un univers non classique. Mais s’il y a un autre univers, l’univers n’est pas un univers. Ce n’est donc que par une fiction de transcendance que nous, nous pouvons dire : dans telle et telle condition, l’univers est classique, dans telle et telle condition, il est non-classique. A ce moment-là nous sommes dans l’entendement de Dieu-Leibniz ; nous comparons des possibles. C’est très important. Parce qu’il faut bien voir que les prescriptions d’univers saisies de manière immanente sont sans alternative.
En théorie des ensembles, un point typique de cela, c’est la cardinalité d’un univers. Il est absolument impossible d’énoncer, de l’intérieur d’un univers, que l’univers est dénombrable, c’est-à-dire que la taille d’un univers est précisément ce qui n’est pas perceptible de l’intérieur. Nous-mêmes, comme habitant de cet univers, nous le représentons comme totalité par des opérations qui sont fictives, nécessairement. Ce sont des fictions de transcendance dans l’immanence.
Le problème fondamental est celui de l’articulation entre immanence et transcendance : de savoir comment de l’intérieur de l’immanence, on peut bâtir des fictions de transcendance, et comment de l’intérieur d’une fiction de transcendance, on peut procéder à une investigation en immanence. Ce qui compte, c’est la circulation entre les deux, ce n’est pas l’opposition simple.
Ne pas savoir ce qu’on ne peut pas dire : telle est la caractérisation d’une situation immanente. Problème central chez Wittgenstein : ce n’est pas le tout de parler de l’indicible, mais comment on sait ce qu’on ne sait pas. Si, comme le dit Wittgenstein, les limites de mon monde sont les limites de mon langage, on tombe très vite dans les paradoxes de l’immanence à l’univers si on veut parler de l’indicible. Même en non-langage. La métaphore du silence n’est pas entièrement satisfaisante, parce que se taire, oui, mais quand ? Puisque la limite est, par définition, ce qu’on ne rencontre pas.
La méthode, par rapport à l’immanence, est une méthode de
saturation. La bonne règle, c’est que, tant qu’on peut rester immanent, on le
reste. Mais il arrive qu’aller plus loin dans l’immanence elle-même exige une
fiction de transcendance. L’apparition de toute fiction de transcendance
intéressante est une preuve de l’impasse de l’immanence.
Nous allons aujourd’hui penser un peu sur la notion, ou sur le concept d’ordre ; c’est-à-dire sur la relation d’ordre.
Je voudrais dire en préliminaire que cette question de la relation d’ordre est absolument fondamentale et qu’elle joue en mathématiques, mais finalement dans tous les réseaux et dans tous les modes de circulation de la pensée de l’être, un rôle extraordinairement versatile, multiforme ; à la fois complexe, ramifié, différencié... Le nombre d’endroits où on la trouve est extraordinaire.
Un des buts de l’élucidation d’univers que représente la théorie des catégories sera aussi de nous faire comprendre pourquoi finalement. Qu’est-ce qui, du point de vue de la pensée, est réellement en jeu dans la notion générale de structure d’ordre ?
Deux exemples opposés. Un en théorie des ensembles, où la structure d’ordre joue un rôle décisif, par exemple dans le théorème de Cohen, donc au comble des problèmes, si je puis dire, métaphysiques de la théorie des ensembles. Et puis, comme nous aurons l’occasion de le voir, en théorie des catégories ça joue aussi un rôle tout à fait fondamental, dans, notamment, la logique, la théorie élémentaire du sous-objet, et dans la théorie de l’objet central.
L’élucidation de ce qui est en jeu dans cette notion n’est pas du tout simple -nous y reviendrons longuement -, et aujourd’hui, je voudrais simplement présenter un tout petit matériel qui vous permettra d’y réfléchir par vous-mêmes, et de tisser quelques ponts entre des domaines apparemment très différents.
Commençons par le plus simple. Qu’est-ce que c’est qu’une relation d’ordre ? C’est une relation qui obéit aux propriétés suivantes :
- réflexivité : x ≤ x
- transitivité : si x < y et y < z, alors x < z
- antisymétrie : si x < y et y < x, alors x = y
Une relation d’ordre est une relation qui a ces trois propriétés. Ces trois propriétés, qui caractérisent la relation d’ordre dans son sens le plus général, qu’est-ce qu’elles ont de particulier ?
Il y a un élément de réflexivité qui signifie que c’est une relation qui, si je puis dire, subsume, inclut, l’égalité. Ce qui est marqué dans le dessin même de la relation : x est en relation avec x par cette relation.
Deuxièmement, c’est une relation qui se propage. Il y a un élément de propagation. Si x est lié à y, et que y est lié à z, alors x est lié à z. Élément que dit assez bien la transitivité ; elle transite, cette relation, elle pivote sur ses moyens termes, sur des termes intermédiaires.
Et troisièmement, ça redit un peu les deux. Si x < y et y < x, alors c’est qu’en réalité c’est les deux mêmes.
Donc, en fin de compte, il y a deux idées dans la relation d’ordre, et deux seulement : il y a une subsumption de l’identité, et l’idée du transit sur le point pivot intermédiaire.
Il y a une chose très importante, bien qu’elle soit toute simple, c’est que lorsqu’on dit : il y a une relation d’ordre sur un ensemble, on ne veut pas nécessairement dire que tous les termes sont reliés par la relation. On veut simplement dire : cette relation est définie dans cet ensemble, il y a des termes qui sont plus petits que d’autres, mais il peut parfaitement y avoir des termes incomparables. Cela est un point dont il faut se souvenir. Aucun de nos axiomes ne nous oblige à ce que, étant donnés x et y, on ait forcément x < y ou y < x. Ils peuvent ne pas être liés par la relation. S’ils sont liés, ils doivent obéir à ces trois caractéristiques. La seule chose qui est certaine, c’est : x < x.
Donc, la structure que nous définissons là s’appellera la structure d’ordre partiel. Cela ne nous impose pas que cet ordre soit total, c’est-à-dire que tous les termes soient reliés.
A partir de là, il y a deux exemples d’ordre partiel, qui sont très simples, et qu’il est fondamental d’avoir à l’esprit.
• Le premier, c’est les sous-ensembles d’un ensemble E,
avec comme relation : e ![]() E.
E.
Vous direz que a < b si a ![]() b.
b.
On peut vérifier immédiatement que les trois axiomes sont vrais, c’est tout à fait trivial.
Donc les sous-ensembles d’un ensemble doté de la relation d’inclusion, constituent une structure d’ordre partiel. Cette structure est fondamentale, figure omniprésente dans la mathématique et dans la logique. Nous aurons l’occasion de penser pourquoi.
• Maintenant, passons à un registre entièrement différent : la relation logique d’implication. Nous allons voir que c’est aussi, sur les propositions, un ordre partiel :
1) Nous savons que : ![]() , c’est un grand axiome de la logique, et donc l’implication
est réflexive.
, c’est un grand axiome de la logique, et donc l’implication
est réflexive.
2) Nous savons que si ![]() , c’est la transitivité de l’implication.
, c’est la transitivité de l’implication.
3) Si on a : ![]() , or
l’équivalence c’est, dans l’ordre du calcul des propositions, la même chose que
deux termes égaux. Donc, nous avons bien aussi l’anti-symétrie.
, or
l’équivalence c’est, dans l’ordre du calcul des propositions, la même chose que
deux termes égaux. Donc, nous avons bien aussi l’anti-symétrie.
Donc, l’implication est un ordre sur les propositions, au sens de la définition générale de ce que c’est qu’un ordre.
Inclusion, dans la théorie des ensembles, et implication, en logique, sont des structures d’ordre partiel. Par conséquent, la structure d’ordre est une structure commune au logique et à l’ontologique. Car c’est une structure de la relation ontologique d’inclusion, mais c’est aussi bien une structure de l’implication logique sur les propositions.
L’hypothèse que nous allons tester par la suite est que la relation d’ordre est par elle-même un thème logico-ontologique, c’est-à-dire une zone d’interférences, de croisements, d’imbrications du logique et de l’ontologique. Si c’est une zone logico-ontologique, cette histoire de l’ordre, on peut tout de suite se poser la question : est-ce qu’il y a une transcription catégorielle de ça ? Est-ce qu’il y a une figure catégorielle de l’ordre ?
Imaginons une catégorie ( Co ) qui a la propriété suivante : il y a, au plus, une flèche entre deux objets.
Convenons de dire que, quand il y a une flèche entre a et b, on la note : <.
Je sais, puisque c’est une catégorie, qu’il y a obligatoirement une flèche entre a et a, qui est Ida. D’autre part, il n’y en a pas d’autre, car j’ai demandé qu’entre deux objets il n’y ait qu’une seule flèche. Dans mon nouveau mode d’écriture, cela va s’écrire comme ça : a < a.
Maintenant, puisque c’est une catégorie, je sais que s’il y a une flèche de a vers b, et une flèche de b vers c, il doit y avoir une flèche de a vers c qui est la composée des deux. La composée existe obligatoirement. Dans ma transcription, ça veut dire que si j’ai les flèches : a < b, et b < c, j’ai une flèche a < c.
Par conséquent, en tout cas, je peux très bien dire que c’est réflexif et transitif. Ce qui n’est simplement que la projection des axiomes catégoriels dans le langage de l’ordre. Je n’ai qu’une seule flèche, ou aucune entre deux objets ; j’ai obligatoirement la flèche identique ; si j’ai une flèche de a vers b, et une flèche de b vers c, j’ai une flèche de a vers c. Reste à examiner le cas de l’antisymétrie.
Le cas de l’antisymétrie, ça voudrait dire que j’ai une flèche de a vers b, et une flèche de b vers a. Alors qu’est-ce que je peux dire dans ce cas-là ? La composée des flèches f et g -de a vers b et de b vers a -est un isomorphisme, et donc les objets sont isomorphes, puisque la définition de deux objets isomorphes, c’est qu’il y a entre eux un isomorphisme. Donc l’antisymétrie est aussi vérifiée : deux objets isomorphes sont indiscernables.
Finalement, cette catégorie-là est une structure d’ordre partiel. Une catégorie qui admet au plus une flèche entre deux objets est une structure d’ordre partiel. Et inversement, une structure d’ordre peut toujours se représenter comme une catégorie de ce type.
Transcription dans l’autre sens : supposons que l’on ait un ensemble avec une structure d’ordre dessus. On va pouvoir le présenter comme une catégorie. Une structure d’ordre peut toujours s’exprimer comme une catégorie qui a la propriété d’avoir au plus une flèche entre deux objets.
Finalement, nous trouvons trois figures possibles -trois sémantiques possibles -de la relation d’ordre :
• une de caractère absolument ontologique, ensembliste, l’inclusion,
• une de caractère purement logique, l’implication propositionnelle,
• et finalement, une catégorielle.
Ce qui nous amènerait bien à dire que la figure catégorielle -qui est absolument générale -est comme si elle donnait ce qu’il y a de sous-jacent aux deux autres.
Mais une catégorie de type Co, à sa manière, c’est un univers. On peut donc dire que l’ontologique et le logique sont enveloppés l’un et l’autre par un univers, par un certain type d’univers, qui est, pour l’instant, les catégories de type Co, univers qui exprime l’ordre partiel et qui, en vérité, de ce fait même, est appropriable à l’ontologique comme au logique. Pour le dire autrement, les propositions liées par l’implication, c’est une catégorie. Et par ailleurs et simultanément, étant donné un ensemble E, l’ensemble de ses sous-ensembles P(E) est aussi une catégorie, avec cette fois, comme flèche, l’inclusion.
Ceci est une miniature tout à fait fondamentale. On trouve un type catégoriel commun à l’univers des propositions et à un univers au sens ensembliste strict, c’est-à-dire un ensemble et ses sous-ensembles. Ce qui est très intéressant, c’est que catégoriellement, ça ne fait pas de différence, la catégorie est formellement la même.
Vous voyez poindre l’idée essentielle suivante : au fond, la pensée catégorielle ne distingue pas, au départ, l’univers du discours et l’univers des objets. Ou plutôt, elle les accueille dans des univers communs. Au fond, que les objets soient des propositions et les flèches des implications, ou que les objets soient des sous-ensembles et les flèches des inclusions, ne fait pas vraiment différence pour la figure catégorielle elle-même. La pensée catégorielle, au départ, son esprit propre est de suspendre l’opposition du logique et de l’ontologique, en tentant d’en donner les figures possibles communes. Ici, nous en avons un mini exemple : catégorie de type Co = figure commune à la figure d’inclusion dans les ensembles, et à la figure de l’implication dans les propositions. Ce qui peut se donner de façon abstraite : la relation d’ordre. Mais qui peut aussi bien se donner comme type d’univers catégoriel.
Et on pourrait continuer la prospection de ce petit univers catégoriel. Je vais en donner deux exemples, très simples :
Supposez que vous ayez une structure d’ordre avec un élément minimal, 0 tel que 0 < x pour tout x. Cela va vouloir dire que vous avez un objet 0 tel qu’il existe une flèche de lui vers tout autre objet de la catégorie, et comme nous savons que c’est une catégorie de type Co, nous savons qu’il existe une seule flèche de lui vers tout objet de la catégorie. 0 est l’objet initial. Donc, l’existence d’un ordre avec minimum, cela veut simplement dire que la catégorie Co a un objet initial.
De même, il est absolument évident que s’il y a un maximum, c’est-à-dire un objet plus grand que tous les autres, la transcription catégorielle va être qu’il y a une flèche et une seule de tout x vers cet objet, ce qui veut dire que cet objet est un objet terminal. Donc, dire qu’une structure d’ordre admet un maximum, c’est exactement la même chose que de dire que la catégorie Co correspondante a un objet terminal.
Donc, si vous avez une structure d’ordre qui admet à la fois un minimum et un maximum, cela veut simplement dire que la catégorie Co correspondante est une catégorie qui a un objet initial et un objet terminal.
Dans nos deux exemples :
- l’inclusion : minimum, l’ensemble vide ; maximum, l’ensemble E lui-même. On dira que la catégorie Co correspondante a certainement un objet initial et un objet terminal. Et l’on peut parfaitement dire qu’après tout, l’ensemble vide est tout simplement l’objet initial de la catégorie considérée, et que l’ensemble E, c’est l’objet terminal de la catégorie considérée ;
- l’implication : un minimum, ça voudrait dire une proposition qui implique n’importe quelle proposition ; appelons-la F, c’est une proposition dont on est sûr qu’elle est absolument fausse. Le faux est l’objet initial de cette catégorie. Maintenant, une proposition qui est impliquée par n’importe quelle proposition, c’est une proposition dont on est sûr qu’elle est absolument vraie. Par conséquent, notre catégorie sous-jacente, elle a un objet initial et un objet terminal. Le faux est son objet initial et le vrai est son objet terminal. Toutes les propositions vont s’espacer implicativement entre l’objet initial qui est le faux, et l’objet terminal qui est le vrai.
Vous voyez se dessiner une corrélation structurale entre le faux et le vide, et le vrai et le tout. La catégorie sous-jacente, la même, Co, admet un objet initial et un objet terminal.
II
Quelques questions, encore, sur le fascicule
1) Sur la négation :
Dans un topos, l’objet central comporte nécessairement deux éléments différents : le vrai et le faux. C’est une donnée primitive d’un topos.
Le faux est la centration de la flèche ![]() , c’est-à-dire la centration de la première différence dans
un topos, de la différence par excellence, celle entre 0 et 1.
, c’est-à-dire la centration de la première différence dans
un topos, de la différence par excellence, celle entre 0 et 1.
Le faux est d’abord et avant tout un deuxième élément de l’objet central dont on est sûr qu’il est non identique au vrai. Les éléments de l’objet central vont être les valeurs de l’univers. Tout ce qui va donner sens aux assertions va se présenter comme élément de l’objet central. Le faux est introduit comme deuxième valeur obligée.
Supposons qu’un topos n’ait que deux éléments de l’objet central ; cela voudra dire qu’il n’y a que deux façons possibles de donner valeur aux énoncés ; il s’agit d’un topos bivalent. Si l’on n’a que deux valeurs, il faut que ce soit le vrai et le faux. Si l’on a d’autres valeurs, dans un topos dont l’objet central a plus de deux objets, ce sont des valeurs qui vont se disposer entre le vrai et le faux.
La négation est l’analyse centrale du faux.
Connecteurs et valeurs sont des flèches : il y a indistinction de la syntaxe et de la sémantique, en théorie des catégories. C’est donc la conception la plus immanentiste de la vérité qu’on puisse proposer. La vérité, c’est une flèche du topos et c’est tout. De même pour le faux, et de même pour la négation. L’approche catégorielle de la logique n’est pas langagière, et c’est sa grande force. La logique est une singularisation d’univers. C’est un noyau immanent de la proposition d’univers que représente un topos.
Toutefois, ce qui caractérise les valeurs, c’est que ce sont des éléments de l’objet central. Tandis que les connecteurs ne sont pas donnés comme des flèches élémentaires.
2) Sur l’exponentiation :
C’est une tentative de penser, dans l’univers catégoriel, l’idée de toutes les flèches d’un objet à un autre.
• Pourquoi est-ce une idée importante ? Parce que toutes
les flèches de ![]() exprime l’idée d’une connaissance intégrale de la
relation de a vers b. On peut dire que le but de l’exponentiation est d’épuiser
la connaissance des modes propres d’actions de a sur b. C’est épuiser toutes
les manières dont a voit b, selon notre métaphore de la visibilité. C’est donc
l’idée d’une certaine exhaustion dans la façon dont a se rapporte à b.
exprime l’idée d’une connaissance intégrale de la
relation de a vers b. On peut dire que le but de l’exponentiation est d’épuiser
la connaissance des modes propres d’actions de a sur b. C’est épuiser toutes
les manières dont a voit b, selon notre métaphore de la visibilité. C’est donc
l’idée d’une certaine exhaustion dans la façon dont a se rapporte à b.
Si on n’a pas cela, on n’a pas quelque chose comme la vérité complète dont a se rapporte à b.
• Sur sa difficulté, elle tient à ce que toutes les
flèches de ![]() est immédiatement un concept ensembliste, et pas catégoriel.
L’habitant de l’univers catégoriel n’a, par rapport à deux flèches, comme mode
de connaissance, que de les composer. Sinon, il ne connaît les flèches qu’une
par une.
est immédiatement un concept ensembliste, et pas catégoriel.
L’habitant de l’univers catégoriel n’a, par rapport à deux flèches, comme mode
de connaissance, que de les composer. Sinon, il ne connaît les flèches qu’une
par une.
Le but va donc être de nous donner quelque chose de
catégoriel qui tienne lieu de cela, l’ensemble des flèches de a vers b.
Avec quoi on peut faire ça ? Ça porte sur la connexion entre a et b.
On en a déjà quelques vues qui ne sont pas tout-à-fait réductibles à une flèche. On a défini le produit de deux objets. Donc, il faut retraverser la question du produit. Le produit est quelque chose qui est corrélé aux deux objets de telle sorte que tout autre objet qui est corrélé aux deux objets a une corrélation au produit, unique, qui fait commuter l’ensemble. Donc le produit, c’est l’objet qui établit la connexion limite aux deux objets pris au départ. C’est celui qui pour cette double liaison est en position universelle. Dans le produit, nous avons une certaine investigation de ce qui caractérise le fait d’être lié à a et à b.
L’exponentiation va chercher un peu de la même façon la question de l’existence de flèches de a vers b.
La clarté du modèle ensembliste, c’est que l’ensemble des fonctions d’un ensemble vers un autre ensemble est aussi un ensemble ; il y a une homogénéité de l’univers ensembliste.
Si on essaie de couper au plus court, on va tenter d’universaliser la propriété : être en produit avec a, et depuis ce produit-là voir b. S’il y a un autre produit d’où l’on voit b, il faut trouver une flèche unique qui va du deuxième vers le premier produit et qui fait commuter le triangle :
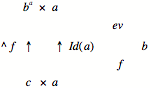
On peut montrer que ^f est en correspondance exacte avec f.
Ce qui veut dire que, à chaque fois que du produit ![]() on a une flèche vers b, on en a une de c vers ba :
on a une flèche vers b, on en a une de c vers ba :

C’est cette corrélation qui va faire que toutes les flèches
de ![]() vers b vont être représentées par des flèches qui
vont vers l’objet exponentiel. La procédure de l’exponentiation consiste à
associer à toute flèche de
vers b vont être représentées par des flèches qui
vont vers l’objet exponentiel. La procédure de l’exponentiation consiste à
associer à toute flèche de ![]() vers b une flèche qui va de x vers ba , ba attestant ainsi sa
capacité à capturer quelque chose de toute corrélation entre a et b. C’est le caractère
indifférencié de x (= c) qui va permettre de capturer tous les mouvements de a
vers b. ba est en position de capture
de toutes ces corrélations, une par une.
vers b une flèche qui va de x vers ba , ba attestant ainsi sa
capacité à capturer quelque chose de toute corrélation entre a et b. C’est le caractère
indifférencié de x (= c) qui va permettre de capturer tous les mouvements de a
vers b. ba est en position de capture
de toutes ces corrélations, une par une.
On peut dire en récapitulation :
Pour se donner le pluriel des flèches de a vers b, on se
donne les flèches de ![]() vers b. C’est de cela qu’on cherche la limite. Cette
limite va s’attester par des flèches de
vers b. C’est de cela qu’on cherche la limite. Cette
limite va s’attester par des flèches de ![]() qui vont fonctionner comme autant d’index d’une
corrélation de a à b.
qui vont fonctionner comme autant d’index d’une
corrélation de a à b.
On peut dire, si on passe par la version ensembliste :
![]() ev
ev
![]()
![]() a f
a f
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (élément
de ba)
(élément
de ba)
Les éléments (au sens catégoriel) de ba représentent les flèches de a vers b. Il
y a autant d’éléments de ba qu’il y a
de flèches de a vers b. C’est en ce sens que ba
peut être tenue comme récollection élémentaire de toutes les flèches de a vers
b. Le nom d’une flèche de a vers b, c’est l’élément de ba qui lui correspond (![]() ) (
) (![]() ). L’exponentiation assigne à toute flèche un nom. Ce nom
étant lui-même un élément de ba.
L’objet exponentiel a puissance de nommer toute flèche de a vers b.
). L’exponentiation assigne à toute flèche un nom. Ce nom
étant lui-même un élément de ba.
L’objet exponentiel a puissance de nommer toute flèche de a vers b.
Une catégorie possède l’exponentiation si, étant donnés deux
objets a et b, ba existe toujours.
Retour sur la question de l’ordre partiel. Sur la motivation de l’examen de cette structure.
La structure d’ordre est une véritable médiation logico-ontologique. C’est pour cela qu’elle joue un rôle clef dans les questions qui nous occupent ici.
La structure d’ordre partiel joue un rôle décisif dans le théorème de Cohen, et dans la construction d’ensembles génériques. L’investigation de la question de la puissance du continu est étroitement liée à la question de la structure d’ordre. Si on admet que cette question de l’errance du continu est ontologiquement décisive, on voit que son investigation prend appui sur des considérations relatives à la structure d’ordre.
Ce que l’on voit ici, c’est que la structure d’ordre partiel va être la clef -c’est une espèce d’aiguilleur -entre les caractérisations ontologiques et des caractérisations logiques d’univers. Pourquoi ?
Il y avait, dans Bourbaki, une intuition assez forte d’avoir isolé la structure d’ordre. Il y a trois structures, dans Bourbaki : algébrique, topologique, et d’ordre, comme si la structure d’ordre représentait une dimension de la pensée irréductible à la simple opposition topologique / algébrique. L’ordre a une autonomie de départ, sans avoir une autonomie de destin.
Ceci, parce que la structure d’ordre, comme structure de la pensée est très particulière : elle n’est pas domaniale, elle ne constitue pas un domaine de l’investigation. Il n’y a pas de domaine de l’ordre. La raison profonde est que la structure d’ordre, de même qu’elle est en interface de l’algèbre et du topologique, est, plus fondamentalement en interface du logique et de l’ontologique. C’est ce qui explique que c’est une structure extrêmement pauvre, et en même temps extrêmement puissante lorsqu’elle travaille autre chose qu’elle même.
Pourquoi ? C’est un problème très réel et très difficile.
Rappels
a- définition (≤) :
• x ≤ x : réflexivité,
• x ≤ y et y ≤ z -› x ≤ z : transitivité,
• x ≤ y et y ≤ x -› x ≤ y : antisymétrie.
b- exemples :
• un ensemble E, avec ses parties, et ![]()
• les propositions, avec ![]()
* p
![]() p
p
* (p
![]() q) et (q
q) et (q ![]() r)
r) ![]() (p
(p ![]() r)
r)
* (p
![]() q) et (q
q) et (q ![]() p)
p) ![]() (p
(p ![]() p)
p)
Ceci nous donne déjà la relation d’ordre comme interface de la logique et de l’ontologie :
- le premier exemple nous donne qu’il y a une structure d’ordre primitive, l’inclusion ;
- le deuxième exemple, le calcul des propositions, nous montre que l’implication est aussi une structure d’ordre.
Il y a distribution de cette relation aussi bien dans un exemple canonique qui renvoie à l’ontologie que dans un exemple qui renvoie à la logique.
c- Il y a de cela une représentation catégorielle :
x ≤ y / x ![]() y
y
-
réflexivité : x ![]() x
x
- transitivité : composition des flèches.
Une structure d’ordre partiel, c’est une catégorie telle qu’entre deux objets, il y a au plus une flèche.
d- Quelques propriétés supplémentaires possibles :
* Supposons qu’il y ait un objet plus petit que tous les autres : on dira que la structure d’ordre a un minimum. La catégorie a un objet initial.
* Il peut y avoir un maximum : la catégorie a un objet terminal.
* Étant donnés deux objets x et y, supposons qu’il existe un objet z tel que :
![]() PPS (x,y)
[le plus petit des supérieurs]
PPS (x,y)
[le plus petit des supérieurs]
Supposons que t ait la même propriété.
z c’est le plus petit des plus grands que x et y.
Transcription catégorielle :
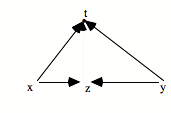
z est le co-produit de x et de y. (L’unicité de la flèche z ![]() t est garantie
par le fait qu’on a supposé qu’entre deux objets, il n’y avait qu’une seule
flèche).
t est garantie
par le fait qu’on a supposé qu’entre deux objets, il n’y avait qu’une seule
flèche).
* Prenons le dual de cela :
![]() PGI (x,y)
[le plus grand des inférieurs]
PGI (x,y)
[le plus grand des inférieurs]
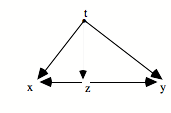
Dans ce cas, il y a existence du produit.
Si, dans une structure d’ordre, il y a le PGI (x,y), dans la transcription catégorielle, cela veut dire qu’il y a le produit de x et de y.
e- A quoi tout ceci correspond-il dans nos deux exemples initiaux ?
a) Ontologie :
- objet initial : l’ensemble vide Æ
- objet terminal : E
- co-produit de deux parties a et b : l’union a È b (ceci explique pourquoi, souvent, on appelle le co-produit, la somme)
- produit : l’intersection a Ç b
Notons ceci : l’ensemble des parties d’un ensemble, doté de la relation d’inclusion, c’est une catégorie à objet initial (Æ), à objet terminal (E lui-même), à produit (Ç), et à co-produit (È). C’est une catégorie déjà relativement structurée, mais structurée en tant que simple catégorie d’ordre.
b) Logique : les propositions :
- objet initial : une proposition fausse quelconque : F (toute proposition équivalente au faux est un objet initial)
- objet terminal : le vrai : V (toute proposition équivalente au vrai est un objet terminal) ; nous retrouvons une catégorie qui se dispose entre le vrai et le faux.
- co-produit : la disjonction de p et de q est le PPS de p et de q :
![]()
Catégoriellement, la disjonction de p et de q atteste la
possibilité de construire dans cette catégorie le co-produit.
- produit :
![]()
la conjonction
de p et de q : ![]()
La conjonction de p et q est le PGI de p et de q. Catégoriellement, c’est le produit de p et de q.
Le calcul des propositions est une catégorie à objet initial, à objet terminal, et à co-produit.
Il y a un parallélisme ontico-logique qui est déployé catégoriellement au sens où c’est la même catégorie, d’une certaine façon. Son identification ultime se dira : il s’agit d’une catégorie à flèche unique (entre deux objets, il y a au plus une flèche), à objet initial, à objet terminal, produit et co-produit. C’est la catégorie d’ordre, avec minimum, maximum, PGI et PPS. La présentation catégorielle exprime l’indiscernabilité de ces deux dispositifs. Entre les parties d’un ensemble et les propositions, la pensée catégorielle nous montre une communauté de possibles.
Or, cette communauté de possibles retient la différence entre l’ontologie et la logique, elle la laisse indistincte. Ce qui est donné là, c’est une catégorie d’ordre, avec des caractéristiques qui sont celles de l’ordre. Jusqu’à un certain point, en tout cas, la structure d’ordre partiel exprime un possible commun du logique et de l’ontologie. Cela va aller jusqu’à une structure encore plus complexe, la structure de l’algèbre de Heyting, dont l’algèbre de Boole est un cas particulier.
Il y a un lien intime entre pensée catégorielle et pensée de l’ordre, au sens où on exprime la possibilité indistincte du logique et de l’ontologique.
Or, objet initial, objet terminal, produit et co-produit sont requis pour un topos.
(Exercice : est-ce qu’on pourrait arriver à définir une
exponentiation, soit directement à partir de la structure d’ordre, soit sur
l’exemple des ensembles, soit sur l’exemple des propositions ? Qu’est-ce
que serait le fait qu’il y ait l’objet central ? [il faut le pull-back]).
III
1) La structure d’ordre partiel apparaît de façon immédiate comme présente dans l’ontologie ensembliste. L’inclusion est une relation d’ordre sur les parties d’un ensemble.
2) La structure d’ordre partiel apparaît directement aussi dans l’ordre de la logique élémentaire puisque l’implication fonctionne dans l’univers des propositions également comme une relation d’ordre partiel.
3) On peut présenter toute relation d’ordre comme une catégorie avec cette particularité qu’il s’agit d’une catégorie où entre deux objets différents, ne peut exister qu’une seule flèche.
C’est donc un organisateur de l’ontologie ensembliste, de l’espace des propositions, et elle est susceptible d’une présentation catégorielle.
Comment vont se lier les trois traits que nous avons décrits ? La structure d’ordre partiel est à la jointure, déjà, du logique et de l’ontologique.
Or, nous soutenons depuis longtemps que l’univers catégoriel est une élucidation logique des décisions ontologiques. Elle est ce qui permet de les élucider. Il faut donc s’attendre à ce que la relation d’ordre intervienne dans cette affaire puisqu’elle apparaît à la jointure des deux espaces.
Par conséquent une partie du travail va consister à montrer comment le principe de la relation d’ordre intervient dans un topos. Il y a tout lieu de penser que si la théorie des topos sert à éclaircir la connexion logique/ontologie, elle va rencontrer cette question de la relation d’ordre.
Ponctuation d’histoire de la philosophie
L’examen de la relation d’ordre remonte très loin, dans l’histoire de la philosophie elle-même. Son origine est double -duplicité intéressante, que nous allons retrouver -:
• L’argumentaire sophistique, d’un côté, qui gravite autour des questions de la relation d’ordre, qui est retraité par la philosophie elle-même.
Ce sont les innombrables considérations sur le plus grand et le plus petit : argumentaire canonique de la discussion entre sophistique et philosophie. Cf. un grand nombre de dialogues de Platon. De même, questions du plus vieux et du plus jeune.
Cette première assignation est du côté argumentairement opératoire. Là, c’est son versant logique, au sens large des procédures d’argumentation, en particulier de déroutement de la pensée. C’est versé du côté de la provocation logique de la pensée, ce qui la provoque paradoxalement.
• D’un autre côté, la relation d’ordre a à voir avec toute une série de caractérisations de l’ordre de l’être lui-même, à travers les grands schèmes de la philosophie antique :
- l’idée de hiérarchie,
- tout ce qui tourne autour de la question de la totalité (versant inclusif).
Là, c’est versé du côté ontologique. L’ordre est une maxime de la disposition de l’être lui-même.[5] Donc, ordre, subordination hiérarchique...
La question est de discerner les régions de l’être qui sont non reliées, pas connectées par la relation d’ordre. Il y a un principe d’ordre, mais il demeure un ordre partiel : il y a des régions et des régimes de pensée qui s’auto-organisent, mais peuvent être disconnectés entre eux, notamment chez Aristote. Cf : le livre g de la Métaphysique : «L’être se dit en plusieurs sens, mais vers l’un (proV en)». Cet énoncé signifie qu’il y a une polysémie du mot être, et en même temps cette polysémie est tenue dans une direction unitaire. Ceci contraint Aristote à toute une série d’investigations sur l’ordre de l’être : tout n’est pas pris dans un ordre unique, il y a des régimes de l’être, eux-mêmes polysémiques, et il y a une direction de récollection qui réordonne les ordres partiels sans les homogénéiser pour autant : c’est ce qui fait la grande tentation de l’ontologie aristotélicienne. L’ontologie aristotélicienne est une intrication d’ordres partiels en direction de l’un. Ici, la question de l’ordre travaille sur le principe de l’être.
Donc, dès les origines, il y a deux usages intriqués de la question de l’ordre :
- Un usage logico-paradoxal. Usage dans le registre de l’argument, langagier, des paradoxes de l’ordre.
- Sur les options ontologiques, toute une série de maximes d’ordre sont intriquées, suspendues à une question fondamentale : y a-t-il un ordre ? La solution d’Aristote est, sur ce point, comme toujours nuancée.
La philosophie a donc elle-même, très tôt, traité du paradigme de l’ordre, dans deux directions : la direction logique et la direction ontologique. Le problème est de savoir comment s’est pensée, en philosophie, l’unité de ces deux directions. Comment l’ordre est-il renommé comme catégorie unifiée ?
En vérité, un des noms de cette unification est le nom de justice, nom typiquement grec.
Justice, c’est le principe du bon ordre, toujours au sens où c’est simultanément une discipline du langage et une discipline de l’univers. C’est un nom de la philosophie pour surmonter la duplicité de la notion d’ordre, c’est-à-dire le fait qu’elle est à la foi un lien paradoxal, sophistique, de la pensée, en même temps qu’elle est philosophiquement investie dans le face-à-face de la philosophie à la question de l’être. Justice désignerait un ordre délivré de cette duplicité, à la fois un principe du bien dire -la langue juste, non trompeuse -, et en même temps le principe de l’ordre juste, dans l’univers, dans la cité.[6]
Si on pense que justice -dans son acception grecque -est ce qui cherche à calmer la duplicité de l’ordre, on dira que justice aussi est à la jointure du logique et de l’ontologique. Justice est une ressaisie philosophique de la fonction de jointure de la question de l’ordre. Voilà pourquoi ça va se distribuer simultanément en question de l’ordre et question de l’univers.
On pourrait dire que justice est, exemplairement, en philosophie, un nom catégoriel. Il y aurait à
l’arrière-plan cet énoncé assez originel, quasiment pré-philosophique, que l’être
est justice. C’est-à-dire que ça administre
l’ordre des choses. C’est un archi-énoncé de la philosophie grecque, avec lequel
la philosophie grecque est en discussion. Donc un peu avant elle. C’est un
énoncé qui entérine en philosophie l’ambiguïté de l’ordre, sous le nom de justice.
La question de l’être est justice c’est : comment cela se dit ? Comment cet archi-énoncé peut promouvoir un dire ? Comment organiser en dire que l’être est justice ? Pour cela, il faut l’organiser en dire dans une langue elle-même juste. Là, on est aux prises avec l’ambiguïté de l’ordre.
C’est donc un concept catégoriel, c’est-à-dire pris par l’ambiguïté entre le possible et le réel. La pensée grecque est constamment embarrassée par la question de savoir si la justice dont elle établit le concept est une figure programmatique ou une description du réel. Est-ce un nom du réel ou un nom du possible ?
Chez Aristote, la justice a des types politiques possibles, et Aristote constate que le réel est toujours une pathologie de ces types : une aristocratie est un type possible de la justice, malheureusement, dans le réel, on a des oligarchies. Même chose pour la monarchie ; dans le réel, on a toujours des tyrannies. Même chose encore de la république ; on a toujours des démocraties !
C’est très intéressant à suivre : ceci signifie que justice, qui pour Aristote serait un nom de l’ordre combiné de la constitution et de l’être social de la cité, est prise dans le paradoxe de l’ordre : là où il y a le type normal, il y a le type pathologique. Cela veut dire que l’ambiguïté de l’ordre, devient un paradoxe de la justice elle-même. Là où on parle de justice, surgit toujours un couplage de termes -jamais un terme simple -qui est comme la projection de la duplicité de l’ordre. Si on admet que justice est un concept catégoriel, une conséquence en serait qu’il y a quelque chose dans la pensée catégorielle qui est profondément lié à la notion de couplage. Il y a quelque chose qui est couplant. Ce qui serait une manière de revisiter la pensée catégorielle.
Il y a la dualité : les vrais concepts catégoriels sont toujours des concepts couplés. Toute catégorie induit immédiatement la catégorie duale, son ordre pris en symétrie. Il y a un travail de l’ambiguïté, mise en scène dans la pensée catégorielle. De fil en aiguille, on retombe sur la question du tiers-exclu, c’est-à-dire sur la question de savoir si on a bien p ou p, sans tierce possibilité. Sinon, on n’a pas de régime de décision. C’est la raison profonde à ce que l’univers catégoriel n’entérine pas le tiers-exclu, tenant à ce que c’est un univers de l’ambiguïté -ambiguïté qui peut être présentée comme ambiguïté de l’ordre, finalement ambiguïté du logique et de l’ontologique, c’est-à-dire du possible et du réel.
Finalement, justice serait le nom -filtré ainsi -grec d’une indécidabilité essentielle, pas d’une indécidabilité de circonstance. On ne pourrait jamais savoir exactement si la justice est de l’ordre du possible ou de l’ordre du réel. Elle aurait à être pensée comme le nom de leur couplage et pas de leur alternative. Justice désignerait toujours le réel d’un possible ou le possible d’un réel.
Qu’est-ce qui tient ensemble le réel et le possible, chacun dans l’autre ? La seule chose qui les tienne ensemble, c’est une prescription. Ça ne peut être énoncé au régime du constat. La prescription est elle-même réelle. Elle est le réel du couplage. Cela, Platon le dit en propres termes à la fin du livre 9 de la République : peu importe que ça arrive ou pas, c’est-à-dire : laissons de côté le tiers-exclu, ce qui compte, c’est qu’il faut vivre sous cette règle. C’est-à-dire : ce qui est énoncé là est un énoncé qui relève de la prescription, et pas du tiers-exclu. Il faut tenter de vivre sous cette pensée-là, ce qui révoque la question de savoir si c’est réel ou si c’est possible. Cf : «En tout cas, on est dans la justice, je n’ai jamais entendu dire le contraire» (Comment c’est - Beckett).
Cela amènerait à la considération que, finalement, peut-être y a-t-il dans la pensée catégorielle quelque chose comme une logique de la prescription. Autre chose qu’une simple logique des propositions. Cette logique de la prescription retiendrait, maintiendrait en suspens, le départ entre réel et possible.
Il y a donc une complication de ma position sur cette affaire :
1) Les Catégories sont l’alternative ontologique aux Ensembles.
Dans ce cas, je choisis les Ensembles.
2) Les Catégories sont du registre du possible, donc de la logique. Elles élucident la logique sous-jacente des décisions ontologiques.
3) Le rapport n’est pas entre décision réelle et possible logique. Il y a un réel de la pensée catégorielle. Ce réel est celui d’un couplage avec le possible.
Ce n’est pas un réel au même sens que la théorie des ensembles. Ce n’est pas une ontologie. Mais ce n’est pas non plus purement une logique. Ou si c’est une logique, c’est une logique de la prescription, c’est-à-dire du couplage du réel et du possible, et non pas simplement de la possibilité. C’est ainsi que je comprends le sentiment très vif de ce que les Catégories présentent un intérêt véritable par rapport à la logique formelle. C’est une conviction très forte.
Dans une première élaboration : la logique, dans sa présentation catégorielle, est supérieure à la présentation usuelle parce qu’elle nous présente des univers. Elle est donc désenchaînée du strict rapport langagier, elle ne présente pas la logique d’abord comme un univers de règles.[7]
Ce que je pense maintenant c’est que la grande force de la logique catégorielle c’est que le possible est aussi donné dans son réel. Il est donné avec et en même temps que le réel de ce possible.
Si on prend une langue logique habituelle : c’est une syntaxe qui est en attente de son interprétation. Raison pour laquelle j’ai toujours pensé que la philosophie analytique et la philosophie herméneutique étaient les deux faces d’une même chose. Le couple syntaxe/sémantique est le couple entre disposition analytique et disposition herméneutique. Le théorème de Gödel nous dit qu’un système formel est toujours polysémique, c’est-à-dire susceptible de plusieurs interprétations.[8]
Si on prend la logique dans son exposition catégorielle, ce n’est pas une syntaxe en attente d’une sémantique. Ce n’est pas un formalisme propositionnel en attente d’une interprétation.
C’est un véritable déplacement philosophique que de considérer que l’exposition catégorielle de la logique déplace l’essence de la logique. Cela soustrait la pensée au couple de l’analytique et de l’herméneutique -lequel recouvre l’académisme philosophique -, pour l’instituer dans une pensée en univers -pas en assignation formelle de la langue -, d’un certain type de couplage du possible et du réel, au regard des possibilités de vérité. Cela nous donne le possible, sans attente. Un possible qui n’attend rien, en particulier aucune interprétation. C’est en ce sens qu’on en donne le réel. On a le possible comme possible, c’est-à-dire dans son réel. C’est le couplage d’un possible avec lui-même comme réel.
Tout cela est une réappropriation de la logique à une possibilité philosophique entièrement dégagée du couple de l’herméneutique et de l’analytique.
Nous sommes en train de renforcer considérablement l’aspect leibnizien de cette affaire. C’est une thèse essentielle de Leibniz que le possible est réel. Lui le prend en deux sens :
• Un premier sens, topique[9] : il faut assigner le lieu. Leibniz va répondre : l’entendement de Dieu, pas en tant que réponse sémantique, mais en tant qu’il peut être le lieu réel de tous les possibles.
• Un deuxième sens, dynamique : par ailleurs, ce qui est possible a une prétention au réel. Les univers possibles ont la prétention d’exister, et Dieu en fait exister un. En réalité, la création, c’est seulement la levée d’un obstacle, d’une retenue. Dieu cesse d’empêcher, pour un univers possible, sa prétention d’exister, il lève ce qui fait obstacle à sa prétention d’exister. Cela va donner un statut particulier à la négation. Il va y avoir un caractère novateur de la négation elle-même. La création est la levée négative d’un interdit. La négation est liée à la création.
Si on revient aux univers catégoriels, on dira : il y a l’ensemble des univers possibles, les topos. Le réel de ces univers, c’est la théorie des catégories elle-même. Il y a une assignation topique, incontestablement.
Maintenant, deux autres questions intéressantes viennent de Leibniz :
1) Peut-on parler d’une prétention à être d’un topos ?
2) Y a-t-il un univers meilleur ?
Sur la première question : elle est assez compliquée. Je pense que les catégoriciens traitent bien les topos dans leur prétention à être. C’est pour ça qu’ils croient toujours que c’est une ontologie alternative. Il y a un jeu complexe sur ce point de l’exemplification. Quand on donne un exemple de topos, on prélève sur les mathématiques un topos dans sa prétention à être. Mais intrinsèquement, il n’y a pas de corrélation dynamique du topos.
Là, j’inscrirai une différence par rapport à la théorie du possible de Leibniz. Je réduirai le réel du possible à la topique. J’établirai une délimitation avec Deleuze, leibnizien sur ce point, pour qui ce qui compte, c’est la virtualité du possible.[10]
Sur la deuxième question, je dirai : jusqu’à plus ample informé, le topos des ensembles est le meilleur des mondes -au titre d’univers fulguré, réel. S’il y en a un autre, qu’on le décide, qu’on le fulgure.
Dans tout ça, que deviendrait la justice ?
Ça deviendait deux choses :
• Elle signifierait d’abord la théorie des catégories elle-même comme prescription, comme lieu général de la logique des prescriptions, comme figure déployée en pensée du possible et du réel, couplage vertical. Ce serait le sens logique de justice ; qu’il y ait de la prescription effective.
• Elle désignerait, du côté de l’ontologie, que le monde fulguré soit réellement le meilleur des mondes possibles. Le Cosmos adéquat de la fin du Timée. La justice, c’est qu’il y ait la théorie des ensembles.
Ce qui serait juste à la fin des fins, c’est qu’il y ait la théorie des ensembles, et la théorie des catégories !!!
|
|
Ensembles A
Í B |
Logique p
® q |
Catégories a
® b |
|
minimum maximum PPS (A,B) PGI (A,B) |
Æ E A È B A Ç B |
F V p Ù q p Ú q |
objet Initial objet terminal co-produit produit |
Cela nous donne une structure d’ordre partiel qui a des propriétés particulières, dont certaines sont quasiment opératoires. A partir de la relation d’ordre, nous bâtissons une structure algébrique. Nous passons de propriétés relationnelles à une structure opératoire.
Programme de pensée de ce qui va suivre :
A partir de cette petite matrice, nous allons nous engager dans l’étude un peu systématique de la question de l’ordre dans un topos. Bien entendu, la question de l’ordre dans un topos ne peut être une catégorie d’ordre telle que nous l’avons vue ci-dessus.[11] D’où la question : qu’est-ce qui fait office d’ordre dans un univers catégoriel ?
Les flèches sont décisives, comme nous le répétons.
I - 1) Définir ce qui pourrait bien être un ordre entre flèches.
En même temps, nous ne voulons pas perdre l’hypothèse d’une investigation ordonnée des objets. D’où :
2) Comment trouver un concept d’ordre qui, quoique fondamentalement assigné aux flèches, permette d’envisager un ordre dans, ou à propos, des objets ?
Cf. le fascicule. On va principalement s’intéresser aux flèches qui définissent des sous-objets. C’est une exploration ordonnée de l’immanence (ordonnée aux monomorphismes). Cela nous intéresse par rapport au fait que l’inclusion est une relation d’ordre par rapport aux sous-ensembles d’un ensemble donné. Donc, nous allons nous donner un certain concept de l’inclusion susceptible de ne pas ressembler du tout aux Ensembles -qui n’est qu’un cas de topos.
II - L’idée va être de se tourner vers le centre logique d’un topos, l’objet central.
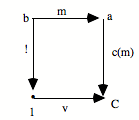
Ce qui est important, en logique de l’objet central, ce sont ses éléments, les évaluateurs, les valeurs logiques. Tous les éléments sont des flèches de source 1. Il y a un problème particulier avec l’ordre quand il s’agit de flèches de source 1.
Si nous prenons un monomorphisme de cible 1, en tant que monomorphisme, il est analysé par l’objet central. C(m) est un élément de C.
|
|
Il y a donc exactement autant de monomorphismes différents de cible 1 qu’il y a d’éléments dans l’objet central.
Mais les monomorphismes de cible 1 sont les sous-objets de 1. Nous avons donc une stricte correspondance entre éléments de C et sous-objets de 1.
C’est la même chose qu’étudier les valeurs logiques d’un topos, éléments d’un topos, et d’étudier les sous-objets de 1.
Or, dans le cas des sous-objets de 1, on peut sans peine introduire la machinerie de l’ordre.
Il en résulte qu’une pièce centrale de l’investigation logico-ontologique va être l’étude systématique des sous-objets de 1, médiation des éléments de C, c’est-à-dire des valeurs logiques d’un topos. Nous rendons lisible une connexion logico-ontologique.
Le point intéressant est le suivant :
Quels sont les sous-objets de 1 ? 1, c’est l’objet terminal. Il a exactement autant de sous-objets qu’il y a de valeurs logiques dans le topos. On peut donc dire que l’objet 1 -comme objet singulier, sa position est terminale, c’est une limite -va représenter en immanence, c’est-à-dire par ses sous-objets, la logique du topos. Cependant que l’objet central le représente par ses éléments.
On passe donc d’une assignation élémentaire à une assignation inclusive -sous-objet de 1 -, comme si on procédait à un épaississement. Dans l’ontologie ensembliste, en règle générale, l’appartenance n’est pas une relation d’ordre, c’est l’inclusion qui l’est.
On se livre à une circulation du logique à l’ontologique qui reste interne au topos. Finalement, la séquence qui s’ouvre, c’est l’étude de l’ordre sur les sous-objets de 1, et nous allons établir une algèbre des sous-objets de 1. On va trouver l’ordre, mais aussi le minimum, le maximum, le PPS, le PGI, dans des conditions telles que ça va nous donner la matrice de tout le topos sous la forme des sous-objets de 1.
Le réel du possible logique d’un topos, c’est les sous-objets de 1, comme figure d’immanence extrinsèque qui retrace, inscrit le système général des valeurs du topos et de leur combinaison possible.
L’algèbre de 1 va exactement donner le poids d’être du possible logique, son lestage objectal. Plus le topos a de nuances logiques, plus 1 a de sous-objets, plus son immanence est saturée.
IV
La logique c’est ce qui traite de la question formelle du vrai et du faux, mais pas seulement. On dira que, dans son intention générale, la logique c’est une assignation de valeur aux énoncés. Et naturellement, l’étude des conditions de cette assignation, de ses résultats, des différentes manières de procéder à cette assignation... Mais, en fin de compte, la logique c’est ce qui se pose la question : à quelle condition formelle doit obéir un énoncé pour se voir attribuer une valeur ?
Et finalement, c’est au lieu de la distribution des valeurs que la question de l’ordre est engagée. La puissance valorisante de la valeur est toujours différenciante, et en même temps, établit en effet un système d’ordre, de partition, de subordination, de hiérarchie, de dépendance ... des énoncés. Finalement, on peut dire que la question de l’ordre, de la structure d’ordre, surgit en jointure entre logique et ontologique sous la forme d’une donation de valeurs aux énoncés. Évidemment, cette donation de valeur doit elle-même être ontologiquement fondée, d’une manière ou d’une autre.
Ceci va donner une torsion assez complexe, proprement philosophique, qu’on peut décrire ainsi :
Toute ontologie, tout propos sur l’être, est plus ou moins situable dans un domaine d’ordre, lui-même présenté comme logique. Toute décision ontologique prescrit une logique et s’y inscrit en même temps. Mais en même temps, toute ontologie -et c’est ça la torsion -doit localiser la valeur comme saisissable, ou pensable, dans son être. Donc, toute décision ontologique va apparaître comme à la fois constituante, et inscrite dans, une domanialité ordonnée qui sous-tend un problème de valorisation des énoncés, mais aussi et en même temps, ce domaine de valorisation, ou la question de la valeur en général, va devoir être ressaisi par le propos sur l’être, sous la question : quel est l’être de la valeur ?
Le point c’est que la question de l’être de la valeur se pose ontologiquement à partir de ce qui n’a pas de valeur, de ce qui est en-decà du procès de valorisation. Pourquoi ? Parce qu’aucune ontologie ne reconnaît l’antécédence de la logique. Elle constitue dans ses propres décisions une domanialité logique, mais elle n’a pas pour thèse qu’il y a une logique antérieure à cette décision. Il y a toujours, dans toute ontologie, un primat organique des décisions sur l’être. Si ces décisions apparaissent comme constituant le champ de valorisation, va surgir de l’intérieur de l’ontologie la question de l’être de cette valorisation, et évidemment la question de l’être de cette valorisation doit être réglée sans présupposés de valeur.
Je donne le schéma avant de le réexpliciter dans des exemples, et en faisant une terminologie un peu heideggerienne : l’institution de la question de l’être déploie nécessairement, dans son ordre propre, un champ d’ordre qui est aussi bien un champ de valorisation -toute décision ontologique véhicule, ou charrie, en tant que proposition d’univers, certaines figures logiques. Donc, la question de l’être va instituer un champ de valeurs, ou de valorisations, mais elle va en même temps être tenue dans son déploiement de rendre raison de la valeur -et donc de l’ordre aussi -sans présupposer son antécédence. Donc, elle va être tenue de procéder à une investigation du champ d’ordre, à partir de ce qui n’est pas elle -le sans-valeur. Cela, c’est le mouvement de torsion. Il y a un ressaisissement inévitable de la question de la valeur, à partir du point de ce qui est sans valeur dans le mouvement par lequel l’ontologie se conjoint à la logique.
Alors qu’à rebours, une logique, supposée isolée, va traiter intrinsèquement de la question de l’ordre et de la valorisation.
Si on prend les choses dans un vocabulaire plus simple, et plus près des topos, on dira que ça se poserait ainsi : est-ce qu’il y a de la logique parce qu’il y a un univers, ou est-ce que le il y a de l’univers répond nécessairement à une conformité logique ? Est-ce que la logique est une condition d’univers, ou est-ce qu’elle est un effet d’univers, en réalité ?
Univers : une quelconque proposition concernant l’être. Par exemple, si on dit : le il y a mathématique, c’est la théorie des ensembles, la théorie des ensembles fonctionne comme une proposition d’univers. Plus généralement, si on dit : l’être n’est rien d’autre que l’histoire de l’être, et l’histoire de l’être se laisse voir dans le système successif de ses figures, aussi bien ontologiquement que phénoménologiquement, c’est une proposition d’univers. Ou si on dit : l’univers c’est ce que fulgure Dieu comme meilleur des univers possibles contenu dans son entendement infini, c’est aussi une proposition d’univers.
Dans toutes ces propositions, la question est de savoir si elles obéissent à un régime logique saisissable en lui-même, ou si, en réalité, le régime logique est ce qui apparaît dans l’univers comme simple nécessité de sa consistance. En réalité, toute ontologie est en torsion sur ce point. Elle déploie la logique comme une condition immanente, et cette condition immanente doit elle-même être ressaisie comme conditionnée et non plus comme conditionnante.
La question de l’ordre est en jointure de la torsion. C’est le centre de la torsion, autour de la question de la nécessité ou de la contingence de l’ordre. Il y a un ordre. Mais est-ce qu’en fait, on appelle ordre la consistance de ce qu’il y a -est-ce que nous extrayons le principe d’ordre de la consistance de ce qu’il y a -, ou est-ce que ce qu’il y a obéit en effet à un ordre, à un ordre qui serait appréhendable dans une antécédence abstraite ?
Si on dit : il y a deux types d’univers, les univers où la logique est classique, et les univers où la logique est non-classique, on verra bien qu’on ne peut pas tirer de choix de la simple considération des logiques en elles-mêmes. Finalement, c’est de l’examen des univers possibles que s’induit l’option logique. Et en même temps, l’option logique est omniprésente dans l’univers. Et donc, la question de savoir si le il y a est logiquement conditionné, ou si le il y a est ce à partir de quoi se pense tout ordonnancement, et tout principe d’ordre, est une des grandes questions de la philosophie. L’ordre de l’être est-il autre chose que la simple lisibilité de l’être ?
Par exemple, pour Leibniz, l’univers réel obéit à un calcul séparable. Il y a une antécédence de la valorisation. C’est exactement ce qu’exprime le fait que le monde est le meilleur des mondes possibles. Il est, en tant qu’il est le meilleur des mondes possibles. Et la polémique voltairienne qui consiste à dire : je constate qu’il n’est pas fameux, ce meilleur des mondes possibles, manque sa cible, parce que la question n’est pas de savoir si, dans l’ordre de l’expérience, il comporte du bon ou du mauvais. Le point est un point d’être, c’est le rapport de l’être et de l’ordre. Pour Leibniz, c’est un principe que ce qu’il y a est en tant que c’est l’effectuation d’une norme, et en fin de compte d’un calcul divin, de maximum. Donc, là c’est clair. La fulguration divine du monde se laisse conditionner par un calcul mathématico-logique qui existe, en quelque sorte, par soi-même, et dont le il y a n’est que conditionné.
On pourrait montrer que l’hypothèse hégélienne est inverse. C’est le déploiement de ce qu’il y a qui produit historialement sa logique d’évaluation et son ordre propre. C’est absolument impossible de séparer cet ordre de son historicité effective. Hegel dira que l’histoire du monde est aussi et en même temps le tribunal du monde. Ce qui veut dire que l’historicité du il y a est une seule et même chose que son évaluation. Le devenir historique du monde est co-extensif au principe d’évaluation, c’est-à-dire au principe d’ordre. Le il y a n’est rien d’autre, pour Hegel, que l’historicité de l’ordre.
Donc, la question dont nous nous occupons, dans ses traits formels, qui est ontologie/logique/principe d’ordre travaille la philosophie au point précis de ce qu’on pourrait appeler la séparabilité de l’ordre. Est-ce que le principe d’ordre de l’être est séparable pour la pensée ? Cette séparabilité, c’est exactement la question de l’autonomie de la logique. Il y a autonomie de la logique pour autant que le principe d’ordre est séparable pour la pensée du il y a, en tant que le il y a obéit, ou est dans l’espace de ce principe d’ordre, et donc où il est évaluable.
Par exemple, pour Leibniz, il n’est pas vrai que l’histoire du monde soit le tribunal du monde. Le monde est, tout simplement, le meilleur des mondes possibles, et le seul tribunal, c’est le calcul divin qui examine, dans le système des mondes possibles, quel est le meilleur possible. Parce que, pour Leibniz, il y a une séparabilité, au moins virtuelle, du principe d’ordre, comme principe de maximalité. Donc, il n’est pas étonnant que Leibniz soit à l’origine des courants, y compris modernes, qui ont tenté de s’engager dans une séparation et une formalisation de la logique, comme discipline autonome. Parce qu’ontologiquement, c’était bien son mode de ressaisissement. Lui, ressaisissait le principe d’ordre dans l’élément d’une autonomisation divine de la logique.
A l’inverse, pour Hegel, il n’y a aucune séparabilité de la logique, et d’ailleurs, ce qu’il décrit sous le nom de logique, c’est directement la structure de l’être. Il n’y a aucune séparabilité possible entre la logique comme telle et la structure de l’être qui est l’élément de l’idée absolue.
Un propos central de toute philosophie, c’est comment elle tente de ressaisir la logique, c’est-à-dire le principe d’ordre et d’évaluation, dans l’élément de sa proposition sur l’être. C’est ce ressaisissement que j’appelle la figure en torsion par laquelle toute philosophie noue en elle-même, autour de la question de l’ordre, la question de l’être d’une part, et la question de la logique d’autre part.
Je voudrais, pour rendre tout cela moins abstrait, prendre trois exemples qui sont successivement l’exemple de Parménide, l’exemple de Nietzsche, et l’exemple de Heidegger. Dans tous les cas, ce que je vais tenter de ponctuer, c’est à la fois la manière dont est constitué le champ d’ordre, c’est-à-dire la question de la valorisation des énoncés -premier temps -, et -deuxième temps -, comment cette question du champ d’évaluation est ressaisie à partir de ce qui n’a pas de valeur, à partir de la question de l’être elle-même, antérieurement à l’inévitable institution d’un champ de valorisation.
1) Considérons les éléments du Poème de Parménide -dans la première traduction de Jean Beaufret-. Je prends le fragment 2 :
«Eh bien donc je vais parler -toi, écoute mes
paroles et retiens-les -je vais te dire quelles sont les deux seules voies
de recherche à concevoir : la première -comment il est et qu’il n’est
pas possible qu’il ne soit pas -est le chemin auquel se fier -car il
suit la Vérité -. La seconde, à savoir qu’il n’est pas et que le non-être est
nécessaire, cette voie, je te le dis, n’est qu’un sentier où ne se trouve
absolument rien à quoi se fier. Car on ne peut ni connaître ce qui n’est
pas -il n’y a pas là d’issue possible -, ni l’énoncer en une parole.»
On peut dire que ce passage véhicule la valorisation, c’est-à-dire l’institution d’un champ d’ordre et de valeur, d’au moins trois façons. On reconnaît la stylistique du moment de la valorisation dans un dispositif ontologique quel qu’il soit.
• Premier mode : C’est l’instance de l’impératif. L’impératif est, si je puis dire, le régime d’énonciation de la valorisation : «toi, écoute mes paroles et retiens-les ». Quand on dit «toi, écoute mes paroles et retiens-les », c’est que ce qui va être dit est de l’ordre, si je puis dire, d’un ordre. Le caractère en impératif de l’énonciation est, en réalité, la subjectivité du caractère en ordre et en valorisation de l’énoncé. Cela, c’est le premier point : la tonalité impérative du moment où la décision sur l’être prescrit son ordre.
• La deuxième figure du moment de la valorisation, dans ce passage, est l’assertion selon laquelle il n’y a que deux voies. Cela, c’est la prescription de ceci qu’en dernier ressort, la valorisation est liée au deux. C’est l’énoncé le plus brutal, mais le plus originaire du principe du tiers exclu. Ou bien l’être est, cela c’est la voie royale ; ou bien l’être n’est pas, c’est l’autre voie, le petit sentier, où il n’y a rien à quoi se fier.
Ce qui nous importe, c’est que nous avons là la fixation du champ de valorisation sous le régime du deux. On dira que c’est la proposition ontologique d’une logique bi-valente, classique. C’est peut-être là l’acte de fondation philosophique de l’énoncé constituant de la logique classique.
• Le troisième point , c’est évidemment que c’est bien un ordre, et pas seulement une différence, parce qu’une voie est supérieure à l’autre. L’une est excellente et l’autre est déplorable. Donc, c’est bien un procès de valorisation. A l’énoncé l’être est est attachée une valeur extrême, tandis qu’à l’énoncé l’être n’est pas est attaché un discrédit. Comme le dit Parménide, c’est «un sentier où ne se trouve absolument rien à quoi se fier». Un sentier de brigands. La métaphorique de Parménide est typiquement destinée à inscrire ce temps ultime de la constitution d’un champ de valorisation qui est que c’est vraiment un ordre.
Ces trois points -la tonalité subjective de l’impératif, la fixation de la différence, la connotation de la hiérarchie -, c’est ce que j’appelle le moment en acte où une proposition s’installe dans le champ de valorisation qu’elle institue nécessairement. Si on raisonne quelques siècles après, on dira que l’ontologie parménidienne prescrit absolument une logique bivalente classique.
Mais ce n’est pas le tout de la chose, parce que la tension, dès Parménide, va tenter de ressaisir cette prescription d’ordre à partir du point où elle n’est pas encore constituée. Le temps de l’impératif est inéluctable, mais il doit toujours être ressaisi du point où la décision sur l’être n’est pas captive de cet impératif. Et du point où il apparaît que cet impératif lui-même n’est pas extérieur à la décision sur l’être, n’est pas un transcendantal pour cette décision, -ce que la forme d’impératif pourrait laisser penser : on ne peut pas penser logiquement autrement qu’ainsi. Or, ce n’est pas la tension philosophique, ici parménidienne. En dernier ressort, il faut ressaisir tout ceci dans l’élément primordial qui est l’assertion fondamentale que l’être est un, qu’il n’y a que l’être. Mais il n’y a que l’être n’est pas du tout transitif à une logique préconstituée. C’est au contraire la logique, y compris dans sa modalité impérative, qui doit être tenue dans cet énoncé fondateur. Cela, c’est ce que j’appelle le temps de la torsion, ou du ressaisissement. En particulier, il faut qu’il y ait une théorie de la mauvaise voie. Ce qui est tout autre chose que sa condamnation. Le procès de valorisation doit être ressaisi de telle sorte qu’on puisse penser la mauvaise voie dans son être, si elle en a un, et pas seulement dans sa condamnation.
Cette question, en philosophie, a des résonances considérables. Pour vous en donner un analogue immédiat, c’est absolument aussi la question du Sophiste de Platon, dans les termes suivants : le sophiste est l’autre du philosophe. Parlant comme Parménide, Platon pourrait dire : il y a deux voies, la voie de la philosophie et la voie de la sophistique, finalement il n’y en a pas d’autre, et la voie du philosophe est la bonne et la voie du sophiste est la mauvaise. Seulement, le problème est finalement de penser l’être du sophiste. C’est pour ça qu’il y a un autre Platon que le Platon des dialogues aporétiques, des dialogues où on polémique, dans l’opinion, de façon déstabilisatrice, sur cette question, pour que les gens viennent au moins au point où ils voient qu’il y a deux voies. Cela n’est que le temps premier. Le temps second, c’est le temps du ressaisissement où il faut montrer que finalement la voie sophistique se laisse comprendre du point de la bonne voie elle-même, et pas simplement comme son autre condamné. Et il va donc falloir monter un appareillage spécifique, homogène à la philosophie dans le cas de Platon, et où on ressaisit le sophiste dans son être possible, et pas seulement dans sa malfaisance. Que doit être l’être pour que le sophiste soit possible ? C’est une tout autre question que déclarer que dans l’ordre de la valorisation, le philosophe est supérieur au sophiste.
Si on revient à Parménide, nous avons des lambeaux. On voit très bien comment la question se formule. La voie du non-être, dont le fragment 2 prononce qu’elle est la seule avec la voie de l’être, mais qu’elle est une voie déplorable, il va falloir quant même en rendre compte : quel est le principe d’être de la voie du non-être ? Comment de l’intérieur de l’affirmation : l’être est , on peut comprendre qu’existe, à titre de voie dévaluée, l’orientation selon laquelle l’être n’est pas. Nous n’avons certainement pas l’argumentation complète de Parménide là-dessus, il n’y en avait peut-être pas, mais il y a une tentative incontestable, par exemple dans le fragment 9 -pour donner une idée du point de tension à laquelle on parvient :
«Mais puisque tout a été nommé lumière et nuit, et ceci
par des noms attachés à telles ou telles choses suivant leurs puissances
respectives, tout est plein à la fois de lumière et de nuit sans lumière, l’une
et l’autre à égalité, car avec aucune des deux ne va de pair ce qui n’est
rien».
Ceci esquisse ce qui va être la solution de Parménide sur le problème que nous posons. Parménide va soutenir que la deuxième voie, la voie du non-être, confond les différences avec des inexistences. La métaphorique va être : on peut considérer que la nuit est le négatif du jour, de la lumière. On fixe ça dans des noms. On pourra dire : la nuit, c’est l’absence de lumière, comme va le reprendre Parménide «la nuit sans lumière». Il y a lumière et il y a nuit, non pas au sens où il y aurait être et non être, mais tout simplement au sens de deux régimes de l’être : «tout est plein à la fois de lumière et de nuit sans lumière, l’une et l’autre à égalité» , cela veut dire à égalité ontologique. N’allons pas, à raison de couplages nominaux qui font apparaître de pseudaux contraires, nous représenter la nuit comme quelque chose de négatif au regard du jour ; la nuit, quoique dite sans lumière, est tout aussi positive et pleine d’être que le jour avec lumière. Parce qu’ «avec aucune des deux ne va de pair ce qui n’est rien». Donc, ce qui n’est rien n’est qu’illégitimement associé, par exemple, à la nuit. La nuit ne doit pas être considérée comme le rien de la lumière, mais comme une figure qualitativement autre de la puissance d’être que celle de la lumière, et puis c’est tout.
Donc, finalement, Parménide va dire : il y a la voie du non-être, parce que les signes, ou les noms, font croire, donnent à croire, qu’il y a de la négation réelle. Comme simplement si quelqu’un dit : la nuit, c’est l’absence de lumière. Et en réalité, il n’y a rien dans la nuit qui ait à être pensé, dans son être, comme absence de lumière ; la nuit est au même degré de puissance que le jour. Elle n’est ni privative, ni négative. Elle est composante de l’un-tout, au même titre que la lumière. Et, par conséquent, encore une fois, la voie du non-être est un sentier nominal, qui n’a pas à être pensé, dans son être, comme une singularité distincte.
Cela, ça va donner quoi ? Cela va dire qu’en fin de compte la voie du non-être est réellement une voie du non-être en ceci qu’elle n’a pas d’être. Parce que c’est exactement comme imaginer que la nuit est en position de dessiner la voie du non-être, alors que, en réalité, elle est dans la voie de l’être, exactement comme l’est la lumière du jour.
Évidemment, la difficulté ultime va être : si la voie du non-être, en réalité, n’a pas d’être, que signifie l’impératif : il y a deux voies ? On va rejaillir sur l’impératif premier, sur le procès de valorisation en termes de il y a deux voies, en se demandant : en réalité, il n’y en a qu’une, puisque si on pense l’autre dans son être, elle se dissipe comme figure pseudo-négative, strictement induite par la maladresse des signes, l’embûche des mots.
Effectivement, c’est ce qui se passe souvent dans les processus de ressaisie ontologique de la logique, qui est le point suivant : quand on la fonde dans l’être, la valorisation, la disposition des valeurs, qui est l’ordre logique, fait apparaître, en son sein propre, une hétéronomie. Cela fait apparaître que là où il y avait plusieurs orientations, plusieurs valeurs, en réalité, il n’y avait pas unité de plans. La valorisation ne constituait pas une unité de plan de l’évaluation.
Si on prend l’exemple de Parménide, on dira que Parménide commence par dire : il y a deux voies pour la pensée ; la voie qui s’en tient strictement au principe l’être est , et la voie qui prétend qu’en un certain sens le non-être est. Ceci est proclamé dans un style de révélation impérative, avec un grand pathos de l’évaluation, une voie fondamentale, et une autre voie dangereuse et méprisable. Ensuite, il faut ressaisir tout ça. On va le ressaisir, dans l’élément qui interroge la voie du non-être, et qui en fait apparaître l’inexistence, en termes d’être. Elle ne se soutient pas à l’être, cette voie. Elle est le non-être d’une voie. Et si, à partir de là, on revient sur l’impératif premier, il y a deux voies, qui est l’impératif de valorisation, il va apparaître qu’il y a hétéronomie : la première et la seconde voie ne sont pas sur le même plan, elles sont décrochées complètement l’une de l’autre. Car la première voie est interne à l’être, elle est dotée de son être propre, tandis que la seconde n’a pas d’être. Elle est un simple effet nominal, sans accrochage de réel ; sans capitonnage sur l’être.
Et donc, sur la question générale de logique et ontologie, on pourra dire : le temps de l’impératif, c’est-à-dire le temps de l’évaluation, qui, encore une fois, est le temps de l’ordre crée un plan d’évaluation -où l’on peut dire : il y en a un qui est supérieur à l’autre -, une structure d’ordre. Et le ressaisissement de la question, c’est-à-dire son réalignement sur la question de l’être, sur la question ontologique, presque toujours rompt l’unité de ce plan, introduit une discordance de plan, qui entre immédiatement en contradiction avec le principe d’ordre apparent que la logique instituait. De sorte qu’on pourrait dire que la torsion, c’est ceci : la question de l’être institue une logique, ne s’avère homogène qu’à un certain type de logique, logique qui va se signaler par le triplet de l’impératif, de la différence et de la hiérarchie, et, en même temps, dans l’après coup de cela, cette logique est défaite.
Cela nous emmène à une idée qui est, à mon avis, caractéristique de la philosophie. On dit toujours que la philosophie, c’est le système, la totalité etc... Si on regarde de près les choses, moi je retiendrai ceci : dans la philosophie, c’est toujours l’ordre qui est en éclipse. C’est-à-dire, c’est toujours lui qui, en fin de compte, ne surgit que pour disparaître. Bien sûr, il y a un ordre, et on peut isoler d’innombrables passages de la philosophie où la tonalité de l’impératif, la prescription de la différence et le goût de la hiérarchie, se manifestent avec éclat. Mais dans le ressaisissement de cela, il y a hétéronomie et rupture du plan, et défection de cet ordre. Si bien qu’il n’est pas vrai qu’en philosophie, les choses se jouent dans l’interstice d’un ordre. Moi, je soutiendrai que c’est l’ordre lui-même qui est interstitiel. Je dirai que l’ordre est l’interstice d’un acte, si formidable soit son bâti.
C’est absolument perceptible, à un niveau matriciel, chez Parménide où, en réalité, la thèse de l’être-un, prise dans sa radicalité nue, ne fonde aucun ordre. La seule chose qu’on peut dire, dans ce cas, de l’être, c’est que l’être est ce qu’il est. Mais être ce qu’on est est proprement ce qui est exclusif de toute position dans un ordre. Donc, l’intuition parménidienne fondatrice ne crée pas un ordre. Cependant, il faut qu’elle se dispose dans un ordre. Parce que, si elle ne se dispose pas dans un ordre, elle est, si je puis dire, inadressée, inargumentable, absolument informe. Donc, elle va disposer un plan d’évaluation, avec, en effet, différences et hiérarchie. Mais comme son intuition essentielle doit ressaisir cette disposition d’ordre, elle va le défaire. Et finalement, ce qui aura été accompli, c’est quoi ? C’est un sujet théorique, appelons-le comme ça, dont l’ordre est la défaillance.
C’est aussi pour ça que la querelle sur le caractère systématique ou non de la philosophie est toujours mal centré. Parce que l’élément du système dans la philosophie est toujours la construction du plan d’évaluation. Elle est inéluctable, d’une manière ou d’une autre, si radicalement existentielle que soit la philosophie, ou si radicalement indicible, comme chez Parménide, mais aussi en un certain sens, chez Wittgenstein. Il y a toujours la construction d’un plan d’ordre, au régime de la différence et de la hiérarchie, qui est une construction systématique. Et, en même temps, il est vrai que cette construction systématique est prise dans une constitution en résiliation. Elle est comme l’éclipse immanente d’autre chose qu’elle-même. Cela se donne dès Parménide. Cela se donne chez Héraclite exactement de la même façon. Et ça court dans toute l’histoire de la philosophie. On pourrait dire que dans une philosophie digne de ce nom, le système, le systématique, est la construction du disparaissant propre de cette philosophie-là. Ce qui subsiste finalement, à prendre l’opération dans son ensemble, c’est le conjointement paradoxal d’un espace et d’un acte ; d’un espace de pensée, et d’un acte de saisie de cette pensée. Ce conjointement ne peut être effectif, et subsister, que si un ordre apparaît et disparaît. Et donc, le système on peut toujours argumenter qu’il est là, on peut aussi toujours argumenter qu’il n’est pas l’essentiel. C’est vrai, mais ce n’est pas le fondement de la chose. Il est absolument vrai que dans toute philosophie, d’un côté il y a systématisme, d’un autre côté, on sent bien que ce n’est pas la forme du système qui retient vraiment ce qui est en jeu dans cette affaire. A mon avis, c’est parce que le système est un terme évanouissant, c’est le terme évanouissant fondamental. Pas en tant que simple construction, mais en tant qu’institution du plan d’ordre. C’est-à-dire, en fin de compte, en tant que logique.
La philosophie, c’est la mise en scène de la disparition de la logique. C’est pour ça qu’elle est toujours citée, déployée, commentée, instruite, construite, systématiquement déployée .... mais en fin de compte ressaisie dans un geste hétéronome qui défait son plan propre.
Déjà dans Parménide, c’est comme ça. Le moment de l’impératif, de la différence et de la hiérarchie, est l’espace d’exposition de la chose, mais quand il est ressaisi du point de la question qui l’anime, il se défait, il devient hétéronome et disjoint.
2) Chez Nietzsche, la question de la valeur est centrale. Deleuze commence son livre sur Nietzsche en disant que l’apport propre de Nietzsche, c’est d’avoir introduit en philosophie les questions de sens et de valeur.
La question de la valeur, chez Nietzsche, c’est très précisément la question de l’évaluation : qui évalue, dans quelle condition, et dans quelle stratégie, qui est l’évaluateur des forces, quelle force a puissance évaluante ...? Ceci organise -dans un plan d’ordre bien connu que je caricature grossièrement -que finalement, il y a des valorisations actives, et des valorisations réactives. Ce qui veut dire finalement qu’il y a des valeurs affirmatives et des valeurs nihilistes, et que c’est bien pour ça qu’on peut se proposer le projet d’un renversement de toutes les valeurs.
Vous voyez à quel point cette idée d’un renversement de toutes les valeurs reste connotée par l’idée d’un espace d’ordre. En fin de compte, c’est changer de sens le signe, déclarer que ce qui était considéré comme plus grand sera considéré comme plus petit, ce qui était déclaré éminent sera considéré comme misérable... C’est donc simplement une inversion du plan d’ordre. Cette inversion, très compliquée dans son acte nietzschéen, renvoie en fin de compte à ceci que le plan d’ordre, c’est la scission de la vie. La vie historialement appréhendée s’organise selon un plan d’ordre, où l’actif et le réactif, l’affirmatif et le nihiliste, se composent et se soutiennent jusqu’aux temps modernes où triomphent les valeurs nihilistes, mais où se prépare le renversement de toutes les valeurs.
Donc, c’est très clair. Chez Nietzsche, le mode propre de la construction du plan d’évaluation se fait, là aussi, selon une dichotomie essentielle, la voie dionysiaque de l’affirmation essentielle, et la voie réactive du prêtre chrétien, et la promesse historiale, c’est le changement de signe de cet espace d’ordre, sa commutation.
On pourrait dire que le dispositif nietzschéen est tout entier consacré à la construction d’un plan d’évaluation des valeurs. Parce qu’après tout, chez Nietzsche, il y a une grande question, c’est : que valent les valeurs ? Pour répondre à cette question, il faut entrer dans la logique de l’évaluation, et pour cela, penser les forces, le dispositif des forces, leur conjointement, leur opposition ...
Le plan de composition de tout ça est nommé la vie, car c’est la vie qui est puissance d’évaluation, aussi bien affirmative, que réactive. Le nihilisme n’est jamais que la vie elle-même travaillant contre elle-même, ce n’est pas un principe externe ; c’est un retournement de la vie sur un espèce d’obstacle singulier qui en a scindé la puissance.
Mais quand Nietzsche ressaisit tout ça, du point de l’affirmation pure, quel est l’énoncé fondamental ? On le trouve dans le Crépuscule des idoles, et ailleurs, c’est : «la valeur de la vie ne saurait être évaluée». Cela, c’est l’exemple type de ce que j’appelais la nécessité de ressaisir le champ d’évaluation lui-même à partir de ce qui n’a pas de valeur. Parce que la vie comme telle, on ne peut pas lui assigner de valeur. La valeur de la vie, c’est justement ce qui ne peut pas être évaluée. C’est donc du point de l’inévaluable vie qu’il va falloir en dernier ressort penser le champ d’ordre et de puissance des valeurs. Or, ce qu’on peut montrer c’est qu’en réalité, là aussi, ce ressaisissement détruit l’unité de plan dans laquelle on procédait à l’analytique de l’évaluation, c’est-à-dire à la description fine ramifiée des grands types de valeurs. Dans l’unité du plan d’ordre, vous pouvez distribuer une typologie de l’évaluation. Or cette typologie, on peut dire que lorsqu’elle est ressaisie du point où la valeur de la vie est, elle, inévaluable, elle se dissout, devient hétéronome, sans unité de plan, non représentable comme telle.
C’est pourquoi, à ce moment-là, au dispositif d’évaluation, Nietzsche va substituer l’acte pur. Il va annoncer le propos de «casser en deux l’histoire du monde», annonce venant au point même où l’unité du plan d’évaluation est insubsistante. Cela, c’est vraiment le moment où l’originarité de la proposition sur l’être, à savoir, chez Nietzsche, de l’être comme vie, revient sur le plan de composition d’ordre où elle s’est par ailleurs entièrement déployée.
Chez Nietzsche, c’est plutôt l’effet ruineux, pour toute logique, de la mise en jeu du point qui n’a pas de valeur, et qui intervient toujours, puisqu’il est attaché à la question de l’être comme telle, avant la disposition de sa configuration valorisante. C’est particulièrement lisible, chez Nietzsche. Quand est remis en jeu le point sans valeur, c’est-à-dire celui qui se résout dans l’affirmation pure, sans contrepartie, l’affirmation de tout ce qu’il y a sans exception, alors la disposition hiérarchique et évaluante de l’ordre se dissémine dans autre chose qu’elle-même.
3) Le troisième exemple, je le prendrai chez Heidegger, plus spécifiquement dans l’Introduction à la métaphysique. Il est intéressant, parce qu’il commence, lui, par une critique intégrale du concept de valeur. Heidegger est celui qui va tenter d’établir la question de l’être dans une soustraction à toute composition d’un plan d’évaluation. C’est la singularité d’Heidegger, et c’est pour ça aussi qu’il s’est représenté comme terminal dans l’histoire de la philosophie. Une des manières de nommer son projet, c’est cela : que la question de l’être puisse se déployer sans avoir à en passer par le moment de l’impératif, de la différence et de la hiérarchie, c’est-à-dire sans avoir à en passer par le moment de la construction du plan de valorisation, ou encore sans avoir à en passer par la figure systématique comme point évanouissant propre du dispositif philosophique.
Dans l’Introduction à la métaphysique, la question des valeurs et de l’évaluation est examinée dans la section qui s’appelle «être et devoir», qui est elle-même prise dans le mouvement par lequel Heidegger essaie de penser ce qu’il appelle la limitation de l’être. Et il apparaît vite que la limitation de l’être, c’est les figures de sa scission. Cela va nous donner être et apparence, être et devenir, être et penser, être et devoir. C’est la scission entre être et devoir, être et devoir-être, qui va donner lieu à l’examen de la question des valeurs.
Entre autre chose, il s’en prend rigoureusement à Nietzsche, précisément. Heidegger écrit ceci : «C’est pour s’être empêtré dans la confusion du concept de valeur, et n’avoir pas compris que son origine faisait question, que Nietzsche n’a pas atteint le centre véritable de la philosophie». Aux yeux d’Heidegger, si Nietzsche n’a pas atteint le centre de la philosophie, c’est parce qu’il est resté dans la nécessité de la construction d’un plan d’évaluation, c’est-à-dire en réalité, dans le moment logique. Il n’a pas su soustraire la question de l’être à sa figure logique, qui, dans l’instance de l’ordre, se propose comme instance de l’évaluation.
Sur les valeurs, voilà ce qu’il dit : «En 1928, il
apparut une bibliographie du concept de valeur, première partie. On y cite 661
publications sur le concept de valeur. Il est probable qu’on a maintenant
atteint le millier. Voilà ce qu’on nomme philosophie...». Heidegger se laisse aller là à une grande violence.
La valeur, c’est le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne lui accorde pas
grande valeur, autre que bibliothécaire. Ce qui est plus intéressant pour nous,
c’est qu’il va s’en prendre à une variante du nazisme sous cette rubrique. Et
puis, il continue comme ça : «Et en particulier, ce qui est mis
sur le marché aujourd’hui comme philosophie du national-socialisme, et qui n’a
rien à voir avec la vérité et la grandeur internes de ce mouvement,
c’est-à-dire avec la rencontre, la correspondance entre la technique déterminée
planétairement et l’homme moderne, la valeur, les valeurs. Ça fait, ça pêche en
eaux troubles dans ces "valeurs", et ces "totalités"».
Deux remarques :
- Il est bien confirmé que le propos de Heidegger, c’est de se soustraire absolument à la problématique de la valeur.
- Cette problématique de la valeur est épinglée à la fois à Nietzsche et au mauvais national-socialisme.
- Le bon national-socialisme, c’est la rencontre entre la technique, déterminée planétairement, et l’homme moderne, avec ce point, qui est tout-à-fait important à noter, qu’une rencontre, ou une correspondance, c’est justement ce qui ne relève pas d’une évaluation, ce qui n’est pas sous la règle d’une valeur. Autrement dit, la vérité et la grandeur du national-socialisme, pour Heidegger, ça n’est pas qu’il a valeur, qu’il est évaluable selon une valeur, c’est qu’il est le pur office historial d’une rencontre, entre l’être-au-monde de l’homme moderne, et la technique déterminée planétairement, parvenue au comble de la figure nihiliste elle-même.
On peut donc dire vraiment que le premier but de Heidegger, à cette époque-là, non seulement, si je puis dire, son but spéculatif et philosophique, mais son but politique, qui est un but d’épuration du nazisme de son versant valorisant, son but est bien de soustraire la philosophie au temps valorisant, c’est-à-dire à la constitution du plan d’évaluation dont il pense que Nietzsche en est resté encore prisonnier, et que c’est pour ça que, finalement, ça s’est perdu et ça n’a pas abouti.
(Heidegger pense que cette soustraction était déjà vivante chez Parménide, et Héraclite, et que c’est à cause de Platon qu’on est tombé là-dedans. En réalité, je pense que c’est absolument présent chez Héraclite et Parménide. Je pense qu’il n’y a pas de figure pré-socratique pré-soustraite à la composition du plan logique, dans la philosophie).
Ce qui est déterminant, c’est que Heidegger voit parfaitement que ce qui est en jeu dans cette soustraction à l’évaluation et à la philosophie des valeurs, dont il dit que c’est devenu une histoire d’opinions vulgaires, c’est la question de la logique. La question fondamentale sous-jacente à la question de la valeur, c’est bien la question de l’ordre, comme suture entre propositions sur l’être d’un côté, et logique de l’autre. De sorte qu’on pourra aussi bien dire que le but de Heidegger, c’est de soustraire la question de l’être à toute prescription logique.
Il va, par exemple, le dire ainsi : «Les valeurs en
soi deviennent maintenant le fondement du devoir. Or, comme les valeurs
s’opposent à l’être de l’étant, c’est-à-dire ici à l’être des faits,
elles-mêmes de leur côté ne peuvent pas être, et donc elles valent. Les valeurs
sont, pour toutes les régions de l’étant, c’est-à-dire du subsistant, ce qui
donne la mesure. L’histoire n’est rien d’autre que la réalisation de valeurs». Il enchaîne tout de suite : «Platon a
conçu l’être comme Idée. L’Idée est modèle, et à ce titre, donne mesure. Il est
alors tentant de comprendre les Idées platoniciennes comme des valeurs, et d’interpréter
l’être de l’étant à partir de ce qui vaut».
Ce passage, dans la discussion que nous avons, est tout-à-fait central. L’argumentation de Heidegger est la suivante : si on pense qu’il y a un univers de valeurs, y compris sous la figure de l’Idée platonicienne, déjà sous la figure de l’Idée platonicienne, de la valeur comme ce qui donne mesure à l’être -et en effet, la valeur, c’est ce qui est assigné aux énoncés, y compris les énoncés sur l’être -, si on s’installe là, alors on va être obligé de penser que les valeurs ne sont pas.
Nous retrouvons ici la chicane parménidienne...
...Cela veut dire qu’on met la logique au-dessus de l’être, et que donc la logique va devenir une espèce de prescription séparable. Elle va valoir pour l’être. C’est cela le séparable, que la logique puisse valoir pour l’être. Et ce faisant, on va complètement perdre la question de l’être, parce qu’on va en faire une question subordonnée, asservie, à la séparabilité de la logique. Et ça commence avec Platon, parce que Platon esquisse dans l’être même le geste de la séparation. En pensant l’être comme Idée, il sépare déjà l’être de lui-même. Il le logicise dans un geste séparateur.
Un autre passage qui complète cette orientation : «Depuis
quand la logique existe-t-elle donc, cette logique qui, aujourd’hui encore,
gouverne notre pensée et notre dire, et contribue à déterminer essentiellement,
dès le début, la conception grammaticale de la langue, et par suite, la
position fondamentale de l’occident quant au langage ? ».
Cela, c’est très important. Nous retrouvons l’idée que comme la logique est assignation de valeur aux énoncés, elle est ce qui prescrit, au moins depuis Aristote, le rapport de l’occident au langage. Et c’est à ce rapport de l’occident au langage que la question de l’être va se trouver asservie comme à une entité séparable.
«A quel moment commence la formation de la logique ?...» Alors, après, Heidegger va essayer de laver les Grecs, quant même, du soupçon d’avoir inventé cette diabolique séparation. «Au moment, dit-il, où la philosophie grecque touche à sa fin, et devient une affaire d’école, d’organisation et de technique, quand l’être de l’étant apparaît comme idée[12], et à ce titre devient objet ou (?). La logique est née dans les perspectives du fonctionnement scolastique des écoles platoniciennes et aristotéliciennes. Elle est une invention des maîtres d’école et non point des philosophes, et lorsque les philosophies s’en sont emparés, ce fut toujours...» Pourquoi Heidegger en vient-il à dire que la logique est une invention des maîtres d’école et pas des philosophes ? Si Heidegger dit cela, c’est précisément parce que pour lui, on n’atteint le centre de la philosophie que si on fait l’économie de son moment logique. C’est exactement ça. Pour Heidegger, par conséquent, un authentique philosophe doit être quelqu’un qui n’a rien à voir avec l’invention de la logique. L’invention de la logique, c’est un parasitisme décadent de l’originarité, c’est pour ça que c’est un maître d’école.
En fin de compte, tout cela situe le projet heideggerien dans la tentative d’une désarticulation du logique et de l’ontologique. Désarticulation qui se ferait au profit de la question de l’être restituée à elle-même, purement restituée à elle-même.
La possibilité de cela va instituer un ordre de questions qu’on peut situer ainsi : comment se fait-il qu’il y ait eu cet asservissement logique de la question de l’être, question historiale ? Et comment réévaluer la philosophie dans cette désarticulation, dans le propos possible de cette désarticulation entre ontologie et logique ?
Ces deux questions occupent une partie considérable des développements heideggeriens, en réalité, même si c’est loin de la question première.
A la première question, qui est la question : «d’où vient la prescription logique ?», «d’où vient l’asservissement logique ?», va se rattacher finalement tout ce qui concerne le procès du platonisme, comme l’indiquent les quelques textes que je vous ai déjà cités. Plus précisément, on peut dire que ça va se jouer sur la différence entre logos au sens héraclitéen, et logos au sens platonicien. Là, on va voir comment logique devient une prescription de l’occident dans l’oblitération de la question de l’être.
La deuxième question, ça va être : «comment activer à nouveau le non-asservissement, la désoccultation de la question de l’être, sa réouverture ?», et là ça va donner lieu à des polémiques contre la thématique de la valeur -la thématique de la valeur étant l’ultime avatar de la logique -, et puis aussi évidemment la promotion du poème comme étant le lieu où quelque chose de la question de l’être, non captive de la construction du plan d’ordre logique, se donne encore à entendre. Fondamentalement, la valorisation heideggerienne du poème est liée à la conviction que le poème est le lieu de parole le moins logicisé, c’est-à-dire le moins captif de la logique comme instance séparable et en même temps asservissante.
Deux remarques conclusives. Ce qu’on peut objecter à Heidegger, c’est trois choses :
1) Il ne voit pas qu’il n’est pas vrai que le statut de la logique, dans la philosophie, soit celui de la séparabilité et de l’asservissement. Il est celui d’un point évanouissant, donc en un certain sens, tout le contraire. D’un point évanouissant, d’où se constitue le sujet de l’acte philosophique, et la disparition de ce point livre nécessairement la philosophie à autre chose qu’à elle-même. Je suis convaincu que le fait que, dans le dispositif de la philosophie, l’élément logique, c’est-à-dire l’élément de la valeur, de l’évaluation, de l’ordre, de la différence... soit en figure de point évanouissant, est proprement ce qui identifie la philosophie dans l’autonomie de son acte. Si ce point vient lui-même à être résilié, si on évanouit l’évanouissement du logique dans la philosophie, on livre la philosophie à autre chose qu’elle-même. On peut la livrer au national-socialisme, on peut la livrer au poème, mais de toute façon, on la livre à autre chose qu’elle-même.
Il faut donc maintenir, comme identité interne, l’articulation de l’ontologie et de la logique.
2) Il n’est pas vrai qu’il y ait une origine pure. Il n’est pas vrai que chez Parménide, Héraclite, ou les Grecs, ou les Grecs tels que les Allemands les rêvent, il n’est pas vrai qu’il y ait chez eux la question de l’être sans construction d’un plan logique. Je tenais à le montrer chez Parménide. La naissance de la philosophie, fût-ce sa naissance ambigüe et pré-socratique, fait déjà apparaître le terme évanouissant dont je parle.
Et donc toute cette histoire de l’origine pure, de la rature platonicienne, de l’oubli originel de la question, précisément par sa logicisation... tout cela est un montage historial, en dernier ressort inconsistant.
3) Le propos, qui se veut chez Heidegger particulièrement radical, de soustraire la question de l’être à la composition du plan dévaluation, à la figure de l’ordre et de la logique, rend impossible la situation de la philosophie par rapport à la politique. J’entends par là une doctrine minimale de son écart et de sa proximité.
Et cela, pourquoi ? Parce que si vous absentez la construction du plan d’ordre comme plan logique, vous libérez nécessairement de l’intérieur de la philosophie ce que j’appellerai un ordre sauvage. Parce que la philosophie ne peut pas évacuer la construction du plan d’ordre. Elle peut, comme Heidegger, avoir le projet de ne pas le faire, mais dans son effectivité elle le fait toujours. Et si cet ordre n’est pas pris dans la question de la logique, même au sens large, et en fin de compte pris aussi, plus ou moins, sous la condition des mathématiques en bien des sens différents, alors ce qui vient là est un ordre sauvage. C’est-à-dire un plan d’évaluation non normé, non réglé, mais qui n’en est pas moins un plan d’évaluation, et qui est le plus souvent une pure dictée, une pure transcription idéologique.
A la fin des fins, on n’aura peut-être pas la logique comme oblitération platonicienne sous la figure de l’idée de la question de l’être dans sa transparence inaugurale, mais comme on aura la race, le sang et la terre... on ne sera pas très avancé. Et pourquoi on a ça, fût-ce un temps ? Parce que c’est typiquement un plan d’évaluation, un principe d’ordre. Or, c’est cela que j’appelle un ordre sauvage. Dans le moment où la médiation logique n’est pas explicitement bâtie comme terme évanouissant, avec un certain type d’humilité laborieuse que ça implique, ne serait-ce que dans l’acceptation, par exemple, du voisinage de la philosophie et des sciences, de choses comme ça, ce qu’on va avoir c’est un ordre nommé dans sa particularité sauvage, qui va venir là dans un espèce de diktamen politique conjoncturel.
Là où la logique s’absente, ce qui vient à valoir parce que quelque chose doit venir, ce sont des métaphores de la politique barbare. Je ne dis pas la politique barbare elle-même, ce serait un autre procès, mais certainement des métaphores de la politique barbare. Et cela, c’est sans exception.
Pour revenir au topos, qu’est-ce qu’un topos, et pourquoi ça nous intéresse au regard de tout ça ?
Un topos va intégrer la localisation de la logique à une proposition d’univers possible. Le topos va donc nous donner, en mathème, la forme générale de l’articulation logico-ontologique. Et il va le faire, à partir et autour, d’un principe d’ordre.
Compte-tenu de ce qu’est le génie propre de la théorie des catégories, la structure d’ordre ne va pas être donnée d’abord sur les objets. Ce qui compte dans la pensée catégorielle, ce sont les liaisons d’objets et pas les objets.
Une partie de ce qui va être dit maintenant commence dans le fascicule dans l’extrême bas de la page 101, 102 et suivantes.
La difficulté, c’est qu’à l’évidence, une catégorie, et a fortiori un topos, se présente dans son concept général comme un réseau d’actions, qui n’a pas, à proprement parler, de structure globale. En tant que proposition d’univers, un topos n’est pas donné par un ordonnancement global. Donc, la question de l’ordre va d’abord être abordée localement. Comment peut-il y avoir un réseau d’ordre centré ? Autour d’un objet ? Dans les entours actifs d’un objet, peut-on présenter une figure d’ordre ?
Le principe local qu’on va adopter, c’est d’examiner l’ordre au regard de flèches qui ont la même cible, qui sont centrées sur un objet.
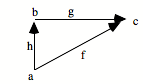
On va tisser un réseau d’ordre à partir de cette matrice élémentaire.
Si les objets a et b sont non reliés entre eux, il n’y a pas de raison de penser qu’il y ait une relation d’ordre entre les deux flèches. Pour une raison évidente, c’est que si a et b ne sont pas reliés, il y a une sorte d’indépendance de f et g. Ce sont deux flèches qui jouent pour leur propre compte. Il est vrai qu’elles ont la même cible, mais comme là d’où elles viennent, ce sont des objets sans corrélation entre eux, on ne voit pas pourquoi il y aurait une structuration véritable du rapport de f et de g. Donc si a et b ne sont pas reliés, on peut exclure qu’il y ait sens à s’engager dans la recherche d’un ordre entre f et g.
Ceci est tout-à-fait conforme à la pensée catégorielle. Il y a des choses indifférentes les unes aux autres dans un univers catégoriel. Il y a des objets non reliés. Il peut y avoir des objets complètement isolés...
On supposera donc que a et b sont reliés.
Maintenant, de quel principe disposons-nous qui permette une structuration élémentaire ? La solution est assez simple. Notre seul et unique principe de structuration, c’est la commutation. Nous n’avons rien d’autre.
g![]() h = f
h = f
On posera alors que f ≤ g
Autrement dit, étant données deux flèches de même cible, f
est inférieure ou égale à g, si il existe une flèche h qui est telle que g![]() h = f.
h = f.
Nous avons là défini une relation entre deux flèches de même cible.
Il faut montrer que c’est une relation d’ordre, c’est-à-dire qu’elle est réflexive, transitive, et anti-symétrique. Cf p. 102 et suivantes.
Ce qui va nous intéresser spécifiquement, c’est que cette relation puisse apparaître comme une structuration de l’objet c. Nous retrouvons là un mouvement que nous suivons souvent. Nous traitons des flèches, parce que c’est le matériau fondamental d’un topos, et nous regardons comment cette relation détermine l’identité elle-même. Nous nous posons la question suivante : comment cette relation entre flèches de cible c peut-elle apparaître comme quelque chose qui inscrit quelque chose de c lui-même dans une prescription d’ordre ?
C’est ce que j’appellerai, en pensée de type catégoriel, l’objectivation. C’est un mouvement fondamental, aller de l’extrinsèque à l’intrinsèque.
Nous allons pour cela nous intéresser aux flèches, non pas en général de cible c, mais aux flèches qui déterminent des sous-objets de c. Fondamentalement, un sous-objet de c est un monomorphisme de cible c. Un monomorphisme de cible c, ça se détermine comme une quasi-immanence de c, au sens où ça inscrit une différence dans c.
Si nous voulons manier notre structure d’ordre de manière objectivante, on va considérer les flèches de cible c, non pas de manière générale, mais plus spécifiquement les monomorphismes de cible c.
Lorsque nous envisageons des monomorphismes de cible c, nous sommes dans l’objectivation, parce qu’un monomorphisme de cible c est une détermination de c, au sens où ça y singularise un protocole de différenciation. C’est un remplissement extrinsèque de lettre vide. Nous allons donc passer à l’idée d’un ordre sur les sous-objets d’un objet déterminé. C’est là que va s’accomplir notre programme local. La relation va être exactement la même.
Je voudrais faire un certain nombre de remarques de portée philosophique plus grande.
Nous avons donc là une relation d’ordre applicable aux sous-objets d’un objet déterminé dans un topos. Mais où ça va se conjoindre à la question de la logique -qui est la question qui nous intéresse -? L’idée est évidemment de renvoyer tout ça à l’objet central.
L’objet central d’un topos est proprement le lieu des valeurs d’un topos. Une valeur, dans un topos, est un élément de l’objet central. Un élément de l’objet central est une flèche qui a 1 comme source, et l’objet central comme cible. Si le topos n’est pas dégénéré, il existe au moins deux éléments de c, le vrai et le faux, et par conséquent, au moins deux valeurs.
L’intérêt extrême de ce genre de présentation, c’est qu’il n’y a aucune espèce de transcendance de la valeur. La territorialité évaluante de la logique est absolument immanente.
On pourrait donc avoir une idée de jointure tout-à-fait simple qui serait : étudions l’ordre sur les valeurs. On accomplirait le programme consistant à lier la question de l’ordre et la question des valeurs.
Ce qu’on peut simplement remarquer, c’est qu’avec ce qu’on a dit là, ça ne va pas être très commode pour la raison suivante :
Prenons une valeur qu’on appelle f et une autre valeur qu’on appelle g :
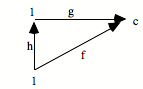
Le problème est qu’il n’y a qu’une flèche de 1 à 1, qui est l’Id(1).
Or : f![]() Id(1) = g
Id(1) = g
f = g
Donc, le seul cas de relation entre f et g possible, c’est l’égalité.
Inversement, si f et g sont différentes, cela veut dire que ça ne commute pas. Et si ça ne commute pas, on n’a pas notre relation d’ordre.
Cela veut dire que deux éléments de l’objet central sont ou identiques, le même, ou incomparables. Donc, il n’y a pas entre eux notre relation d’ordre.
Cela veut dire que les éléments d’un objet, au sens catégoriel, n’entrent pas dans la structure d’ordre. Deux éléments d’un objet restent indépendants les uns des autres.
Si on parle plus spécifiquement de l’objet central, on dira que les valeurs sont incomparables. Cela nous montre bien que l’ordre dont il s’agit est un ordre partiel.
On va prendre un détour qui va utiliser la remarque suivante.
Supposons un monomorphisme de cible 1, c’est-à-dire un sous-objet de 1. Ce monomorphisme, par définition d’un topos, a une centration.
Nous constatons que cette centration est nécessairement une valeur, car c’est un élément de l’objet central.
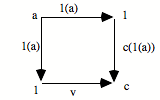
Par conséquent, la centration d’un sous-objet de 1 est nécessairement une valeur.
Inversement, considérons une valeur quelconque, et considérons le pull-back de cette valeur avec la vérité.
C’est une caractéristique d’un topos que ce pull-back existe nécessairement car dans un topos, le pull-back de deux flèches de même cible existe toujours.
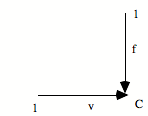
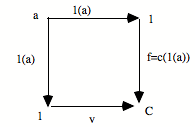
La flèche 1(a) est nécessairement un monomorphisme. Elle est donc un sous-objet de 1. Par conséquent, la flèche valeur f apparaît bien comme la centration d’un sous-objet de 1.
La centration d’un monomorphisme de cible 1 est une valeur, et inversement toute valeur est la centration d’un monomorphisme de cible 1.
On a donc une correspondance exacte, biunivoque, entre valeurs et monomorphismes de cible 1, donc entre valeurs et sous-objets de 1.
Donc, cela revient au même d’étudier la structure des éléments de l’objet central, ou d’étudier la structure des sous-objets de 1. Donc, si la question de l’ordre, avec la définition simple que nous en avons donnée, ne fonctionne pas bien pour les valeurs, parce que deux valeurs sont indépendantes, on va étudier l’ordre sur les sous-objets de 1.
Finalement, cela va nous donner ceci que l’investigation logique d’un topos va largement passer par l’étude des sous-objets de 1, les sous-objets de 1 étant en quelque manière les représentants des valeurs.
C’est cela qui va nous servir de point de départ la prochaine fois, à la fois techniquement et philosophiquement.
Que peut nous évoquer ceci qui est que la logique d’un univers va largement être décrite en étudiant la structure de 1 ? Ça va nous donner l’algèbre des sous-objets de 1.
On va partir de là et on va se poser deux questions :
1) Philosophiquement, est-ce que ça a une consonance ou une résonance quelconque, cette idée que la logique, ça a comme terrain d’exercice la structure de 1 ? Il y a un texte phare : c’est le Parménide de Platon, qui n’est absolument rien d’autre que l’étude de la structure de 1.
Donc, on parlera du Parménide de Platon vu sous cet angle, et on verra que le très vieux Parménide propose très exactement cela : c’est-à-dire de déployer la logique, ce qu’il appelle un exercice dialectique, sur la question de la structure de 1. Évidemment, il aboutit à ce résultat que 1 inconsiste. Nous verrons ce que ça veut dire.
2) D’accord, mais est-ce que le 1 d’un topos, ça a quelque chose à voir avec le Un ? Est-on en droit de dire que c’est le Un ? Il est défini comme objet terminal, il est donc défini positionnellement, ce qui inclut une unicité. Mais est-ce que la définition du 1 comme objet terminal communique avec le thème de l’un, au sens où il en est, par exemple, question dans le Parménide de Platon.
Côté philosophie, que nous suggère l’idée que la logique s’investit par les structures de l’Un, et côté topos, est-on fondé à considérer que l’1 comme objet terminal a à voir avec l’Un philosophique ?
V
Reprise :
1) Il est possible de définir une structure d’ordre partiel sur les sous-objets d’un objet déterminé.
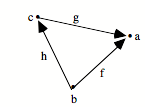
![]()
Si h n’existe pas, on dira que f et g sont incomparables. Donc, l’ordre n’est pas total.
Ceci signifie que les sous-objets d’un objet donné constituent le site[13] d’une relation d’ordre partiel possible, définie.
2) Dans un topos, il y a correspondance biunivoque entre les éléments de l’objet central et les sous-objets de 1.
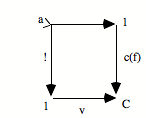
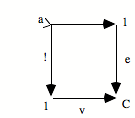
A tout sous-objet de 1 correspond un élément de l’objet central, et inversement, à tout élément de l’objet central correspond un sous-objet de 1.
Il y a donc correspondance terme à terme et complète entre les éléments de l’objet central et les sous-objets de 1.
Quelles que soient les valeurs de vérité d’un topos considéré, il leur correspond autant de sous-objets de 1. Nous avons donc une correspondance entre la structure élémentaire de l’objet central (la structure des valeurs de vérité du topos), et la structure en sous-objets de 1. On peut donc étudier la structure élémentaire de l’objet central en étudiant la structure des sous-objets de 1. En gros, on dira que les sous-objets de 1 sont isomorphes aux valeurs de vérité du topos.
L’avantage est que notre relation d’ordre, elle est efficace pour les sous-objets de 1. Alors que sur des éléments, ça ne donne pas grand chose, puisque deux éléments différents sont incomparables.
|
|
|
Remarque : On utilise très souvent le fait qu’il n’y a qu’une flèche de 1 vers 1. C’est un trait d’unité de 1.
|
Donc : ils sont identiques, ou s’ils ne le sont pas, ils sont incomparables, non reliés par l’ordre. Selon cette relation d’ordre là, les valeurs de vérité de l’objet central demeurent incomparables.
Mais on peut tout-à-fait comparer deux sous-objets de 1. Donc, c’est une commodité opératoire, mais aussi signifiante, que d’entreprendre l’étude des valeurs de vérité sur les sous-objets de 1.
En pensée, ça dit ceci :
La structure des valeurs de vérité, ça va être le cœur de la logique des topos. Là, va se jouer pour l’essentiel la caractérisation de l’univers.
Ex : si l’objet central n’a que deux éléments, ces deux éléments sont le vrai et le faux, et nous aurons un topos bivalent, classique.
Si l’objet central a plus de deux éléments, tout va dépendre des caractéristiques algébriques du rapport entre ces éléments. Grosso modo, ou on aura une algèbre de Boole et le topos sera classique, ou bien ça ne sera pas une algèbre de Boole, ce sera une algèbre de Heyting qui n’est pas une algèbre de Boole, et alors la logique de l’univers sera non-classique, de type intuitionniste.
On peut aussi bien dire que la structure de 1 va commander le type logique de l’univers. De sorte que ce type logique est suspendu à la structure des sous-objets de 1.
Nous retrouvons l’idée que la logique de l’être se joue sur la structure de l’Un. C’est la question parménidienne, qui transite à travers toute l’histoire de la philosophie. L’être, quant à sa logique, est tout entier dans l’Un, pour autant qu’il est dans l’élément d’une prescription logique.
Il est tout-à-fait frappant que la théorie des topos nous le dise dans un montage rationnel transparent.
Ceci renvoie à une question encore plus fondamentale : que signifie que l’Un ait une structure ? Comment l’Un, s’il est vraiment l’Un, s’il est l’archi-transcendance du simple, peut-il avoir une structure ? (Pour ne rien dire de la théologie trinitaire -théorie de la structure en trois de l’Un).
Il y a toujours eu deux voies principales :
• Une orientation qui soutient que l’Un est absolument un, et qu’aucun prédicat structurant ne lui est appropriable. Sa forme ultime est la théologie négative qui pense l’Un au bord du néant : l’Un n’est pensable que selon ce qu’il n’est pas, puisqu’aucun prédicat ne lui est appropriable. Ce qui aboutit à poser que l’Un est au-delà de l’être, dire que «l’Un est» étant équivoque. La thèse est qu’il n’y a pas de structure de l’Un autre que son indiscernabilité ultime au regard du néant, dans cette voie.
Ce thème s’origine dès Platon. Dans la République, le Bien -qui est l’Un -est au-delà de l’Idée. Il n’est pas une substance. Aucune figuration idéelle ne lui est appropriable, et donc aucune structure.
• L’autre voie consiste à penser que l’Un lui-même est. Donc il est appropriable dans une disposition structurée quelconque, il y a des prédicats qui lui conviennent. Et notamment, des divisions internes à l’Un, dans la scission de son être même. Ce qui suppose de dire que l’Un est. Il y a un décollement de l’Un et de l’être ; il y a donc un écart entre l’Un et l’être comme possibilité de scission interne à l’Un. L’Un a intérieurement rapport à son autre du biais de son être.
Cela veut dire pour nous que la théorie des topos nous présente une théorie de l’Un structuré qui commande l’exercice logique sur le topos. La logique générale sur l’existant est ici suspendue à une orientation sur la structure de l’Un. C’est l’idée proprement du Parménide de Platon : «En un mot, pour tout ce dont tu poseras ou l’existence ou la non-existence ou toute autre détermination, examiner quelles conséquences en résultent, d’abord relativement à l’objet posé, ensuite relativement aux autres : l’un quelconque, d’abord, à ton choix, puis plusieurs, puis tous. Tu mettras de même les autres en relation et avec eux-mêmes et avec l’objet à chaque fois posé, que tu l’aies supposé exister ou non-exister. Ainsi t’exerceras-tu, si tu veux, parfaitement entraîné, être capable de discerner à coup sûr la vérité». (136 b)
- D’abord, on prend quelque chose dont on pose l’existence, et aussi la non-existence.
- Ensuite, on examine les conséquences de l’existence et de la non-existence par rapport à lui-même et par rapport aux autres.
|
|
|
|
- Mais il faut aussi procéder en sens inverse, c’est-à-dire examiner les autres que x sous la supposition que x existe, et que x n’existe pas, dans le rapport à eux-mêmes et dans le rapport à x.
Donc, discerner la vérité suppose l’étude des huit cas.
Or, dans le Parménide , il y a neuf cas. La méthode de Platon est toujours une méthode de type diagonal. C’est toujours du point du +1 qu’on boucle le cheminement de la pensée.
Parménide présente comme méthode universelle de la pensée, une méthode d’exhaustion logique. Quand on va discerner à coup sûr la vérité, le à coup sûr désigne une vérité logique, c’est-à-dire de l’ordre de ce que x détient comme possibilités. Ce dont il s’agit là, c’est de fictionner la catégorie x. Et la mise en place de la catégorie x procède par l’étude de ces huit étapes relationnelles.
Sommé de procéder lui-même à cet exercice, le vieux Parménide va dire qu’il va le faire pour l’Un : x = Un. L’intuition fondamentale est que, pour autant qu’il y a une logique de l’indéterminé, elle est présentée sans reste dans la logique de l’Un.
Tout ce début du Parménide va nous indiquer :
1) La pensée de la possibilité logique, c’est un déploiement catégoriel.
2) L’Un est ce qui convient comme x.
Le résultat auquel arrive Parménide, c’est que cette catégorie est inconsistante. Donc, l’exercice logique platonicien dans la guise de Parménide sur l’exhaustion logique d’un être indéterminé saisi comme Un délivre une catégorie inconsistante. Cela veut probablement dire que, pour Platon, ultimement il n’y a pas de structure de l’Un -ce qui consonne avec la République, l’Un-Bien. L’Un à l’épreuve de la structuration comme telle entraîne son inconsistance. Ce qui voudrait dire que l’Un ne supporte pas la structuration. Cela veut dire que la pensée de l’Un est une pensée qui n’est pas prise dans un dispositif de structuration. L’Un n’est pas catégoriel. Il n’y a pas de catégorie 1.
Par contre, la voie dans laquelle s’engage la théorie des topos -non platonicienne -c’est qu’il y a une structure de l’Un, qui est la structuration logique de l’univers.
L’objection pourrait être que l’1, dans un topos, est un 1 positionnel plutôt qu’intrinsèque, et que ça n’a rien à voir avec l’Un de la philosophie. L’1, dans un topos, est défini comme objet terminal, définition positionnelle, dans la géométrie du topos. On pourrait dire : ce n’est que par une homonymie qu’il est question de l’Un dans cette affaire. Il faut donc revenir de plus près à la définition de l’1 dans un topos.
Il y a des déterminations qui rapprochent l’1 (topos) de l’Un :
• L’1 n’est pas vide. Il a un élément : ![]() . Cet élément est lui-même. 1 n’est pas vide et il est rempli
par lui-même. Nous avons donc une unicité d’appartenance à soi-même, qui est une détermination plus
intrinsèque de l’1.
. Cet élément est lui-même. 1 n’est pas vide et il est rempli
par lui-même. Nous avons donc une unicité d’appartenance à soi-même, qui est une détermination plus
intrinsèque de l’1.
• 1 est ce qui prescrit l’élémentaire, ce qui compte l’élémentaire, ce qui le chiffre. Ce serait sa caractérisation atomique.
• 1 est catégoriellement unique, au sens où deux objets terminaux sont isomorphes. Pour l’habitant de la catégorie, il n’y a qu’un 1.
• Saisi cette fois comme opérateur, 1 est une sorte d’annulateur des différences intrinsèques :
![]()
![]()
La différence élémentaire en a est annulée par f.
f compte pour un les différences élémentaires. f est le co-égalisateur de e1 et e2. 1, au regard de la différence élémentaire, a la propriété universelle d’annulation.
Si on récapitule tout ça, ça détermine toute une série de déterminations intrinsèques : le 1 topique mérite d’être appelé Un, pas seulement dans son office de position terminale.
Maintenant, nous pouvons nous engager dans la question de sa structure.
Remarquons d’abord :
• 1 a certainement au moins deux sous-objets, correspondant aux deux valeurs de vérité : le vrai et le faux. Ce sont deux monomorphismes, et nécessairement des monomorphismes non similaires, pour la raison que 0 ne peut pas être isomorphe à 1.
![]()
![]()
Dans tout topos non dégénéré, il y aura, dans la structure de 1, ces deux sous-objets distincts.
• Examinons la structure de l’ordre de ces deux sous-objets :
|
|
|
Donc, là, c’est structuré par l’ordre, dans un topos quelconque. |
• Considérons les cas suivants :
- Nous supposons qu’il existe un sous-objet de 1 qui ne serait ni 01 ni Id(1).
|
Le sous-objet 01 est inférieur à tout sous-objet de 1. Donc, dans l’ordre des sous-objets de 1, 01 est minimal. |
|
S’il y a un sous-objet quelconque nommé f, l’Id(1) lui est nécessairement supérieur. Donc, Id(1) est maximal. |
1 est structuré par l’ordre de telle manière qu’il y a un
terme minimal et un terme maximal : 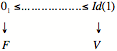
Les valeurs de vérité s’espacent entre le faux et le vrai. Le faux est la valeur de vérité minimale, et le vrai est la valeur de vérité maximale.
On voit donc apparaître l’idée des valeurs de vérité comme un spectre, avec un minimum et un maximum. Le faux, c’est le moins possible (des valeurs) de vérité ! Le vrai, c’est le plus possible (des valeurs) de vérité. Le vrai et le faux ne sont que des limites. Simplement, si c’est bivalent, il n’y a rien entre les deux. Dans la bivalence, il n’y a que les limites. Dans la bivalence, on peut dire que la position limite du vrai et du faux ne se donne plus comme limite, parce qu’elle n’est limite de rien. La bivalence est le moment où le vrai et le faux cessent d’apparaître comme limite, et donc apparaissent comme choix, c’est-à-dire comme tiers-exclu. La bivalence, c’est l’exclusion du tiers, c’est-à-dire l’illisibilité de la position limite.
C’est là-dessus que va se jouer le fait que la bivalence induit une logique de la décision. Tandis que le cas général, l’espacement, induit une logique de l’approximation. C’est plus ou moins proche de la limite, plus ou moins vrai, ou plus ou moins faux. On pourra avoir une mesure de ce que l’on peut dire quant à la vérité, de l’approximation à la limite.
Qu’est-ce qui fait nœud d’une logique de la décision et d’une logique de l’approximation ?
Il va falloir enrichir notre logique de 1.
Corrélation ensembliste de ce point :
Dans le topos des ensembles, 1 c’est un singleton.
![]()
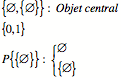
Le topos des ensembles est l’exemple canonique du topos bivalent. Où nous retrouvons le point qu’il y a dans la configuration ensembliste un élément décisionnel. Étant donné un ensemble, il appartient ou il n’appartient pas à un autre.
Et cela se lit dans la structure même du 1 : ![]() qui est doté de
deux objets : le vide et lui-même.
qui est doté de
deux objets : le vide et lui-même.
On peut dire que : ![]()
c’est la trinité, dans sa version ensembliste, c’est-à-dire dans sa version décisionnelle.
VI
I
La question de ce que l’on peut appeler le réseau de l’Un est déployée dans le Parménide de Platon. Que le réseau de l’Un constitue en quelque manière le foyer du pensable est, dès ce moment-là, explicité. Le mouvement est le suivant :
Zénon commence par soutenir son argumentation bien connue sur l’impossibilité du mouvement, du multiple.
Socrate, supposé tout jeune, se lance vaillamment dans une réfutation de Zénon : en réalité, Zénon n’a pas donné, soutient-il, une véritable localisation du pensable. De là que les paradoxes n’ont pas l’importance que leur attribue Zénon. La théorie des Idées intervient comme un changement de terrain par rapport à l’argumentation zénonienne.
Cela, parce qu’il est important de voir que dans le
Parménide, l’attaque concerne non pas
directement la question de l’Un, mais la question de la constitution du
pensable, de sa localisation. C’est ce qui permet de comprendre que, dans ce
début du dialogue, Parménide semble encourager le jeune Socrate contre son
champion officiel, Zénon. Ceci parce que la discussion va porter sur : à
quelles conditions la pensée s’approprie le pensable ? D’où
l’encouragement de Parménide lui-même à la théorie des Idées. Nous savons que
dans le Sophiste, Platon va
revendiquer une filiation parménidienne, dans la guise du parricide. Cette
filiation est homogène au mouvement du Parménide.
Une fois dans cette affaire de la pensabilité de la pensée, Parménide va soutenir que Socrate n’est pas assez audacieux. La radicalité porte sur le point qu’il faut admettre des Idées de tout. Parménide est ici celui qui énonce que l’Idée désigne la pensabilité en général.
Donc, la phase introductive dit deux choses :
- La clef, c’est : qu’est-ce que la pensée pense ? -Question préliminaire, par rapport aux disputes, amusantes, mais empiriques -.
- Cette question ne se résout pas du point d’une sélection singulière d’objets. La pensée pense le pensable, de façon universelle.
Ensuite, Parménide va dire qu’il faut s’exercer. Cette notion d’exercice, c’est elle qui va infléchir le Parménide du côté d’un examen que l’on peut dire, au sens large, de type logique. Parce que la notion d’exercice véhicule naturellement la notion des possibilités de la pensée : de quoi la pensée est-elle capable ? -question ici posée indépendamment de la question : qu’est-ce que la pensée décide ?
Cela signifie que le Parménide est, à certains égards, un dialogue non axiomatique (contrairement à l’orientation fondamentale de la pensée de Platon), au sens où axiome dessine l’engagement de la pensée sur un point. Dans le Parménide, l’engagement est retenu au profit de l’exploration des possibilités de la pensée. Donc, on ne va pas s’engager dans une axiomatique de l’Un.
C’est tout le contraire du surgissement de l’Idée du Bien dans la République, qui n’apparaît que comme décision. Ce qui va faire qu’elle va être déployée dans une figure semi-poétique. L’Idée du Bien dans la République est sans réseau, elle n’est pas catégorisée.
Dans le Parménide, on a tout le contraire : non pas une institution décisionnelle, mais un exercice concernant l’Un, qui n’a pas d’autre enjeu que de tisser le réseau. C’est dans cet exercice que le vieux Parménide va s’engager. Constitution de réseau va vouloir dire : détermination d’une entité par le système complet des relations qu’elle supporte, et pas du tout par rapport à l’intuition simple de son identité, ni du tout par image ou métaphore. Donc, dans le Parménide, il y a une inspiration catégorielle essentielle : un parcours, si possible saturé, d’un réseau relationnel.
On peut donc soutenir que le premier texte d’inspiration catégorielle est bien le Parménide 136-b :
• c’est l’exercice du possible, donc logique et non ontologique ;
• c’est une pensée de type réseau relationnel, et non saisie décisionnelle du simple.
On va le reprendre dans la minutie textuelle :
L’existence n’est pas ici ce dont on part, ou ce qu’on
décide. Elle n’est pas ce sur quoi l’on tranche. Existence ou non-existence
sont traitées comme des propriétés possibles de l’entité : «On peut
poser l’existence, ou la non-existence, ou toute autre détermination».
Nous avons là un texte où formellement l’existence ou la non-existence sont traitées comme des propriétés de l’entité. Ceci a ouvert dans l’histoire de la philosophie un grand débat : peut-on considérer l’existence comme une propriété ?
Il faut se référer aux objections que Kant fait à cette
idée : Critique de la Raison Pure -
4 ème section, chapitre 2 : De la dialectique
transcendantale -de
l’impossibilité d’une preuve ontologique de l’existence de Dieu. Kant va considérer que si on tient une preuve
ontologique de l’existence de Dieu, c’est qu’on prend l’existence comme une
propriété. Descartes prend l’existence comme une propriété de ce dont l’idée
est l’idée, propriété dont on peut démontrer si ce dont l’idée est l’idée l’a.
Kant remarque que Descartes traite l’existence comme une propriété. Il va
opposer concept et existence. La conclusion de Kant est que je ne peux pas
passer du concept à l’existence quant à un objet déterminé. Concept et
existence sont deux rapports à l’objet hétérogènes. Le concept indique une
conformité aux conditions universelles de la connaissance, alors que
l’existence indique une inscription dans la totalité. Concept et existence sont
deux types de donation de l’objet intransitives. L’existence est une donation
irréductible. Il en résulte que l’existence, si on la prend comme une
catégorie, échoue à exister. Si on la prend comme une catégorie, elle est
indiscernable de la possibilité. Et, par conséquent, Descartes n’a montré au
mieux que ceci que l’existence de Dieu est possible, mais nullement que Dieu
existe. Pour trancher entre existence et possibilité, il faut changer de
registre : «Quelles que soient la nature et l’étendue du contenu
de notre concept d’un objet, nous sommes obligés de sortir de ce concept pour
lui attribuer l’existence».
Dans le Parménide, existence et non-existence sont traitées comme des propriétés de l’entité. Pour Kant, on est seulement dans le registre de la possibilité.
Comment traiter cette discussion ?
Ce qu’il faut remarquer, c’est que pour Platon, dans le Parménide, l’existence est en effet une sorte de possibilité axiomatique. On peut prendre pour axiome : l’Un existe, ou au contraire : l’Un n’existe pas. Kant objecterait : dans ce cas-là, ce que vous faites, c’est que vous dites : l’Un, il est possible qu’il existe, ou il est possible qu’il n’existe pas.
Mais la position platonicienne va être que nous pouvons différencier ces deux possibilités par leurs conséquences. Si l’existence entraîne des effets différents de la non-existence, alors il faut poser que l’existence est une catégorie, du point où le réel de cette attribution va se signaler par cette différence. La conséquence va être la consistance ou l’inconsistance de la pensée. Alors, le point réel de ce que suppose l’existence est effectivement mis en jeu.
En réalité, il est absolument évident que Kant, dans la dialectique transcendantale, reste dans une conception entièrement empiriste de l’existence. L’existence, comme mode d’accès à l’objet, est de l’ordre du constat. Il n’est pas étonnant qu’il aboutisse à ceci qu’on ne peut en donner aucune preuve ! Par définition, l’existence est l’improuvable. Son essence est d’être ce qui se donne. C’est le point qui, lui, ne relève pas de la constitution transcendantale. C’est ce qui se donne pour la constitution transcendantale.
Tout se donne dans le doublet : supposition / justification dans le texte de Kant. Pour lui, la pensée peut toujours supposer une existence, mais si elle en veut une justification quelconque, c’est-à-dire en faire un réel, alors il n’y a pas d’autre recours que l’expérience, c’est-à-dire la donation comme telle. Tant qu’il n’y a pas ce recours à l’expérience, la supposition reste supposition. Le critère de la supposition va être alors l’utilité. A défaut d’une donation d’existence, nous sommes dans l’indiscernabilité entre existence et possibilité.
C’est ce que nous avons appelé l’espace de la logique : l’espace dans lequel l’existence est retenue dans la possibilité. Dans le lexique de Kant, l’existence des objets de la pensée pure, étant indiscernable de la possibilité, est une existence purement logique, tandis que l’existence réelle relève de ce qui s’inscrit dans l’unité de l’expérience. Le processus de la supposition n’est pas lui-même appréhendé dans son réel. Le protocole de Kant est foncièrement dualiste en ceci que l’existence n’est pas une catégorie qui serait transversale à la pensée et à l’expérience. Ce qui s’évanouit dans cette affaire, c’est la question de savoir quel est le réel de la supposition elle-même, le réel de la pensée (à supposer que le réel ne soit pas dans son objet).
Dans la pensée platonicienne, il n’y a pas le doublet supposition/justification. Le véritable doublet platonicien est celui de la décision et de la consistance. On peut décider l’existence-même d’un objet pur de la pensée, sous la réserve de mettre cette existence à l’épreuve de la consistance. Ce qui ne veut pas dire que la supposition d’existence est inconnue. C’est l’examen des conséquences de la supposition qui est la preuve en réel de l’existence.
En réalité, celui pour qui il y a unité de plan, c’est Platon. Il est celui qui déclare que sur la question de l’existence, il y a unité de plan. Si vous décidez une existence, vous êtes comptables des effets pensables de cette décision. Par contre, c’est pour Kant qu’il n’y a pas unité de plan. Si on veut de l’existence au sens du réel, on est renvoyé à l’expérience. La question de l’existence est moniste chez Platon et dualiste chez Kant. Le matérialiste, si on entend par là l’homogénéité du processus de connaissance, est Platon.
Si on revient à la question de l’Un, l’enjeu du Parménide va être de constituer le réseau de sa pensée dans un espace homogène : qu’est-ce que ça constitue comme champ consistant ou non du pensable ? La norme va être mathématique, parce qu’en mathématique, il n’y a pas d’autre norme de l’existence que la consistance.
Ce qui est important, c’est que ce paradigme mathématique institue un champ homogène quant à la question de la pensée. La question de la pensée de la boue ou du cheveu n’est pas différente de celle du triangle. Il n’y a qu’un champ du pensable. Ce que Parménide dira c’est que la boue et les cheveux, il faut les penser mathématiquement.
La démarche platonicienne est catégorielle en un double sens :
- existence et non-existence ne vont pas être décidées mais supposées : on reste dans la logique, mais avec une claire conscience d’y être ;
- on va en constituer le réseau catégoriel.
II
L’identité n’est nullement, dans le Parménide, une qualité substantielle. C’est une relation à
soi, qui va être examinée sur le même plan que la relation aux autres. Cela,
c’est très catégoriel aussi. Que l’entité soit supposée exister ou non doit permettre
une investigation des conséquences quant à la relation qu’elle entretient avec
elle-même. L’investigation de l’identité va se faire à partir de l’examen de la
relation à soi, lequel va se faire sous l’hypothèse de l’existence ou de la
non-existence. On va de la supposition d’existence à la détermination
identitaire. Ce qui veut dire que l’Un n’est pas l’identique. C’est un trait catégoriel. Cf. 139-d : «L’Un
et l’identique ne sont point même nature ... C’est que devenir identique à quoi
que ce soit n’est pas ne faire qu’un... Devenir identique aux plusieurs est forcément
devenir plusieurs et non pas un... Or, si l’un et l’identique ne différaient en
rien, devenir identique serait toujours devenir un et devenir un serait
toujours devenir identique... Donc, pour l’Un, être identique à soi ne sera pas
ne faire qu’un avec soi».
L’idée de l’identité ne doit pas être enfermée dans la substantialité de l’Un. L’identité est disséminée dans la pluralité de la relation.
III
Sur la conception de la vérité : une vérité, c’est une détermination locale pensée dans un réseau global. C’est une conception possiblement catégorielle de la vérité : un rapport toujours fuyant entre le local et le global.
L’Un va être une localisation paradigmatique. Or ce point est absolument vrai dans un topos, puisque la structure de l’Un détermine la logique du topos.
Tout ça pense l’Un comme clef logique du champ du pensable, logique s’introduisant ici parce qu’il y a symétrie entre existence et non-existence, au régime général du possible.
La question du Parménide de Platon, c’est : quel est le champ de possibilité du pensable ? Y a-t-il un topos du pensable ? La conclusion du Parménide est négative : il n’y a pas de topos du pensable. Que l’on suppose que l’Un existe, ou que l’on suppose que l’Un n’existe pas, c’est inconsistant.
Que signifie donc que Platon ait établi -au moins à ses propres yeux -qu’il n’y a pas un champ de consistance où se donneraient les possibilités de la pensée ? Cela signifierait que, pour Platon, il ne faut pas partir du possible. La logique n’est pas le point de départ de la pensée. Elle en est le pur exercice, mais un exercice aporétique, d’inconsistance. Ce qui veut dire qu’il faut partir de la décision. Cela seul établit une consistance du pensable.
Ce que dit Platon, ce n’est pas du tout que l’Un existe, ou que l’Un n’existe pas. Il dit : vous ne pouvez pas poser cette question dans le champ du possible. Par conséquent, ce qu’il faut dire, c’est : il y a de l’Un. Mais pas en tant qu’on peut examiner la possibilité qu’il y en ait, ou qu’il n’y en ait pas. On dessoude il y a de l’Un de toute possibilité. C’est autre chose que le remplissement de la possibilité qu’il y en ait.
C’est quoi ? C’est un axiome, au sens philosophique, au sens fort. Un axiome est une décision pensante qui institue un champ dans lequel on suppose une consistance jusqu’à la preuve contraire. Mais ce n’est pas l’institution d’une possibilité. Donc, pour Platon, la décision ontologique précède la logique. Sur ce point, Platon est le fils de Parménide, et pas Zénon qui argumente sur les possibilités. Zénon est un logicien des possibilités.
C’est une intuition très forte de Platon de mettre en scène Zénon comme un infidèle, parce qu’il argumente sur la thèse de l’Un. Or, la thèse de l’Un n’est pas argumentable sur horizon de possibilité.[14]
Le Parménide est véritablement un dialogue aporétique.
IV
Si l’on revient à l’Un catégoriel. Dans l’univers catégoriel général :
• La question de l’existence de l’1 est une simple possibilité. L’1 est une possibilité définitionnelle. On suppose, ou on ne suppose pas, qu’il existe un objet terminal. On suppose, ou on ne suppose pas, qu’il est différent de 0.
• L’1 est constitué par la relation générale des autres à lui.
Un / Unicité / Universalité :
![]() : la flèche de a à 1 est unique. 1 est en
quelque sorte en position universelle, en position limite.
: la flèche de a à 1 est unique. 1 est en
quelque sorte en position universelle, en position limite.
• ![]() : quand l’1 a une relation à un autre, c’est une relation
élémentaire. Ça constitue 1 comme élément de a. Quelque chose dans a est compté
pour 1.
: quand l’1 a une relation à un autre, c’est une relation
élémentaire. Ça constitue 1 comme élément de a. Quelque chose dans a est compté
pour 1.
• Dans un topos, le 1 touche à la vérité d’un biais essentiel :
|
|
![]()
L’analyse d’une différence renvoie à la combinaison de la flèche vrai et de la flèche compte pour un de a. Toute différence assignable, tout sous-objet d’un objet, s’analyse du point de l’1 et de la flèche vrai.
Cette équation est philosophiquement très importante de ce qu’est un topos. Elle fait apparaître : • l’inscription d’une différence,
• l’inscription de son analyse, qu’elle fait correspondre au compte-pour-un d’un objet, combiné à la vérité.
Nous avons une corrélation entre différence, centration, vrai et 1.
VII
La logique d’un univers quelconque se concentre dans la structure de 1.
Le 1, comme les fondateurs de la philosophie en ont eu l’intuition, est ce qui opère à la charnière du logique et de l’ontologique. On le retrouve dans le concept de topos, au point où la structure de 1 commande la disposition logique de l’univers considéré.
Qu’est-ce que la structure de 1 ? C’est la structure des sous-objets de 1. Pour autant que 1 est doté d’une intériorité quelconque, cette intériorité est celle des sous-objets. Un sous-objet, c’est une classe de monomorphismes.
Disons donc que la logique d’un topos va être commandée par l’algèbre des sous-objets de 1. Cette algèbre est elle-même construite à partir d’une structure d’ordre.
Soit un sous-objet de 1 représenté par un monomorphisme :
|
|
|
|
Ces deux diagrammes existent nécessairement, et ils commutent.
Id(1) ![]() 1(a) = 1(a)
1(a) = 1(a)
1(a) ![]() O(a) = O(1)
O(a) = O(1)
Donc :
1(a) ≤ Id(1) Id(1) est maximum
O(1) ≤ 1(a) O(1) est minimum
La structure d’ordre sur les sous-objets admet un maximum et un minimum.
Dans la correspondance sous-jacente entre structure des sous-objets de 1 et structure élémentaire de l’objet central, on sait que O1 correspond au faux, cependant que l’Id(1) correspond à la flèche vrai :
le vrai est la centration de l’Id(1),
le faux est la centration de O1.
On peut donc aussi dire que le faux est en position minimale, et le vrai en position maximale dans les éléments de l’objet central C. Étant entendu que, pour l’instant, nous ne savons rien sur la structure d’ordre des éléments de C.
L’espace des valeurs de vérité lui aussi va admettre comme minimum le faux, et comme maximum le vrai. Si le topos est bivalent, il n’y aura que le vrai et le faux, avec le faux inférieur au vrai. De même, il n’y aura que O1 et Id(1). Si le topos n’est pas bivalent, ses valeurs de vérité vont se disposer entre le vrai et le faux.
On voit qu’on ouvre là à une approche locale du vrai et du faux. On va avoir des choses plus ou moins vraies, ou plus ou moins fausses, selon leur distance au vrai et au faux. On pourra donner à cela des repérages précis, en considérant l’espace ouvert par le vrai et le faux comme un espace topologique. Ceci finira par donner un sens au «quasiment vrai» et au «presque faux». Et à l’élément de moyen. Le vrai fil sera une progressive topologisation des valeurs de vérité, une conception somme toute topologique et localisante de la vérité.
On pourra donner sens au fait que, dans un topos des énoncés sont vrais autour d’un endroit, et quand on s’écarte de cet endroit, ce sera de moins en moins vrai. Et donc s’ouvrira une théorie du localement vrai, et donc une géométrisation de la question de la vérité. Cette théorie requiert en particulier qu’on dote les topos d’une topologisation. Nous en sommes encore très loin, mais on voit que cette possibilité est déjà ouverte par la structure d’ordre des éléments de C.
Attardons-nous sur le cas élémentaire du topos bivalent :
- Tout topos bien pointé est bivalent.[15]
- Un topos bien pointé est un topos tel que deux flèches parallèles différentes sont élémentairement différentes.
![]()
f ≠ g f ![]() x ≠ g
x ≠ g![]() x
x
C’est un univers dans lequel toute différence admet une évaluation locale.
Un topos qui n’est pas bien pointé -c’est-à-dire l’écrasante majorité des topos -est un topos qui admet des différences globales. Dans ce cas, on peut dire que la différence est qualitative.
A l’arrière plan, cela concerne la théorie des multiplicités. Dans un topos bien pointé, les multiplicités ont ceci d’homogène qu’on peut toujours tester leur différence en un point. Donc le bien pointé, c’est quant même un principe d’homogénéité. C’est un univers dans lequel il y a un principe d’homogénéité dans la différenciation. Si ce n’est pas bien pointé, il y a des différences globales et qualitatives, et par conséquent, il y a de l’hétérogène.
Dans un topos global, on voit apparaître deux types de différences, la différence homogène, et la différence hétérogène. La différence homogène est celle qui se laisse élémentairement traiter, la différence hétérogène est celle qui ne se laisse pas élémentairement traiter.
Philosophiquement, ce débat sur la différence des différences, qui est ultimement la différence des multiplicités, est fondamental.
C’est un élément fondamental pour Bergson ou Deleuze que le fait qu’existent deux types de multiplicités, qualitatives et quantitatives. Cela veut dire qu’il y a deux types de différences, et la dynamique des choses -élan vital bergsonien, flux deleuzien -n’est intelligible que parce qu’il y a ces deux types de multiplicités. A chaque fois, ça se joue entre les deux types de multiplicités, c’est-à-dire dans une différence dans la différence, pour que l’on puisse rendre intelligible le devenir. On peut le dire aussi : il y a de l’hétérogène.
Ceci est tout-à-fait mis en mathème dans l’écart entre élémentairement différent, et globalement différent, dans la théorie des topos. L’exemple type du topos bien pointé, c’est la théorie des ensembles dont la clef de voûte est l’axiome d’extensionalité. Par conséquent, l’option ensembliste comme option ontologique, c’est une option pour l’homogène, qui, à la fin des fins, est un homogène matériel, puisqu’à la fin des fins, tous les ensembles sont composés avec du vide. Il n’y a qu’un principe d’être.
Installe-t-on la pensée dans une théorie homogène de la différence, ou dans une théorie essentiellement hétérogène de la différence ? Tel est l’enjeu philosophique. Les deux ne sont pas absolument en symétrie, parce que dans les ontologies de l’hétérogène, il y a en même temps de l’homogène. Tandis que dans la théorie de l’homogène, il n’y a pas d’hétérogène. On pourra dire que les théories dynamiques ou vitalistes subsument l’homogène ; c’est pour ça qu’elles sont des théories de complexité.
Du point de vue des topos, il est certain que ça fait apparaître que le cas général n’a aucune raison d’être celui de l’homogène. Être bien pointé, c’est une propriété très particulière et logiquement très contraignante. Elle impose que la logique soit bivalente.
Une fois de plus, topos va nous apparaître comme subsumant les options : compatible avec l’homogène sans le prescrire, et compatible avec la coexistence de l’homogène et de l’hétérogène. La question est de savoir comment tous ces problèmes vont se trouver concentrés dans la structure de 1.
Pour donner un premier exemple :
Dans un topos bien pointé, il ne peut y avoir que deux éléments de l’objet central, ce qui veut dire qu’il n’y a que deux valeurs de vérité, le vrai et le faux. Cela veut dire que dans un topos bien pointé, il n’y a que deux sous-objets de 1.
Dans le topos des ensembles, qu’est-ce qu’un objet
terminal ? C’est un singleton, par exemple : ![]()
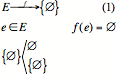
Prenons un topos bien pointé quelconque, et supposons que dans ce topos bien pointé il y ait un objet a qui ne soit isomorphe ni à 0, ni à 1. Il y a donc une flèche de a vers 1. Mais nous savons qu’il n’y a que 2 sous-objets de 1. Donc, ce n’est pas un sous-objet de 1.
![]()
![]()
![]()
![]() ce n’est pas un monomorphisme.
ce n’est pas un monomorphisme.
Prenons le diagramme suivant :
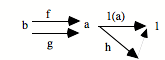
Si la flèche de a vers 1 n’est pas un monomorphisme, il n’est pas vrai que, dans tous les cas, elle conserve les différences. Donc, il existe forcément deux flèches parallèles différentes dont elle ne conserve pas la différence :
f ≠ g, et cependant : 1a![]() f
= 1a
f
= 1a![]() g
g
Donc :
Dans un topos bien pointé, une flèche de a vers 1, si a n’est ni 0 ni 1, détruit forcément une différence, l’égalise.
Supposons qu’il y en ait une autre h qui détruise les différences. Le triangle commute, et la flèche de a vers 1 est en position limite, donc universelle pour la propriété : annuler la différence de f et de g. Donc la flèche de a vers 1 est le co-égalisateur de f et de g.
Dans un topos bien pointé, toute flèche de a vers 1, où a n’est isomorphe ni à 0, ni à 1, est le co-égalisateur d’au moins une paire de flèches.
On a l’habitude de la noter ![]() :
: ![]() (ce qui est une
inflexion de pensée). On peut considérer que la flèche de
(ce qui est une
inflexion de pensée). On peut considérer que la flèche de ![]() vers 1 est le
compte-pour-un de
vers 1 est le
compte-pour-un de ![]() , ce qui envoie
, ce qui envoie ![]() sur 1. Comme il
n’y en a qu’une, il n’y a pas d’ambiguïté.
sur 1. Comme il
n’y en a qu’une, il n’y a pas d’ambiguïté.
On dira :
Dans un topos bien pointé, tout ![]() qui n’est pas 0
ou 1 est en position universelle pour la destruction d’une différence.
qui n’est pas 0
ou 1 est en position universelle pour la destruction d’une différence.
Cela veut dire que, dans un topos bien pointé, nous avons la
propriété que toute différence se laisse appréhender de façon élémentaire.
Mais, par ailleurs, tout objet ![]() qui n’est ni minimal,
ni maximal -ni 0, ni 1-, apparaît comme destructeur en position
universelle d’au moins une différence.
qui n’est ni minimal,
ni maximal -ni 0, ni 1-, apparaît comme destructeur en position
universelle d’au moins une différence.
On peut méditer sur le point suivant : l’envers de ce que toute différence est évaluable est qu’en un certain sens, tout objet pris selon son compte-pour-un est un opérateur de résiliation universelle de différence.
J’appellerai ça : la structure dialectique d’un topos bien pointé, c’est-à-dire une certaine
corrélation pensable entre localisation des différences, et destruction des
différences par l’1. Ce ![]() qui détruit une
différence n’identifie pas un sous-objet de 1. Donc ce qui est un peu là est un
compte-pour-un qui n’est pas dans
1. C’est un compte-pour-un qui n’inscrit pas une différence dans 1 ;
alors, il détruit une différence. Mais détruire une différence, c’est faire 1
de ce qui était 2. Ce qui n’est pas dans 1, fait 1.
qui détruit une
différence n’identifie pas un sous-objet de 1. Donc ce qui est un peu là est un
compte-pour-un qui n’est pas dans
1. C’est un compte-pour-un qui n’inscrit pas une différence dans 1 ;
alors, il détruit une différence. Mais détruire une différence, c’est faire 1
de ce qui était 2. Ce qui n’est pas dans 1, fait 1.
Il y a trois opérateurs dans cette affaire :
- 1
- Compte-pour-un (![]() ) : fonction de 1 comme objet terminal ;
) : fonction de 1 comme objet terminal ;
- Immanence à 1 (![]() ) :
les sous-objets de 1.
) :
les sous-objets de 1.
Faire-un (![]() ) -co-égalisateur de f et de g -est l’opération du
compte-pour-un lorsqu’elle n’est pas inscrite dans l’1.
) -co-égalisateur de f et de g -est l’opération du
compte-pour-un lorsqu’elle n’est pas inscrite dans l’1.
Dans le Parménide de Platon, il y a tout ça. Cela, c’est le système des opérateurs de l’1.
Si le topos est bien pointé, immanence à 1 et faire-un sont contradictoires. Si l’on n’est pas dans l’immanence à l’1, alors on est dans le faire-un.
La technique des opérations algébriques sur les sous-objets de 1 est traitée dans le fascicule entre les pages 112 et 128.
Ce qui est intéressant à retenir, c’est ceci : on
définit, en termes internes au topos, sur les sous-objets de 1, trois opérations :
l’intersection, l’union et le complémentaire. Pour réinscrire ça, nous adoptons
la convention qui consiste à nous donner le droit d’appeler ![]() un sous-objet de
1.
un sous-objet de
1.
On définit donc :
• L’intersection de ![]() et de
et de ![]() -qui est aussi une flèche ;
-qui est aussi une flèche ; ![]() est une flèche,
est une flèche, ![]() est une flèche.
Toutes ces opérations sont des opérations sur des flèches définies par ces
écritures -. Le thème sous-jacent à l’intersection, c’est que c’est le correspondant
de la conjonction logique. Dans la correspondance entre sous-objet de
est une flèche.
Toutes ces opérations sont des opérations sur des flèches définies par ces
écritures -. Le thème sous-jacent à l’intersection, c’est que c’est le correspondant
de la conjonction logique. Dans la correspondance entre sous-objet de ![]() et valeur de
vérité permettant d’évaluer une proposition, l’intersection va être le correspondant,
du côté de l’algèbre des sous-objets, de ce que la conjonction logique est du côté
de l’évaluation des propositions, en terme de valeur de vérité.
et valeur de
vérité permettant d’évaluer une proposition, l’intersection va être le correspondant,
du côté de l’algèbre des sous-objets, de ce que la conjonction logique est du côté
de l’évaluation des propositions, en terme de valeur de vérité.
• L’union de deux sous-objets ![]() et
et ![]() de 1, qui, elle,
va avoir comme correspondant logique la disjonction.
de 1, qui, elle,
va avoir comme correspondant logique la disjonction.
• Le complémentaire de ![]() , -
, -![]() , dont la thématique sous-jacente va être la négation.
, dont la thématique sous-jacente va être la négation.
La remarque que je voudrais faire est la suivante : l’intersection et l’union sont définies sans recours direct à l’objet central et aux opérations logiques. Si on regarde de près, il y a des recours indirect, mais la définition est, d’une certaine manière, strictement catégorielle. Il s’agit vraiment de diagonales de pull-back, de coproduits, d’images etc... On est renvoyé à l’arsenal des diagrammes, des limites et des concepts organiques d’une catégorie cartésienne close. On pourrait dire que ces opérations sont introduites comme des opérations algébriques pures sur les sous-objets de 1.
En fait, en ce qui concerne l’intersection, ce qui est
requis c’est l’existence du pull-back de ![]() et de
et de ![]() -et cela nous le savons, parce que dans un topos, deux
flèches de même cible ont toujours le pull-back. En ce qui concerne l’union, on
a besoin de deux choses, essentiellement : du co-produit de
-et cela nous le savons, parce que dans un topos, deux
flèches de même cible ont toujours le pull-back. En ce qui concerne l’union, on
a besoin de deux choses, essentiellement : du co-produit de ![]() et de
et de ![]() , et de la décomposition de toute flèche entre une partie
épique et un monomorphisme. On a besoin de ceci qu’étant donné une flèche f
quelconque dans un topos, il existe un épimorphisme e qui va vers le point k,
et un monomorphisme m tel que : m
, et de la décomposition de toute flèche entre une partie
épique et un monomorphisme. On a besoin de ceci qu’étant donné une flèche f
quelconque dans un topos, il existe un épimorphisme e qui va vers le point k,
et un monomorphisme m tel que : m ![]() e = f.
e = f.
Par conséquent, on peut dire que la définition de l’union et la définition de l’intersection de deux sous-objets de 1 procèdent selon l’existence, dans un topos, de différentes limites : pull-back, coproduit...
Par contre, la définition du complémentaire convoque directement
la négation. Là, je rappelle la définition du complémentaire : le
complémentaire de ![]() , c’est le sous-objet de 1 dont la centration est la négation
de la centration de
, c’est le sous-objet de 1 dont la centration est la négation
de la centration de ![]() .
.
|
|
|
|
Ce qu’il faut remarquer c’est que là on passe directement par la médiation logique : objet central, négation. Ce n’est pas une construction catégorielle obtenue par la voie diagrammatique ordinaire. On est obligé de requérir la négation, d’impliquer le connecteur logique lui-même.
J’insiste sur ce point parce qu’il est un symptôme. De quoi ? De ce que la question-clef, en réalité, dans cette affaire, c’est bien la question de la négation. Ce qui va finalement commander la structure logique du topos, c’est en réalité la négation. C’est cela qui est le point de partage. On peut soutenir que, dans une logique non classique, la négation n’a pas le même sens que dans une logique classique. C’est cela qui va être le point décisif. Plus précisément, la négation ne nie pas de la même manière. L’acte de nier n’est pas le même. Nous verrons que, quand ce n’est pas classique, l’acte de nier est plus faible, la négation nie moins. Le non-classissisme est un affaiblissement du négatif, et une corrélation en pensée tout-à-fait différente entre négation et affirmation.
C’est la raison, à mon avis, pour laquelle la psychanalyse rencontre toujours, d’une manière ou d’une autre, la question des logiques non-classiques. La psychanalyse fait droit à des négations qui ne nient pas absolument. Cela, c’est essentiel, c’est une des trouvailles essentielles de Freud. Quelque chose de ce qui est nié est cependant là. Toutes les histoires du déni, du désaveu, du refoulement etc... Si on les prend dans leur logique sous-jacente, elles signifient bien quant même que bien que quelque chose ait été nié, il n’en est pas moins actif. Donc qu’il y a bien négation, mais il y a bien un type de négation qui n’est pas incompatible avec l’affirmation. Il est certain donc que la psychanalyse est logiquement inconcevable sans l’introduction d’un opérateur affaibli de la négation. Par ailleurs, à un autre niveau, la psychanalyse peut aussi faire usage d’un opérateur de négation fort (le psychotique). Cela est très intéressant, parce que la question : quel est le site logique de la psychanalyse ? est une question qui a énormément travaillé son histoire, et pas seulement Lacan, mais déjà au moment de Freud. Lisez l’extraordinaire labyrinthe que constitue son texte sur la négation. C’est un texte inépuisable dans sa complexité. Les énoncés aussi radicaux que : «l’inconscient ne connaît pas la contradiction» portent bien sur la question de la négation ; cela signifie qu’il y a un affirmatif inconscient qu’aucune négation n’entame. La question du site logique de la psychanalyse, pour l’essentiel, c’est la question de la négation. Je dirai que la psychanalyse s’établit dans une mixité du site logique -et non pas dans l’intuitionnisme -qui ramifie la négation, c’est une doctrine ramifiée de la négation. On le voit chez Freud, il y a plusieurs espèces de négations, mais ce qui est sûr c’est que la psychanalyse est astreinte à faire droit à la négation faible. Et par conséquent, elle a forcément des coquetteries avec l’intuitionnisme. C’est exactement cela chez Lacan. Jamais n’est assumée une position intuitionniste comme telle. Mais il y a des coquetteries avec l’intuitionnisme, et c’est inévitable parce qu’il y a la reconnaissance d’une négation faible, qui n’est pas une négation dialectique non plus. Ce n’est pas la négation hégélienne, la négativité qui relève et conserve. Chez Hegel aussi la négation de la négation n’équivaut pas à l’affirmation. C’est au contraire ce qui donne la vérité de l’affirmation qui n’est pas l’affirmation immédiate. Chez Hegel, il y a aussi une négation qui n’est pas exactement la négation classique. Mais ce n’est pas exactement de cela dont il s’agit, de toute évidence, dans la négation freudienne.
Sur une intervention disant que, dans la psychanalyse, il y a deux plans disjoints dans lesquels opère la négation : le plan de l’existence et le plan de la logique. C’est ce que j’appelais la ramification, il n’est pas possible de construire un plan logique unifié dans lequel se ferait l’ensemble de la description. Je suis bien d’accord, il y a des plans, et jamais ils ne sont en recollement. Mais ils sont en croisement, en même temps, ils sont en nouage. Il y a des temps de nouage, et dans les temps de nouage, la question de savoir quel est le type d’enchevêtrement des négations différentes est une question réellement complexe. Freud a d’emblée pointé la complexité. Alors, on la distribue comme ça. Mais il y a dans l’acte psychanalytique quelque chose qui n’est pas complètement distribuable, qui est comme un point de trouée de l’un dans l’autre, sans que ça constitue jamais un plan homogène. La question du site logique, c’est là que je la situe. Quel est le site de ce nouage ? Y en a-t-il une pensée quelconque ?
Je voulais simplement souligner que, si ramifiées que soient ces négations, l’admission d’une négation faible est un opérateur inéluctable, quel que soit l’ordre dans lequel, après, la psychanalyse le réélabore. C’est pour ça que, malgré tout, il y a des coquetteries avec l’intuitionnisme qui ne se résolvent jamais, je pense, dans un intuitionnisme logique formalisable. Et par conséquent, il y a aussi quelque chose comme une ouverture locale à une pensée de type catégoriel ou toposique. En particulier, à l’idée que la double négation est en réalité un opérateur de voisinage, et non pas un opérateur de réduction de l’affirmation ; quelque chose qui nie une négation fait venir non pas la chose même, mais comme un site connexe de la chose, comme un entour brouillé, comme un point épaissi, qui en réalité est comme un point, mais n’est pas un point.
Ceci, pour montrer à quel point la question de la négation va être une question cruciale.
Or, ce que va nous montrer la description en terme de topos,
c’est le lieu où ça se joue, cette question de la négation. La méthode
d’investigation, ça va être l’étude du complémentaire, c’est-à-dire du
sous-objet de 1 qui correspond à la négation. Qu’est-ce que la négation de ![]() à l’intérieur du
sous-objet de 1 ? Ça va être représenté par le complémentaire de
à l’intérieur du
sous-objet de 1 ? Ça va être représenté par le complémentaire de ![]() . Parce que le complémentaire de
. Parce que le complémentaire de ![]() est le
sous-objet dont la centration est la négation de la centration de
est le
sous-objet dont la centration est la négation de la centration de ![]() . Et ça va nous montrer où ça bifurque. Ou on s’engage dans
la négation plénière, c’est-à-dire en fin de compte la négation classique, ou
on s’engage dans une négation d’un autre type, qui va avoir toute sorte de
propriétés particulières, affaiblies dans leur rapport à la négation, et dont,
par exemple, un des symptômes sera que la négation de la négation n’équivaut
pas à l’affirmation. Elle sera plutôt dans un voisinage de l’affirmation.
. Et ça va nous montrer où ça bifurque. Ou on s’engage dans
la négation plénière, c’est-à-dire en fin de compte la négation classique, ou
on s’engage dans une négation d’un autre type, qui va avoir toute sorte de
propriétés particulières, affaiblies dans leur rapport à la négation, et dont,
par exemple, un des symptômes sera que la négation de la négation n’équivaut
pas à l’affirmation. Elle sera plutôt dans un voisinage de l’affirmation.
On va établir un certain nombre de théorèmes essentiels, qui sont vraiment les grands théorèmes de la structure de 1.
• Théorème 1 :
l’intersection est le PGI de ![]() et de
et de ![]() .
.
Cela veut dire que ![]() est le plus
grand de tous ceux qui sont plus petits à la fois que
est le plus
grand de tous ceux qui sont plus petits à la fois que ![]() et que
et que ![]() , le plus grand des inférieurs.
, le plus grand des inférieurs.
Cela se démontre. On démontre que, dans la structure d’ordre
sur les sous-objets, le ![]() , tel qu’on l’a défini comme flèche, est une flèche qui est
la plus grande à être plus petite à la fois que la flèche
, tel qu’on l’a défini comme flèche, est une flèche qui est
la plus grande à être plus petite à la fois que la flèche ![]() et la flèche
et la flèche ![]() .
.
• Théorème 2 :
![]() est le PPS de
est le PPS de ![]() et de
et de ![]() .
.
On démontre que la flèche ![]() , dans la structure d’ordre des sous-objets de 1, est la plus
petite à être plus grande que
, dans la structure d’ordre des sous-objets de 1, est la plus
petite à être plus grande que ![]() et que
et que ![]() , plus petit des supérieurs.
, plus petit des supérieurs.
(La démonstration de ce théorème n’est pas particulièrement commode !)
L’intéressant pour nous c’est que nous avançons dans la structure de 1. Nous avions dit : il y a un maximum [Id(1)], il y a un minimum 01, et nous voyons aussi maintenant que c’est un ordre pour lequel il y a, pour toute paire de flèches, le PGI et le PPS. Donc, nous nous acheminons vers une structure algébrique qui est la structure de treillis.
Enfin, on démontre que :
• Théorème 3 :
l’intersection de ![]() et du
complémentaire de
et du
complémentaire de ![]() est isomorphe à
0.
est isomorphe à
0.
Deux remarques :
1) Les sous-objets de 1 apparaissent comme dotés d’une structure
d’ordre partiel avec maximum et minimum, avec pour toute paire de sous-objets ![]() et
et ![]() le PGI et le
PPS, et avec pour tout sous-objet l’existence d’un complémentaire tel que
le PGI et le
PPS, et avec pour tout sous-objet l’existence d’un complémentaire tel que ![]() .
.
Le fait que ![]() est le PGI de
est le PGI de ![]() et de
et de ![]() va nous rappeler
que dans la structure du calcul des propositions, il en va de même pour la
conjonction de p et de q.
va nous rappeler
que dans la structure du calcul des propositions, il en va de même pour la
conjonction de p et de q.
Le fait que ![]() est le PPS de
est le PPS de ![]() et de
et de ![]() va nous rappeler
que dans la structure du calcul des propositions, il en va de même pour la
disjonction de p ou q.
va nous rappeler
que dans la structure du calcul des propositions, il en va de même pour la
disjonction de p ou q.
Que le complémentaire renvoie à la négation nous rappelle l’énoncé : p et p=F.
Par conséquent, le théorème 3 c’est le principe de non-contradiction en termes de sous-objets de 1. Comme ce théorème est un théorème de tout topos sans restriction, nous pouvons dire : le principe de non-contradiction est réellement un principe logique universel. La logique de tout topos valide le principe de non-contradiction. On remarquera au passage que, dans un topos, on démontre le principe de non-contradiction.
Revenons maintenant à Aristote, livre g de la Métaphysique. Il nous dit, après nous avoir annoncé une science de l’être en tant qu’être -dont ensuite il ne dit plus un mot, d’ailleurs, il parle de tout autre chose qui sont les principes de la logique -, Aristote nous dit : il y a trois grands principes :
- l’identité, dans notre vocabulaire, ça voudrait dire
que ![]() est isomorphe à
est isomorphe à ![]() , ça n’a pas beaucoup d’intérêt,
, ça n’a pas beaucoup d’intérêt,
- le principe de non-contradiction ; nous on le dira
![]() ,
,
- le principe du tiers-exclu.[16]
Dans notre jargon concernant les structures de 1, ça se
dirait comment le principe du tiers-exclu ? ![]() . Donc, si l’univers toposique était aristotélicien, on
aurait
. Donc, si l’univers toposique était aristotélicien, on
aurait ![]() et
et ![]() . Le premier, on l’a, on le démontre, c’est un théorème. Le
problème, c’est que le deuxième n’est pas un théorème. Dans un topos en
général, on ne peut pas démontrer que
. Le premier, on l’a, on le démontre, c’est un théorème. Le
problème, c’est que le deuxième n’est pas un théorème. Dans un topos en
général, on ne peut pas démontrer que ![]() ; on peut fabriquer des exemples de topos où ça n’est
pas vrai. On peut aussi fabriquer des exemples de topos où c’est vrai. Cet
énoncé est indépendant de la définition générale d’un topos. Au regard de la
définition générale d’un topos, ni cet énoncé, ni sa négation, ne sont
vrais ; cet énoncé est indécidable.
; on peut fabriquer des exemples de topos où ça n’est
pas vrai. On peut aussi fabriquer des exemples de topos où c’est vrai. Cet
énoncé est indépendant de la définition générale d’un topos. Au regard de la
définition générale d’un topos, ni cet énoncé, ni sa négation, ne sont
vrais ; cet énoncé est indécidable.
L’univers logique d’un topos met donc en évidence ce point : le principe de non-contradiction régit tout univers possible. Pourvu que ça soit non-contradictoire, ça peut faire monde. Par contre, le principe du tiers-exclu requiert autre chose que la simple définition d’un univers possible. C’est une propriété singulière que peuvent avoir certains topos. Si un topos a cette propriété, on dira que c’est un topos booléen.
Mais il est cohérent de se représenter des topos non-booléens. Dans des topos non-booléens, on n’a pas, dans toutes les circonstances, p ou p.
Prenons une image. Si on prend ![]() et le
complémentaire de
et le
complémentaire de ![]() , ça veut dire que ça ne remplit pas tout, il y a un reste.
Cela exprime bien qu’il y a du tiers, on n’est pas dans le tiers exclu. Il y a
quelque chose comme le tiers inclus, dans cette marge qui reste dans 1.
, ça veut dire que ça ne remplit pas tout, il y a un reste.
Cela exprime bien qu’il y a du tiers, on n’est pas dans le tiers exclu. Il y a
quelque chose comme le tiers inclus, dans cette marge qui reste dans 1.
Donc, dans un topos non booléen, vous voyez bien pointer l’affaiblissement de la négation, parce qu’en un certain sens, la négation de quelque chose, ça n’est pas exactement tout ce qui n’est pas lui. L’affaiblissement de la négation va porter sur le point précis suivant qui est que lorsque vous niez, vous obtenez quelque chose, mais ce quelque chose n’est pas le tout du ne pas. Quelque chose persiste à s’affirmer en dehors, qui n’a pas été touché, investi ou atteint par la négation.
Évidemment, l’image ensembliste est très rebelle à ça.
L’ensemblisme est profondément booléen, dans son esprit, dans sa visualisation,
dans son imagerie. Il nous impose que si vous prenez quelque chose, et que vous
l’unissez à son complémentaire, vous avez tout. En réalité, dans une figuration
non-classique, que je vais représenter impossiblement, si je puis dire, de
manière ensembliste, c’est comme si ayant ![]() et ayant le
complémentaire de
et ayant le
complémentaire de ![]() , cela ne faisait pas tout. Encore une fois, cette image est
en un certain sens incohérente, parce que du coup, on ne sait pas ce que veut
dire complémentaire. Mais justement, dans un topos, on va pouvoir comprendre
cela. On va pouvoir comprendre comment la négation de
, cela ne faisait pas tout. Encore une fois, cette image est
en un certain sens incohérente, parce que du coup, on ne sait pas ce que veut
dire complémentaire. Mais justement, dans un topos, on va pouvoir comprendre
cela. On va pouvoir comprendre comment la négation de ![]() , dans un espace originel donné, ne restitue pas tout ce qui
n’est pas lui, et que quelque chose est soustrait en quelque sorte à l’empire
négatif. Il est évident que cet ébrèchement atteste l’affaiblissement de la
négation.
, dans un espace originel donné, ne restitue pas tout ce qui
n’est pas lui, et que quelque chose est soustrait en quelque sorte à l’empire
négatif. Il est évident que cet ébrèchement atteste l’affaiblissement de la
négation.
Cet affaiblissement de la négation est, vous le voyez,
souterrainement lié à la question du pas-tout. En termes toposiques, il n’y
aura pas de tout, il n’y aura que des isomorphies. On dira que ça échoue à être
isomorphe à. Et la non-isomorphie est ici la non-identité, le
non-remplissement, ou le non-tout. Si on passe à l’image ensembliste, improbable
ou incohérente, on voit bien que c’est quelque chose comme le fait que la
négation appliquée à quelque chose ne fait pas tout lorsqu’on réunit
l’ensemble. Et donc, en un certain sens, il y a pas-tout pour autant que la
négation n’est pas exactement une négation booléenne. De là à dire qu’une femme
est un être non booléen... il y a un pas à franchir que je franchis
aussitôt ! Toute la question étant de savoir si le fait qu’on dit que
c’est non booléen indique que c’est intuitionniste. Cette question est
compliquée. Nous verrons la prochaine fois pourquoi. Le fait est qu’il y a un
élément non booléen, c’est-à-dire un élément qui touche à une soustraction à la
négation. Ce qui veut dire, à l’envers, qui touche à un affirmatif
irréductible. Mais c’est une affirmation qui, en vérité, est pour le moment insituable,
le dessin n’arrivera pas à en rendre compte. Peut-être est-ce dans ![]() lui-même que
quelque chose vient à ne pas pouvoir être nié ? Ça ne fait pas un parce
que soit quelque chose se soustrait à l’empire de la complémentarité niante,
soit quelque chose demeure dans l’affirmatif inentamé. Toujours est-il qu’il
faut dire qu’il y a là quelque chose de pas-tout, de non-booléen, c’est-à-dire
quelque chose de non-classique, malgré tout, mais en retenant la pente
relativement triviale consistant à dire qu’elle est intuitionniste -on l’a
toujours dit, platitude ! -. On pourrait dire plutôt qu’elle est comme un
trait qui décomplète le classique, au sens où le faire-tout booléen n’aboutit
pas.
lui-même que
quelque chose vient à ne pas pouvoir être nié ? Ça ne fait pas un parce
que soit quelque chose se soustrait à l’empire de la complémentarité niante,
soit quelque chose demeure dans l’affirmatif inentamé. Toujours est-il qu’il
faut dire qu’il y a là quelque chose de pas-tout, de non-booléen, c’est-à-dire
quelque chose de non-classique, malgré tout, mais en retenant la pente
relativement triviale consistant à dire qu’elle est intuitionniste -on l’a
toujours dit, platitude ! -. On pourrait dire plutôt qu’elle est comme un
trait qui décomplète le classique, au sens où le faire-tout booléen n’aboutit
pas.
Par ailleurs que ![]() ne fasse pas 1
est un des mathèmes possibles du fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel, ça
c’est évident. Si on avait 1, ça ferait 1.
ne fasse pas 1
est un des mathèmes possibles du fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel, ça
c’est évident. Si on avait 1, ça ferait 1.
Moi je dirai ceci : le fait qu’il n’y ait pas de rapport sexuel suppose en fin de compte, d’une manière ou d’une autre, que l’espace en topos de la question soit réellement non booléen. Ce qui après tout se laisse discuter. L’espace en topos de la question est-il ou n’est-il pas booléen ? Ce n’est pas une question que vous pouvez trancher de prime abord.
Laissons toutes ces questions en l’état.
L’exploration peut donc se continuer par l’examen précis des conséquences pour un topos de son caractère booléen ou non-booléen. Qu’est-ce que ça engage qu’effectivement un topos soit booléen ou non-booléen, c’est ce que nous instruirons avec des exemples, la semaine prochaine.
***