LĠimmanence
des vrits (4)
Dernier
sminaire dĠAlain Badiou (2015-2017)
[compte
rendu par Daniel Fischer]
Calendrier et
localisation 1
Calendrier.............................................................................................................................. 1
Localisation.......................................................................................................................... 1
19 octobre 2015 2
9 novembre 2015 11
11 janvier 2016 16
15 fvrier 2016 26
11 avril 2016 33
6 juin 2016 44
Calendrier et localisation
Calendrier
Lundi 19 octobre
2015
Lundi 9 novembre
2015
Lundi 11 janvier
2016
Lundi 15 fvrier
2016
Lundi 11 avril 2016
Lundi 6 juin 2016
Lundi 17 octobre
2016 (Platon/Nietzsche, avec M. Dixaut, D. El Murr et Q. Meillassoux)
Lundi 12 dcembre
2016
Lundi 16 janvier
2017 (exceptionnellement partir de 14h)
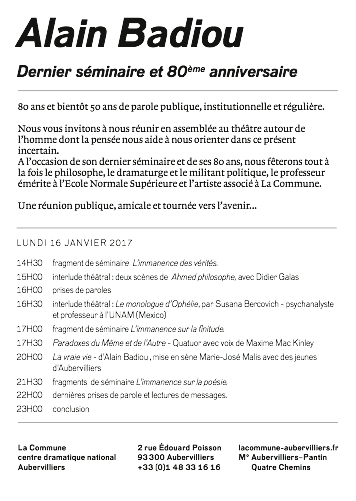
Localisation
Un lundi par mois, 20h
Thtre de la Commune - 2, rue douard Poisson –
Aubervilliers
(cliquer sur lĠimage pour plus de dtails)
Pour se rendre au Thtre de la Commune (Aubervilliers)
—
par
le mtro : prendre la ligne 7 jusquĠ la station Aubervilliers-Pantin
Quatre-Chemins. Ensuite pied, remonter lĠavenue de la Rpublique vers
Aubervilliers-centre et prendre la cinquime rue gauche (compter 10mn). Il
est ventuellement plus rapide de prendre au mtro le bus 150 ou 170 jusquĠ
lĠarrt Andr Karman.
—
par
le bus : bus 35 de gare de lĠEst mairie dĠAubervilliers.
—
en
voiture : il y a un parking en face du thtre.
A lĠissue du sminaire il y aura une navette qui desservira
Porte de la Villette, Stalingrad, gare de lĠEst et Chtelet.
Le bar-restaurant sera ouvert avant et aprs le sminaire.
19 octobre 2015
Le 17 janvier 2017, jĠaurai quatre-vingt ans. Et le 18
janvier, je commencerai ma quatrime vie. Alors, vous allez dire :
pourquoi quatre ? Eh bien, je vais vous le dire ; cette soire est
celle des confidences. Je considre que ma premire vie a t celle de
lĠenfance, de 1937 1953, peu prs. Je nĠen dirai pas plus, on ne va se
mler ici dĠauto-analyse ou tout ce qui y ressemblerait. La deuxime vie, a
a t ma jeunesse, que je situe de 1953 1968. Cette jeunesse, comment la
dcrire ? Du point de vue des rfrents, en termes de procdures de
vrits, je dirai que cĠest pour moi lĠpoque de lĠcriture romanesque - cĠest
lĠpoque o jĠai publi deux romans – et de la politique classique.
Classique, a veut dire : lectorale. JĠai particip activement des
campagnes lectorales et je sais donc ce que cĠest. Et puis, cĠest aussi
lĠpoque de lĠinstallation amoureuse et familiale. Du ct, en somme, des
procdures artistiques plutt une reprsentation du ct du roman ; du
ct de la politique, la politique en son sens ordinairement dmocratique - la
seule chose que jĠai vite cĠest dĠtre candidat, heureusement; il y a eu la
traditionnelle installation amoureuse et familiale ; et du ct de la
science, dj, je mĠintressais beaucoup aux mathmatiques, a, a va courir
tout du long. La troisime vie, cĠest le dploiement adulte, le long
dploiement adulte, que je situe de 1968 2017. Je pourrais tenter de le
rsumer, ou de le formuler, en termes de procdures. Il y a les nouvelles
formes de la politique, partir de 68, qui tentent de sĠinscrire dans un autre
espace que lĠespace de lĠtat parlementaire tel que nous le connaissons depuis
dj prs de deux sicles ; du point de vue de lĠcriture, lĠinflexion va
tre plutt thtrale ; du ct de lĠamour, cĠest le moment o il apparat
que lĠamour est une aventure complexe, je le dirai comme a, je nĠen dirai pas
plus, ce nĠest plus la priode de lĠorigine ou de lĠinstallation, la priode
la fois conqurante et nave, mais cĠest lĠamour comme aventure soutenir,
comme labeur complexe ; finalement, et du point de vue de la science,
cĠest lĠinstallation vraiment prolonge, dtaille, dans certains secteurs des
mathmatiques, en appui de la philosophie. Et cĠest aussi lĠpoque du
dploiement philosophique, videmment, lĠpoque des grandes Ïuvres
philosophiques proprement dites o effectivement, pendant toute cette poque,
la philosophie elle-mme convoque, comme une espce de noyau fondamental de son
tre, la politique, les mathmatiques, la posie, le thtre etc. Voil.
Alors, normalement, il faudrait que tout a aille doucement
sa fin vers janvier 2017 de telle sorte que, la
diffrence des squences antrieures, celle-l serait marque par un lment de
dcision, quand mme. On nĠest pas oblig de considrer que le dploiement
adulte sĠachve, on peut considrer que le dploiement adulte inclut la
vieillesse, inclut finalement, comme dirait lĠautre, Ç lĠtre-pour-la-mort È.
Moi, non. Je veux dcider quelque chose. Alors il faut videmment des symboles.
Le symbole, cĠest quatre-vingt. Quatre-vingt ans, cĠest quand mme pas rien.
CĠest une date quĠon atteint maintenant assez souvent, mais il nĠy a pas si
longtemps, elle tait dj trs vnrable, cĠest par exemple lĠge de la mort
de Platon. Alors, Ç vivre aprs Platon È, si vous voulez É un
objectif moderne É Ce sera quoi cette quatrime vie ? Je ne sais pas
encore. Ce sera en tout cas quelque chose qui sera dcid au rgime du commencement.
Le commencement de quoi ? Eh bien, le commencement engendr par ce que je
considre quand mme comme lĠachvement philosophique, cĠest--dire le
sentiment que jĠaurai dĠavoir explor, pens, dploy et discut ce dont
jĠtais capable dans ce champ. Ce qui veut dire en ralit lĠachvement du
troisime ou quatrime volume, selon quĠon compte ou quĠon ne compte pas Thorie
du sujet, de la grande fresque philosophique proprement dite - Thorie
du sujet, LĠtre et lĠvnement, Logiques des mondes et LĠimmanence des
vrits - quĠil faudrait donc finir, ventuellement publier en grande
pompe, le 16 janvier 2017. Je mĠy emploierai. Ce dernier livre, vous le savez,
vous en tes en partie les tmoins et aussi les acteurs, puisque cĠest le titre
du sminaire et le work in progress philosophique proprement dit.
Ë ce propos, je voudrai dire un mot des sminaires,
lĠoccasion, tout simplement, de la parution du dernier, savoir le sminaire
sur Nietzsche qui sort, est sorti, ou va sortir, qui est le sminaire des
annes 92-93. Il a donc une vingtaine dĠannes. Je voudrai faire un peu de
propagande pour le sminaire, non pas seulement ceux auxquels vous assistez, je
ne vais pas quand mme simplement vous fliciter dĠtre l, ce que je fais trs
volontiers, mais vous le recommander pour la raison que je vais vous expliquer.
Je pense que si on considre ce que jĠai fait, il y a, sĠagissant de la
philosophie proprement dite, deux mthodes dĠentre, deux lectures, deux
pratiques etc. La premire, cĠest ce que jĠappellerai lĠapproche systmatique :
a consiste parcourir, et si possible dans lĠordre, les trois ou quatre
grands massifs de la doctrine ; a comporte un assez rude travail, a
comporte des enjambements mathmatiques certes trs clairs mais trs
prsents, et a comporte lĠessentiel des propositions. Il y a peut-tre une
autre manire de faire, outre la manire qui consisterait faire nĠimporte
quoi, qui serait ce que jĠappellerai le voyage ordonn – ordonn, mais
non selon la construction systmatique. Alors, a pourrait tre quelque chose
comme a : a pourrait intgrer, en lecture prliminaire, les deux Manifestes
(le Premier manifeste pour la philosophie et le Second manifeste
pour la philosophie), de manire avoir en quelque sorte les artes, les
points de repres, les articulations, les nouages. Et ensuite, dans lĠordre
quĠon voudrait, le Sminaire, justement. CĠest autre chose, mme si, la fin
des fins, cĠest la mme, mais cĠest quand mme une autre faon de faire. Je voudrais
profiter de leur prsence pour remercier Vronique Pineau et Isabelle Vodoz qui assurent quand mme le gros du labeur,
cĠest--dire lĠtablissement du texte partir de documents variables :
soit des enregistrements intgraux, soit des documents crits, des notes etc.
et avec tout a composent les sminaires les uns aprs les autres. Ils ne sont
pas publis dans un ordre chronologique, mais justement ils incitent au voyage.
Je rappelle que sont parus Lacan (94-95), Malebranche (1986), Images
du temps prsent (2001-2004), Parmnide (1985), Heidegger (1987),
et puis Nietzsche (92-93). Ds lĠautomne de lĠanne prochaine, il y aura
le sminaire sur lĠUn. Descartes, Platon, Kant (1983) et le sminaire Que
signifie Ç changer le monde È ? (2011-12).
Pour terminer avec ces premires annonces, je vous signale
que le Nietzsche fera lĠobjet dĠune prsentation par moi la librairie Tropiques,
63 rue Raymond-Losserand, Paris 14e,
le mercredi 11 novembre 18h30.
*
Nous allons terminer la thorie de lĠimmanence des vrits
par un retour la question la plus originaire, la plus primitive, qui est
celle des conditions de la philosophie. Vous savez quĠil y a trs longtemps
jĠai nonc que la philosophie est sous condition gnrale des vrits, et plus
spcifiquement de quatre procdures de vrit : la science, lĠart, la
politique et lĠamour. On mĠa souvent pos, et je lĠaffronterai prcisment, je
lĠespre, la fin de LĠimmanence des vrits, la question de quĠest-ce
quĠon pourrait se reprsenter comme lĠventuel croisement, lĠventuelle
combinaison, de deux procdures de vrit distinctes. Question ultime, puisque
cĠest la philosophie qui fait retour vers ses conditions un niveau de
complexit maximal, puisquĠil sĠagit de ce quĠon pourrait appeler le rseau des
vrits, soit ce qui se tisse entre les vrits. Ë lĠarrire-plan de tout cela,
il y a un point dont jĠessaierai de dire quelque chose, mais plus tard, qui est
que, en fait, un croisement de vrits cĠest ontologiquement un croisement
dĠinfinis de types diffrents. Une vrit touche en gnral un type dĠinfini
particulier que lĠontologie mathmatique permet de dchiffrer : avec
lĠontologie, nous pouvons savoir ce que sont des types de vrit diffrents.
Ceux-ci sont convoqus dans chaque procdure de vrit de faon variable :
infini de proximit absolue, infini inaccessible etc. Il en rsulte que le
croisement de deux procdures de vrit est en ralit la question
combinatoire, extrmement sophistique, du rapport entre deux infinis
diffrents. Cette question, nous ne cesserons de la hanter jusquĠau 17 janvier
2017, comme ce qui habite vritablement la question du rapport de la
philosophie aux vrits.
Cette question prend videmment un tour empirique, que lĠon
connat bien. Par exemple, il a t beaucoup crit depuis les origines sur le
rapport de lĠamour avec dĠautres procdures, notamment la procdure
artistique ; amour et posie, cĠest ce qui dfinit un genre particulier,
la posie lyrique ; amour et roman : on peut douter que le roman
existerait si lĠamour nĠexistait pas ; amour et cinma É Il y a galement
quantit de mditations sur le rapport entre science et politique, notamment
cristallises autour de la question de lĠconomie : quelle est, en fin de
compte, la pesanteur propre de lĠconomie et de la science possible de
lĠconomie dans lĠarticulation finale de la politique ? Le marxisme, ou le
lninisme, pouvaient se prsenter comme des politiques scientifiques, cĠest une
tentation mme de lĠÏuvre dĠAlthusser certains gards. De faon gnrale, la
recherche de mdiations de type scientifique entre la science et la politique
tait constante, commencer par lĠanalyse sociale, la thorie des socits. La
convocation de lĠconomie, de la sociologie, de lĠanthropologie, du calcul des
probabilits etc. est inhrente la tentative de faire se croiser science et
politique. Le rapport de la science et des arts est une donne constante aussi,
depuis le dbut. Ds le dbut de lĠarchitecture, celle-ci a convoqu des
problmes complexes la fois de dynamique et de gomtrie dans lĠespace.
AujourdĠhui mme, une partie de lĠart contemporain est une tentative de
sĠapproprier des lments scientifiques, y compris de logique quantique
alatoire, de thories formelles etc. dans les productions artistiques
proprement dites : construction dĠobjets, de prsentations,
dĠinstallations, de performances, qui ont pour soubassement des dveloppements
parfois extrmement raffins et contemporains des diffrentes disciplines
scientifiques. Des figures comme Lonard de Vinci sont des figures qui
sĠtablissent explicitement la jonction de la science et de lĠart. La
politique et lĠart : cĠest toute la question, sans cesse rebattue, de
lĠart engag, de lĠart au service de la rvolution etc. question galement
banale, surtout au XXe sicle, mais qui remonte fort loin : dĠune
certaine faon, lĠexclusion des potes de la cit par Platon, cĠest la mme
affaire, cĠtait dj la suspicion porte sur cette forme de lĠart au nom de la
politique juste. Quant au croisement entre amour et politique, il est quasiment
le sujet principal dĠune grande partie du thtre, notamment dans la forme de
la tragdie. Le plus difficile, sans tre impossible, cĠest de croiser amour et
science, je vous le laisse en exercice É Nous montrerons plus tard que la difficult
de ce croisement, cĠest la difficult du croisement de deux infinis qui ont du
mal sĠapparier lĠun lĠautre É
*
AujourdĠhui, je voudrais reprendre la question de la relation
spciale entre politique et posie dans la forme du prsent dĠun exemple
historique. La connexion est triple dans ses donnes initiales. Premirement,
a se rapporte lĠpoque o, au niveau plantaire, et quoi quĠon pense par
ailleurs de cette situation, il existe deux hypothses diffrentes sur le
devenir gnral de lĠhumanit. Quand on parle de cette question, il faut bien
se souvenir que ce nĠtait pas simplement lĠapparition dĠune orientation
politique parmi dĠautres, a a t, pendant toute une priode, qui a commenc
ds le XIXe sicle et sĠest acheve dans le XXe, lĠide que le devenir gnral
de lĠhumanit tait soumis une division conflictuelle essentielle entre
lĠorientation capitaliste et impriale dĠun ct, et lĠorientation communiste
de lĠautre, et que cĠtait une affaire qui excdait dĠune certaine manire y
compris la politique elle-mme. Autrement dit, cet exemple se situe dans la
squence de lĠexistence de deux visions du monde, deux reprsentations du
destin de lĠhumanit, lĠune fonde en fin de compte sur la proprit et la
concurrence, lĠautre sur lĠide de lĠgalit et de la communaut et puis aprs
a se ramifie jusquĠaux derniers dtails des politiques concrtes. Priode qui,
en ralit, dans sa vivacit propre, va mon avis de 1920 1980 peu prs,
cĠest--dire quĠelle a occup une soixantaine dĠannes. Deuximement, a se
situerait dans le contexte dĠune grande effervescence potique, artistique en
gnral, mais potique aussi, partir des annes 20, avec le surralisme et
quantit dĠautres orientations et propositions concernant lĠactivit
artistique, potique, tout fait extraordinaires, de
lĠhumanit. Et troisimement, a se situe lĠoccasion dĠun pisode historique
essentiel, la guerre dĠEspagne, entre 36 et 39. Donc posie et politique,
cette occasion, dans une figure exceptionnelle de croisement, qui nĠa pas
beaucoup dĠquivalents.
Commenons par les potes. Durant le dernier sicle, dans
presque toutes les langues de la Terre, de trs grands potes ont t des communistes
revendiqus. Donnons une liste : en France, luard et Aragon ; en
Turquie, Nazim Hikmet ; au Chili, Pablo Neruda ; en Espagne :
Rafael Alberti ; en Italie : Eduardo Sanguinetti ; en
Grce : Yannis Ritsos ; en Chine : Ai
Qing ; en Palestine : Mahmoud Darwich ;
au Prou : Cesar Vallejo ; et en
Allemagne : Bertold Brecht. a, quĠon soit
communiste ou anticommuniste, cĠest une collection extraordinaire de potes. Il
sĠest constitu en vrit cette poque une Internationale communiste des
potes. Ce lien, cet ensemble, est-ce quĠon va le comprendre comme lĠeffet
dĠune illusion, dĠune erreur, dĠune errance, ou, au mieux, dĠune ignorance de
la frocit et de la cruaut, indubitables, des tats qui se rclamaient du
socialisme et du communisme ? - ce qui est quand mme le discours dominant
ce sujet. Je voudrai dire que ce qui a anim ces potes, mme quand par
ailleurs ils adoptaient la position du ralliement explicite des
organisations, des partis, ce qui les a anims cĠest une conviction dĠun lien
essentiel entre la posie telle quĠils la concevaient, de faon transforme et
radicale, et le communisme, si on prend communisme au plus proche de son sens
premier, quĠil ne faut jamais perdre de vue, savoir le souci de ce qui est
commun tous. Une sorte dĠamour, tendu ou paradoxal, de la vie commune, de ce
qui, dans la vie commune, permet de dilater et dĠexprimer de faon diffrente
la vie individuelle. Le dsir que ce qui devrait tre commun ne soit pas
appropri hors du commun, cĠest--dire lĠide quĠil fallait dsapproprier le
commun de son appropriation privatise. AujourdĠhui, il nĠest question que de
privatisations, et faire dĠune privatisation un objet potique ce nĠest pas
facile, croyez-moi. La posie de la privatisation, on lĠattendra longtemps ...
Alors que la posie communiste, elle a eu lieu. Je crois aussi que le pote est
communiste en un sens originaire pour une raison tout fait essentielle, cĠest
que son domaine exclusif cĠest la langue, le plus souvent la langue maternelle,
la langue en son sens le plus immdiat. La langue, cĠest ce qui est
originairement donn tous, ds lĠenfance, comme lĠexemple mme de ce qui
devrait tre, de ce qui est, un lien commun. La langue, cĠest ce quĠon donne
celui qui nat pour quĠil devienne un adulte, homme ou femme. CĠest le don
social premier. La langue, cĠest ce qui tend tre le support mme de toute
ide dĠgalit. LĠgalit, cĠest dĠabord lĠgalit dans la langue et pour la
langue. Or je soutiens que la posie, quel que soit son air raffin etc.,
travaille cela. CĠest une des dfinitions possibles de la posie : le
pome cĠest ce qui travaille la langue comme un don fait tout le monde. De l
quĠil y a un rapport profond de la posie lĠenfance, on le sait depuis longtemps.
La posie est lĠart le plus proche de lĠenfance mme quand elle est extrmement
complexe et sophistique. Au fond, le pome cĠest un don que le pote fait la
langue, cĠest un accroissement de la langue, et, comme la langue elle-mme, il
est destin au commun, ce point o il ne sĠagit de personne en particulier
et, en fin de compte, o il sĠagit de tous singulirement. Je pense vraiment
que cĠest pour a que les grands potes du XXe sicle ont interprt, leur
manire, le grand projet rvolutionnaire du communisme, ils y ont reconnu
quelque chose qui leur tait familier. Et cĠest pourquoi tant dĠentre eux ont
ralli cette entreprise. Quelque chose qui leur tait familier, savoir que le
pome donne ses inventions la langue et comme la langue est donne tous, il
convient que le monde entier, intgralement, soit donn tous comme le pome
lĠest. Il faut que, comme le pome, les choses deviennent le bien commun de
lĠhumanit tout entire. Je pense que cĠtait l un projet trs proche de
lĠessence du pome lui-mme. Et cĠest pourquoi nous avons eu cette poque un
croisement effectif, rel, entre le communisme et la posie.
Ce qui est trs frappant, cĠest que, dans le communisme, les
potes ont surtout vu une figure nouvelle du peuple. Ils ont vu une figure
potique du peuple, la possibilit de potiser le peuple lui-mme.
Ç Peuple È, ici, a voulait dire, cette poque, dĠabord les pauvres
gens, la masse immense des pauvres gens, les ouvriers, les femmes abandonnes,
les paysans sans terre etc. Pourquoi tout cela, cette question des
Ç damns de la terre È, intressait-il le pome, me direz-vous ?
Eh bien, parce que cĠest ceux qui nĠont rien quĠil faut tout donner. CĠest au
muet, lĠtranger, quĠil faut donner le pome. Il nĠest pas fait pour tre
donn au barbare, au grammairien, au nationaliste. LĠide mme que le pome
pouvait trouver l une donation ouverte autre chose que la spcialit a
enthousiasm les potes. Au fond, cĠest au proltaire, dfini comme celui qui
nĠa rien que sa force de travail, quĠil faut donner la Terre entire, tous les
livres, toutes les musiques, toutes les peintures, toutes les sciences et cĠest
lui, exemplairement, quĠil faut par consquent donner le pome. Tout a
conduit ces potes, et cĠest l que le croisement entre politique et posie
devient interne la posie elle-mme, retrouver de nouvelles formes ou une
trs ancienne forme, savoir lĠpope. Le pome des communistes, cĠest
lĠpope de lĠhrosme des damns de la terre, de lĠhrosme des proltaires.
Par exemple, Nazim Hikmet distingue dans sa propre Ïuvre dĠun ct les pomes
lyriques, explicitement consacrs lĠamour, et dĠun autre ct les pomes
piques consacrs lĠaction des masses populaires. Cette conscience quĠon
rintroduit lĠpope dans le pome par la mdiation de la nouvelle esprance
politique, est rflchie comme telle par les potes. Si on prend un pote
extraordinairement savant, trs dense, trs mtaphorique, savoir Cesar Vallejo, il est lĠauteur dĠun pome qui sĠappelle
Ç Hymne aux volontaires de la rpublique È dont vous penseriez
quĠil a t crit par Victor Hugo. CĠest lĠindice que, au croisement de la
politique rvolutionnaire et de la posie, vous avez ncessairement quelque
chose dĠpique. Au fond, il dcouvre ce que Victor Hugo avait effectivement
dcouvert, un autre niveau, savoir que le rle du pote, dans sa liaison
avec le mouvement historico-politique, cĠest de chercher dans la langue la
ressource neuve dĠune pope. Une pope qui ne soit plus lĠpope de
lĠaristocratie, des chevaliers, mais qui soit lĠpope du peuple. Et finalement
lĠInternationale des potes communistes de cette poque va organiser le champ
qui sĠtablit entre la misre, lĠextrme duret de la vie, lĠoppression
affreuse, tout ce qui appellerait au fond la piti, mais au lieu dĠen faire une
potique de la piti ils vont en faire une potique de la leve, du combat, de
la pense collective, du nouveau monde, donc de tout ce qui appelle en ralit
lĠadmiration. Cette posie sĠtablit dans un conflit entre compassion et admiration.
La figure de la misre du monde doit-elle tre traite par la compassion,
compassion qui est invitable, quĠil est juste de ressentir, mais son destin
nĠest-il pas dĠadmirer ce quĠil y a de rsistance hroque et de grandeur
cratrice dans le mouvement politique rvolutionnaire, dans la leve,
lĠinsurrection, la rvolte etc ? On a une
proposition qui est violemment potique, qui structure tous ces pomes, entre
lĠabaissement et la leve, le renversement de la rsignation en hrosme,
quelque chose de cet ordre. CĠest ce dont ils cherchent, tous ces potes, la
reprsentation, la figure, la puissance symbolique. Ils cherchent dire, dans
une figure de lĠpope nouvelle, ce quĠon pourrait appeler la patience des
opprims au long des sicles, leur endurance, et le moment o elle se change
enfin en force collective qui va tre celle des corps qui se relvent et des
penses qui se partagent.
CĠest autour de tout cela que les potes qui crivaient
entre les annes 20 et 40 se sont en quelque sorte rassembls,
involontairement, autour de ce moment historique singulier, la guerre
dĠEspagne. On pourrait explique de bien des faons cet engouement pour la
guerre dĠEspagne, je nĠentrerai pas dans les dtails sur ce point, mais il y a
un point quĠil faut souligner, qui est que la guerre dĠEspagne est le moment le
plus fort, peut-tre unique ce jour dans lĠhistoire du monde, de ralisation
du grand projet marxiste de lĠInternationale. LĠInternationale, dans la guerre
dĠEspagne, cĠtait autre chose quĠune bureaucratie sovitique, mais la ralit
dĠune politique rvolutionnaire rellement internationaliste. Comme vous le
savez quand mme, jĠespre, il y a eu un moment dcisif, et immortel en un
certain sens, dans la guerre dĠEspagne, qui a t lĠintervention des Brigades
Internationales. Elles se sont appeles comme a : les Brigades Internationales.
a a t quelque chose sans prcdent, une mobilisation internationale des esprits
et des peuples, rellement. On peut prendre lĠexemple de ce pays : ce sont
des milliers dĠouvriers franais qui sont venus comme volontaires combattre en
Espagne. Il faut imaginer a, ce nĠest pas un pisode quelconque É Et il y
avait aussi des Amricains, des Allemands, des Italiens, des Russes, des gens
de tous les pays É CĠest peut-tre la plus frappante russite, momentane,
circonstancielle, de ce que Marx avait pens sous le nom dĠInternationale, et
qui se rsume en deux phrases. Ngativement : les proltaires nĠont pas de
patrie, leur patrie politique cĠest le monde entier des hommes et des femmes vivants ;
et si le pril dĠune fraction de ce monde est imminent et terrible, comme
cĠtait le cas de faon explicite dans la guerre dĠEspagne, o lĠaffrontement
en dernier ressort tait celui du fascisme et du communisme, alors cĠest une question
pour tout le monde, ce nĠest pas une question quĠon va laisser aux Espagnols.
Et positivement, a veut dire : une organisation internationale cĠest ce
qui permet dĠaffronter et de vaincre lĠennemi de tous, lĠennemi de tous les
peuples du monde, cĠest--dire le camp capitaliste, y compris sous sa forme
extrme : le fascisme.
Les potes communistes ont trouv dans la guerre dĠEspagne,
vous le comprenez bien, de grandes raisons de renouveler la posie pique. En
un certain sens, cĠtait par soi-mme, dans la figure de lĠInternationale des
choses, une pope populaire qui tait simultanment, comme je le disais tout
lĠheure, une pope de la souffrance des peuples - car la souffrance a t
terrible en Espagne - et de leur hrosme internationaliste, organis et
combattant. Et la jointure de tout cela pouvait tre la fois la figure dĠune
pope effective et politique, et la figure de lĠinvention dĠune pope potique
rendant justice, en quelque sorte, dans la langue, dans toutes les langues,
lĠinternationalisme de tous les peuples. Il faudrait faire le livre de tous les
pomes crits pendant la guerre dĠEspagne, ce serait quelque chose de magnifique.
Les titres mmes de ce recueil sont significatifs, ils indiquent presque
toujours une sorte de raction sensible du pote, de souffrance partage avec
lĠpreuve du peuple espagnol et dĠenthousiasme partag avec lĠaction
internationale pour relever cette souffrance. Par exemple, le recueil de Pablo
Neruda a pour titre : Espagne au cÏur LĠengagement premier du pote
est videmment une solidarit subjective, immdiate, affective, et cĠest autre
chose que lĠengagement politique. Le titre le plus magnifique est celui de Cesar Vallejo Espagne, loigne de moi ce calice. Le
calice, cĠest videmment la mtaphore du dchirement et de la souffrance du
peuple espagnol, mais lĠEspagne est ce qui va loigner le pote du calice,
lĠEspagne saura relever cette souffrance et la gurir. En mme temps, Neruda et
Vallejo, partir de points de dpart communs, vont dvelopper des directions
opposes, ils vont chanter la libert inconnue, qui est au fond le secret de
cette posie. Une figure inconnue de la libert, parce quĠelle est la libert
hausse au niveau de la libert galitaire des peuples et des damns de la
terre et non pas la libert aristocratique de lĠindividu qui exprimente sa
propre vie. Tout va tmoigner du renversement dĠune situation angoisse et
particulire en une promesse universelle dĠmancipation. La fonction du pome
va tre de saisir dans lĠabsolue singularit du sensible le travail de la
relve universelle de ce sensible.
Je vais vous dire comment fonctionne ce renversement dans
les mtaphores de Cesar Vallejo. coutez-bien.
Proltaire qui meurs dĠunivers, dans quelle harmonie
frntique
sĠachvera
ta grandeur, ta misre, ton tourbillon foulant,
ta
violence mthodique, ton chaos thorique et pratique, ton besoin
dantesque,
trs espagnol, dĠaimer,
mme
en le trahissant, ton ennemi !
Librateur entrav de chanes, sans ton effort,
lĠtendue
aujourdĠhui nĠaurait point dĠanse,
les
clous erreraient, acphales,
le
jour serait ancien, lent, pourpre
les
crnes que nous aimons seraient sans spulture !
Paysan tomb pour lĠhomme avec ton feuillage vert,
avec
lĠinflexion sociale de ton petit doigt,
avec
ton bÏuf qui demeure, avec ta physique,
avec
ta parole aussi, attache un piquet,
et
ton ciel afferm,
et
lĠargile insre dans ta fatigue
et
celle reste sous ton ongle, cheminant.
Constructeurs
agricoles,
civils et guerriers
de
lĠactive, fourmillante ternit ; il tait crit
que
vous feriez la lumire
fermant
demi les yeux avec la mort
quĠ
la chute cruelle de vos bouches
viendra
lĠabondance sur sept plateaux
tout
dans le monde sera dĠor subit
et
lĠor,
fabuleux mendiants
de votre propre scrtion de sang,
et
lĠor lui-mme alors sera de lĠor !
Vous voyez comment la mort elle-mme, dont il est question
ici tout du long, la mort au combat des volontaires du peuple espagnol, devient
une construction. On peut mme dire que, dans le pome, elle devient une sorte
dĠternit non religieuse, une ternit terrestre. Le pote communiste peut
dire ceci : Constructeurs / agricoles, civils et guerriers / de
lĠactive, fourmillante ternit. LĠternit ce nĠest pas la simplicit une
de lĠau-del, elle est ici, elle est convoque par tous ces hros populaires,
elle est lĠactive, fourmillante ternit. CĠest celle du vrai rel, tout
simplement. Le vrai rel arrach aux puissances cruelles et cĠest
lĠaction qui change tout dans la vie en lĠor vritable. Mme lĠor maudit des
riches et des oppresseurs redeviendra simplement ce quĠil est, pour tous :
de lĠor. Et lĠor lui-mme alors sera de lĠor ! Vous voyez que or
est pris en deux sens opposs, il y a une commutation, une transfiguration,
du mot or, du signifiant de la richesse au signifiant du don qui est
fait tout le monde. On peut dire que la posie chante le monde revenu son
rel, le monde-vrit. a peut natre, a, pour toujours, quand le malheur et
la mort se changent en hrosme. Cesar Vallejo dira
plus loin Victimes en colonnes de vainqueurs. Les victimes, quand elles
se sont disposes dans la puissance collective de leur rassemblement, forment
une colonne de vainqueurs. Et il va sĠexclamer, poussant la synthse son
comble : En Espagne, Madrid, on appelle / tuer, volontaires de la
vie ! CĠest la force du pote de traiter dans la langue la puissance
du paradoxe nu.
Quant Pablo Neruda, il part du mme point : la misre
et la compassion. Dans son grand pome pique, qui, lui aussi, a un titre
extraordinaire : Arrive Madrid de la Brigade Internationale, il
crit : La mort espagnole, acide et aigu / plus que dĠautres morts /
emplissait les champs / jusque l magnifis par les bls. CĠest un constat
terrible. Mais ce quoi il est vraiment sensible, cĠest lĠinternationalisme,
les camarades venus du monde entier sauver cette Espagne o la mort a pratiquement dessch les bls.
Camarades
alors
je vous ai vus
et mes yeux sont encore maintenant
remplis dĠorgueil
parce
que je vous ai vus
au
travers du matin de brume
arriver
sur le front pur de Castille
fermes et silencieux
comme les cloches avant lĠaube.
Arriver
de loin, et de loin pleins de solennit et dĠyeux bleus
arriver de vos cachettes, de vos patries
perdues
de vos rves
pleins de douceur, brls, et de fusils
pour dfendre la cit espagnole o la
libert traque
put tomber et mourir dchire par
les btes.
Frres,
que ds cet instant
votre puret, votre force, votre
histoire solennelle
soient connus de lĠenfant et de
lĠhomme, de la femme et du vieillard
quĠelles parviennent tous les tres
sans esprance, quĠelles
descendent dans les mines ronges par lĠair
sulfurique
quĠelles montent aux chelles inhumaines
de lĠesclave,
que toutes les toiles, que tous les
pis de Castille et du monde
crient votre nom et lĠpret de votre
lutte
et votre puissante et terrestre
victoire pareille un chne rouge.
Car
vous avez fait renatre par votre sacrifice
la foi perdue, lĠme absente, la
confiance dans la terre
et, par votre gnrosit, votre
noblesse, par vos morts,
comme travers une valle de dieux
aux roches de sang,
court un immense fleuve de colombes,
dĠacier et dĠesprance.
Ce
quĠon a l, surtout, cĠest lĠvidence de la fraternit. Le mot camarades
est suivi immdiatement du mot frres. La fraternit, l, met en avant
pas tellement le changement du monde rel que le changement subjectif. CĠest l
que va se jouer le croisement entre la posie et la politique. La dtermination
de la situation va se faire non pas principalement par lĠobjectivit, mais dans
lĠavnement dĠune nouvelle figure de la subjectivit. Ce que Neruda appelle la puissante
et terrestre victoire pareille un chne rouge cĠest avant tout
lĠinstallation dĠune nouvelle confiance. CĠest un point trs important. Il
sĠagit de sortir de toutes les figures du nihilisme rsign en mettant
profit toute situation capable de crer une nouvelle confiance. Confiance dans
les autres, confiance en soi, confiance en la situation, confiance dans la
possibilit. Cette valeur constructive de la confiance est particulirement
ncessaire aujourdĠhui. CĠest une leon que nous devrions retenir, parce que la
menace du nihilisme rsign est particulirement prsente. Nous devons aussi
lire ces potes comme des potes dĠaujourdĠhui.
On
pourrait parler aussi dĠluard, dont il est frappant de voir que le ton
lgiaque - beau monde des masures, de la nuit et des champs - est aussi
appropriable cette situation, qui est une situation pique. luard pense que
les femmes et les enfants, plutt que les guerriers, incarnent tout
spcialement la bont universelle, le trsor subjectif, si vous voulez. Il
interprte la guerre dĠEspagne comme la dfense par les hommes requis au combat
de ce quĠincarnent plutt les femmes et les enfants en tant que figures
universelles de la bont galitaire. Je vous lis un passage du pome La
victoire de Guernica.
Les
femmes les enfants ont le mme trsor
De
feuilles vertes de printemps et de lait pur
Et
de dure
Dans
leurs yeux purs
Les femmes les enfants ont le
mme trsor
Dans les yeux
Les hommes le dfendent comme
ils peuvent
Les
femmes les enfants ont les mmes roses rouges
Dans
les yeux
Chacun
montre son sang
La
peur et le courage de vivre et de mourir
La mort
si difficile et si facile
Hommes
pour qui ce trsor fut chant
Hommes
pour qui ce trsor fut gch
Hommes
rels pour qui le dsespoir
Alimente
le feu dvorant de lĠespoir
Ouvrons
ensemble le dernier bourgeon de lĠavenir
Parias
la mort la terre et la hideur
De
nos ennemis ont la couleur
Monotone
de notre nuit
Nous
en aurons raison.
Je voudrais, pour terminer, voir comment la chose se
prsente plus loin – plus loin que la langue espagnole. Je vous parlerai
de Nazim Hikmet dĠun ct et de Brecht de lĠautre. Le turc et lĠallemand. CĠest
une autre langue et une convocation potique diffrente. La singularit de
Nazim Hikmet, immense pote, comme tous ceux que je vous ai cits, cĠest quĠil
voit dĠabord dans la guerre la profonde universalit de la nostalgie. Il veut
faire entendre que le communisme potique nĠest pas rductible une solide et
vigoureuse certitude de la victoire. Il veut faire entendre le fait que la
conscience politique rencontre par le pome est aussi la conscience de quelque
chose de mditatif, de patient et de profond et quĠil ne faut pas la rsumer en
une sorte dĠpope de la victoire inluctable et de lendemains assurs. Il
crit un cantique une sentinelle de Madrid, un soldat rpublicain espagnol
pris dans sa mditation nocturne. CĠest la nostalgie anticipe ou
lĠanticipation comme nostalgie : ce quĠil prte ce soldat de Madrid,
cĠest lĠide dĠune grandeur et dĠune beaut qui sont ncessaires mais qui ne
sont pas encore tout fait venues. Il pense que la subjectivit vritable de
la patience militante, ce nĠest pas la certitude de la victoire mais cĠest la
reprsentation de sa ncessit, reprsentation nostalgique prcisment de ce
que cela nĠest pas encore advenu, alors quĠil serait tellement ncessaire et
logique que cela advienne. Voici la conclusion de son pome.
Je le sais
tout
ce quĠil y a de grand et de beau
tout
ce que lĠhomme crera de grand et de beau
cĠest--dire
cette terrible nostalgie
cette
fin de mon me
sont
dans les yeux de ma sentinelle la porte de Madrid.
Et moi comme hier, demain, ou ce soir
je
ne peux lui dire que mon affection.
CĠest un mlange du prsent, du pass et du futur que le
pome cristallise sur le personnage imaginaire de la sentinelle face lĠarme
fasciste dans la nuit et la neige de Madrid. Au fond, il y a la nostalgie, au
pass futur si lĠon peut dire, de ce que lĠhumanit vraie, cĠest--dire le
peuple combattant de Madrid, est capable de crer en fait de beaut et de grandeur.
Si ce peuple est capable de le crer, alors lĠhumanit tout entire le crera.
En ce sens, nous pouvons tre, nous avons le droit dĠtre dans la nostalgie de
ce que serait le monde si cette cration avait dj eu lieu. Donc, la posie
est lĠanticipation nostalgique de ce que la politique porte comme possibilit
et qui est reprsente par le sujet nostalgiquement comme Ç cela aurait d
dj tre, cela sera, mais cela nĠest pas encore È. Le pome sĠempare de
ce Ç pas encore È pour en faire entendre la voix aussi, et non pas
seulement la voix en quelque sorte pique du combat. La posie communiste peut
tre aussi une posie lyrique en ce sens l. Je pense que le gnie propre de
Nazim Hikmet tait lyrique et il a Ç lyricis È
la posie pique elle-mme. Si le communisme, cĠest lĠhumanit rconcilie avec
sa propre grandeur, avec ce dont elle est capable, eh bien cĠest ce qui aura
t aprs la victoire. Pour le pote, cĠest dj regret et mlancolie que cet
Ç aura t qui nĠa pas encore t È, aussi bien, comme il le dit, que
la fin de son me. CĠest un pass futur, cĠest un point potique o
nostalgie et esprance sont la mme chose.
Nous terminerons ce florilge de lĠInternationale communiste
des potes par Brecht. Il sĠest naturellement lui aussi engag dans la question
de la guerre dĠEspagne, en crivant une pice didactique qui sĠappelle Les
Fusils de la mre Carrar. Elle est consacre
– de faon trs brechtienne, cĠest--dire toujours un peu oblique –
la ncessit de participer un juste combat, quelles que soient les
excellentes raisons de sĠen tenir lĠcart. Ces raisons, il les dtaille avec
une conscience aigu du fait quĠil les aurait sans doute partages, car cĠtait
un homme engag, absolument, et en ralit dĠune grande patience et dĠune
grande prudence. La prudence, il savait ce que cĠtait, cĠest pour a quĠil a
fait de Galile son hros. Galile, cĠest celui qui avait ouvert le
monde lĠinfini physique mais qui nĠavait pas trs envie de se faire brler
vif par lĠInquisition et qui a sauv sa proposition aussi en trouvant le moyen
de se sauver lui-mme. Ce personnage intresse Brecht, il sĠy reconnat en
partie. Quant la mre Carrar, elle expose de
solides raisons pour ne pas se mler de cette affaire bourbeuse et sanglante,
mais la pice est aussi consacre au fait quĠ la fin des fins il faut quand
mme sĠen mler. CĠest aussi ce que pensait Brecht qui pensait souvent que,
comme il le dit dans une de ses pices, Ç tout a sentait un peu le
poisson pourri È, mais quĠil fallait sĠen mler quand mme. CĠest une
leon quĠil dit esthtiquement et dont il a fait
thtre et posie. Mais le plus important, je pense, dans lĠcriture
brechtienne, cĠest que lui a t contemporain de trs graves et sanglantes dfaites de lĠaction communiste. La guerre dĠEspagne
elle-mme. On a chant la guerre dĠEspagne dans le mouvement de son incertitude
combattante, mais cĠest quand mme une terrible et sanglante dfaite des
rpublicains face aux fascistes. Lui-mme, Brecht, a t prsent et actif au moment
dĠune autre antrieure terrible dfaite : la dfaite du communisme
allemand face au nazisme. Cette question de la dfaite rsonne vraiment dans
lĠÏuvre de Brecht, lĠintrieur mme de la validation potique de lĠensemble
de lĠentreprise. Une des tches quĠil sĠtait fixe
depuis longtemps, comme une tche potique, cĠtait de soutenir la confiance
politique. Pas dĠexprimer ou de traduire la confiance politique, pas de faire
des pomes politiques au sens strict du terme, mais de pousser le pome ou le
thtre jusquĠau point subjectif o on peut soutenir la confiance mme justement
quand les raisons de la perdre sont extrmes. CĠest l la fonction propre de sa
didactique. Ce qui lĠintresse ce nĠest pas du tout dĠopposer, de faon
classique, deux conceptions du monde, mais cĠest la relve de la perte de
confiance. Il a consacr cette tche subjective, qui finalement tourne aussi
autour de la transformation de la rsignation en hrosme, certains de ses plus
beaux pomes. Il y a une concentration abstraite, chez lui, autour du motif de
la confiance et il vise quand mme produire une sorte dĠenthousiasme. Le
titre du pome loge de la dialectique, que jĠai dj plusieurs fois
cit au cours des sminaires, est par excellence un titre brechtien puisquĠil
sĠagit de lĠloge des difficults de la contradiction, cĠest lĠloge de la
possibilit de retournement de la ngativit contre celui qui la manie. On y
retrouve les mtamorphoses temporelles de Nazim Hikmet, cĠest--dire la puissance
du futur, le prsent ramen la puissance du futur et le lien entre tout a et
les lments historiques. Je rappelle cette fin :
Qui donc ose dire : jamais ?
De qui dpend que lĠoppression demeure ? De nous.
De qui dpend quĠelle soit brise ? De nous.
Celui qui sĠcroule abattu, il se dresse.
Celui qui est perdu, il lutte.
Celui qui a compris pourquoi il est l, comment le
retenir ?
Les vaincus dĠaujourdĠhui sont demain les vainqueurs
Et jamais devient : aujourdĠhui.
Le Ç jamais È de la perte de confiance doit tre
le Ç aujourdĠhui È, pour autant quĠon comprenne pourquoi on est l
cĠest--dire quĠon ait comprhension effective et novatrice de
Ç aujourdĠhui È. La thse de Brecht qui est concentre dans ce pome
est que si vous comprenez pourquoi vous tes l, alors vous pourrez dire que ce
qui se prsente comme impossible jamais est en ralit aujourdĠhui dj l.
En effet, comment lĠaction pourrait-elle se soutenir si elle nĠtait pas dĠune
certaine faon lĠaction au prsent ? Ce nĠest pas vrai que lĠaction puisse
tre motive par je ne sais quelle chimre au futur. La propagande est l pour
dire, tout instant, : Ç il y en a qui ont
essay, vous avez vu ce que a a donn etc. È La chicane de Brecht cĠest
de dire : celui qui a vraiment compris pourquoi il est l, il est dj
tourn vers le futur rel et par consquent pour lui lĠnonc Ç a nĠarrivera
jamais È devient Ç a arrive aujourdĠhui È, cĠest dj l. CĠest
la leon la plus importante aujourdĠhui : les spculations sur Ç a
nĠa pas eu lieu È, Ç a nĠaura pas lieu È, Ç o en est le
rapport des forces ? È etc., tout a cĠest bien joli, mais a ne fait
pas une subjectivit active. Et cette subjectivit, cĠest de contraindre
absolument lĠaujourdĠhui, en tant que cet aujourdĠhui cĠest lui seul qui
affirme que les vaincus dĠaujourdĠhui sont demain les vainqueurs et
mtamorphoseront Ç jamais È en Ç aujourdĠhui È.
Vous le voyez : la posie dit toujours lĠessentiel,
cĠest sur quoi je voudrai conclure. La posie, lorsquĠelle croise la politique,
exprime, projette dans le langage, un noyau essentiel de la politique, qui
nĠest pas politique proprement parler, et qui est la dcouverte du type
dĠalchimie latent dans la politique, la force subjective et pensante de la
politique. La posie communiste des annes 30 et 40, dont on vient de parler,
nous rappelle, entre autres choses, que lĠessentiel du communisme, de lĠide
communiste, ce nĠest pas identifiable la frocit dĠun tat, la
bureaucratie dĠun parti, lĠattitude dĠobissance aveugle, et encore moins
lĠesclavage et au travail forc dans les camps, tout cela ayant exist,
absolument. Ç Communisme È ne nomme rien de tout cela.
Ç Communisme È, cĠest la compassion pour la simple vie populaire,
accable par lĠingalit et lĠinjustice, qui ensuite, en tant quĠon comprend
pourquoi elle est l, est la vision dĠune leve la fois pense et pratique.
Le communisme cĠest ce qui rend possible de sĠopposer la rsignation (plus
fondamentalement encore que de sĠopposer au capitalisme). LĠennemi principal,
cĠest de se rsigner ce que les choses soient comme elles sont, ce nĠest pas
un jeu dĠentits abstraites. Finalement, il sĠagit de changer la rsignation en
ce que jĠappellerai un hrosme patient. Ç Hrosme È, parce que, de
fait, dĠune certaine manire, puisquĠon a compris o on en est aujourdĠhui, on
a compris que la situation nĠest pas bonne, quĠelle nĠest pas toujours
excellente. Ce qui importe cĠest lĠinstallation dĠaujourdĠhui en lui-mme en
tant que finalement se constitue cet hrosme patient qui a la capacit
dĠaffronter le monstre sur place et dans la conscience assure quĠil suffira de
faire ce quĠil est requis de faire pour que en ralit ce qui est possible se
transforme. On ne peut pas prjuger de la possibilit parce que dĠune certaine
manire il faut la crer aujourdĠhui. On ne peut pas dire : Ç bon,
alors voyons ce qui est possible, je prends un morceau de possibilit É È
On voit bien que le premier geste de la possibilit, cĠest de dclarer que
cĠest possible sinon vous ne pouvez pas demander que la possibilit vienne vous
trouver, vous, et vous dise : Ç mon petit ami, je vous dclare que
cĠest possible È. CĠest quand mme vous qui devez dclarer la possibilit
et non la possibilit qui va vous dire que vous devez dclarer que cĠest possible.
a cĠest trs important. a nĠempche pas, ensuite, dĠanalyser, comme disait
Lnine, la Ç situation concrte È. Bien au contraire. CĠest
exactement ce que dit Brecht : il faut comprendre pourquoi on en est l
mais de telle sorte quĠon ne puisse pas vous retenir aprs, quand mme.
CĠest--dire que vous soyez celui qui, sachant absolument pourquoi il est l,
va sĠefforcer de crer une possibilit qui soit, aujourdĠhui, la possibilit de
nĠtre pas l, et dĠtre autrement.
La posie nous rappelle tout a dans le trsor des images,
des rythmes, des mtaphores, de la musicalit – de lĠart. Brecht a trs
bien vu a aussi et cĠest la raison pour laquelle il sĠest oppos la vision
tragique et monumentale du communisme, o les peuples sont rassembls sous la
houlette de leur petit pre. Potiquement, il a refus dĠtre stalinien. Il ne
lĠa pas toujours refus dans la situation É Il pouvait, au moins potiquement,
fonctionner comme un homme libre. Brecht dira quĠil y a une posie pique du
communisme, il sĠest toujours prsent comme lĠauteur dĠun thtre pique, mais
cette pope, cĠest lĠpope patiente. Hroque, par sa patience mme. Parce
que classiquement, lĠpope est toujours lĠpope de lĠimpatience, o tout va
se dcider en une fois. Lui, il sait que tout doit toujours tre re-dcid aujourdĠhui et que cĠest la patience qui va venir
bout de lĠadversaire et pas lĠimpatience. Il faut que tous ceux qui se rassemblent
sĠorganisent pour gurir le monde des maladies mortelles que sont lĠinjustice
et lĠingalit et pour a il faut aller la racine des choses, analyser les
situations etc. mais tout cela, va nous dire Brecht, nĠest pas une vision
eschatologique, ce nĠest pas quelque chose de grandiose et de messianique,
quoi on lĠa souvent compar : lĠanalyse du communisme comme
Ç religion sculire È, comme disait Gauchet,
lĠide que a vitait la religion mais en plus mauvais, cĠest une ide
courante. En tout cas Brecht dit exactement le contraire, il dit : a
nĠest pas du tout quelque chose dĠextraordinaire, de monumental, ce nĠest pas
une eschatologie, ce nĠest pas un changement absolu, ce nĠest pas une vision
apocalyptique, cĠest au contraire ce qui est absolument normal. CĠest lĠautre
qui est un monstre. La patience militante, lĠaujourdĠhui conscient de lui-mme,
cĠest a qui reflte le dsir de tous sans quĠils le sachent. Si on explique
cette patience aux gens, ils la rallieront parce que, au fond, cĠest le grand
discours du monument qui les effraie. Cette fonction du pote communiste, telle
que le voit Brecht, doit nous rappeler que la maladie, la violence, la
monumentalit, le grandiose en carton-pte, le blockbuster social cĠest
du ct du monde capitaliste et imprial. Ce nĠest pas du tout du ct de la
grandeur calme, moyenne et patiente de lĠide communiste. CĠest elle qui est du
ct de lĠvidence tranquille, ce sont les autres qui sont des monstres affreux
qui sĠagitent et qui mentent. CĠest ce que nous dit Brecht dans un pome au
titre tonnant : Le communisme, cĠest la solution moyenne.
Je vous lis ce pome.
Appeler renverser lĠordre existant / peut sembler terrible
/ mais ce qui existe nĠest pas un ordre / Se rfugier dans la violence / peut
sembler mchant / mais ce qui sĠexerce constamment, cĠest la violence / et a
nĠa rien de particulier / Le communisme nĠest pas lĠextrme / il ne peut tre
ralis quĠen une toute petite partie / mais avant mme quĠil ait t
compltement ralis / il ne peut y avoir dĠtat supportable / mme pour
quelquĠun dĠinsensible / le communisme est vraiment lĠexigence la plus petite /
ce qui est le plus notre porte / la solution moyenne, raisonnable / Celui
qui devrait tre contre lui / nĠest pas quelquĠun qui pense autrement / cĠest
quelquĠun qui ne pense pas / ou qui ne pense quĠ soi / cĠest un ennemi du
genre humain / qui, terrible, mchant, insensible / et particulirement voulant
lĠextrme / dont il ralise lui-mme la plus petite partie / prcipite
lĠhumanit entire / dans la destruction.
La posie communiste, dĠun bout lĠautre, nous propose une
pope trs particulire, lĠpope de lĠexigence minimale, lĠpope de ce qui
nĠest ni extrme ni monstrueux, cette posie a une grande ressource de douceur,
avec une ressource dĠenthousiasme. DĠun bout lĠautre, elle nous a dit ceci,
cette Internationale potique, bien distincte certains gards de la troisime
Internationale : Ç levez-vous en tout cas pour vouloir, penser, faire
que le monde soit offert tous, comme le pome appartient tous È. Il y
a eu, encore aujourdĠhui, dĠinnombrables discussions concernant lĠhypothse
communiste, on en discute, on en discutera en philosophie, en sociologie, en
conomie, en histoire, en science politique, mais le plus fort, le plus
singulier que je voulais vous dire ce soir, cĠest quĠil y a peut-tre une
preuve du communisme par le pome.
9 novembre 2015
Je vais vous parler ce soir de la terreur (texte prononc
aprs une petite saynte fort rjouissante interprte par Didier Galas, dans
le rle dĠun dnonciateur dĠagissements suspects Sarges-les-Corneilles,
et Alain Badiou, dans le rle du voisin du dessus qui nĠhsite pas se servir
du bton contre le premier, mais Ç le moins possible È,
prcise-t-il).
Comme vous le savez, la terreur exerce par les tats se
rclamant du socialisme et du communisme au XXe sicle a t lĠargument central
pour, en quelque manire, crer un consensus concernant le caractre
intrinsquement ngatif, voire pervers, de ces expriences et, au fond, crer
un oubli gnral de leur signification. La terreur a t lĠlment par lequel,
dĠune certaine faon, on a apprhend lĠensemble de lĠexprience, ce qui
rendait opaques dĠautres lments de cette exprience, comme par exemple le
fait que des millions de gens dans le monde entier sĠtaient passionns pour
cette exprience, avaient consenti pour elle les sacrifices les plus grands,
chose qui ne peut pas sĠexpliquer elle-mme par la terreur.
Au fond, je pense que sur cette affaire de la relation entre
politique communiste et terreur, histoire qui remonte quand mme jusquĠ la
Rvolution franaise, aux annes 93 et 94, il y a eu deux tapes.
Dans un premier temps, sĠagissant tout particulirement des expriences
communistes sovitique et chinoise, on a dit, du ct de la raction ordinaire,
que lĠide communiste tait criminelle ; ds le dbut en ralit, ds le
XIXe sicle, on a affirm que lĠide dĠune galit intgrale tait intenable.
Du ct des communistes, par contre, il faut bien reconnatre quĠon a ni toute
existence de la terreur. On a donc eu une affirmation dprciative absolue dĠun
ct et de lĠautre ct une ngation factuelle qui ne crait aucun espace
dĠintelligibilit de tout a.
Il y a ensuite une seconde squence historique, dans
laquelle en ralit nous sommes encore, o le discrdit de lĠide au nom de la
terreur est peu prs gnral. La conception dmocratique et anti-totalitaire, appelons-l comme a, a affirm la
ralit dĠun lien organique, ncessaire, irrcusable, entre les ides
rvolutionnaires communistes, considres comme utopiques, et la terreur
dĠtat. On ne voit pas aujourdĠhui merger de position affirmative claire
dfaisant ce lien. Ainsi a presque entirement disparu lĠide quĠon puisse
imaginer un bouleversement complet du rgime de la proprit, et en
particulier, comme le disait Marx pour rsumer ses ambitions, la progressive
disparition de la concentration de la proprit prive comme rgle sociale
majeure. LĠide quĠelle soit ncessairement lie la terreur dĠtat a entirement
fait disparatre lĠhypothse elle-mme. Personne ne va plus soutenir
aujourdĠhui, comme cĠtait le cas dans Le manifeste du parti communiste, que
le cÏur de la question cĠest la disparition de la proprit prive É
Je pense que sur cette question de la terreur, prise de
diffrents biais, il faudrait ouvrir une troisime squence, o lĠon
affirmerait quatre points diffrencis.
Premirement, je crois en la ncessit absolue de proposer
une ide stratgique, quel que soit le nom quĠon lui donne, contre la
mondialisation capitaliste actuelle. Il sĠagit dĠempcher que cette mondialisation
apparaisse comme le destin inluctable unique de lĠhumanit, et de recrer la
conviction que, au regard du processus dĠorganisation des socits humaines, il
existe une autre possibilit et non pas une seule. Je pense que nous paierons
un jour un prix terrible si ceci nĠest pas fait.
Le deuxime point, cĠest la reconnaissance de la ncessit
absolue de reconnatre le caractre terroriste de toute tentative dĠincarner
strictement cette vision dans un tat et reconnatre que cette tentative a
dmontr son caractre non seulement mortifre mais impuissant. Ë la fin des
fins, le prix pay a non seulement t extrmement sanglant, mais tout sĠest
effondr ; cela nĠa mme pas comme argument historique en sa faveur une
dure historique et politique consquente.
Le troisime point, cĠest de construire une interprtation
nouvelle, une thorie historique, sur les origines circonstancielles de cette
terreur. JĠentends par l le fait de dlier cette terreur de lĠide stratgique
elle-mme et de montrer que les circonstances de cette ide, la manire dont
elle a t pratique, les dveloppements historiques qui ont t les siens,
lĠont effectivement affecte de ce que le point deux reconnat, savoir le
caractre indubitablement terroriste de la fusion de lĠide dĠmancipation et
de lĠtat.
Le quatrime point, ce serait la possibilit dĠun
dploiement politique de lĠide dĠmancipation, de lĠide communiste,
prcisment orient vers une limitation radicale de lĠantagonisme terroriste et
de son incarnation dans lĠtat. Autrement dit, lĠide dĠune minimisation de
lĠantagonisme dans la contradiction antagonique elle-mme, cĠest--dire la
possibilit dĠun traitement tendanciellement non antagonique (non dictatorial,
violent ou terroriste) de ce qui est pourtant reconnu comme une contradiction
antagonique.
LĠvnement rvolutionnaire, en tant quĠvnement, est, sous
des formes trs diverses, lĠorigine de toute incarnation historique et
politique de lĠide alternative - appelons-l lĠide communiste parce quĠaprs
tout on ne connat pas beaucoup dĠautres termes. Mais cela ne signifie pas que
cette vnementialit rvolutionnaire soit la rgle ou le modle. La terreur,
quĠil faut reconnatre, a t en ralit lĠinsurrection, ou la guerre,
continues en temps de paix par les moyens de lĠtat. Comme si lĠtat socialiste,
lĠtat de dictature du proltariat, peu importe son nom, tait la coagulation,
la forme fige mais durable dans laquelle les moyens utiliss dans
lĠinsurrection et dans la guerre taient aussi les moyens de la construction et
de la paix.
Ce que je pense, cĠest que mme si lĠide neuve,
lĠalternative au monde actuel, a d traverser les pripties de la guerre et de
lĠinsurrection, la politique de cette ide, cĠest--dire la construction de sa
dure, ne doit jamais tre rductible lĠinsurrection et la guerre. La
ralisation politique de lĠide ne doit pas considrer que, parce que la
contradiction est antagonique, les formes spcifiques de cette dure sont
toujours sur le modle de lĠaffrontement. Comprenons bien que lĠessence
vritable du temps politique nouveau quĠil faut construire nĠest pas en soi la
destruction de lĠennemi. La destruction de lĠennemi est une tche ventuelle,
circonstancielle, et en ralit la politique elle-mme nĠest pas dfinissable
dans son essence par la destruction de lĠennemi mais par la rsolution positive
des contradictions au sein du camp rvolutionnaire lui-mme. LĠenjeu est la
construction dĠune nouvelle configuration collective, cĠest--dire dĠune
nouvelle manire, pour le collectif lui-mme, de se reprsenter son propre
destin. CĠest cela la dfinition de la politique : ce nĠest pas le fait de
construire, dans la figure de lĠtat spar, un tat qui soit charg des tches
politiques de la rvolution, mais cĠest la construction politique dĠune
nouvelle configuration collective au sein du collectif.
Il faut repartir des deux dernires hypothses qui ont
prcd celle que je vous suggre ici concernant la terreur. Vous savez que la
discussion sur les chiffres demeure trs importante et que lĠon se jette la
tte les millions de morts. Je pense quĠil faut reconnatre pleinement la
violence et lĠtendue de la terreur stalinienne, il ne sĠagit pas dĠtre
rtract ou dfensif sur ce point. Il faut au contraire la reconnatre et
reconnatre que cela tient pour part aux circonstances. Parce que je rappelle
que jusquĠ prsent les circonstances de lĠavnement de lĠautre hypothse,
cĠest--dire lĠhypothse qui ne serait pas celle de la perptuation du
capitalisme imprial, ont partout t celles de la boucherie mondiale, des
guerres inter-imprialistes. Guerres dans lesquelles le communisme nĠtait pour
rien. Il a mme dsesprment cherch rester extrieur le plus longtemps
quĠil le pouvait ces guerres, avant de sĠy engager de faon dterminante. Les
guerres ont cr le contexte de la possibilit de lĠmergence rvolutionnaire.
La guerre de 14 a t lĠarrire-plan du pouvoir bolchevique, et celle de 40
lĠarrire-plan du communisme chinois.
Ces circonstances ont t aussi la pnurie constante de
cadres rvolutionnaires expriments. CĠest un point trs important, parce que
quand vous nĠavez pas de cadres rvolutionnaires expriments, vous avez des
opportunistes qui sĠimpliquent dans le parti victorieux. Si on suit lĠhistoire
de la Russie stalinienne, on voit des gens prendre telle ou telle position
parce que cĠest a le courant tabli, et ces gens dfendent ainsi la place
quĠils occupent dans la hirarchie de lĠtat. Tout a cre une subjectivit politique
qui, au rebours de ce qui tait requis, est faite de mfiance, dĠangoisse chronique,
dĠincertitude, dĠignorance et de peur de la trahison. La principale maxime a
ainsi t de traiter toute contradiction comme si elle tait antagonique. Ds
quĠun problme surgissait, il fallait dsigner le coupable du problme et
lĠexterminer. Autrement dit, a voulait dire que la politique nĠtait rien
dĠautre que le traitement par lĠtat de toute difficult, de tout problme, de
toute contradiction, par la liquidation des ennemis supposs. Au fond, cĠest
une habitude qui a t prise pendant la guerre civile et pendant la guerre
mondiale : le plus simple est de tuer quiconque nĠest pas avec vous. Si le
plus simple est de tuer quiconque nĠest pas avec vous et si cela sĠincruste
dans lĠtat, eh bien nous avons un tat terroriste comme agent suppos de la
contradiction victorieuse.
Tout cela, vous le voyez, ne concerne pas lĠide communiste
en elle-mme, elle ne concerne pas la construction immanente dĠune nouvelle
conviction politique quant au destin de lĠhumanit. a concerne le processus
particulier de sa premire exprimentation historique, avec les caractristiques
flagrantes dĠune naissance dans le contexte barbare de guerres mondiales
dclenches par les autres, par lĠadversaire, du dclenchement de guerres
civiles froces et impitoyables, comme le sont toutes les guerres civiles, et
en fin de compte la construction dĠun tat dĠune certaine manire dfensif, un
tat qui nĠarrive pas dployer lĠide elle-mme, un tat qui dfend sa propre
existence dans la figure dĠune maxime selon laquelle toute contradiction qui
surgit est lĠÏuvre de lĠennemi et que lĠaction politique consiste dbusquer
cet ennemi et lĠabattre. Je pense que nous devons, et que nous pouvons,
dtacher progressivement la perspective stratgique dĠune ide alternative au
capitalisme mondialis des circonstances qui ont conduit la prsentation de
cette ide dans la figure dĠun tat terroriste.
Le problme qui videmment surgit cĠest : si ce nĠest
pas lĠtat qui en est le garant unique, comment se constitue la prservation
des forces politiques nouvelles ? Comment les forces politiques nouvelles
peuvent-elles subsister dans un univers qui leur est irrductiblement hostile
pendant une longue priode, tant en effet que la nouvelle forme de la collectivit
nĠest pas tablie ? En quoi consiste, en politique, la prservation de
forces htrognes la domination ? CĠest un point cl. En ralit,
jusquĠici la rponse dominante a t que la prservation de forces htrognes
la domination se concentre invitablement dans un tat nouveau. Et on sait,
cĠest a que le XXe sicle nous a appris, que cette maxime est insuffisante. En
ralit, la fin des fins, lĠtat terroriste ne prserve nullement les forces
htrognes la domination. La preuve, historiquement, est l : il finit
par sĠeffondrer et par ramener la situation aux rgles du capitalisme mondialis.
Nous savons donc que ce problme ce nĠest pas la terreur qui peut le rsoudre.
CĠest une affirmation qui remonte loin, parce que souvenons-nous quand mme que
les premiers avoir pens que protger le dveloppement et la continuit des
forces politiques htrognes exigeait un moment donn
la terreur, ce sont les rvolutionnaires franais en 93 et 94. Ce nĠest pas une
invention du communisme, a.
Si nous
pensons que ce nĠest pas la cl du problme, il faut en tirer les consquences
et dĠabord constater que la terreur, au fond, contrairement ce quĠelle
prtend, ne cre dans le peuple quĠune unit politique trs faible. Ce nĠest
pas une unit de conviction, mais, largement, une unit de passivit, conserve
sous la faade de la peur. CĠest une unit fragile. Prserver lĠunit des
forces, cĠest toujours en fin de compte rsoudre des problmes internes au camp
politique concern. Ce que lĠexprience montre, cĠest que lĠaction antagonique
sur le modle militaire ou policier dirige contre les ennemis ou les supposs
ennemis, nie la terreur au sein de son propre camp et ne peut en rien rsoudre
les problmes suscits par votre propre existence politique. Ces problmes
relvent de ce que Mao Zedong a appel la juste rsolution des contradictions
au sein du peuple et, peut-tre, la thse fondamentale de lĠavenir cĠest
dĠafficher un primat de la rsolution des contradictions au sein du peuple sur
le maniement de la contradiction antagonique. Pour bien comprendre ce point, il
faut insister sur un point qui est trs simple, cĠest que la politique cĠest la
recherche de solutions des problmes politiques. La politique, ce sont des
problmes et cĠest le mouvement de solution de ces problmes qui constitue la
garantie de la dure dĠune politique. La politique mancipatrice, communiste,
est une politique immanente. CĠest pour cela que a a voir avec le cours qui
se fait ici sur lĠimmanence des vrits. CĠest une activit qui est sous le
signe dĠune ide partage, elle nĠest pas sous le signe dĠune peur partage ni
mme sous le signe dĠun intrt partag. Au fond la doctrine conomiste cĠest
que tout rassemblement se fait sous le signe dĠun intrt partag et la vision
terroriste, la fin des fins, cĠest quĠil se fait sous la figure dĠune peur
partage (peur la fois de lĠennemi et des moyens disposs contre lĠennemi).
En vrit, elle est une activit qui se fait sous le signe dĠune ide partage,
cĠest une activit subjective. CĠest la construction dĠune subjectivit
politique forte, module en ralit dĠabord par des diffrences - et non par
des units. Il faut se dlivrer de la prdominance suppose de lĠconomie pour
qui la politique est lĠexpression dĠintrts communs (ce qui est la vision
capitaliste elle-mme en ralit), en mme temps quĠil faut se dbarrasser de
lĠide que toute unit relve la fin des fins du formalisme juridico-policier
de lĠtat. Je dirai que tout problme politique se ramne un problme dĠunit
dĠorientation, de construction, aussi lente et longue quĠil le faut –
cĠest un point trs important – sur une question collectivement dfinie
comme tant la question principale du moment ou de la situation. Cette unit
dĠorientation, jĠy insiste, ne peut tre obtenue quĠen traversant et en
activant par la discussion et lĠinvention collective des diffrences constitutives
de tout tre multiple. Mme une victoire contre lĠennemi dpend de lĠunit
subjective qui a t celle des vainqueurs et de rien dĠautre, en fin de compte.
Si ce nĠest pas le cas, nous savons que cĠest une fausse victoire. CĠest une
leon majeure de lĠhistoire du XXe sicle, sicle qui a t truff de fausses
victoires, parce que la figure subjective qui tait derrire tait prcaire ou
inexistante. Entre parenthses, cĠest la conscience que Lnine a trs
tt ; ds les annes 20, il est convaincu quĠune unit politique nĠa pas
vritablement t ralise et que par consquent on va remplacer cette unit
par une unit bureaucratique et tatique qui ne sera pas acceptable. Autrement
dit, la cl dĠun traitement victorieux de lĠantagonisme, cĠest--dire du
conflit avec lĠennemi, rside au long cours dans la juste rsolution des
contradictions, ce qui, en ralit, est la dfinition de la dmocratie relle.
Je
reviens la terreur. La terreur affirme que la coercition tatique est seule
la mesure des menaces qui psent sur lĠunit du peuple en priode
rvolutionnaire. Il faut bien reconnatre que cĠest une ide qui emporte
lĠadhsion subjective de beaucoup, quand le pril est trs grand et la trahison
trs rpandue. Ceci dit, la terreur nĠest jamais la solution du problme
quĠelle prtend traiter, cĠest ce que je pense absolument. Elle est en un sens
son amnagement, pendant un temps. Et a, on lĠa su ds la Rvolution franaise
o, aprs tout, la Terreur nĠa pas empch Thermidor, le coup dĠtat
contre-rvolutionnaire et la dgnrescence de la rvolution. Au lieu dĠtre la
solution dĠun problme, la terreur en est lĠapparente suppression. CĠest une
distinction de la plus haute importance : si le problme disparat, cela
ne veut aucunement dire quĠil a t rsolu. Donc, on nĠest pas du tout dans
lĠassurance quĠil y ait politique, si, comme je vous lĠai dit, la politique
cĠest la position et la solution des problmes. Au fond, la terreur est une
pense qui soutient lĠide suivante : en dplaant les donnes du
problme, on va finalement rendre possible sa solution. Or tout problme
supprim, remplac, par la force est destin faire retour – jĠintroduis
une thse freudienne, si vous voulez : le retour du refoul. Je pense que
la terreur est un refoulement et non une solution. Elle prtend radiquer
lĠadversaire, en ralit elle en rend inluctable le retour. LĠtat terroriste
est un tat qui est habitu aux solutions purement apparentes. LĠide quĠil y a
des ennemis se substitue lĠabsence de solution effective de problmes non ou
mal poss. Ce qui va se passer, cĠest que le personnel de lĠtat lui-mme va
finir par reproduire lĠintrieur la trahison quĠil a pourchasse
lĠextrieur. On sĠaperoit en effet que la caractrisation de lĠtat
terroriste, cĠest quĠil est lui-mme infect de tratres - si on entend par
Ç tratres È des gens qui ont abandonn les objectifs et lĠide
stratgique de la rvolution et qui sont l pour dĠautres raisons que cette
ide : le confort, le fait que ce sont dĠautres qui travaillent et pas
vous, le fait dĠavoir une autorit locale, etc., etc. Et a, cĠest quoi ?
CĠest quĠ lĠintrieur de lĠappareil qui se prsente comme coercitif, comme le
gardien de lĠide politique prolonge, se constituent
prcisment la division et la trahison principale. De ce point de vue, il y a
un rapport avec ce quĠavait dit Mao Zedong : Ç On me demande
toujours, puisque nous sommes dans un pays socialiste : o est la
bourgeoisie ? Eh bien, cĠest trs simple : la bourgeoisie est dans le
parti communiste ! È Et cĠtait bien vrai.
Au
fond, pour viter le court-circuit terroriste, qui est une impatience menant
la trahison, lĠessentiel est de donner la formulation des problmes et leur
rsolution le temps requis. La protection de la politique, cĠest la
construction dĠune temporalit spcifique, et dĠune temporalit qui a pour emblme
la patience. Ce que jĠappelle Ç patience È, cĠest de ne pas rivaliser
avec le temps de lĠadversaire. La plupart des emballements rvolutionnaires ont
pour origine lĠide : Ç on va faire mieux que lĠadversaire et
beaucoup plus vite È. CĠtaient les mots dĠordre : Ç rattraper
lĠAngleterre en cinq ans È, etc., crant une espce de dchanement,
notamment de lĠappareil productif, qui conduisait utiliser le travail forc
et aussi les trucages (les statistiques taient toujours falsifies, plus
personne ne savait ce qui se passait rellement). Cette obscurit interne
lĠexcitation terroriste et la rivalit avec lĠadversaire doit absolument tre
vite. Disons-le comme a : le temps politique de lĠide communiste, la
stratgie de construction dĠun autre monde, ne doit jamais rivaliser avec le
temps tabli de la domination et de ses urgences. Ce qui veut dire que la
temporalit elle-mme est dissymtrique. Au fond, rivaliser avec lĠadversaire,
en ce sens-l, a conduit toujours au semblant de la force et non son rel,
a consiste riger la norme de la force dans la figure du semblant. Au fond,
il faut poser, ce qui peut paratre paradoxal, que le communisme nĠest pas en
rivalit avec le capitalisme, il entre avec lui dans une relation
dissymtrique. Pour rivaliser, il faut que lĠobjectif soit le mme. Les
conditions dramatiques mises en Ïuvre dans la rivalit avec lĠadversaire, quĠil
sĠagisse de la manire dont se sont installs les plans quinquennaux
sovitiques, mais aussi, il faut bien le dire, le Grand Bond en avant de Mao
par beaucoup de cts, cĠtaient des constructions forces. a impliquait un
forage, cĠtait une dnaturation de lĠide stratgique, et en dfinitive
lĠobligation de la terreur. Ë force dĠchouer dans la rivalit, on pensait
quĠelle ne peut tre obtenue que de manire coercitive.
Il y a
en politique une ncessaire lenteur. Une lenteur dmocratique et populaire qui
est propre la juste rsolution des contradictions au sein du peuple. La juste
rsolution des contradictions au sein du peuple, a prend du temps et vous ne
pouvez pas accepter un court-circuit de ce temps par les moyens de
lĠautoritarisme dĠtat. Vous savez que les capitalistes se sont toujours moqus
du fait que dans les usines socialistes, on travaillait assez lentement, et
parfois mme assez peu. Au fond, cĠest une critique de capitaliste. Nous ne
sommes pas ncessairement sous la loi dĠune productivit intense et de lĠextraction
dĠun surprofit li au temps de travail... Il y avait des plaisanteries
l-dessus dans le monde socialiste lui-mme. On disait : Ç cĠest un
monde trs quilibr parce que nous faisons semblant de travailler, et quĠils
font semblant de nous payer !È. Ce nĠtait pas si agressif que a. a
voulait dire en ralit quĠau fond, on nĠtait plus vraiment dans la rgle
salariale, cĠtait un changement dĠunivers ; aurait d rgner le fait
quĠon travaillait parce quĠon avait la conviction quĠil fallait travailler,
mais pas pour le semblant du paiement ou du salaire. Le communisme, cĠest aussi
la fin du salariat. Il y avait une atmosphre de fin du salariat qui rgnait,
malgr tout. JĠai connu lĠpoque o des professeurs qui allaient en Union
sovitique taient assez choqus par le rythme de travail : a commenait
8 heures, mais 9 heures et demie, cĠtait lĠheure du petit-djeuner etc. et
la fin de la journe la quantit de travail avait t assez limite. Plutt
que de mĠen moquer, je pensais que cĠtait au contraire le dernier dbris de
socialisme prsent cette poque, on nĠtait pas encore dans ce que nous
connaissons aujourdĠhui : la cadence, la norme, lĠvaluation, la
rentabilit, etc. Ce qui manquait, cĠtait la conviction subjective lie au problme
politique lui-mme. Le travail productif tait coinc entre Ç on ne fait
pas grand chose È et le travail forc. Et quand il nĠy a plus eu vraiment
le travail forc, le non-travail sĠest impos de lui-mme comme tant la
meilleure solution. Entre les deux, le travail forc, y compris le travail
forc par le salariat, et le travail dsorganis, trop lent, etc., il y a quand
mme autre chose qui est le travail collectivement dcid dans des conditions
claires pour ceux qui travaillent, et qui soumet la production la politique
et non pas lĠinverse. Sinon, le rgime de la concurrence se substitue lĠide
mancipe du travail qui est : ce que je fais, je le fais parce que jĠai
la conviction que cĠest intressant pour moi et pour les autres de le faire. Si
lĠorganisation collective du travail est diffrente, a porte l-dessus la
fin des fins, cĠest--dire sur le statut effectif du travail, la relation du
travail lĠargent et la circulation montaire en tant que telle. Si on ne
touche pas ce point, cĠest, dĠune certaine manire, quĠon nĠest pas dans une
orientation rellement htrogne. Autrement dit, y compris la question du
temps de travail nĠest pas mesurable de la mme faon selon quĠelle est
rapporte la production de plus-value pour le propritaire de lĠentreprise,
cĠest--dire les profits de lĠoligarchie, ou selon quĠelle est rapporte aux
prvisions nouvelles de ce que doit tre la vie des gens au travail. Ce qui est
essentiel dans lĠide alternative, cĠest dĠaffirmer que notre temps, le temps au
sens de la temporalit, nĠest pas celui du capital.
Je
dirai ceci : la terreur, loin dĠtre une consquence de lĠide stratgique
communiste, rsulte en fait dĠune fascination pour lĠadversaire. Le capitalisme
a t le serpent crotale du communisme. Il sĠest install une rivalit
mimtique avec lui, y compris dans les moyens qui nĠtaient pas du tout ceux de
lĠadversaire et qui nĠavaient rien lui envier sur leur caractre rpressif,
savoir lĠusage massif du travail forc comme compensation lĠabsence de
subjectivit politique construite concernant le travail mme. Ensuite, il faut
bien voir que cet effet de rivalit avec le capitalisme, cet effet de
coercition, induit peu peu un abandon pur et simple de lĠide elle-mme.
LĠide qui justifiait cette pseudo-rivalit, lĠide quĠon construisait un monde
alternatif, diffrent de celui qui existait, est elle-mme puise petit
petit dans une sorte de violence paradoxale qui consiste vouloir obtenir les
mmes rsultats, voire des rsultats suprieurs, y compris par les moyens de la
coercition pure et simple, alors que ce qui a t dsir, et en partie cr,
cĠtait des conditions nouvelles qui justement ne pouvaient pas obtenir les
mmes rsultats parce que ce nĠtait pas dans la mme norme. Au fond, la violence
terroriste dtruit le temps propre de lĠmancipation. Alors, la fin de tout
a, on voit apparatre des gens comme Gorbatchev, ou les actuels dirigeants
chinois, dont le seul but est dĠtre admis comme des gens raisonnables,
civiliss, dans le petit groupe de lĠoligarchie capitaliste internationale, des
gens qui veulent tout prix tre reconnus par leurs supposs adversaires, des
gens pour qui lĠide nĠa plus aucun sens, et pour qui, la fin des fins, le
but de la diffrence aura t de conqurir un pouvoir dans lĠidentit. On
sĠaperoit alors, cĠest un point essentiel, que la terreur nĠa abouti quĠ la
renonciation, prcisment parce quĠelle nĠa pas permis la conservation des
forces et leur dplacement, et elle nĠa pas consacr lĠessentiel du temps,
comme toute pense politique le doit, cette prservation. Elle nĠa pas
constamment politis le peuple, elle lĠa au contraire dpolitis, et en fin de
compte, elle a descell, dsorient, lĠide mme du communisme.
Si lĠon
admet, je vous propose cette hypothse, cĠest la mienne, que le recommencement
de lĠide communiste est la tche du sicle en cours, je pense que lĠide
dĠurgence rvolutionnaire doit tre remplace par ce que jĠappellerai son
esthtique, au sens de Kant. Nous dsirons crer non pas une modification
locale, ventuellement violente, concentre, de ce quĠil y a, nous dsirons que
le collectif humain lui-mme soit en quelque sorte courb dans un nouvel
espace, install dans une nouvelle dimension du point de vue de sa temporalit
gnrale. Nous trouverons alors l dans lĠide ce qui lui a fait dfaut, dfaut
dont la cause et le prix pays ont t le recours la terreur, au travail
forc et au primat absolu de lĠantagonisme. On trouvera lĠabsolue indpendance
des lieux et du temps. Et a, cĠest la condition sine qua non dĠun
nouveau monde bien plus que le problme dĠun nouvel tat. On peut le dire
autrement : ce qui importe, cĠest que lĠide gouverne la temporalit
politique et quĠelle puisse unifier les trois termes constitutifs de toute
situation historique, savoir le mouvement de masse, lĠtat, et lĠorganisation
politique. Ces trois termes ont t, sous le rgime de la terreur, disjoints en
ralit, spars et concentrs dans lĠtat, et il faut quĠils soient nouveau
distribus dans leur singularit et articuls, traverss, par la conviction
commune. Voil pourquoi, en dfinitive, la terreur, nous pouvons en proposer un
bilan interne lĠhistoricit de lĠide, sans avoir renoncer, je crois,
lĠide elle-mme.
11 janvier 2016
2 PUBLICATIONS
RECENTES DE ALAIN BADIOU
Notre
mal vient de plus loin (qui
est une version un peu corrige de la confrence faite le 23 novembre 2015
propos des meurtres de masse du 13 novembre) [ditions Fayard]
Le noir
– clats d'une non-couleur [ditions
Autrement]
Je commence par vous prsenter mes vÏux.
Les vÏux ont partie lie avec la question du fini et de l'infini. Un vÏu
authentique est un vÏu qui cherche soutenir le systme des possibilits
auxquelles est expose l'existence de l'autre, au choix et au dploiement de
ces possibles. C'est le ct infini du vÏu, car ces possibilits prtes
l'autre, ce quoi, prcisment, il se voue, a peut tre une ouverture
l'infini – mais c'est trs difficile soutenir, surtout sur une petite
carte ... Par contre, quand le vÏu est du ct fini, c'est le vÏu intress,
par lequel il est suggr l'autre (souvent le suprieur) non pas qu'il
ralise les possibilits qui sont les siennes propres, mais qu'il aide
raliser les vtres, ou, comme on dit, renvoyer l'ascenseur. On s'adresse ici
l'autre en tant qu'il s'agit que l'autre s'adresse vous.
Le vÏu en tant que rituel social, ce sont les vÏux protgs, d'une
certaine faon, de leur possibilit immanente d'infini. C'est pour a que cela
se rduit Ç Bonne anne !È.
En tenant compte de tout a, je vais vous prsenter les miens. Aprs les
avoir rdigs – parce qu'il faut faire attention : devant un public
aussi vaste, largement compos de gens que je ne connais pas, je me suis rendu
compte que je m'exposais de grands risques. Notre Premier ministre a trs
justement proclam un axiome politique qui marque un heureux tournant dans nos
valeurs bien franaises et totalement rpublicaines : Ç L'essence de
la libert, c'est la scurit È (en ralit il n'a pas dit
Ç l'essence È, il a dit : Ç La premire des liberts, c'est
la scurit È, c'est moi qui traduis dans mon jargon philosophique).
Si je suis le fil de la pense de notre Premier Ministre, la scurit
doit tre absolue, sinon nous sommes exposs l'infinit insinuante et
angoissante des risques. Or l'homme rpublicain, libre et occidental a le droit
de ne courir aucun risque. L'tat est avant tout une assurance tout risque,
plus ou moins gratuite. Ce droit, il convient la police rpublicaine de le
garantir chaque citoyen-n-e. Si bien que nous devons oser cette
formule : Ç L'essence de la libert, c'est la police È. Et quand
apparat le moindre risque, l'urgence est d'appeler au renforcement infini de
la protection policire de notre finitude. Formule qui n'est dialectique qu'en
apparence : l'infinit policire de l'tat d'urgence est destine
protger les citoyens de l'infinit elle-mme ; les mesures les plus
rpublicaines dont il se compose visent mettre dans une ombre carcrale
extrmement finie quiconque est souponn d'un dvouement ou d'une tentation
perverse quelque forme d'infinit, ou, comme il est galement dit, quiconque
est souponn de Ç radicalisation È.
Ds ses dbuts, notre actuel chef de gouvernement (aprs avoir t chef de
la police, rappelons-le) avait, sans hsiter, dispers, incarcr et perscut
ceux qui, sous le nom un peu louche de Roms, sont des
nomades de provenance incertaine qui circulent sur notre territoire fini. Un
nomade, c'est quelqu'un qui semble prfrer l'infinit des voyages, l'incertitude
du nomadisme, l'inscurit des campements en plein air un logement clos dont
l'heureux habitant rpublicain et citoyen nourrit le juste dsir de devenir le
propritaire exclusif. Il sera alors prt, cet habitant, dfendre sa
scurit, donc sa libert, c'est--dire la clture de sa proprit, avec un
fusil et un chien policier. Contre ce beau et libre dsir, l'errance infinie du
Roms, qui menace la finitude du propritaire, n'est
pas rpublicaine, a dit alors raisonnablement et trs fermement Valls, chef de
la police, et donc chef de la scurit, ce qui veut dire, la formule est
audacieuse mais juste, chef de la libert. Il a dit, ce chef de la
libert : Ç ces gens veulent de l'infini, du risque, eh bien ils vont
en avoir ! È Il a envoy la police rpublicaine disperser et dvaster
leurs campements sauvages et on a entam, Dieu merci !,
leur rducation rpublicaine par la belle finitude de l'incarcration.
Ceci se disposait dans une pense plus vaste qui est la suspicion
rpublicaine l'gard de quiconque n'est pas un Franais incontestable, dot
de parents franais, et aussi, si possible, d'arrire-grands-parents franais,
pour ne rien dire de l'excellence ce qu'ils soient franais du ct de vos
deux parents franais. L, votre finitude identitaire fait plaisir voir.
L'tranger, c'est le contraire. Tout tranger, en effet, n'tant pas d'ici, est
d'ailleurs. Or, ailleurs c'est grand, et mme trs grand. C'est peut-tre
infini, et l'infini est bourr de terroristes, tout le monde le sait. Ces
trangers, il faut donc les avoir l'Ïil et user, les concernant, de la
perquisition jour et nuit et des contrles incessants dans la rue. Notre
libert l'exige, c'est le minimum, et s'ils continuent obstinment aller souvent
ailleurs, notamment dans les rgions du monde o svissent les radicaux de la
radicalisation, il faut les rduquer par une finitude svre et, si a ne
marche pas, les renvoyer. Les renvoyer o ? En tout cas, ailleurs. C'est
pour a que je me suis dit, moi-mme : Ç en prsentant tes vÏux
ton sminaire, des gens que tu ne connais pas tous, tu cours des risques,
donc tu n'es pas en scurit, donc tu n'es pas libre È. Et en vous
regardant, l, tous, je me dis qu'il y a peut-tre parmi vous des gens qui
viennent d'ailleurs, et mme de plusieurs pays, ce qui veut dire qu'ils
viennent de plusieurs ailleurs diffrents – de l'infini multipli en
somme. En plus l'entre est libre, dans ce Thtre de la Commune. Libre,
c'est--dire risque, c'est--dire inscure,
c'est--dire pas libre. C'est dialectique en apparence, mais, je l'ai dj dit,
c'est le prix payer pour que le chef de la police soit content. Songez que
mme un Roms pourrait s'asseoir tranquillement l,
dans la salle. Vous n'allez pas me dire que a ne menace pas notre finitude
rpublicaine É Et d'ailleurs, ce thtre a un nom un peu suspect. Parce que la
Commune de Paris, entre nous, c'tait la rverie infinie, il y avait l trs
peu de finitude, c'taient quasiment des communistes, ces gens de la Commune de
Paris, ils taient infinis fond. Il a fallu tous les tuer, c'est vous
dire. Vingt mille fusills dans les
rues de Paris pour sauver in extremis la scurit des propritaires, et
donc la libert. C'est triste, mais c'est ncessaire. Qui les a fusill ?
Eh bien ceux qui ont fond notre rpublique, ceux qui ont des rues et des
avenues partout en France : Auguste Thiers, Jules Ferry, Jules Simon,
Jules Grvy, Jules Fabre. ils ont fait un boulot terrible, ces fondateurs de la rpublique.
Triste, mais juste. Parce que fusiller l'infini est souvent une ncessit pour
l'tat, pour sa police, pour la scurit et donc pour notre libert
rpublicaine. Dans ce thtre hant par l'infini, je dois donc me protger un
max, comme on dit dans notre pays libre, festif, joyeux, rpublicain et scure. Il faut que j'applique le principe de prcaution,
le principe de la scurit maximale, donc de la libert la plus finie, donc la
plus grande, il faut que je contrle mes vÏux au contact de tout l'ailleurs
qu'il y a ici, qu'il ne devienne pas infini. Parce qu'alors ma finitude
disparatra dans l'infini et ce sera ici-mme, Aubervilliers, la Commune de
Paris. Et alors, mes amis, on y passera tous, parce que le spectre de Jules
Ferry, fondateur de la rpublique, de l'cole laque et du colonialisme veille
sur tout ce qui est enseignement public. Jules Ferry qui a dit, dans un
discours l'Assemble Nationale : Ç Messieurs, il faut parler plus
haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet les races suprieures
ont un droit vis--vis des races infrieures, parce qu'il y a un devoir pour
elles, elles ont un devoir de civiliser les races infrieures È.
Je dois vous dire, entre parenthses que, pendant plusieurs annes, j'ai
enseign l'amphithtre Jules Ferry, vous voyez l'amer problme subjectif É
Alain Badiou fait alors la lecture de Ç la version prcautionneuse
de (ses) vÏux, laquelle est en conformit avec le principe de prcaution
inscrit dans la Constitution et avec tous les impratifs de la scurit É et
donc (qui sont) libres comme l'air È. Inutile de prciser qu'il s'agit
d'un texte parodique.
[Transcription
par Gustavo Chantaignier]
Avant
de prsenter mes vÏux un public aussi vaste, largement compos de gens que je
ne connais pas, je me suis soudain rendu compte que je mĠexposais de
considrables risques. Notre premier ministre, lĠnergique Manuel Valls, a trs
justement proclam un axiome politique qui, je le crois, marque un heureux
tournant dans nos valeurs bien franaises et totalement rpublicaines. Il a dit
en effet : Ç lĠessence de la libert, cĠest la scurit È. Notez bien, il
nĠa pas dit Ç lĠessence È, qui pour lui dsigne trs justement du ptrole
raffin. Mais je rsume sa pense concrte dans une phrase abstraite. Cette
magnifique sentence de Valls nous dit quĠil faut concevoir la libert
rpublicaine dans le juste appareil dĠune protection par la finitude. La
scurit, en effet, qui concerne lĠindividu et ses proprits, qui porte donc
sur un domaine essentiellement fini, doit tre absolue. Sinon, nous sommes
immdiatement exposs quoi ? Eh bien, lĠinfinit insinuante et angoissante
des risques. Or lĠhomme rpublicain libre et occidental a le droit, le droit
absolu, de ne courir aucun risque. LĠtat est dĠabord et avant tout une assurance
tous risques. Et ce droit, il revient la police rpublicaine de le garantir
chaque citoyen, et naturellement, dans notre Rpublique moderne, galement
chaque citoyenne. Si bien que nous devons oser une formule qui parait en effet
ose, mais qui dcoule absolument de la formule de notre premier ministre. Oui,
lĠessence de la libert, cĠest la scurit, et donc, la philosophie
rpublicaine de la finitude scuritaire nous impose de dire : lĠessence de la
libert, cĠest la police. Et par consquent, lĠurgence quand apparait le
moindre risque, cĠest dĠappeler urgemment un renforcement infini de la
protection policire de notre finitude. La formule -- protger notre finitude
individuelle par lĠinfinit policire -- peut paratre exagrment dialectique.
Mais elle est heureusement dpourvue de tout risque. LĠinfinit policire de
lĠtat dĠurgence est en effet exclusivement destine protger tous les
citoyens de lĠinfini lui-mme. Comme le montrent les trs belles formules qui
dfinissent les actions particulirement finies de lĠinfinit policire. Citons
parmi ces belles formules, lĠincarcration prventive, la restriction du droit
dĠaller et de venir, lĠassignation rsidence, la privation de la nationalit,
lĠlargissement du droit de la police tirer sur tout ce qui bouge, le droit
de perquisition illimit jour et nuit et le droit dĠcouter les conversations
tlphoniques de nĠimporte qui nĠimporte quel moment, tout comme celui de
lire les messages lectroniques de nĠimporte qui dans nĠimporte quelle
direction. Toutes ces procdures, rigoureuses mais indispensables, visent
mettre dans une ombre carcrale extrmement finie quiconque peut tre souponn
de tendances infinies, et ainsi de le rduquer par les mthodes les plus rpublicaines.
En particulier, on radiquera en lui la tendance effrayante croire quĠil y a
quelque chose de plus que le monde tel quĠil est. Tendance trs justement
nomme Ç radicalisation È, ce qui veut dire : avoir une pense radicale. Et Ç
radicale È, cela veut dire : qui pense les choses jusque dans leurs racines.
Voil le pril de lĠinfini : la racine ! Les choses que nous connaissons auraient-elles
dĠinvisibles racines quĠil faut penser avec force, et ventuellement extirper ?
Cette vision des choses est non seulement ridicule, mais dangereuse. Les
mthodes finies de lĠinfinit policire visent d-radicaliser tout ce qui
bouge, et arracher toutes les racines de la pense radicale. Arracher les
racines de la pense enracine est la racine mme de la dradicalisation.
Sur ce but suprme, il faut tre intransigeant et constamment vigilant.
Un
point symbolique de cette vigilance a t du reste affirm, bien avant les
rcents attentats, par celui qui est devenu, sous la protection paternelle du
prsident Hollande notre actuel chef de gouvernement aprs avoir t notre chef
de la police, celui que jĠai nomm en commenant ce prambule mes vÏux,
lĠinflexible Manuel Valls. Ds ses dbuts, et sans hsiter, il a dispers,
incarcr, perscut, ceux qui, sous le nom par lui-mme louche de Ç Roms È, sont des nomades de provenance incertaine qui
svissent de faon anormale sur notre territoire fini. QuĠest-ce en effet quĠun
nomade, je vous le demande ? CĠest quelquĠun qui semble prfrer lĠinfinit des
voyages, lĠincertitude du nomadisme, lĠinscurit des campements en plein air
un logement clos dont lĠheureux habitant rpublicain et citoyen nourrit le
juste dsir de devenir le propritaire exclusif. Et quand il le deviendra, il
sera prt dfendre sa scurit, cĠest dire la clture de sa proprit, avec
un fusil et un chien policier. Contre ce beau et libre dsir, lĠerrance infinie
du Roms, qui menace la finitude du propritaire,
nĠest pas rpublicaine, a dit alors trs fermement et raisonnablement Valls,
chef de la police, et donc chef de la scurit, ce qui veut dire, la formule
est audacieuse mais juste : chef de la libert. Il a dit, le chef de la libert
: Ces gens veulent de lĠinfini, ils veulent du risque ? Ils vont en avoir. Et
il a envoy la police disperser et dvaster leurs campements sauvages et
entamer leur rducation rpublicaine par la belle finitude des contraventions,
des expulsions et des incarcrations.
Ceci
du reste se disposait dans une pense plus vaste, qui est la suspicion
rpublicaine lĠgard de quiconque nĠest pas un franais incontestable, dot
de parents franais. Et aussi, si possible, dĠarrire-grands-parents franais,
cĠest encore mieux. Pour ne rien dire de lĠexcellence quĠil y a ce que vos arrires-arrires
grands parents soit eux-mmes franais, et ce du ct
de vos deux parents franais. L, votre finitude identitaire fait plaisir
voir. LĠtranger, cĠest le contraire. Tout tranger en effet, nĠtant pas
dĠici, est dĠailleurs. Or ailleurs, cĠest grand. CĠest mme trs grand. CĠest
peut-tre infini, Ç ailleurs È. Et lĠinfini est bourr de terroristes, cĠest
vident. Donc, ceux qui nĠont pas leurs arrire-grands-parents tous franais,
dans les deux directions parentales, il faut, au minimum, les avoir lĠÏil et
user les concernant de la perquisition jour et nuit comme du contrle incessant
dans la rue. Notre libert, dont je vous rappelle que le chef est le chef de la
police, lĠexige. Au maximum, sĠils continuent obstinment aller souvent
ailleurs, notamment dans les rgions du monde o svissent les compltement
radicaliss de la radicalisation, il faut les rduquer par une finitude
svre, draciner leur got pour les ides qui vont la racine des choses, et
si a ne marche pas, les renvoyer. Les renvoyer o ? En tout cas, ailleurs.
Alors,
vu tout a, je me suis dit, en me parlant moi-mme familirement, dĠindividu
fini individu fini : Ç mon vieux, en prsentant tes vÏux ton sminaire,
comme a, des gens que tu ne connais pas tous, tu cours des risques. Donc tu
nĠes pas en scurit. Donc tu nĠes pas libre È.
En
vous regardant, l, tous, devant moi, je me dis : il y a peut-tre l des gens
qui viennent dĠailleurs. Et mme, des gens venus de plusieurs pays diffrents,
ce qui veut dire quĠils viennent de plusieurs ailleurs diffrents. a, cĠest de
lĠinfini multipli, un risque norme ! LĠentre est libre, dans ce thtre de
la Commune. Libre, cĠest--dire risque, cĠest--dire inscure,
cĠest--dire pas libre. CĠest dialectique en apparence a, pas libre parce que
cĠest libre. Mais je lĠai dj dit : cĠest le prix payer pour que le chef de
la police soit content. Songez que mme un Roms
pourrait sĠasseoir tranquillement l, dans la salle. Vous nĠallez pas me dire
que a ne menace pas notre finitude rpublicaine, un truc pareil.
Et
dĠailleurs, ce thtre, il a un nom un peu suspect. Parce que la Commune de
Paris, entre nous, cĠtait de la rverie infinie. CĠtait quasiment de vrais
communistes, les gens de la Commune de Paris. Ils taient infinis fond ! A
mon avis, ils taient tous, je dis bien tous, compltement radicaliss. Et rien
faire pour les d-radicaliser ! Mme une thrapie de groupe muscle
accompagne de puissants neuroleptiques ne pouvait y parvenir. Il a fallu tous
les tuer, cĠest vous dire. Vingt-trois mille fusills dans les rues de Paris
pour sauver in extremis la scurit des propritaires, et donc la libert.
CĠest triste, mais cĠest ncessaire. Et qui les a fusills ? Ceux qui ont fond
notre rpublique, ceux qui cĠest quĠils ont des rues et des avenues partout en
France : Auguste Thiers, Jules Ferry, Jules Simon, Jules Grvy, Jules FavreÉIls
ont fait un boulot terrible, ces fondateurs de la Rpublique. Triste, mais
juste. Fusiller lĠinfini est souvent une ncessit pour lĠtat, pour sa police,
pour la scurit et donc pour notre libert rpublicaine.
Alors,
vous imaginez ! Dans le thtre de la Commune, un thtre hant par lĠinfini,
je dois me protger Ç un max È, comme on dit dans notre pays libre, festif,
joyeux, rpublicain, scureÉ Il faut que jĠapplique
le principe de prcaution, le principe de la scurit maximale, donc de la
libert la plus finie, donc la plus grande. Il faut que je contrle mes vÏux,
quĠau contact de tout lĠailleurs quĠil y a ici, ils ne deviennent pas infinis.
Parce quĠalors, ma finitude disparatra dans lĠinfini, et ce sera, ici mme,
Aubervilliers, la Commune de Paris. Et alors, mes amis, on y passera tous.
Parce que le spectre de Jules Ferry, fondateur de la Rpublique, de lĠcole
laque et du colonialisme, veille sur tout ce qui est enseignement public. Il a
dit, Jules Ferry, je le cite exactement, cĠest tir dĠun discours du vnr
fondateur de notre cole rpublicaine, laque, et pleine ras bords de
scurit, coutez bien : Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il
faut dire ouvertement qu'en effet les races suprieures ont un droit vis vis
des races infrieures, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un
devoir de civiliser les races infrieures [...]
Vous
avez bien entendu ! Les infrieurs sont ailleurs, il faut leur apprendre ce que
nous sommes, ici. Civiliss, nous sommes ! Encore rcemment, suite des
massacres de masse nihilistes et horribles, notre prsident a dit quĠil y avait
une guerre mondiale entre les barbares et les civiliss. Hollande et Jules
Ferry, mme combat, civilis, policier, laque et scuritaire ! Mme en
prsentant mes vÏux, je ne dois pas oublier, vu quĠil y a peut-tre ici des
gens dĠailleurs, les devoirs de la civilisation, les valeurs franaises. Je
suis coinc, ici, entre le nom de ce thtre, le nom infini Ç La Commune È, et
le spectre de Jules Ferry, qui a enseign aux communards et aux coloniss la
finitude civilise. Il faut, en vous prsentant mes vÏux, que je me faufile
entre ces deux termes contraires : Ç Commune de Paris È et Ç Jules Ferry È, ou
encore Ç infini È et Ç fini È.
CĠest
l que je vais utiliser largement des formules de Christian Duteil, journaliste
et philosophe, critique et humoriste, qui sait parler
comme il convient de ceux qui nous gouvernent, comme de nos rites sociaux.
Voici
donc la version prcautionneuse de mes vÏux laquelle est en conformit avec le
principe de prcaution inscrit dans la Constitution, et avec tous les
impratifs de la scurit sociale, ce qui veut dire : bien dans lĠabri des
lois, de la justice, de la police, et donc libre comme lĠair.
Je
vous prie tous, l devant moi, d'accepter mes vÏux l'occasion du solstice
d'hiver et du premier de l'an sans aucune obligation implicite ou explicite de
votre part, surtout si vous tes franais la troisime gnration, mais sans
exclure les autres, sans non plus exactement les inclure, du moins sans examen
pralable. Mes vÏux seront en adquation avec la tradition, la religion ou les
valeurs existentielles de votre choix, dans le respect de la tradition, de la
religion ou des valeurs existentielles des autres, ou dans le respect de leur refus,
en la circonstance, de traditions, religions ou valeurs existentielles, ou de
leur droit de manifester leur indiffrence aux ftes populaires programmes, en
sorte quĠau bout du compte, mes vÏux soient indubitablement laques,
cĠest--dire marqus par une indiffrence totale toute conviction sinon la
forte conviction laque elle-mme, savoir quĠavoir une conviction ou une
Ide, quelle quĠelle soit, expose en gnral lĠinfini, donc des risques, et
nĠest donc pas conforme notre conception rpublicaine pleine dĠune festive
finitude. Juste aprs lĠimpratif rpublicain de lĠessence de la libert en
tant que suprmatie de la police, vient en effet le sage conseil philosophique
de notre socit : vis sans Ide ! Ceci dit, pour ne prendre aucun risque, je
prsente aussi mes vÏux ceux qui ont une Ide, tout en leur faisant savoir,
en toute fraternit rpublicaine, que je nĠen ai aucune. Et en particulier, je nĠai
aucune ide contraire lĠide quĠils ont, sinon justement lĠide de nĠavoir
aucune ide, laquelle nĠest pas une ide, mais une opinion que je ne veux
imposer personne, mme si je me lĠimpose moi-mme.
Bien
entendu, mes vÏux concernent votre sant. Mais ceci ne suppose de ma part aucune
connaissance particulire de votre dossier mdical, ni une quelconque volont
de m'immiscer dans le dialogue confidentiel tabli avec votre mdecin traitant.
De mme, je ne prtends nullement mĠinsinuer entre vous et votre assureur,
notamment dans le cas o vous seriez en train de discuter avec lui une
convention visant couvrir les frais de vos obsques.
Mes
vÏux concernent aussi votre prosprit. Mais bien entendu, jĠignore tout de la
somme figurant sur votre dclaration de revenus, de votre taux d'imposition et
du montant des taxes et cotisations auxquelles vous tes assujetti.
Mes
vÏux concernent enfin votre bonheur. Mais l'apprciation de cette valeur est
laisse votre libre arbitre et il n'est pas dans mon intention de vous
recommander tel ou tel type de bonheur. JĠai sans doute crit un livre qui
sĠappelle Ç Mtaphysique du bonheur rel È, mais vous nĠavez mes yeux nulle
obligation de le connatre, encore moins de le lire, et encore moins dĠen tirer
quelque ide qui mettrait en danger vos opinions ordinaires, et vous exposerait
peut-tre, pour couper vers le pire, un risque de radicalisation.
Je
tiens faire ici les prudentes remarques suivantes, concernant le calendrier,
toutes tires du trs remarquable texte de vÏux de Christian Duteil, que je
soutiens sur tous ses points sans cependant forcer quiconque le soutenir, ni
du reste ne pas le soutenir.
1.
Le concept d'anne nouvelle est ici bas, pour des raisons de commodit, sur le
calendrier grgorien, qui est celui le plus couramment utilis dans la vie
quotidienne du pays, savoir la France, partir de laquelle ces vÏux vous
sont adresss. Son emploi n'implique aucun dsir de proslytisme, car je pense
que ceux qui sont ici sont ici, que ceux qui sont ailleurs sont ailleurs, et
que chacun doit, restant chez lui, observer ses coutumes. Je pense mme quĠil
est lgitime que chacun, vu le principe de scurit et de finitude, pense que
ses coutumes sont bonnes puisque ce sont les siennes. La lgitimit des autres
chronologies utilises par d'autres cultures n'est donc absolument pas mise en
cause par moi, pour autant quĠelles restent chez elles, pour que les vaches de
chaque pays et de chaque culture soient mieux gardes. En particulier, la
chronologie de la naissance des veaux doit rester, comme les vaches bien
leves, le propre des pays et des populations dans lesquelles ils naissent,
les veaux. Rappelons-nous du reste, quand il sĠagit de dfendre les valeurs bien
franaises, de ce quĠa un jour dclar le grand de Gaulle : Ç les franais sont
des veaux È.
Tirons
de ce point de principe quelques consquences prudentes.
-
le fait de ne pas dater ces vÏux du yawm as-sabt 1 Safar de l'an 1434 de
l'Hgire (fuite du Prophte Mdine) ne constitue ni une manifestation
d'islamophobie, ni une prise de position dans le conflit isralo-palestinien;
-
le fait de ne pas dater ces vÏux du 2 Teveth 5773, ne
constitue ni un refus du droit d'Isral vivre dans des frontires sres et
reconnues, ni le dlit de contestation de crime contre l'humanit;
-
le fait de ne pas dater ces vÏux du 3me jour (du Chien de Mtal) du 11me mois
(Daxue, Grande Neige) de l'anne du Dragon d'Eau,
78me cycle, n'implique aucune prise de position ngative, ni ne manifeste une
crainte, au regard de la monte en puissance du capitalisme chinois. Il
nĠimplique pas non plus une panique au regard de la crise boursire Shanghai.
-
le fait de ne pas dater ces vÏux du Quintidi de la 3me dcade de Frimaire de
l'an 221 de la Rpublique Franaise, une et indivisible, ne saurait tre
assimil une contestation de la forme rpublicaine des institutions et plus
gnralement ne saurait conduire quelque doute que ce soit concernant les
valeurs franaises de libert en tant que scurit, gaiet, galanterie,
lacit, esprit critique, tolrance au blasphme, hostilit aux foulards et aux
jupes longues, confortable proprit pour les ouikindes,
bonnes bouffes entre amis et voyage sympa dans les les Hbrides comme
Marrakech.
Tout
ceci tant dit et garanti, je peux vous adresser mes riches vÏux, certes
internes au principe de prcaution, mais dmocratiques et libres, mĠexprimant
tout entier dans toute leur libre originalit, leur sincrit individuelle,
leur cho confortable. coutez bien :
BONNE
ANNE.
Cherchons maintenant caractriser l'opration parodique laquelle je
viens de me livrer. Il s'agit d'une opration de recouvrement, notion
dont je vais me servir dans toute la suite de ce sminaire.
C'est une catgorie majeure de l'imposition oppressive de la finitude
l'infinit potentielle. Au fond, il s'agit d'asphyxier les possibles en tant
que risques et d'assumer les identits sans communication entre elles. Dans la
parodie en question, aucune chappe du discours protocolaire du vÏu n'est
permise, de faon aboutir en effet un nonc insignifiant, qui ne
dplace rien dans l'univers constitu l'intrieur duquel il fonctionne et
qui il semble s'adresser : Ç Bonne anne ! È. C'est le
recouvrement d'une potentialit infinie par un jeu systmique et rhtorique de
recouvrement du systme des possibles. On appellera oprations de recouvrement,
de faon gnrale, des oprations de ce type-l, c'est--dire des oprations
qui consistent discerner une potentialit infinie quelque part et, plutt que
de la dnier directement au nom d'une conception finie contradictoire, de la
rendre inactive en la recouvrant, en la dissimulant, par des considrations
tires elles-mmes de la finitude de faon ce qu'elle soit en dfinitive inaudible.
Je pense que les procdures propagandistes, dont notre socit est alimente
plus qu'aucune autre ne l'a jamais t, ne sont pas de
faon majoritaire des oprations de ngation, mais des oprations de recouvrement.
Prenons comme exemple ce qui s'est pass propos des meurtres de masse
de novembre, j'y reviens nouveau. Ë quoi nous engageait une comprhension
vritablement complexe et effective de ce qui s'est pass l ? J'ai
propos de dire que, a minima, cela exigeait un va et vient de la pense
elle-mme entre la situation telle qu'on pouvait la comprendre, qui s'avrait
d'ailleurs uns situation mondiale et pas simplement franaise, et
l'intelligibilit de la subjectivit active des assassins, que je considre
comme des fascistes, je ne vais pas revenir ici sur ce point. Le cheminement de
pense remontait ensuite de cette lucidation jusqu' la vision d'une situation
mondiale autre que celle de dpart, situation qui serait caractrise par le
fait qu'elle ne pourrait plus produire de tels dsastres.
Ce parcours en forme d'aller-retour est potentiellement infini, c'est
vrai. L'exploration complte d'une
subjectivit l'est dj par elle-mme. C'est la raison, entre parenthses, pour
laquelle on ne veut pas de procs, que donc on tue toujours ces gens. Dans un
pays qui interdit la peine de mort, on les tue sans exception. On exerce une
vengeance et non pas une justice, au sens le plus formel du terme. La justification
latente de cela, c'est qu'on s'engagerait, s'il y avait procs, dans des
considrations extrmement compliques, subtiles, qui prcisment engageraient
ce mouvement de va et vient entre la situation et les subjectivits, ce que
l'on ne veut pas. L'infinit potentielle de cette situation est perceptible
pour tout le monde, tout le monde est traumatis, inquiet, non pas seulement
par ce qui se passe, mais parce que l'intelligibilit de ce qui se passe est
fuyante, douteuse et mme terrible, d'une certaine manire. Un procs serait la
mise en scne de cette intelligibilit, quelle que soit ses limites. Donc, on
va recouvrir cette infinit potentielle par une finitude ferme, on va rduire
l'pisode la confrontation simple de deux identits normatives. En
l'occurrence, le codage lmentaire de cette affaire a immdiatement t
l'opposition entre Ç civiliss È et Ç barbares È; ou
encore : Ç valeurs franaises È contre Ç terrorisme
islamique È ; et finalement la consquence de tout a tait
l'vidence d'une union nationale parce que la Ç patrie È tait
Ç en guerre È. Au lieu que la pense se dilate l'chelle du monde -
parce qu'en ralit pour avoir une interprtation complte, il faut ouvrir une
large discussion sur comment est le monde aujourd'hui, quelle est la signification
des interventions de l'arme franaise ici ou l, que fait exactement l'arme
franaise en Centrafrique ou au Mali, d'o viennent les gens etc. etc. - on a
l'identit tricolore contre un extrieur indtermin et ngatif et l'opration
se termine sans qu'aucune forme d'intelligibilit ait t rellement dploye.
Par ailleurs, la non
comprhension expose la perptuation du risque. Si vous faites une dclaration
de guerre comme si les camps de cette guerre taient dj dessins et que tout
le monde tait dans l'union nationale autour de ces problmes, vous vous
engagez en ralit dans la perptuation de la situation telle qu'elle est,
celle qui est prcisment l'origine de ce qui est advenu. Or, si on ne la
change pas, on ne va pas changer non plus le systme des risques que l'on
entend prvenir.
Vous voyez donc en quoi consiste cette opration que j'appelle de
recouvrement. Un recouvrement, c'est toujours la pratique qui consiste
recoder la situation dans des paramtres dj connus, dj dtermins, dj
dploys, de sorte que la nouveaut, et donc l'infinit potentielle que ce qui
s'est pass peut dtenir, ne soient pas mises jour. C'est pourquoi je
soutiens que tout recouvrement est conservateur. En mme temps, c'est une
mthode de propagande, puisque cela consiste donner immdiatement une sorte
de formule simple de ce qui se passe. C'est sous la main et c'est simple. Simplification
radicale qui sert en dfinitive un resserrement de l'ensemble des boulons du
systme existant. Car concrtement, le solde du recouvrement a t le
renforcement des pouvoirs de la police et un durcissement extrme de toute une
srie de facteurs du droit. Il n'y avait pratiquement rien d'autre.
Le problme thorique du recouvrement est le suivant : comment une
donne potentiellement infinie peut-elle se laisser recouvrir par des codages
finis ? a parat paradoxal. Il semble que que
la seule solution consiste dire que si ce qui chappe au codage de la
situation est effectivement ni par le fait que vous le recouvrez par des
termes qui sont des termes de la situation dj existants (y compris en puisant
dans un stock de vieilleries recycles), eh bien c'est que l'infinit en
question n'est pas encore vritablement infinie. Si son infinit tait dj
constitue, si sa nouveaut tait vidente si vous voulez, on ne pourrait pas
la coder.
Le point trs intressant o nous sommes arrivs est le suivant :
dans quelles conditions le fini conserve-t-il de la puissance au regard mme
d'un infini suppos ? Quelle est la puissance de la finitude ? Une
chose qui empche souvent d'intgrer l'infini dans les analyses, c'est que
l'ide que la finitude c'est la loi des choses et donc que s'il y avait de
l'infini a se saurait, car l'infini l'emporterait sur le fini de faon
voyante, vidente. Que tel n'est habituellement pas le cas est prcisment ce
qu'attestent les oprations de recouvrement - qui, soit dit en passant, sont
des expriences de la vie quotidienne : beaucoup de novations potentielles
dans la vie subjective n'arrivent pas natre parce qu'elles ont t recouvertes
par des dcisions limitatives ; c'est la protection permanente de notre
finitude, la technique pour nous viter d'tre exposs au risque, la
nouveaut.
L'approche thorique de ce problme a t invente par Kurt Gdel dans
les annes 30 du dernier sicle sous l'appellation de Ç thorie des
ensembles constructibles È. Les ensembles constructibles sont les
ensembles qui vont tre mobiliss pour recouvrir des ensembles prcisment inconstructibles,
c'est--dire des ensembles qu'on ne parvient pas construire partir des
lments qu'on a dj sous la main dans la situation.
Le noyau de l'invention de Gdel c'est qu'il va donner une nouvelle
dfinition, trs largie, du fini. Pour traiter des problmes du recouvrement,
on ne peut pas en effet se contenter de dire que le fini c'est ce qui est petit
ou bien que c'est ce qui n'est pas infini. Il faut dfinir le fini d'une autre
manire, par des procdures qui ne sont pas essentiellement quantitatives, mais
qualitatives. Gdel va dfinir le fini, au regard d'une situation dtermine,
comme ce que l'on peut construire, bricoler, dterminer, partir
des lments existant dj, au double sens des objets qui sont dj l et des
proprits dont on se sert pour dcrire ce qui est dj l. En un certain sens,
c'est un rapport entre l'tre et le langage : le constructible, c'est tout
ce que dans la situation on a dj nomm ; le constructible permet
d'utiliser des noms qui ont un sens prdtermin dans la situation et par la
situation (exemples : Çla FranceÈ, Ç valeurs franaises È). L'infini,
par contre, c'est ce qui est inconstructible, c'est--dire ce qui est nouveau
au sens o a ne peut pas tre dduit, dans son tre et dans ses proprits,
partir de ce qui est dj l ; a chappe la finitude constitue de la
situation.
Quel va tre alors le processus de validation d'un infini vritable,
puisqu'on n'a pas les moyens de le construire partir de ce qui est dj l ?
Eh bien, on peut seulement faire une hypothse, affirmer que c'est l et
mettre au dfi l'adversaire de prouver que a n'y est pas. C'est donc
immdiatement dialectique parce que la proposition de l'inconstructible ne peut
pas tre construite. Cette affirmation – Ç l'inconstructible est
l È – est sans preuve, sans garantie. On affirme seulement que a
chappe la dtermination par ce qui existe dj et on fait la supposition
qu'en l'affirmant on n'introduit pas une contradiction mortelle au regard de ce
qui existe dj.
C'est un point subtil, et qui a d'importantes
consquences politiques. Au dpart, contrairement beaucoup de suppositions,
il ne s'agit pas de rsistance ou d'antagonisme ce qui existe. Il s'agit en
ralit de dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut que vous
introduisiez quelque chose (une affirmation, une proprit É restons dans le
vague pour l'instant) qui soit tel qu'il n'est pas constructible (c'est
l'lment de nouveaut irrductible de ce quelque chose), qu'il va claircir de
faon neuve la situation bien plus que ne le fait le codage de ce qui existe
dj, et que personne n'arrivera dmontrer qu'il est contradictoire de
l'introduire. Ce sera donc une validation ngative.
Ce que Gdel introduit, c'est l'ide trs intressante que, au fond, l'infini
c'est toujours un axiome nouveau, ce qui signifie, disons-le de faon
mtaphorique, que l'infini se soutient toujours d'une affirmation nouvelle
– nouvelle au sens o elle n'est pas constructible. Cet axiome, cette
affirmation, c'est quelque chose non pas qui s'oppose la situation, c'est
quelque chose que vous ajoutez la situation. a introduit l'ide trs
profonde, difficile, que l'essence de la nouveaut n'est pas la destruction
mais la supplmentation. Quelque chose en plus, non pas partir de ce
qui est dj, mais quelque chose en plus dont l'en plus mme ne se soutient que
de son affirmation. Et aprs, si quelqu'un n'en veut pas, qu'il dmontre que a
ne marche pas, que c'est contradictoire avec ce qu'il y a.
Reprsentez-vous a comme un arbre avec des branches successives –
la prochaine fois, je vous apporterai un schma. Vous partez de la situation
telle qu'elle est constructiblement, c'est--dire du
stock de ce qui est dj existant, affirm, dmontr etc., autrement dit de ce
qui a dj trouv sa place, son nom, dans la situation telle qu'elle est. Et du
matriel de codage aussi : car coder, ce sera puiser l-dedans pour
recoder le nouveau de faon ce qu'il soit mconnaissable comme nouveau et
fonctionne comme si c'tait la continuation de l'ancien. C'est a le
recouvrement. Ë partir de l, vous avez, lorsque s'introduit quelque chose de
nouveau, la division du
constructible et du non constructible.
Premire forme de la nouveaut : la nouveaut constructible. a, on
nous fait le coup chaque fois : prsenter comme nouveau quelque chose
qui est construit partir de ce dont on savait dj que a existait. C'est
ce rgime-l qu'on nous assure que notre socit est constamment nouvelle
(nouveau modle de smartphone etc. É). C'est cette nouveaut
constructible qui va tre considre comme le vrai concept du fini, mme si en
apparence il y a de l'infini dedans.
De l'autre ct, vous avez la nouveaut inconstructible, c'est--dire
des existences affirmes, des existences qui ne peuvent exister que parce qu'on
en affirme l'existence. Le risque pris par de telles affirmations c'est qu' la
fin des fins, a s'avre contradictoire, inconsistant, bref que a ne tienne
pas. C'est ainsi que la branche o va se loger l'inconstructible va elle-mme
se diviser. Vous aurez, d'un ct, quelque chose d'inconsistant, et auquel il
faudra renoncer, et de l'autre ce qui est non contradictoire avec ce qui existe
au sens o a continue se dvelopper sans qu'apparaisse de contradiction avec
ce qui existe. Puis a se divise nouveau ...
Mais pouvez-vous prouver que quelque chose est Ç non
contradictoire avec ce qui existe È ? Si vous le pouviez, a
reconduirait malheureusement un peu au constructible. Or Gdel montre qu'on
ne peut pas dmontrer que du non constructible est absolument
cohrent.
En politique, on demande souvent de prouver qu'une nouveaut Ça
marche È. Mais la nouveaut politique est inconstructible par dfinition,
comme toutes les nouveauts, et donc on ne peut pas lui demander d'argumenter
en sa faveur de faon constructible. Elle ne peut pas constructiblement
tre dclare non constructible. Il y a toujours un lment de pari. Il faut
parier. Sur ce point, Pascal avait raison. Il faut parier sur l'infini. a
reste vrai indpendamment de toute religion, de toute transcendance. Ds que
vous avez un point d'infini quelque part, c'est sr qu'il doit tre soutenu par
un pari, c'est--dire par un nouvel axiome, par une nouvelle affirmation que
vous ne pourrez pas domestiquer dmonstrativement.
Si vous ne pouvez pas dmontrer que c'est non contradictoire, alors
comment fates-vous ? Eh bien, vous en tirez les consquences. Si c'est
contradictoire, un jour ou l'autre, a se verra. Tant que les consquences
n'amnent pas de contradiction, vous supposerez que c'est non contradictoire.
La non contradiction de l'infini est entirement mesure par le systme de ses
consquences. Il n'y a pas d'autre preuve, en politique par exemple, que les
consquences que vous tirez de vos nouveaux axiomes. Si vous ne tirez aucune
consquence, a restera douteux. C'est la version formelle du primat de la
pratique : si votre hypothse n'est que thorique, elle peut tre
suspendue dans l'ala du contradictoire ou du non contradictoire, on ne saura
pas. L'exprimentation du fait que votre hypothse nouvelle tient au rel,
c'est le systme du dploiement des consquences que vous en tirez. C'est
pourquoi la politique cratrice est axiomatique, au sens o ce qu'elle permet
de construire de nouveau est la seule garantie possible de sa consistance, de
sa cohrence avec ce qu'il y a.
Donc, dans cette affaire, ce qui chappe au recouvrement a va tre
l'infini non constructible en tant que vous en affirmez l'existence. C'est une
hypothse d'existence au sens strict : vous affirmez que a existe,
vous ne vous contentez pas d'affirmer que a peut exister. Ë charge pour
l'adversaire de dmontrer que c'est incohrent, charge pour vous de dmontrer
que c'est cohrent, tant entendu que justement vous ne pouvez pas le
dmontrer, mais vous pouvez seulement en tirer les consquences telles qu'on ne
verra pas apparatre de contradiction avec le rel, c'est--dire qu'on ne verra
pas apparatre d'impossibilit stricte.
Comment cela se prsente-t-il du point de vue des exemples que j'ai mis
en avant aujourd'hui ?
Prenons l'exemple des vÏux. Qu'est-ce que prsenter des vÏux
inconstructibles ? Pour que des vÏux soient vritables, il faut que
l'autre voie ses dsirs satisfaits, mais pour autant qu'ils sont compatibles
avec l'universalit. Sur ce point, Kant a raison. Sinon le vÏu consiste
simplement rentrer dans le systme des intrts (sachant que l'intrt de
l'autre est aussi le vtre ...), et il n'y a aucune raison que a ne soit pas
constructible. Vous n'chappez a qu'en tant que vous reconnaissez que son
dsir est universel. Mais tout a va rester suspendu aux consquences,
c'est--dire au comportement de l'autre au regard des vÏux que vous avez
formuls le concernant ; vous ne pourrez jamais dmontrer que votre vÏu
tait ajust, c'est--dire que la charge d'universel qu'il comportait par
obligation tait rellement l.
Dans l'affaire des meurtres de masse, vous allez affirmer le va et vient
dont j'ai parl entre le monde tel qu'il est, les subjectivits qui s'en
infrent et la transformation de ces subjectivits se dployant en dfinitive
comme transformation du monde lui-mme, sans naturellement prouver que ce va et
vient se dduit de la situation, mais uniquement par le fait qu'il l'claire,
la transforme, c'est--dire par les consquences.
Vous voyez o nous en sommes : comment chapper au recouvrement
comme loi gnrale de la dictature de la finitude ? Concernant ce qui
vient de se passer, qui est un exemple spectaculaire, je vais vous dire :
je ne suis pas sr que a ait march vraiment. On entre un petit peu dans le
journalisme, mais j'ai trouv que le rassemblement pour la rpublique d'hier a
t un bide. La preuve c'est que les media n'ont pas pu
faire un grand tapage dessus. Or c'tait une opration typique de recouvrement
qui consistait coder novembre par janvier (janvier avait dj t cod
fond). a ne fonctionne pas bien parce que les catgories du recouvrement de
janvier taient toutes tires du caractre cibl de l'acte : on s'en prenait
en effet Charlie Hebdo, aux blasphmateurs religieux, on s'en prenait aux
Juifs spcifiquement avec l'Hyper cacher, et on s'en prenait la police. Le
recouvrement pouvait se btir partir de l : antismitisme, ngation de
la libert d'expression etc. et c'est cela qui a t mis en scne de sorte
qu'on a tout de suite organis une mobilisation massive. Cette fois, ce n'est
pas du tout la mme chose et la tentative de mobilisation
massive n'a pas march. Pourquoi ? Eh bien je pense qu'il aurait fallu un
autre recouvrement et que celui-l a laiss les gens un peu sceptiques, un peu
proccups, un peu inquiets ; ils n'ont pas march derrire avec la mme
intensit que l'autre fois, ce qui prouve que le recouvrement laissait pointer
quelque chose qui n'tait pas clair. Le recouvrement a laiss quelque part une
trace obscure, un non-dit, qui mon sens existent absolument. On pourrait
dire : l'infini court toujours dans cette affaire, et donc ce n'est pas
fini, au sens strict. Je crois qu'un des points, aussi, c'est que les gens
n'ont pas envie de faire la guerre, il faut dire ce qui est, mme si c'est une
guerre un peu Ç comme a È, une guerre destine au recouvrement. La
guerre, c'est quand mme une grosse affaire. D'un seul coup, Ç on tait en
guerreÈ. C'tait une pure et simple rptition du coup que Bush avait racont
et la guerre, on a vu ce que a a donn. On pourrait donc dire que
l'tablissement par le gouvernement, les organes de propagande etc. de la
constructibilit de cette affaire a t une opration mdiocre. Quand vous voulez
montrer que quelque chose est constructible, il faut quand mme É le montrer,
un peu, c'est--dire introduire des recouvrements significatifs, appropris
la singularit de l'acte. Ce qui n'a pas t le cas. Et donc l'infini court
toujours. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Quand l'infini court
toujours, a veut dire que, peut-tre, on peut le cranter par une affirmation
nouvelle, c'est--dire le reprer et dire : Ç voil, il est
l È. videmment sans pouvoir le dduire de la situation puisqu'il n'est
pas constructible.
La prochaine fois, ce que nous allons faire c'est prciser tout a en
l'clairant y compris son niveau formel et abstrait. Je crois que c'est d'une
importance considrable. Aborder les choses par la lutte contre les recouvrements,
plutt que par la contradiction, je pense que c'est une opration moderne.
C'est une modernisation de la
politique critique, ou
rvolutionnaire, peu importe le terme, et aussi de la vie personnelle.
C'est--dire essayer de voir dans ce qui nous arrive, dans ce que nous
devenons, dans ce que nous faisons, la part de recouvrement d'une virtualit
qui serait une virtualit vritable. Quelque chose dont il s'agirait de
soutenir, par l'affirmation, c'est--dire par la vie, c'est--dire par les consquences,
l'infinit. Quelque chose qui serait l'introduction dans la vie d'un nouvel
axiome. Parce qu'en gnral la vie consiste tirer les consquences des
axiomes dj l, coder par des emprunts conservateurs la situation telle
qu'elle est. Je ne suis pas en train de dire que le conservatisme n'est pas une
obligation. Quatre-vingt-dix pour cent de l'existence est conservatrice, il ne
faut pas se faire d'illusions l-dessus. Mais ce n'est quand mme pas la mme
chose si les dix pour cent restants courent toujours, c'est--dire si leur
infinit latente est quand mme saisissable un moment donn dans un registre
affirmatif axiomatique qui va en soutenir l'existence. Ce qui est une
dfinition possible de la libert.
La libert en tant que scurit dont j'ai parl au dbut, la libert des
opinions qui est de pouvoir raconter ce qu'on veut en restant tranquille, il
n'y a l-dedans pas du tout de libert. La libert vritable c'est le moment o
vous devez subjectivement soutenir une affirmation qui, au regard de la
situation, est en position d'infinit virtuelle et qui ne se soutient que des
consquences qui sont les siennes, charge pour vous de les poursuivre et
charge pour les adversaires de votre position de dclarer ou de dmontrer que
tout cela est incohrent et ne peut pas marcher. C'est en ce sens qu'on peut
dire que toute libert touche l'infini. Et le codage c'est par consquent
l'ennemi de la libert. C'est un artifice extraordinaire de voir que, dans les
situations qui sont les ntres aujourd'hui, le mot libert est utilis comme un
mot particulirement ajust au codage de sa ngation.
L'infini chappe au recouvrement, c'est ce dont traitent
des thormes mathmatiques magnifiques sur lesquels nous reviendrons. Notre
tche, dans le monde asphyxi, surcod, d'aujourd'hui, dans ce moment aussi
fortement constructible dans tous ses paramtres, c'est la dcouverte de la
possibilit dans une fissure d'un infini qui chappe au recouvrement. ĉtre
libre, c'est bien sr tre oppos l'oppression, mais c'est trop vague, car
l'oppression fondamentale aujourd'hui c'est l'oppression par le recouvrement.
Et donc tre libre, c'est chapper au recouvrement, c'est--dire ne pas laisser
la virtualit infinie tre recouverte et asphyxie par des prlvements constructibles.
15 fvrier 2016
L'ide capitale dont nous nous occupons pour l'instant, je le rappelle, c'est l'ide selon laquelle, en dfinitive, toute figure d'oppression revient un enfermement dans une figure finie de l'existence, l mme o pourrait se tenir une perspective infinie. Autrement dit, nous transformons le problme de l'mancipation, ou le processus de libration des possibilits humaines, nous ne le traitons plus directement sous la forme d'une contradiction explicite entre termes disjoints et spars du type des oppresseurs et des opprims. Nous supposons en fait que ce qui attire sur soi l'oppression, dans ses diffrentes figures, c'est toujours la crainte, le risque, la possibilit que quelque chose merge qui serait radicalement en excs sur l'ordre dont les matres sont les gardiens. Faute de ce quelque chose, l'ordre constituerait lui-mme la figure oppressive. Le point de dpart intuitif c'est que l'oppression se montre quand quelque chose qui pourrait s'extraire de l'ordre qu'elle contient risque d'apparatre. C'est une des significations possibles d'une sentence rvolutionnaire fort ancienne qui tait : Ç L o il y a oppression, il y a rvolte È. Ce n'est malheureusement pas tout fait vrai, ce n'est pas mcaniquement vrai. Ce qui est certain, par contre, c'est que l o il y a rvolte, il y a oppression. C'est--dire que l o quelque chose surgit qui parat perturber l'ordre gnral, l'ordre va tout de suite, toujours, mettre en place des oprations spcifiques qui sont celles qui nous intressent – et, comme nous allons le voir, cela ne concerne pas seulement la politique.
L'hypothse de nature ontologique que je fais, c'est que la dialectique adquate pour penser a, pour le penser dans son tre, c'est la dialectique du fini et de l'infini. Un ordre clos, quelle qu'en soit la nature, a pour ambition de se perptuer, de maintenir sa clture comme telle, c'est--dire d'empcher que se manifeste quelque chose de qualitativement tranger cette clture. On peut toujours dcrire cet ordre clos comme le maintien d'un certain type de finitude. Tout ce qui apparat comme tant au-del de la conception dominante de la finitude, tout ce qui apparat en excs, comme drglant cette clture, est peru comme tant un pril d'in-finitisation de la situation. Et en particulier de l'in-finitisation des possibles, parce que le verrouillage des possibles c'est la cl du maintien de l'ordre. C'est pourquoi l'ordre commence en gnral par dire que rien d'autre que lui n'est possible, barrant de ce fait en un point prcis le possible lui-mme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher la logique profonde sous-jacente, bien plus fondamentale que le systme des moyens, en ralit bien connus de tout le monde (mcanismes de propagande, policiers, de rpression ouverte etc. etc.) par lesquels l'ordre cherche justement briser ce qui parat aller au-del de la norme et de la rgle.
La deuxime hypothse que je fais est qu'une procdure extrmement importante c'est celle que j'appelle la procdure du recouvrement. Au niveau le plus gnral, c'est la tentative de neutraliser l'mergence possible d'une infinit neuve en la recouvrant de significations prexistantes, dj donnes dans la situation, et qui ont pour but d'en interdire le dveloppement, d'une part, mais aussi la signification interne, le sens immanent. Il ne s'agit pas de dclarer qu'il ne s'est rien pass ou qu'il ne se passe rien, mais que ce quelque chose n'a pas la signification qu'il se donne lui-mme : il est en effet possible d'en analyser la situation dans les termes de l'oppression elle-mme, en recouvrant en quelque sorte, comme si on mettait un sac dessus, l'ensemble de ce qui est dit, de ce qui est fait au nom de cette nouveaut, par des significations anciennes, gnralement strotypes, de sorte que l'intelligibilit mme de ce qui se passe soit anantie et que y compris ceux qui y participent finissent par ne plus trs bien savoir si rellement ce qu'ils font est vraiment ce qu'ils disent que c'est. Car on vise aussi une dmoralisation intrinsque des acteurs de la nouveaut, en les convaincant, par des artifices nombreux, que ce qu'ils croient tre nouveau est tout fait ancien, et non seulement ancien, mais d'une anciennet nuisible etc. Il s'agit de rendre dfinitivement inintelligible, de tuer le sens lui-mme de la nouveaut et d'tablir en figure d'impossibilit ce qui paradoxalement a paru possible.
Se constitue ainsi une lgende noire rtrospective : au point mme o quelque chose comme une esprance ou une nouveaut avaient sembl infinitiser la situation, le recouvrement fait apparatre une espce de moignon informe, une chose qui n'aurait pas d exister, une chose insignifiante ou abominable. Il cre des mmoires distinctes, des lgendes historiques et, finalement, qualifie, dtermine ou modifie la signification historique de ce qui est arriv. De ce point de vue, le recouvrement est une opration longue porte, c'est une sorte de poison infiltr dans le temps. C'est quelque chose qui dfigure ce qui a eu lieu, et pas simplement l'abolit, de sorte que a devient mconnaissable, et de faon d'autant plus vive qu'il est maintenu que a a eu lieu.
Quelques exemples.
C'est ainsi qu'un vnement de nature politique potentiellement
infini par ses consquences possibles est recouvert par des lieux communs
ngatifs. Dj la partie vive de la rvolution franaise (1792-1794), qui
ouvrait l'infini d'un rel processus galitaire, a t immdiatement
recouverte par des lieux communs
concernant l'action du Ç monstre froid È Robespierre, aigri et
sanguinaire. Les acteurs du coup de force de Thermidor, les
Ç thermidoriens È, firent passer dans ce recouvrement (qui est encore
mani aujourd'hui par les ractionnaires de tous bords) leur retour la
dictature des propritaires et des corrompus.
De mme, la Rvolution Culturelle en Chine (1965-1968), tentative
sans prcdent de relancer le mouvement communiste rel dans l'espace de l'tat
socialiste en voie de sclrose, et ce par l'intervention massive et directe des
tudiants et des ouvriers, a t rapidement qualifie par les experts en
finitude, tant chinois qu'occidentaux, de manipulation dsespre de Mao pour revenir au pouvoir dont il
avait t cart cause de ses erreurs, dchanant pour ce faire des violences
inacceptables.
On en dira autant de Mai 68 et de ses consquences en France : le plus grand mouvement de masse en Europe de l'Ouest depuis la seconde guerre mondiale, ouvrant pour la premire fois la possibilit d'un processus politique commun pour les tudiants rvolts et pour les ouvriers en grve, a t qualifi, et l'est encore souvent, comme une petite secousse anarchisante emballant la Ç libration sexuelle È dans un discours rvolutionnaire parfaitement fictif.
On peut trouver de semblables oprations d'anantissement d'un infini potentiel par son recouvrement fini dans toutes les autres procdures de vrit : amour, art, science. Exercice propos : chercher des exemples dans l'histoire, collective ou personnelle.
Je voudrais moi-mme procder une variation sur ce que peuvent tre les oprations de recouvrement dans le domaine de l'amour. Vous voyez bien qu'elles consistent habiter l'amour de l'intrieur de lui-mme de telle sorte qu'il soit hant en permanence par une incertitude quant son existence, et cette incertitude finit par l'envahir comme une sorte de cancer intrieur. La figure de la jalousie en est la figure la plus acheve. Proust dcrit cela admirablement. Il montre trs bien comment le jaloux institue un genre de quadrillage prexistant de l'existence de l'autre qui dcoupe le temps de sorte qu'aucune continuit n'est plus possible ; la suspicion qui est la sienne est une finitisation permanente du mouvement gnral de l'amour, ainsi bloqu dans une fragmentation recouvrante qui est une instance de la finitude. C'est pour cela qu'une des chapitres du livre de Proust s'appelle La prisonnire. Au lieu que l'amour soit le dveloppement intense d'une nouvelle figure de l'existence, il devient une clture, un enfermement, une prison, dans laquelle finalement ce qui importe n'est pas tant l'autre, que l'autre de l'autre. L'obsession du jaloux c'est la surveillance, mais ce qui le menace tout moment, ce qui met en pril son amour, c'est l'autre de l'autre. Y a-t-il un autre de l'autre ? Ce souci devient finalement prioritaire et c'est cette altrit insaisissable qui barricade l'amour, l'asphyxie, ou l'empoisonne. Vous voyez que le recouvrement, l, n'est pas extrieur, il opre l'intrieur de l'amour comme une espce de morcellement qu'il ne peut pas s'empcher d'imposer.
*
Il faut maintenant se demander quelle est la substructure logique de ces oprations de recouvrement – et quelle conditions on peut les contrarier de telle sorte que serait permise, autorise, l'mergence d'une infinit vritable.
Pour commencer, il faut d'abord savoir prcisment ce que l'on va entendre par fini. Parce que l'intuition ne nous sert pas beaucoup l-dessus. On dira qu'un ensemble est fini si ses lments sont dfinissables, ce qui veut dire qu'ils sont soumis la langue dominante dans le contexte de cet ensemble, langue compose de proprits bien rpertories, connues de tout le monde.
Ce sont ces lments dj nous par la langue que les oprations de recouvrement vont utiliser pour prcisment recouvrir des Ç choses È qui risqueraient de surgir l'extrieur de cette barrire que je trace ici au tableau, barrire qui va nous servir figurer la clture du monde de l'ordre que ces Ç choses È menacent de transgresser et de dplacer. L'opration de recouvrement va permettre de dire que les Ç choses È en question ne sont pas, comme elles le prtendent, extrieures ce monde et on les aura ainsi compltement verrouilles. Au lieu de voir Robespierre comme un rvolutionnaire qui tente d'introduire les figures d'galit dans le systme politique, vous le voyez comme Ç un aventurier È Ç opportuniste È, Ç sanguinaire È et Ç aigri È, c'est--dire des dterminations repres par tout le monde dans le monde tel qu'il est.
Par consquent, derrire le recouvrement, il y a une thorie de la soumission complte de ce qui existe la langue documente. Dans la situation, les parties dfinissables sont souvent ce qu'on appelle des Ç lieux communs È, c'est--dire les trucs consensuels, partags par tout le monde, a peut finir par tre Ç les valeurs franaises È ou des choses comme a É Ce sont des choses (noncs, actions, morceaux de pouvoir d'tat etc.) qui sont en ralit des dominations chevilles la langue tablie et disponibles pour l'opration de recouvrement.
Vous pourrez vous exercer trouver vous-mmes des exemples o l'usage de ces procdures est constant. Dans une dispute, par exemple, vous tes toujours en train d'imputer l'autre qu'on peut recouvrir ce qu'il raconte par ce que vous considrez, vous, comme une proprit bien dfinie : Ç tu dis a, mais en ralit je sais trs bien que ... È. C'est pour a que dans les disputes, il y a tant de lieux communs et que le bavardage de la dispute est un bavardage gnralement insignifiant au long cours, son inventivit tant brise par le fait qu'on puise dans ce qui est agressivement constitu dans la situation qu'on partage. Ces choses partages, on peut les voquer sans trop dire ce qu'elles sont, car de toute faon le seul point intressant c'est qu'elles soient satures du point de vue de la langue. Si vous dites Ç la France È, tout le monde sait ce que c'est, sauf que, justement, ce n'est pas vrai que tout le monde sait ce que c'est, et que personne peut-tre aujourd'hui ne sait exactement ce que c'est. Mais le savoir n'est pas la vraie question. La vraie question c'est qu'entre la chose suppose, la France, et le nom, il y a un verrouillage qui ne propose pas d'aller plus loin. Le nouage de la chose et de son nom va fonctionner tout seul et va se plaquer sur une situation qui n'a peut-tre aucun rapport avec lui et qu'il va tenter de colmater ou de recouvrir.
Quand on regarde de plus prs, on s'aperoit que c'est un peu plus compliqu, car le mot Ç proprit È est un mot quivoque. Il faut s'en mfier pour tenter d'viter les traquenards de la contradiction pure et simple. Mme celui qui, en vue d'opprimer les gens, recouvre ce qu'ils font, ce qu'ils racontent etc., essaie d'viter la contradiction explicite. Ce n'est pas toujours le cas, quelquefois il y tombe quand mme. Par exemple, j'ai t trs intress par le fait que Valls, qui est le chef de l'tat, et en plus aussi le chef des coles, ait dclar que Ç commencer comprendre, c'est forcment commencer excuser È. C'est quand mme un nonc philosophique remarquable. De quoi cet nonc est-il le recouvrement, ou la tentative de recouvrement, sinon de la comprhension de ce qui s'est pass ? Il prend un lieu commun flottant, savoir : Ç quand il se passe une chose horrible, l'urgence n'est pas de comprendre È (beaucoup de gens pensent a, peut-tre que tous nous le pensons un moment donn) et aboutit un nonc au bord de la contradiction. Si vous tentez d'opposer la raison au fanatisme, la lacit la religion, la paix la violence, etc., vous ne pouvez pas faire tenir cette opposition sur le fait qu'il ne faut pas comprendre ce qu'est l'autre. Au contraire, l'impratif de la raison, y compris de la raison politique, serait de comprendre ce qui se passe, vous devriez revendiquer une pleine construction rationnelle des choses. Les pannes du recouvrement, c'est quand on est pris en flagrant dlit de ne vouloir que recouvrir. Si d'un ct vous dites qu'on pitine nos valeurs par quelque chose d'abominable et que d'un autre ct, vous interdisez aux gens de le comprendre, vous vous prenez les pieds entre ce qui est dfinissable et ce qui ne l'est pas. Car comment pouvez vous dfinir ce qui s'est pass, ou le dclarer indfinissable, si vous ne savez mme pas de quoi il s'agit.
*
Ces oprations de recouvrement sont donc elles-mmes tenues, y compris dans leur vacuit propagandiste, dployer une certaine cohrence et en tout cas nous, pour les comprendre, nous devons essayer de voir comment rendre le concept gnral de recouvrement parfaitement comprhensible. Il faut pour cela que donnions une dfinition rigoureuse de la notion de Ç proprit È. C'est pour cela, et non pas par manie, que la thorie complte du recouvrement est une thorie mathmatique. a, on ne va pas le faire, c'est, il faut bien le dire, extraordinairement barbant. Mais ce sont les choses ennuyeuses de la pense dont en tout cas on ne peut pas se passer de savoir qu'il faut les faire – ce qui est un demi-recouvrement de l'activit relle É
Nous supposerons par la suite que nous avons fait ce travail, c'est--dire que nous disposons d'une langue formelle rigoureuse : nous savons prcisment ce qu'est une proprit et nous savons ce qui est dfinissable, savoir un ensemble constitu d'lments pourvus de proprits bien dfinies. Ë partir de l, nous allons traiter quatre points que j'numre parce qu'ils constituent une stratgie :
1. La dfinition de ce qu'est un Ç ensemble marqu par la finitude È, soit un concept particulier du fini : le fini n'est en effet pas une donne objective indpendante des processus.
2. La rencontre d'une alternative. Il est tout fait frappant qu'on ne peut pas luder le fait que, peut-tre, tout est fini, c'est--dire que les tenants de l'ordre ont raison et que ce qui n'est pas dans l'ordre assign la finitude est en ralit impossible, inexistant, voire dangereux. Il n'est pas possible de dmontrer que la doctrine des oppresseurs est intenable et que par consquent leur affaire ne va pas marcher. a signifie, d'une certaine manire, qu'il faut cesser de penser que a va s'crouler tout seul. Chez Marx, on sait bien qu'il y a une hsitation sur ce point : tantt, il laisse entendre que l'Histoire travaille quand mme dans le bon sens, vers l'croulement du systme de domination ; et d'autres moments, et en particulier quand il s'occupe de btir son Internationale, c'est une autre musique : car il semble que ce soit trs difficile justement, n'allant pas du tout de soi, traversant des pripties trs compliques etc.
Mais vous ne pouvez pas non plus dmontrer que si vous fates la supposition que quelque chose ne peut pas tre recouvert, vous avez tort. Ce qui veut dire qu' un moment, il y a un choix. Toute pense rationnelle est aussi habite par un choix fondamental et on ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas se dire qu'on est convaincu de part en part et jusqu'au bout par une dmonstration rationnelle de ce que la position que vous allez choisir est vraie, pertinente et victorieuse terme. On ne le peut pas, et ce au niveau de l'abstraction extrme qu'est la thorie du recouvrement. Et on ne peut pas non plus dmontrer le contraire, savoir que la position de l'adversaire est ncessairement victorieuse.
3. Ë quelle condition la position infinitisante peut elle se soutenir ? Puisqu'elle ne se soutient pas d'une dmonstration rigoureuse, on peut la choisir. Mais Ç choisir È ici, cela veut dire quoi ?
4. Ce que j'appelle l'thique fondamentale rcapitule tout a. C'est la dtermination de ce qu'il faut assumer pour tre du ct, disons, que j'estime tre le bon, c'est--dire la thse selon laquelle il n'est pas vrai que tout peut tre recouvert.
Je reprends ces points un un.
1. Pour commencer, il faut d'abord savoir prcisment ce que l'on va entendre par un Ç ensemble finiÈ. L, Ç fini È veut dire : ce dont on peut se servir dans un recouvrement.
Un Ç ensemble marqu par la finitude È, au sens du recouvrement, n'est pas une notion quantitative : il n'est pas spcialement petit, et par ailleurs nous verrons que des choses qui paraissent infinies peuvent tre en ralit finies du point de vue du recouvrement. Ce qui compte c'est sa composition.
Le point de dpart est le suivant. Un ensemble quelconque sera dit fini ds lors qu'il n'a pour lments que des multiplicits qui, dans un autre ensemble prexistant, figuraient comme parties dfinissables. Une partie dfinissable d'un ensemble, comme nous l'avons vu, est une partie soumise la langue dominante dans le contexte de cet ensemble.
Pour tre trs simple : soit un ensemble A. Soit une proprit P clairement dfinie, au sens o on sait ce que veut dire qu'un lment de A possde la proprit P. Alors l'ensemble des lments de A qui ont la proprit P constitue une partie dfinissable de A (cette partie est en effet dfinie par la proprit P). Une partie dfinissable d'un ensemble est ainsi une partie soumise la langue dominante dans le contexte de cet ensemble, une langue compose de proprits bien rpertories, connues de tout le monde.
Voyons comment se construit un ensemble fini (on dit aussi : un ensemble constructible). Cette construction va se faire de faon ordonne, hirarchique, dessinant une sorte d'ventail dans lequel les ensembles situs le plus loin du point de dpart ne sont composs que de parties dfinissables de l'ensemble prcdent. Autrement dit : chaque tape, l'ensemble constructible ne retient que le dfinissable de l'tape antrieure.
Dans la doctrine la plus radicale, le point de dpart c'est le vide. Comme il n'y a rien de dfinissable dans le vide (puisqu'il n'y a rien), vous marquez l'ensemble vide. Celui-ci est le seul lment de l'ensemble qui suit, c'est--dire le un. Ensuite, vous passez un niveau suivant en Ç tirant È du prcdent toutes les parties dfinissables : chaque tape, vous aurez des ensembles constructibles entirement composs de choses dfinissables dans la langue formelle, partir des multiplicits dfinissables antrieures. Vous pouvez arriver par chelons jusqu' des complexits considrables qui n'excluent pas que vous ayez un ensemble infini constructible. Ce fini-l n'est donc pas dfini par le petit ou par le grand, mais par sa structure interne de soumission la langue courante. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il est clos[1].
Le constructible est une catgorie qu'autrefois on aurait dit Ç de l'idologie È, parce que c'est n'admettre comme existant que les choses qui sont dj soumises la langue dominante. Dans cette affaire, vous n'acceptez pas qu'il y ait de l'indfinissable. Si vous n'admettez que ce qui est dfinissable, cela veut dire, d'un certain point de vue, que vous n'admettez que ce que le monde connat dj, a dj nomm, structur, pratiqu etc. C'est a la structure d'une idologie dominante en tant que conservation gnrale du systme. Elle n'admet que des oprations sur le dfinissable qui est le sien, c'est--dire sur la langue qu'elle utilise, elle, pour nommer les choses et les hirarchiser dans l'ordre du dfinissable. Les ensembles constructibles sont la forme gnrale de tous les matriaux utiliss dans les procdures oppressives et singulirement dans les procdures oppressives de recouvrement. C'est plus sophistiqu que la notion d'idologie dominante, parce que a se constitue en rseaux capables de tout recouvrir l'intrieur de l'ordre. Cela ne veut pas dire qu'il n'apparatra pas des choses nouvelles ; vous pouvez toujours ajouter un tage, mais dans le nouvel tage il n'y aura que du dfinissable venant de l'tage d'avant. Cela sera nouveau parce que cela combine une autre manire de dfinissable, mais cela ne sera pas nouveau au sens o cela ne serait pas du dfinissable. Il y aura ainsi une espce d'automorphie de l'ordre dominant, qui, du point de vue du rapport entre les multiplicits et les noms qui leur sont donns, va s'auto-entretenir sous l'gide de la langue dominante, sans que jamais rien ne se montre qui ne serait pas rduit cette langue. Autrement dit : il n'y aura pas d'innommable (innommable qui, comme vous le savez, est le titre d'un roman de Samuel Beckett).
2. Est-il possible d'admettre qu'il n'existe que des ensembles constructibles ? Kurt Gdel, le plus grand logicien du XXe sicle, celui qui a invent le concept de constructible, a dmontr, avec virtuosit, qu'il n'tait pas contradictoire d'admettre que tous les ensembles existants sont constructibles. Cela signifie que si, la thorie gnrale des ensembles, vous ajoutez l'axiome Ç tout est constructible È, eh bien cela ne s'effondre pas. Lorsque les matres d'une situation disent Ç tout est constructible È, cela tient la route, ils ne vont pas ruiner le systme gnral de la pense possible. Soulignons cependant que le fait que ce n'est pas contradictoire est diffrent du fait que c'est vrai ...
Il s'est pass une chose tout fait intressante : la mathmatique o tout est constructible, qui est plus Ç facile È d'un certain point de vue, pratiquement aucun mathmaticien n'en a voulu, a ne les a pas fascin; pratiquement personne ne s'est prcipit dans le paradis constructible. Les mathmaticiens se sont plutt pos la question suivante : puisque Gdel a dmontr qu'il n'tait pas contradictoire d'admettre que tous les ensembles existants sont constructibles, est-ce qu'on ne pourrait pas dmontrer qu'il n'est pas non plus non contradictoire d'admettre qu'il y ait de l'inconstructible. C'tait un gros dfi. Parce que si vous voulez introduire du non constructible, il va falloir que vous construisiez quelque chose qui n'est pas dfinissable, quelque chose qui chappe au systme dominant de la langue. La mathmatique, pendant des dcennies, a t hante par ce problme : comment est-il possible de dmontrer qu'il peut exister quelque chose qui, du point de vue dominant, n'est pas constructible ?
C'est le problme auquel toute cration est confronte de faon universelle. Vous pouvez le dire aussi bien d'un parti rvolutionnaire que d'un tableau cubiste premire manire, des premires Ïuvres dodcaphoniques de Schnberg, ou de la thorie de Galois. Dans tous ces exemples, et dans beaucoup d'autres, on produit quelque chose qui, prcisment du point de vue de l'ordre tabli, n'est pas constructible, c'est--dire quelque chose qui n'a pas pu tre finalement recouvert. Et en mme temps, on fait avec ce qui est dj l. Le monde vous pouvez le surpasser, mais vous le surpassez de l'intrieur de ce monde, les procdures que vous inventez empruntent ncessairement, qu'elles le veuillent ou non, au dfinissable ambiant. Ce dfinissable ambiant, il va falloir le tordre, le manÏuvrer, pour aboutir quelque chose qu'il refuse. Toute invention, de ce point de vue, est en quelque sorte refuse par le monde dans lequel elle se produit.
Finalement Paul Cohen a trouv le biais. Il a dmontr qu'on peut aussi admettre qu'il existe des ensembles intrinsquement non constructibles, des ensembles qui ne seront pas atteints par la hirarchie constructible. Et il est tout fait remarquable qu'il ait nomm ces ensembles des ensembles gnriques. Ce mot, gnrique, a une longue histoire, c'est le mot par lequel Marx, dans les Manuscrits de 44, dsigne le proltariat. Il dit que le proltariat est la reprsentation de l'humanit gnrique, c'est--dire de l'humanit comme telle. Ce qu'il entendait par proltariat, c'tait le point existant non constructible de la socit bourgeoise : a existait, les gens taient l, mais en tant que capacit subjective, c'tait un point que l'ordre non seulement ne pouvait pas construire mais ne pouvait mme pas imaginer qu'on puisse construire. Je ne crois pas du tout qu'il y ait filiation directe, mais spontanment, si on peut dire, Paul Cohen a retrouv ce vieux mot de gnrique pour dsigner, non plus l'humanit immanente au proltariat en tant que dpourvu de proprits venues du dehors, mais les ensembles non constructibles.
Alors on s'est retrouv dans la situation suivante : il est possible de dclarer que tout est constructible, il est aussi possible de dclarer que non, c'est--dire qu'il y a de l'inconstructible. Que faire dans ce genre de situation ? Dans ce genre de situation, il faut choisir, il n'y a rien faire. Vous ne pouvez pas dire les deux la fois. Si le mathmaticien n'assume pas l'axiome de constructibilit, a ne peut pas tre pour des raisons de cohrence ; l'assumer est plus simple et tout aussi cohrent. Quand il dcide de ne pas se situer dans le champ du constructible, c'est qu'il trouve plus intressant de s'installer dans le champ du non constructible. Plus intressant pourquoi ? Parce que si vous admettez le non constructible, vous allez admettre qu'il existe quelque chose de radicalement extrieur au champ du constructible, que le dpassement de la limite est effectif puisqu'il existe au moins un point en excs, quelque chose qui ne peut pas tre recouvert. C'est une relance, au sens o vous pouvez vous appuyer sur ce point pour btir autre chose, pour construire un nouvel univers du dfinissable. Il suffit d'adjoindre de nouvelles entits qui vont travailler le nouveau dfinissable par une espce d'instabilit permanente.
C'est exactement ce que pensait Marx. Le proltariat, c'tait le support de la rvolution en tant qu'il tait gnrique, en tant qu'il dployait, de l'intrieur de la socit o tout tait dfini par les proprits, la hirarchie sociale etc., quelque chose d'insaisissable du point de vue du recouvrement. Et, dans un deuxime temps, ce quelque chose devient le principe d'une rorganisation de la socialit tout entire, pour d'ailleurs aller se diffuser et disparatre, de telle sorte que ce qui existe c'est l'humanit du gnrique. Le proltaire va rendre gnrique l'humanit tout entire et on va compltement sortir du systme antrieur par lequel tai dfini le systme des positions sociales.
On peut retenir ceci : il y a un choix fondamental, choix que vous rencontrez chaque fois que vous tes confront, pour des raisons x, de faon intense, la possibilit d'un surgissement de quelque chose d'autre, et par consquent la logique du recouvrement. Une partie de ce que j'appelle les vnements sont une sommation de ce point de vue-l. Une fonction de l'vnement c'est de mettre l'ordre du jour le choix de rester dans le constructible ou d'en sortir, autrement dit de s'exposer au gnrique, c'est--dire quelque chose qui, pendant tout un temps, est peu dfini, mal dfini, insaisissable. Cette dtermination comme coefficient d'incertitude tait une qualit fondamentale du proltariat, que par la suite il a bien perdue. Le proltariat c'tait en effet la promesse de l'avenir, et c'tait aussi le fantme de la socit, ce qui n'tait pas par elle constructible, dfinissable. Il faut que la politique garde a, qu'elle demeure une politique du gnrique. Si elle redfinit tout, si elle reclasse tout, elle substitue un ordre constructible un autre, ce qu'on appelle une constructibilit relative. Vous pouvez trs bien prendre Ç proltariat È (au lieu de l'ensemble vide comme dans la constructibilit gnrale), le fermer comme gnricit unique et close et rebtir l'univers du dfinissable partir de cette fermeture. C'est ce qui se passe si l'tat est la seule ralit nouvelle. Ç L'tat proltarien È, c'est largement la reconstitution d'une dfinissabilit de type nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui perd en mouvement de gnricit sa capacit dissolvante, sa capacit de se rpandre dans l'humanit tout entire pour y dissoudre les constructions et les subordinations une langue dominante. En dfinitive, tout choix fondamental est toujours un choix d'acceptation d'une gnricit, en un point. C'est l'acceptation que quelque chose va chapper au systme d'autorit de la langue dominante. Ce faisant, a va vous chapper aussi en partie, parce que vous tes aussi dans la langue dominante. Il y a donc un effort pour que l'acceptation du gnrique soit un processus, qu'on en tire les consquences et pas seulement qu'on soit branl ou anesthsi au regard des dfinitions antrieures.
Je pense que l'antinomie Gdel-Cohen - qui n'tait d'ailleurs pas une antinomie, parce qu'ils taient tous les deux parfaitement d'accord, aucun des deux n'aimait vraiment le constructible, et Gdel a t trs content de voir qu'on pouvait faire un autre choix – cette antinomie, c'est quand mme une admirable formalisation de ce que c'est que la libert de la pense. Il faut bien en venir au fait que le choix n'est pas prescrit - ni prescriptible, puisque vous ne pouvez pas revendiquer la cohrence. Vous pouvez dire Ç le constructible, c'est quand mme mieux, parce que c'est clair et stable, la langue y est son affaire È. Vous pouvez dire Ç le gnrique, c'est formidable, parce que c'est l'aventure, le trouble, c'est ce qui dborde les dfinitions È. c'est une discussion permanente, partout, tous les niveaux de l'existence humaine. Les pripties de l'existence font que souvent on est dans un registre de soi-mme d'un ct et dans un autre registre tout fait de l'autre, ce n'est pas une distribution globale et systmique. C'est une chose que les mathmaticiens ont vue en profondeur et qui est un point existentiel majeur. Est-ce que je vais tenir ma place dans l'ordre de la constructibilit, c'est--dire du dfinissable ? Est-ce que je vais chercher tre plac ? Parce que la contrainte du dfinissable, c'est que a vous place quelque part, vous avez vos attributs, votre nom É et tous vos entours sont pareils. Ou est-ce que, finalement, je vais assumer que quelque chose ne peut pas tre plac. Parce que le gnrique c'est a, quelque chose qui est instable quant son nom, sa disposition et mme son existence fantomatique : deux ensembles gnriques, par exemple, sont trs difficiles distinguer l'un de l'autre puisqu'ils n'ont pas une dfinition stabilise ; ils sont pareils. Il faut donc assumer du compltement diffrent et du compltement identique. C'est bien connu dans les entreprises de fraternit politique ou d'amour ou d'autres. Toute l'histoire intellectuelle de l'interprtation de l'amour a toujours oscill entre le fait que ce qui est formidable dans l'amour c'est qu'on tait deux et le fait que ce qui est formidable dans l'amour c'est qu'on tait un. On pourrait dire : l'amour la Gdel, l'amour la Cohen.
3. Toute pense contient un choix fondamental. La pense est donc libre, en un sens profond, et non pas parce qu'elle peut dire n'importe quoi, ce qui est la libert d'indiffrence et qui n'a aucun intrt. Supposez qu'on ait fait le choix d'tre du ct du non constructible, pour une raison ou pour une autre. Ce n'est pas forcment, j'y insiste, parce que vous avez sous la main un ensemble non constructible, parce qu'un ensemble non constructible, a ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Votre choix fondamental peut se prsenter sous la forme : il y a du non constructible, il y a de la nouveaut indfinissable dans l'ordre tabli (en termes mathmatiques : vous dclarez que l'axiome de constructibilit est faux). En ralit, l, on touche vraiment l'infini. Car, en dfinitive, il faut affirmer qu'il y a de l'infini – de l'infini au sens strict, de l'infini non constructible. Il faut l'affirmer, et aprs, voir. Dans la subjectivit non constructible, appelons-la comme a – et ce dans tous les ordres de la pense - vous supposez l'existence d'un infini non constructible, supposition que vous allez faire travailler dans le rel, c'est--dire : regarder attentivement, se dfendre contre des recouvrements, dnoncer le dfinissable facile, traquer les dclarations de constructibilit qui sont manifestement uniquement destines maintenir l'ordre et ainsi de suite, c'est tout un travail. Vous ne ferez pas ce travail si vous n'avez pas fait le choix fondamental de le faire, c'est--dire si, d'une manire ou d'une autre, vous n'avez pas opt pour la supposition qu'il y a rellement de l'infini non constructible. Ce type d'infini va vous servir tmoigner du fait qu'en effet quelque chose qui transgresse l'ordre constructible dominant peut exister.
Moi, c'est ce que j'appelle une Ide. Une Ide, quelle qu'elle soit, c'est toujours une anticipation infinie sur l'existence d'un univers possiblement gnrique. L-dessus, les mathmaticiens ont fait un travail formidable. Ils ont dmontr qu'il existe certains certains types d'infinis dtermins, qui, si on admet qu'ils existent, attestent par leur seule existence que l'univers n'est pas constructible. Ils ont en quelque sorte dmontr la puissance de l'Ide.
Si vous croyez en ce type d'infini (parce qu'un infini non constructible, vous ne pouvez pas dmontrer qu'il existe), il va tmoigner du fait qu'il y a du non constructible, que l'univers ne peut pas tre rduit du constructible. a, c'est dmontr. Je pense que c'est une indication existentielle absolument remarquable. Elle signifie que si vous avez une Ide et que vous tes en tat de la soutenir rellement, ce qui revient dire que vous affirmez son existence, si vous arrivez installer cette Ide dans un petit fragment de rel quelque part, eh bien vous avez de bonnes chances qu'elle fasse basculer le monde hors du constructible. Mais si vous n'avez pas d'Ide du tout, a ne sera pas facile d'en sortir, du constructible. La premire forme de cette dmonstration mathmatique a t trouve par le mathmaticien Scott, dans un thorme qui dit que s'il existe un Ç ensemble mesurable È (ensemble trs mal nomm d'ailleurs), alors l'univers n'est pas constructible, il y a du non constructible. a a t bouleversant, parce qu'on voit bien qu'en ralit la question de savoir si tout est constructible ou s'il y a quelque part du non constructible, a parat tre une caractristique de l'univers tout entier. Alors que l, il suffisait d'un seul tmoin, si je puis dire, d'une seule configuration trs particulire, c'est--dire un ensemble ayant certaines proprits, pour que soit aussitt rcuse la thorie du constructible. Je pense que c'est toujours comme a que a se passe dans le rel : une invention, une nouveaut, une cration, c'est que quelqu'un en a l'Ide, quelque part. Il en a l'Ide au sens fort, c'est--dire il affirme cette Ide existentiellement, il organise son existence autour du fait que cette chose dont il affirme l'existence, peut exister. Dans ce cas-l, il est dans la situation du thorme de Scott, c'est--dire que si a existe suffisamment pour qu'on puisse dire que a existe, pour que d'autres se rallient au fait que a existe, que a a des consquences etc., eh bien a voudra dire que l'univers n'tait pas aussi constructible qu'on l'a dit. Et que donc quelque chose de l'ordre du recouvrement, de la domination, etc. a t brch, rduit. C'est tout fait tonnant comme connexion symbolique entre la thorie formelle du constructible et tout ce que nous venons de dire sur l'obstacle au recouvrement. Parce que si vous tenez ferme sur l'Ide, c'est--dire sur le type d'infini qu'elle contient, a veut dire que vous avez les moyens de vous opposer au recouvrement, puisque le recouvrement ne subsiste qu' supposer que finalement tout est recouvert par du constructible. Pour s'extirper du recouvrement, il faut donc avoir une Ide, au sens prcis o je le dis, c'est--dire la reconnaissance possible d'un type d'existence dont la consquence serait que l'univers n'est pas constructible. C'est autre chose que de rencontrer par hasard, quelque part, quelque chose qui ne serait pas constructible. C'est un dur labeur qui remanie en quelque sorte notre perception du monde de faon ce que vous trouviez des chemins qui en effet installent petit petit la cohrence de votre Ide. Puisque, par contre, on sait qu'elle est cohrente, Cohen l'a montr, vous ne serez pas contredit dans cette affirmation. Mais peut-tre que vous ne trouverez rien. Le thorme dit cependant que vous devez normalement la fin trouver quelque chose. Parce que si le corrlat de votre Ide existe, alors l'univers n'est pas constructible et il y a des limites au recouvrement.
4. De tout a, on peut tirer une thique fondamentale, qui nous servira de conclusion : il faut toujours assumer une Ide, participer au dcouvrement, se dgager ainsi de la finitude et ouvrir la pense l'infini rel.
Ç Il faut toujours assumer une Ide È, c'est--dire s'opposer une thse fondamentale du monde contemporain : l'impratif Ç Vis sans Ide !È, avec toute une doctrine derrire de recouvrements. C'est uniquement a qui se cachait derrire le motif d'apparence anodine, voire progressiste, de la mort des idologies. La mort des idologies, a veut dire : Ç Jouis (si tu peux) et vis sans Ide ; jouir est une norme suffisante ; tiens-toi devant le grand march plantaire, si tu peux y acheter quelque chose a sera bien, pour le reste ne nous em É barasse pas l'esprit avec tes Ides È. Le premier point est donc de tenir une Ide : une Ide politique videmment, mais c'est plus vaste que a. a veut dire : placer son existence sous le signe de ce qu'on ne cdera pas sur une Ide, c'est--dire en ralit sur un type d'infini ; on agira de telle sorte que finalement la rencontre du gnrique, elle aura lieu ; le fait que l'univers ne sera plus, pour vous et pour ceux qui vous entourent, constructible, a adviendra. C'est a que j'appelle : toujours assumer l'Ide.
Ç Il faut participer au dcouvrement È. videmment, arm de l'Ide, vous pouvez intervenir, dfaire les recouvrements. Les recouvrements sont prcaires ds lors que quelqu'un a une Ide, a c'est sr. Il y en a de nombreux exemples, mme dans la vie ordinaire. Si vous avez une Ide de ce que peut tre la vie, elle ne se laissera pas facilement recouvrir par des dbris mortifres.
Entre Ç Se dgager ainsi de la finitude È et l'Ide, il y a un chemin, celui du choix fondamental premier (Ç je suis Cohen È).
Ç Ouvrir la pense l'infini rel È, c'est la synthse de tout a. Avoir la force de ne pas se laisser recouvrir, toujours tenir sur l'Ide, c'est toujours se dgager partiellement, jamais totalement (parce que quand c'est absolutis, a devient chimrique), de la finitude et c'est, par consquent, faire d'une partie de son existence une cration. Une cration qui ne sera pas recouverte. Vous vous garderez de faon ce qu'elle ne soit pas recouverte.
11 avril 2016
Aujourd'hui je voudrai parler, de faon, comme vous le verrez, un peu indirecte de, disons, de ce qui se passe ici (s'il se passe quelque chose), de ce qui est dcrit comme se passant ici, l'ensemble de la constellation constitue par les projets qui s'acclrent du gouvernement, l'opposition ces projets, la cristallisation de cette opposition autour de la question de la rforme du code du travail et finalement l'apparition du mouvement Ç Nuit debout È qui rdite, rinvente la pratique de l'occupation constante des places, de l'organisation dans cette occupation d'assembles gnrales, d'un nouveau mode de fonctionnement etc.
En parler comment ? Je ne veux pas en parler en tant que participant, partir d'une exprience locale active, dans ce qui serait un compte-rendu de participation et d'enqute et pas non plus en parler comme tmoin mdiatique, juge, ou des choses de ce genre. En ralit, je ne vais pas donner prcipitamment mon point de vue sur ce qui se passe l, mais je voudrai en parler partir d'une question trs dfinie, trs prcise : quel peut tre le rapport entre ce type de mouvement localis dans l'espace et dans le temps, ce type de mouvement de masse - c'est quand mme le nom gnrique de ce type d'occurrence historique - et d'autre part l'ide ou le processus stratgique d'une transformation relle des lois du monde, que ces lois soient conomiques, sociales, politiques, tatiques ? Autrement dit, quel est le diagramme de transformation dont quelque chose de cet ordre est porteur dans les conditions d'aujourd'hui, et en quel sens, sur ce point prcis, un pisode qui se prsente comme vnementiel et historique peut tre aussi, et en mme temps, un pisode ou une tape de la pense elle-mme ?
On pourrait plus prcisment examiner la thse selon laquelle ce genre de mouvement, et ce mouvement particulier, quelles que soient ses incidentes quantitatives par ailleurs, porte, comme il le dit, ou comme on le dit pour lui, une transformation de ce que c'est que l'action collective et la vie collective. Je voudrai faire une remarque prliminaire, qui est une remarque de style ou de concept. Il y a une thse qui circule depuis longtemps selon laquelle les mouvements de ce genre (mouvements qui datent de plusieurs annes, on peut mme dire que la France vient en dernier) peuvent modifier de faon radicale notre ide du politique, qu'il s'agit l, fondamentalement, d'une autre pratique de la politique, ou mme d'une suppression de la politique, d'une pratique non politique de la politique ou d'une pratique de la politique s'opposant toutes les formes existantes de la politique.
Je ferai remarquer qu'on emploie quelquefois ce propos l'expression Ç le politique È, expression trs usite dans cette discipline qu'on appelle la philosophie politique. On pourrait mme dire que la philosophie politique se dfinit comme la construction d'un concept du politique, examin ensuite la fois conceptuellement et empiriquement. Je voudrai quand mme dire que cette expression Ç le politique È me parat vide de tout contenu et que je la rprouve. Je la rprouve parce que ce qui existe toujours, ce qui se donne penser, c'est la politique et mme plus prcisment les politiques. La politique c'est l'espace du conflit des politiques. C'est pour cela que la politique est un concept dialectique, un concept qui suppose qu'il y a un espace d'affrontement des politiques, ce n'est jamais un concept simple. J'irai mme jusqu' dire que quand il n'y a qu'une politique, c'est qu'il n'y en a aucune. Quand il n'y a qu'une politique, c'est qu'on a seulement les affaires de l'tat, la gestion de l'administration, on n'a pas de politique proprement parler en tant que dtermination subjective. La consquence de cela, c'est que, dans le systme parlementaire actuel, l'existence de plusieurs politiques est en ralit une fiction. Quand les politiques se succdent, elles font la mme chose, et sont obliges de rvler leur essence propre, qui est qu'il n'y a en ralit qu'une politique. Ce qui donne lieu des lamentations sur Ç la mort de la gauche È - dont il faudrait dmontrer qu'elle a t vivante, car c'est une condition pour mourir. Cette politique, on pourrait la dfinir. Elle est subordonne au couple du rgime reprsentatif lectoral d'un ct et du capitalisme libral de l'autre ; elle gre ce couple, nous le voyons bien depuis 20 ou 30 ans au moins, selon des normes absolument comparables, n'introduisant que des diffrences insignifiantes. C'est ce que je propose d'appeler le capitalo-parlementarisme. On peut signaler au passage que l'expression Ç capitalisme libral È est une redondance, pour ne rien dire de Ç nolibral È ; cette dernire expression, tout fait la mode, consiste faire croire que comme c'est Ç nolibral È, a ne serait dj pas mal que ce soit seulement Ç libral È ... En ralit, le nolibralisme n'est qu'un retour la doctrine librale formule et dploye la fin du XVIIIe-dbut XIXe, retour qui s'effectue aprs une priode un peu secoue – et secoue par quoi ? Par l'existence du communisme, il faut bien dire les choses comme elles sont.
Le fait qu'il n'y ait qu'une politique, le capitalo-parlementarisme, revient dire qu'il n'y a aucune politique proprement parler. Au fond, un nombre grandissant de gens savent que la politique est une fiction aujourd'hui, et que quand on est appel voter pour les uns ou pour les autres, le geste politique est dj lui-mme annul dans sa conception collective, d'o une conversion au scepticisme politique. Je dirais, c'est une remarque empirique, que dans le mouvement en cours, et dans les mouvements qui l'ont prcd, lorsqu'ils se dressent contre la Ç politique unique È, il y a des traces de ce scepticisme, c'est--dire l'ide qu'il faudrait en un certain sens abandonner la politique et faire autre chose. Autre chose qui n'aurait qu'indirectement, ou mme pas du tout, le nom de Ç politique È. C'est pour cela qu'on voit apparatre des choses comme : Ç Nous ne voulons pas faire de politique, pas mme une nouvelle politique, nous voulons changer la vie, inventer de nouvelles formes de vie È. C'est un des sens de l'nonc Ç notre vie vaut mieux que tout a È, o on peut entendre : Ç notre vie vaut mieux que la politique sous toutes ses formes È. Je ne dis pas que c'est la conviction de tout le monde, mais je dis que a flotte comme un symptme. Ce que je soutiens c'est que cette dclinaison anti-politique est une consquence, et est en ralit sous la loi, de l'inexistence de la politique dans la forme du capitalo-parlementarisme. C'est d'abord le monde dominant actuel qui supprime la politique. Et pas seulement le monde dominant actuel, c'est aussi ce qu'ont fait les rgimes socialistes tablis du XXe sicle qui ont d-politis la situation, et exactement dans le mme sens qu'aujourd'hui, savoir en centrant toutes choses sur le pouvoir d'tat, en identifiant politique et gestion du pouvoir d'tat, voire mme en identifiant politique et gestion de l'conomie.
Si bien que la position antagonique relle aujourd'hui, la vraie rvolte, me semble-t-il, ce n'est pas qu'on comprenne la raison de dire Çqu'on ne nous parle plus de politique, notre tche est autre È, mais ce serait de pouvoir dire exactement le contraire : Ç enfin une politique, enfin un espace reconstitu de l'antagonisme des politiques compltement asphyxi et annul par le capitalo-parlementarisme !È. C'est--dire une politique qui pourra recrer le monde rel du combat, et non pas une absence de politique du ct de l'exercice de la vie, contre une absence de politique du ct de l'exercice du pouvoir conomique. Une politique qui pourra recrer le monde rel du combat, c'est--dire une politique contre l'tat, ce qui signifie finalement politique contre politique. Parce que la politique tatique, si elle est attaque, doit se dfendre et elle devra proposer elle-mme une subjectivation politique de son existence, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui parce qu'elle est consensuelle.
Ce qui est vrai, de toute faon, c'est qu'un mouvement n'est pas par lui-mme une politique. Un mouvement, c'est quelque chose qui commence, qui finit, qui peut ventuellement avoir des mots d'ordre, mais il n'est qu'un moment historique. Sans de tels moments historiques, une rnovation, ou une re-cration de la politique, est certainement impossible. Ceci dit, tout ce qui est historique n'est pas politique. Il peut y avoir un mouvement historique significatif et important, j'en ai mme dsigns certains comme tmoignant d'un Ç rveil de l'histoire È. Ç Rveil de l'histoire È est une catgorie de ce qui se passe historiquement comme pr-condition possible de la politique, mais qui ne constitue pas par soi-mme une politique. On peut mme dire aujourd'hui, et c'est un terme de bilan auquel je tiens, que ce qui est historique peut chouer par manque de politique.
Nous avons de cela des exemples trs proches et des exemples plus lointains. L'exemple proche, c'est tout de mme la question des occupations de places. Les occupations de places, c'est quelque chose qui a plusieurs annes, dans le monde entier. Il y en a eu en gypte, en Tunisie, en Espagne, aux tats-Unis, en Grce ; il y en a eu de trs importants aussi Hong-Kong et en Turquie. Dans tous ces cas, nous avons une espce de forme spcifique qui est la prise de possession de l'espace urbain par des mouvements dont la configuration interne est variable. Dans certains, domine absolument la jeunesse, et plus singulirement la jeunesse tudiante ou scolarise, dans d'autres, au contraire, il y a une mixit sociale beaucoup plus grande, plus constitue, comme cela a t le cas en gypte. Ce type de mouvement d'occupation de places d'un certain nombre de grandes villes, sur une priode prolonge, avec une organisation de la vie collective, de l'occupation etc., c'est un phnomne de ces dernires annes que nous pouvons maintenant tudier sur un nombre d'exemples important et nous savons maintenant que la question intressante porte videmment sur forces et faiblesses de ces mouvements. L'tre historique de ces mouvements, la sympathie qu'ils provoquent, sont une donne vidente, mais nous sommes maintenant en tat, sur un certain nombre des plus importants de ces mouvements, d'analyser ce qui s'est pass. Or, je crois que nous pouvons dire que ces mouvements ont dans l'ensemble chou modifier fondamentalement la situation politique ou la situation tatique et qu'il me semble que cela n'a pas t parce qu'ils taient historiquement inconstitus, car ils l'taient, leur dmocratie interne tait vritable, leur nouveaut tait incontestable, mais parce qu'il s'est pass, du point de vue de ces mouvements, quant la politique. L'exemple de l'gypte est videmment saisissant. Il est saisissant parce que c'est le mouvement qui a t le plus complexe, le plus socialement complexe, a n'a pas t uniquement un mouvement de la jeunesse, il n'a mme pas t le mouvement d'une seule religion ; il a t durable et on pourrait imaginer qu'il a t, au moins tactiquement, victorieux, puisque le mot d'ordre qui cimentait les gens qui taient prsents au Caire et ailleurs, c'tait Ç Moubarak dgage ! È et que Moubarak a dgag. Il faut maintenant mditer sur la question de savoir pourquoi on a maintenant al-Sissi qui certains gards est la mme chose que Moubarak et mme un peu pire. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce qu'il s'est pass c'est que la seule force politique disponible, de l'intrieur du mouvement, la seule force qui tait non seulement historique, c'est--dire vnementielle, mais installe, greffe dans la situation, c'tait les Frres musulmans que ce sont eux qui ont ramass la mise de faon apparente, puisqu'on s'est ralli au processus lectoral et qu'il a donn une majorit crasante, notamment dans les milieux populaires, aux Frres musulmans, et que les Frres musulmans ne plaisaient pas une bonne partie des manifestants, qui ont re-manifest contre les Frres musulmans, ce qui a permis l'arme d'intervenir et de reprendre le pouvoir. Donc, la leon gyptienne c'est que l'unification historique d'un mouvement ne signifie pas l'unification politique. Elle ne suffit pas. Et pourquoi ? Parce que dans ce cas, et c'est trs clair en gypte, mais partout ailleurs, s'il n'y a pas d'unification politique du mouvement, mais seulement son unification concrte, historique, prsente, vitale pourrait-on dire, ce qui les unifie peut tre strictement ngatif. Quand vous avez une configuration d'un mouvement qui en ralit n'est pas constitu politiquement, mais exclusivement historiquement, il est politiquement divis, qu'il le sache ou pas d'ailleurs, et il ne se met d'accord que sur du ngatif. Des gens qui ne sont pas unifis sur la cration politique, sur son invention positive, peuvent passer des accords sur leur adversaire commun, mais ce ne sont que des accords, c'est tout. Ç Moubarak dgage ! È c'tait bien joli, sauf que les gens qui voulaient que Moubarak dgage n'avaient pas du tout la mme reprsentation de ce que cela signifiait, le contenu affirmatif de cette ngation n'tait pas partag. Or la politique commence lorsqu'il y a une unification affirmative. La ngation ne peut rassemblement que tactiquement, au moment de son opration.
L'autre exemple, qui est tout fait diffrent, c'est que faute d'une unification politique interne au mouvement, le mouvement va lui-mme revenir la politique classique, il va se solder par le retour la comptition politique telle qu'elle est organise dans le tissu de l'histoire. a, c'est ce qui se passe en Grce et en Espagne. Parce que Syriza et Podemos, ce sont des organisations parlementaires, des organisations qui ont l'intention de prendre le pouvoir, et qui d'ailleurs le prennent, dans les conditions institutionnelles et tatiques dominantes telles qu'elles sont. Le mouvement est alors cristallis dans une espce de relve des forces politiques existantes. J'ai propos de dire qu'en ralit ces mouvements attestent que l'chec et la compromission de la vieille social-dmocratie sont telles qu'on a besoin d'une social-dmocratie nouvelle. Dans l'exprience du mouvement historique, se cre quelque chose qui va s'intgrer au jeu dominant dans une espce de rnovation de la capacit de sa gauche se distinguer un peu de sa droite. Parce que ce qu'il s'est pass c'est qu'aujourd'hui il y a une visibilit de la fiction de l'opposition des politiques qui est trop grande et qui nuit au systme. Il faut donc qu'il y ait une relve. De quoi ? Eh bien, une relve du ct de l'opposition parlementaire, si on veut avoir une opposition parlementaire plus muscle, plus solide sur ses revendications etc. Ce qui peut ne pas tre mauvais d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout une mutation dans l'espace politique, c'est simplement une sorte de correction, ou de rattrapage, dans des conditions de corruption du parlementarisme qui, en Espagne, en Grce et en vrit en partie chez nous, avait atteint des proportions prcdemment inconnues. L on peut revenir l'axiome : le parlementarisme, s'il est une fiction de politique, doit animer un peu sa fiction. Si la fiction est une pice absolument joue d'avance, o les personnages sont tous identiques, la fiction ne prend plus sur le public. Les gens ne viennent plus au spectacle - ce qui veut dire qu'ils ne viennent plus voter. Or, a c'est embtant, sauf dclarer le vote obligatoire, ce qui est une tentation permanente mais trs difficile organiser dans les pays qui n'en ont pas l'habitude.
Du point de vue du rapport entre histoire et politique, on peut s'imaginer que, sous couvert de dmocratie, l'unit ngative du mouvement en tant que mouvement historique suffit le constituer comme l'aube d'une rupture politique, ou d'une rupture tout court. Le bilan des choses montre que ce n'est pas vrai. L'historicit du mouvement achoppe en ralit soit sur le manque pur et simple d'une unit politique, comme en gypte et aussi comme aux tats-Unis, soit sur le fait que l'unique dbouch qui semble se prsenter soit en ralit un retour dans la figure de l'tat tel qu'il est constitu, sous un mot d'ordre qui en ralit est le mot d'ordre de la rnovation de la dmocratie – autrement dit : rnovation de la fiction politique elle-mme en lui redonnant un peu de tension interne, afin qu'elle puisse nouveau fonctionner.
C'est pour cadrer ce genre de question que je vous ai fait distribuer ce schma, que certains connaissent de longue date.
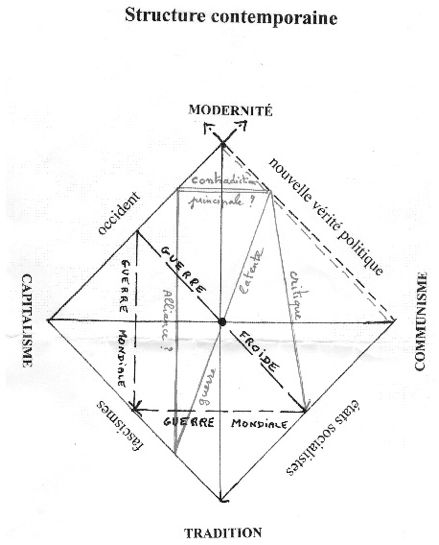
La situation contemporaine, depuis les annes 80, ne peut pas tre comprise dans ses effets subjectifs partir d'une contradiction unique. Je voudrai le montrer tout de suite propos de ce que sont les propagandes politiques disponibles une vaste chelle. Quelles sont les propagandes qui travaillent les subjectivits ? Il y en a, selon moi, trois.
Il y a d'abord ce qu'on peut appeler le camp occidental ou imprial, c'est--dire le grand capitalisme mondialis sous sa forme la plus avance. Ce camp fait propagande sur le fait que, dit-il, il est le seul vrai reprsentant de ce qui est l'unique modernit politique, savoir l'tat reprsentatif dmocratique, qui tire sa lgitimit des lections libres. Dans cette vision, le capitalisme est considr comme naturel, vident et irremplaable et donc la question de l'organisation conomique est rgle, c'est cette vision qui porte l'ide de la fin de l'Histoire : l'organisation capitaliste est telle, qu'on n'en voit pas d'autre. C'est l'interprtation fondamentale de l'chec des tats socialistes, de l'chec du communisme etc. Il n'est par consquent pas question, sauf pour des ajustements, d'aller contre cette unicit du dispositif conomique dominant, de sorte que la contradiction principale devient tatique : elle est en gros entre dictatures et dmocraties ; ou, dans des formes affaiblies, entre tats autoritaires et tats libres. Je remarque que cela nous ramne au dbat politique de la fin du XVIIIe sicle : le vrai dbat serait entre despotisme et dmocratie, despotisme et rpublique, pouvoirs autoritaires et pouvoirs libres etc. - puisque l'arrire-plan, savoir le capitalisme mondialis, n'est pas modifiable, qu'il est le fond naturel de toute disposition conomique ou politique.
Il y a une deuxime propagande, celle d'un camp que j'appellerai ractif. C'est un camp qui en appelle la tradition contre la modernit, et en particulier contre les formes juges inacceptables de la modernit dmocratique sous sa forme occidentale. Ce camp se rclame trs souvent d'une identit ethnique ou religieuse ou nationale. Comme vous le savez, a peut tre le christianisme, comme dans certaines figures en Pologne aujourd'hui ou bien dans la droite du parti rpublicain aux tats-Unis o vous avez des gens qui considrent comme tout fait naturel d'abattre avec de grands fusils des mdecins qui pratiquent des avortements. Il faut le rappeler, parce que sinon on a une vision unilatrale : on aurait une mauvaise religion, des meilleures, des moins mauvaises etc. Non, lorsque vous r-accordez la vie collective sur des identits de cet ordre, les effets de violence sont inluctables. Car naturellement, a peut tre aussi l'islam, comme en Turquie, en Iran ou dans des bandes armes qui ravagent le Moyen-Orient, a peut tre la singularit juive comme en Isral, a peut tre le nationalisme militariste rnov comme au Japon, en Inde, en Hongrie, a peut tre un autoritarisme semi-religieux comme la Russie de Poutine ... Tout a dfinit des particularits locales, mais l'essentiel c'est que tous ces mouvements affirment, sans exception, la compatibilit de leur raction traditionnelle avec le capitalisme dominant. Aucune de ces entreprises ne prtend dessiner une nouvelle voie sur le fond immuable du capitalisme historiquement dominant, ce sont des gens qui affirment au contraire la compatibilit entre un retour ractif aux traditions et une explosion ingalitaire et violente du capitalisme lui-mme. Comme on le sait, l'extrme-droite rpublicaine aux tats-Unis n'est nullement en train de prcher le retour une conomie collective, ce sont au contraire des partisans farouches et fanatiques de la proprit prive. Je propose de donner cette tendance ractive le nom de Ç fascisme È. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est raisonnable aujourd'hui d'appeler Ç fascisme È une vision anti-moderniste acharne, nostalgique de l'poque des nations, des religions, des conservatismes, et aussi des tats autoritaires, mais qui reste articule, et mme violemment articule, au capitalisme lui-mme. Dans le premier courant, toujours sur le mme fond capitaliste, la contradiction principale devenait celle entre dmocratie et autoritarisme, alors que dans la vision ractive traditionaliste qui comme vous le savez se dveloppe aujourd'hui, et qui est dj trs puissante, mme en Europe, par exemple en Europe de l'Est o elle se dveloppe vive allure, on a le mme fond capitaliste invariable mais la contradiction principale est la contradiction entre les vicieuses liberts modernes et l'ordre traditionnel, c'est--dire entre le dmocratisme socital et le culte de telle ou telle identit ferme.
J'insiste sur le point que la contradiction dont on nous parle tous les jours comme tant la contradiction principale, avec mobilisation anti-islamique etc. etc. est une contradiction qui en tout cas se fait sur fond d'un accord fondamental : la maintenance, l'invariabilit comme organisation conomique naturelle, du capitalisme dsormais mondialis, avec d'ailleurs des luttes d'influences pour s'emparer de tel ou tel fragment de cette mondialisation.
On pourrait imaginer une troisime position – je suis bien oblig de l'imaginer, parce que c'est la mienne – savoir un camp, aujourd'hui affaibli l'chelle plantaire, soutenant que la contradiction principale demeure celle qui oppose, opposerait, ou doit opposer, et ce toujours dans des expriences locales reprsentables, un mouvement d'mancipation collective - qui a t appel Ç communisme È, que Marx appelait aussi la Ç libre association È (on peut lui donner plusieurs noms) - au capitalisme lui-mme.
En somme, nous avons trois contradictions dclares principales par des tats, des opinions publiques ou des groupes restreints. Il y en a deux sur fond de capitalisme assum comme seule organisation naturelle de la production, des changes et des socits : pour l'une, la contradiction dictature et dmocratie (ou autoritarisme et libert moderne), et pour l'autre la contradiction entre modernit et tradition. Et puis, il y en aurait une troisime ( laquelle j'appartiens) qui s'en prendrait directement au capitalisme dominant et qui affirmerait que la contradiction principale reste depuis deux sicles celle qui oppose le capitalisme et la proprit prive au communisme et la libre association collective dans la production.
Ma thse c'est que dans la conscience des gens, la conscience des masses en gnral, et singulirement, chez nous, dans la fraction qu'on appelle Ç les classes moyennes È, la contradiction entre modernit et tradition opre finalement contre la contradiction entre capitalisme et mancipation. Elle la recouvre et, en dernire instance, elle en annule la pertinence. Appeler, comme notre prsident Hollande, Ç la dfense de nos valeurs (rpublicaines et dmocratiques)È contre la sauvagerie de la tradition, c'est dclarer qu'il ne faut plus tenir aucun compte de la vielle contradiction entre capitalisme et mancipation. C'est a le programme de modernisation de la conscience de gauche, c'est a qui est visible sur la tte mme de Valls : il va tre terrible sur la contradiction entre modernit et tradition, mais quand il rencontre les patrons, il va tre trs aimable, la contradiction, l, on peut Ç l'harmoniser È, c'est une question de bonne volont. En plus, qui n'est pas libral ? Il n'y a que les mchants qui ne sont pas libraux.
Ceci a des effets plantaires, parce que du coup apparat chelle d'ensemble ce que j'appellerai Ç le dsir d'Occident È comme seul recours contre la tradition. Et les mouvements qui se passent aujourd'hui dans le monde, quels qu'ils soient, sont exposs, travers cette fascination pour la modernit et la contradiction modernit-tradition, une captation au service des intrts du capitalisme mondialis partir d'une disparition, d'un effacement, d'une relativisation, de la contradiction qui prcisment opposerait frontalement un processus d'mancipation ce capitalisme mondialis.
C'est partir de l que je voudrais commenter le schma. Au centre, au croisement des deux axes (la
contradiction capitalisme-communisme et la contradiction modernit-tradition),
il y a l'quivoque des subjectivits contemporaines, qui sont tirailles par
quatre dterminations (et non pas seulement deux). Si, sur l'axe horizontal, le
mot Ç communisme È vous gne, vous pouvez le remplacer par
Ç politique d'mancipation È, Ç politique nouvelle È, tout
ce qui cristalliserait la ncessit d'en finir avec l'ordre ingalitaire,
oppressif et scandaleux impos l'humanit tout entire par la proprit
prive.
Tradition. La tentation identitaire des traditions
subsiste trs fortement. Parlons d'ici : Ç tre franais È,
Ç les valeurs de la France È et la prsence chez nous de gens qui ne
les respectent pas, Ç d'tranges trangers È É L'lment identitaire
caractrise toujours la tradition. La tradition, c'est toujours la volont de
prserver, de multiplier, de rpter une identit.
Modernit. La fascination pour la modernit, chez
nous, ce sera la marchandise, l'argent, le tourisme, la libert des mÏurs, le
rgime dmocratique etc.
Capitalisme. L'allgeance dominante au capitalisme
comme l'unique voie pour l'organisation des socits, je l''appellerai le
Ç capitalisme subjectivement naturel È, le capitalisme devenu comme
une seconde nature en quelque sorte de tous les sujets - force qu'on les ait
convaincu que rien d'autre n'tait possible. Il ne faut pas sous-estimer ce
point : on peut tre formellement, dans les dclarations, anti-capitaliste, mais profondment pntr en fait de la
conviction que rien d'autre n'est possible et que c'est l-dedans qu'il faut se
mouvoir.
mancipation,
communisme, É tout ce
que vous voulez, comme valeur absolue, la fois pense et rve – finalement,
dans les subjectivits contemporaines, passe, termine, finie.
Ce quadrangle, reprsent
dans le schma, je pense qu'il tourbillonne dans les subjectivits contemporaines,
avec des variabilits d'accent qui dpendent des conjonctures et de ce qui
arrive aux gens, tout simplement.
Tournons dans ce schma
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Ë la priphrie du
schma, on trouve le monopole que le capitalisme a conquis quant au dsir de
modernit. Le capitalisme est en tat de se prsenter comme l'unique support
possible de la modernit contemporaine, de l'invention, de la transformation,
mais aussi des liberts nouvelles etc. Et donc, vous avez un axe qui va du
capitalisme vers la modernit, que j'appelle Ç l'Occident È, comme
tout le monde. Le dsir d'Occident, c'est le dsir de cette orientation. C'est
un dsir qui fusionne quelque part capitalisme et modernit et qui fait de
modernit l'alibi majeur du capitalisme lui-mme. Avec l'injonction que si ce
n'est pas a, alors a va tre la terrible identit traditionnelle qui va
reprendre le dessus.
En continuant dans le
mme sens, vous avez l'axe entre capitalisme et tradition. Il y a en effet de
nombreuses tentatives contemporaines pour corrler le capitalisme des motifs
identitaires (religieux, nationaux, familialistes ou autres). Je l'appelle le
fascisme, comme je vous l'ai dit, puisque je pense que la dfinition gnrique
du fascisme c'est cette corrlation, paradoxale en apparence, entre capitalisme
et tradition qui
s'oppose la corrlation entre capitalisme et modernit. Le capitalisme tolre
cette tentative, et dans l'Histoire le capitalisme a tolr le fascisme, en
ralit. Il y a eu des conflits entre les dmocraties et les fascismes, mais le
capitalisme a pu servir, et sert aujourd'hui encore, d'arrire-fond de
nombreux tats parfaitement despotiques. Le capitalisme peut donc s'en
accommoder, notamment quand il est menac par autre chose. C'est pourquoi le
fascisme peut tre un adversaire apparent de la dmocratie librale, mais dans
la reconnaissance que l'arrire-plan est le mme. De l que la contradiction
historique entre fascisme et dmocratie a t stratgiquement moindre que la
relation antagonique constitutive entre capitalisme et communisme.
On tourne, et on trouve
un axe qui corrlerait communisme et tradition, axe qui, finalement, a t incarn
par les tats socialistes du XXe sicle. Ces tats, et les partis communistes
qui s'en rclamaient, ont garanti la stabilit de leur pouvoir - non
capitaliste de fait (ils avaient quand mme bris le monopole de la proprit
prive) - et ils l'ont en partie conserv en termes d'opinion, par une mfiance
l'gard de toute modernit - en dehors de la leur propre. Car c'tait une
cration moderne. Il faut quand mme insister sur ce point : briser le
monopole socital de la proprit prive, cela ne s'tait jamais vu pendant les
millnaires de l'Histoire. Ce qui s'est pass l - et qui pour l'instant a
chou – que ce soit en Russie, en Chine, c'tait une innovation
historique sans prcdent. Parce que la totalit des figures socitales depuis
des millnaires reposait, travers des modes de production trs diffrents,
sur le monopole de la proprit prive et la constitution d'une classe de
propritaires comme la classe naturelle dirigeante de tous les tats concerns.
Or, ce qu'il s'est pass c'est que cette transformation sans prcdent, qui a
cr dans le monde des lots d'organisation sociale chappant au caractre
naturel du capitalisme et de la proprit prive, s'est cramponne en termes
d'opinion, de subjectivits, des lments de tradition, notamment par
mfiance de la corrlation entre capitalisme et modernit, par mfiance du
monopole que le capitalisme prtendait sur la modernit. Y compris ici :
il y avait au PCF une hostilit dclare la lgislation de l'avortement, il y
avait une homophobie circulante, il y avait le Ç ralisme
socialiste È comme couverture du conservatisme formel dans le domaine de
l'art, la famille a t maintenue et encourage et puis mme, la fin des
fins, l'identit nationale est revenue (comme disait Aragon : Ç mon parti
m'a rendu les couleurs de la France È), il y a eu des traces
d'antismitisme dans les tats socialistes et, dans les partis communistes, des
traces importantes de mpris colonial envers les peuples domins. Tout a
rattachait quand mme les tats socialistes un socle traditionnel qui les a empchs
en fait de dployer É quoi ? Une nouvelle modernit. De dployer quelque
chose de concurrentiel au capitalisme, non seulement dans les mthodes de
production, mais plus gnralement dans une vision du monde, une construction
des subjectivits, un systme de valeurs, qui auraient t diffrents mais
aussi modernes. Et aussi, en un certain sens, de crer une dfinition
spcifique de la libert qui aurait t capable de rivaliser avec ce que le
capitalisme proposait dans son ordre propre et qui est devenu aujourd'hui la
figure du dsir d'Occident l'chelle de la plante entire. Le primat de
l'tat, c'tait la conviction que pour protger les acquis, c'est--dire la
proprit collective tatise, pour protger l'lment anti-capitaliste
dans son aspect le plus formel, il fallait ncessairement un tat autoritaire
dpolitisant la socit et, en mme temps, organisant des lambeaux de
tradition, dfaut d'une vritable modernit nouvelle (modernit qui avait pourtant
t recherche de faon trs active en Russie dans les annes 20).
C'est pourquoi, le
quatrime ct, qui est en pointill, hlas, ce serait l'invention d'une
nouvelle vrit politique qui assumerait d'un ct la contradiction principale
entre communisme et capitalisme et qui d'autre part dvelopperait une nouvelle
modernit. C'est a, quelles que soient les figures de mouvements auxquelles
nous participons et dont nous pouvons tmoigner, qu'il faut, la fin des fins,
travailler. Parce que, on peut le dire de faon un peu violente, ce qu'il faut
briser aujourd'hui, c'est le dsir d'Occident qui travaille chelle mondiale,
y compris la masse norme des victimes du capitalisme mondialis. Il faut
rappeler, par quelques chiffres, l'tat rel du monde d'aujourd'hui : on
sait que 264 personnes possdent l'quivalent de ce que possdent trois
milliards d'autres É ce sont des chiffres sans prcdent dans l'Histoire.
Aucune monarchie absolue n'est parvenue des carts de cet ordre. On peut s'en
accommoder comme si c'tait naturel, mais on peut aussi avoir quelques doutes
sur le fait que ce soit absolument ncessaire pour faire marcher l'conomie
mondiale. On a le droit de penser que c'est pathologique. Je suis quelquefois
tonn de l'apathie gnrale devant cette monstruosit. Pourquoi y a-t-il cette
apathie ? C'est que les gens se disent : Ç C'est vrai, ce n'est
pas formidable, mais c'est quand mme la condition de ma libert personnelle,
du fait que je ne vais pas si mal, de ceci, de cela, et puis du fait que par
rapport l o je suis, c'est pire ailleurs È. C'est si pire ailleurs que
ceux qui sont ailleurs veulent venir ici. Les rfugis ne sont qu'un pisode
dans une affaire beaucoup plus vaste, qui est que le dsir d'Occident travaille
la terre entire. Car ct des 264 personnes qui ont presque tout, il y a
50 % des gens qui n'ont rien. Des gens qui n'ont rien et qui on explique
que s'ils n'ont rien, c'est de leur faute (c'est l'explication la plus
rpandue), ils ne sont pas monts dans le char de l'Histoire comme il fallait
etc., Eh bien, il y a toujours un moment o, pour des raisons trs concrtes -
une famille, des enfants É - ils s'en vont l o le dsir les mne. Bien sr,
quand il y a des guerres, quand il y a des bandes armes vos portes, des
tortionnaires partout et des bombardements par-dessus le march, a acclre le
mouvement. Mais vous savez trs bien que depuis des dcennies, il est venu de
faon continue des ouvriers d'origine africaine dans notre pays, ce n'est pas
depuis deux ou trois ans. S'il y a aujourd'hui six millions de musulmans dans
notre pays, c'est qu'ils y sont venus, ce n'est pas parce qu'il y a eu une
gnration spontane de musulmans. Ils sont venus et ils sont venus pour
survivre, articuls et domins par le dsir d'Occident, puisqu'on leur raconte
que c'est a l'lment naturel de l'existence des socits productives. Si on
leur dit a, a veut dire que, eux, ils sont hors nature, ils ne sont pas au
bon endroit, l o ils sont on ne peut pas vraiment vivre. Alors on peut
dire : c'est la faute de leurs gouvernements. En ralit, quand on regarde
de prs, on voit comment a se passe : ce sont des zones de pillage
organis de longue date, avec des gouvernements corrompus pays par les
Occidentaux pour que le pillage puisse se continuer tranquille, les gens qui
sont l-dedans sont des gens qui n'ont pas de possibilits de s'installer, de
vivre É
Le schma indique tout
a. Il montre que si on ne construit pas, d'une faon ou d'une autre, le quatrime
ct de faon sensible, c'est--dire si on ne cre pas un dsir autre que le
dsir d'Occident, un rival du dsir d'Occident, savoir la cration d'une
politique qui soit expressment destine mettre fin la monstruosit du
capitalisme mondialis, eh bien ce quatrime ct ne pourra pas fonctionner. Il
y aura une pathologie plantaire que nous pouvons constater aujourd'hui
d'innombrables symptmes et dont les deux formes les plus caractristiques
sont : d'un ct l'apparition de plus en plus tendue de forces fascisantes,
y compris dans des tats apparemment raisonnables de l'Europe occidentale, et
la deuxime chose ce sont de gigantesques migrations de populations avec des
gens qui cherchent dsesprment aller l o on leur dit qu'on peut vivre.
a, a cre petit petit les conditions de la guerre.
C'est dans ce maelstrom
historique que nous pouvons nous situer. Un mouvement, quel qu'il soit, est une
bonne chose, parce que le mouvement exprime toujours une inquitude ou une
exaspration sur certains aspects de la situation prsente. Encore que,
souvent, on peut discerner aussi des phrases trs importantes du dsir
d'Occident, par exemple que ce soit encore mieux l o on est, avec une
solidarit minimale avec la vision plantaire des choses. Parce que les ennuis
qui sont les ntres sont encore loin de valoir ceux de gens qui sont prts
monter dans des barcasses et aller sur l'eau avec le risque de s'y noyer. Il
faut penser eux. Il faut penser eux, parce que c'est la bonne faon de
penser nous. Sinon on est engag soi-mme dans une espce de pathologie
gnrale cratrice de mort. Tout a pour dire que l'apprciation que nous
pouvons porter sur une figure de mouvement, quelle qu'elle soit, doit se faire
partir d'un dsir, et par consquent d'une pense, qui soit hostiles ou
expressment dgags du dsir d'Occident. Et donc, il faut une ide stratgique
qui va nous servir d'valuation de ce qui se passe concrtement : ce que
nous disons dans cette ide stratgique se trouve-t-il confort, consolid, ou
pas du tout, par ce qui se passe ? Il faut avoir le mouvement, mais aussi
il faut avoir ce que j'appellerai le mta-mouvement, c'est--dire une ide
interne au mouvement qui lui donne la capacit de juger ce qu'il est
historiquement. Il ne faut pas seulement avoir les ides du mouvement, il faut
avoir les ides de ces ides : il faut que le mouvement soit situable par
ses acteurs eux-mmes dans la situation que nous venons de dcrire, qu'il
puisse y reprer sa place, ses objectifs, ses tentations ngatives, dans quelle
mesure est-il rellement dgag ou pas par rapport au dsir d'Occident
etc.
Cette ide stratgique,
je pense qu'on peut la ramener quatre points programmatiques bien classiques,
qui constituent des oprateurs de jugement pour valuer la porte stratgique
relle de ce qu'on est en train de faire et de penser. C'est l'affirmation de
quatre possibilits, possibilits dont le dsir d'Occident se constitue en
dclarant que c'est impossible, justement. Nous tombons sur cette maxime, dveloppe
sous une forme ou sous une autre : une politique relle, c'est toujours
une politique qui dcide elle-mme de ce qui est possible et impossible,
c'est--dire qui n'entre pas dans un consensus avec l'adversaire sur ce qui est
possible et impossible. Car la domination, a consiste, fondamentalement,
dclarer ce qui est possible et ce qui est impossible et convaincre les gens
qu'il en va bien ainsi. L'exemple le plus frappant, bien entendu, c'est la
dclaration : Ç le capitalisme est la seule chose possible, la seule
figure rationnelle et naturelle de l'organisation de la socitÈ (les camps,
Staline etc., ce ne sont que des annexes argumentatives). La politique commence
quand vous n'acceptez pas que la distinction entre le possible et l'impossible
soit en partage avec votre adversaire. Vous affirmez que vous n'avez pas la
mme loi d'valuation de ce qui est possible et impossible que celle que la
propagande dominante tente d'imposer. C'est un geste de dgagement absolument
fondamental. Les 264 dont nous parlions, et dont la propagande dit que
Ç ce sont eux qui donnent le travail È, on leur dit :
Ç merci, messieurs, les donateurs de travail de cette espce, on peut s'en
passer !È.
Ces possibilits, nous
pouvons, dans un mouvement rel, mme une chelle trs petite, tester si
elles sont vivantes, ou si elles ne le sont pas, ce sont
des critres d'valuation. Voil ces quatre possibilits.
Premirement, il est
possible d'organiser la vie collective autour d'autre chose que la proprit prive
et le profit. Il faut revenir quand mme l'nonc crucial de Marx dans le Manifeste
o il dit un moment que tout ce qu'il raconte se ramne un seul
point : l'abolition de la proprit prive. Cette ide tait prsente dj
depuis un certain temps puisqu'on la trouve chez Platon, elle a anim toute la
pense mancipatrice du XIXe sicle, elle est assez largement oublie
aujourd'hui, et il faut la ressusciter tout prix. Autrement dit : le
capitalisme n'est pas, et ne doit pas tre, la fin de l'Histoire.
Deuximement, il est possible
d'organiser la production autour d'autre chose que la spcialisation et la
division du travail. En particulier, il n'y a aucune raison que se maintienne
la sparation entre travail intellectuel et travail manuel ou entre les tches
de direction et les tches d'excution. C'est plus profond que la notion
convenable d'galit, c'est l'ide que les divisions qui organisent le travail
lui-mme sont des divisions mortifres.
Troisimement, il est
possible d'organiser la vie collective sans se fonder sur des ensembles identitaires
ferms comme les nations, les langues, les religions, les coutumes. La
politique, en particulier, peut unir l'humanit tout entire hors de ces
rfrences. Toutes ces diffrences doivent et peuvent coexister de faon
fconde, mais l'chelle politique de l'humanit tout entire. De ce point de
vue, l'avenir est un internationalisme complet et il faut affirmer que la politique
peut et doit exister de faon
transversale aux identits de ce type.
Et enfin, quatrimement,
il est possible, peu peu, de faire disparatre l'tat comme puissance spare
ayant le monopole de la violence (police et arme). Autrement dit, la libre
association des humains et la rationalit qu'ils partagent peuvent et doivent
remplacer la loi et la contrainte.
Pour faire court :
abolition de la proprit prive (videmment, a ne veut pas dire :
nationalisation de vos canaps et de vos sommiers, a c'est qu'on veut faire
croire, a concerne diverses fonctions relevant du bien public, notamment les
grands ensembles de production, commerciaux etc.) ; fin de la division du
travail (point trs important, auquel Marx, qui appelait l'entre dans l're
du Ç travailleur polymorphe È tenait beaucoup, et qui est trs
occult aujourd'hui) ; la politique doit tre la politique de l'humanit
tout entire (l'internationalisme doit tre une ralit effective tous les
niveaux); dprissement de l'tat.
Ce n'est pas exactement
la donation d'un programme, il ne faut pas qu'il y ait d'ambigut l-dessus.
Ce n'est pas la description d'une socit venir qui surgirait on ne sait pas
trop comment. Ce sont des principes d'valuation de ce qui se passe : ce
qui se passe a-t-il une relation avec l'un de ces quatre points, lequel, et
dans quelles conditions ? Si aucun de ces points n'est convoqu d'aucune
faon, on jugera que ce qui se passe n'est en tout cas pas dans la direction
stratgique gnrale ncessaire pour qu'une politique nouvelle soit cre. Si
on voit les mouvements des places dans leur ensemble, de l'gypte Nuit
Debout, je pense que l'ide tait de traiter directement, et un peu
fantasmatiquement, le point quatre, en ralit : on allait construire tout
de suite, l, quelque chose comme un mode d'existence collective soustrait
toute autorit spare, on allait construire une autorit immanente,
c'est--dire l'autorit du collectif sur le collectif. C'est l'ide bien connue
de l'horizontalit, avec la mfiance et la suspicion vis--vis de l'mergence
de dirigeants, et finalement l'ide que c'est a la dmocratie absolue, la
dmocratie vritable. Du coup, je crois que a isole le point quatre, exprimentalement
: on exprimente localement une espce de disparition en partie magique de
l'tat, dans une horizontalit localise, qui n'a aucune prise finalement sur les
autres points. a produit l'effet trange que cette disparition de l'tat
spare cette horizontalit locale du reste, c'est une exprience qui elle-mme
est spare. Alors on dit : Ç Bon, on va l'tendre È. Mais pour
l'tendre, il faut d'autres propositions, il faut s'adresser d'autres gens,
il faut donc entrer dans une exprience qui va relever les trois autres points
d'une manire ou d'une autre. C'est a qui fait que Ç dmocratie È
est un terme insuffisant. Ç Dmocratie È, par lui-mme, n'est pas un
terme qui dit qu'il faut s'en prendre la proprit prive. Parmi les 264 qui
possdent presque tout, il y a certainement un bon nombre d'excellents
Ç dmocrates È É
exceptons les milliardaires chinois, que la dmocratie n'intresse pas
beaucoup. On peut soutenir que les rpublicains qui ont fait le coup d'tat de
Thermidor, c'tait a leur ide principale : on allait montrer que le seul
homme vritablement libre, c'tait le propritaire, cela a t quasiment
inscrit dans la Constitution aprs le renversement de Robespierre ; quant
aux ceux qui n'avaient pas de proprit, c'taient des individus l'existence
douteuse et surtout il fallait s'en mfier (comme l'homme est mauvais,
pensaient-ils, celui qui n'a pas de proprit voudra la voler, il ne faut donc
pas lui donner le pouvoir). La sparation vis--vis des autres points de l'ide
dmocratique, ft-elle pousse de faon extrme comme dans les mouvements des
places, est en ralit une sparation vis--vis de la socit tout entire.
C'est ce qui s'est pass en gypte de faon flagrante : ils n'ont pas vu
que l'crasante majorit des gens, si on leur demandait de voter, eh bien ils
votaient pour les Frres musulmans. Ils n'allaient pas voter pour la
continuation indfinie de la dmocratie des places parce qu'ils savaient
parfaitement que cela, c'tait une fiction, qu'un jour ou l'autre, il faudrait
rentrer la maison. Et la maison, on retrouverait quoi ? On
retrouverait la maison, comme elle est, avec son propritaire, qui vient vous
rclamer le loyer É
a montre quand mme
qu'il y a une solidarit des quatre points. Si je tentais de redonner quelque
force au mot Ç communisme È, je dirais que le communisme c'est le nom
de la solidarit des quatre points, de ces quatre hypothses. C'est le nom du
fait que vous ne pouvez pas tre vraiment dmocrate, si vous ne mettez pas fin
aux ingalits monstrueuses que le capitalisme engendre partir du droit de proprit
et de la logique de la concentration du capital ; mais vous ne le serez
pas non plus si vous maintenez la sparation, l'intrieur de la division du
travail, entre les cadres et les pas-cadres, les ouvriers et les techniciens
etc. ; et vous ne pouvez pas l'tre non plus si vous continuez vous
prvaloir d'une identit du type Ç les valeurs de la France È ou
d'une tradition religieuse etc.
Je vais conclure. La
politique nouvelle, si elle peut tre engendre par l'historicit des mouvements,
je la dfinirais par la mobilit, dans les subjectivits agissantes, des quatre
points fondamentaux. C'est leur prsence comme instruments d'valuation et leur
introduction ncessaire partout o il y a des mouvements populaires. Au fond,
la circulation concrte des quatre points va se cristalliser dans les mots
d'ordre du mouvement. Il y a une ncessit absolue qui est de dpasser les mots
d'ordre strictement ngatifs. Le mouvement, la fin des fins, va tre jug sur
quelle a t sa ou ses propositions affirmatives dans la situation concrte. Si
vous dtes simplement : Ç Ë bas la loi sur le code du travail È,
vous tes mort d'avance. Peut-tre que vous mourrez avec la loi elle-mme É Le
mouvement ne va pas tre jug sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il dit,
parce que les mouvements, du point de vue de leur tre, sont presque toujours
pareils, ils n'ont pas chang depuis l'Antiquit grecque : on se
rassemble, on occupe un lieu, on est trs content, on fait la cuisine, on tient
des assembles gnrales, tout le monde a droit la parole etc. etc. Il ne
faut quand mme pas nous prsenter a comme une innovation sensationnelle. Non,
c'est la loi des mouvements de masse, et elle est excellente, mais elle ne
traite pas la situation proprement parler, elle traite sa situation,
c'est--dire sa configuration interne, lgitime mais son inscription relle
dans l'Histoire va dpendre de ce qui est dit. C'est pour a qu'il y a aussi
des mouvements d'extrme-droite qui ont des caractristiques voisines, hlas.
Mme le grand mouvement contre le mariage pour tous É les gens taient l, contents, ils affrontaient la police avec
vigueur etc. et pour dire quoi ? Pour dire des saloperies. Donc, on les a
jug l-dessus, on n'a pas dit : Ç a c'est un beau mouvement de
masse È, on a dit : Ç c'est des cochons È. C'est pour vous
dire que l'tre formel du mouvement de masse est un invariant de la dmonstration
historique d'un groupe dtermin et ce qui va le qualifier en tant que tel, du
point de vue de sa position dans le diagramme que vous avez, c'est ce qu'il
dclare affirmativement. Parce que quand on dclare ngativement, on peut
toujours tre alli avec des gens qui ont les mmes ngations que vous et qui
ne valent pas grand chose. Par contre les
affirmations, a divise, a c'est sr ; et l'affirmatif va tre la cl de
ce qu'un mouvement signifie. Nous devons viser la construction d'une modernit
politique, qui sera aussi sociale, productive, travailleuse, intellectuelle,
artistique, technologique, qui sera capable de rivaliser avec le monopole contemporain
ingalitaire mortifre et guerrier de la modernit capitaliste.
Je vais conclure par la
posie. Quand il y a un mouvement, on dit Ç a bouge È et c'est bien
que a bouge, parce que sinon c'est mort. a bouge a rapport avec le souffle.
C'est infra-politique, mais c'est ce qui rend possible, peut-tre, qu'un
certain nombre des points fondamentaux commencent se mouvoir. Je voudrais
conclure par une grande mtaphore potique de ce souffle lui-mme et je le
trouve dans le pome Ç Gnie È de Rimbaud.
Ce pome est une nigme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, Ç le gnie È, d'un bout l'autre du pome. Quand Rimbaud dit Ç il È, je vous prie chaque fois d'entendre Ç politique nouvelle È ou Ç communisme È, votre choix (rires dans la salle)
GNIE
Il
est l'affection et le prsent, puisqu'il a fait la maison ouverte l'hiver
cumeux et la rumeur de l't, - lui qui a purifi les boissons et les
aliments - lui qui est le charme des lieux fuyants et le dlice surhumain des
stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout
dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempte et les
drapeaux d'extase.
Il est l'amour, mesure parfaite et rinvente, raison merveilleuse et
imprvue, et l'ternit : machine aime des qualits fatales. Nous avons tous
eu l'pouvante de sa concession et de la ntre : jouissance de notre sant,
lan de nos facults, affection goste et passion pour lui, lui qui nous aime
pour sa vie infinie...
Et nous nous le rappelons, et il voyage... Et si l'Adoration s'en va,
sonne, sa promesse sonne : "Arrire ces superstitions, ces anciens corps,
ces mnages et ces ges. C'est cette poque-ci qui a sombr !"
Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira
pas la rdemption des colres de femmes et des gats des hommes et de tout ce
pch : car c'est fait, lui tant, et tant aim.
O ses souffles, ses ttes, ses courses ; la terrible clrit de la
perfection des formes et de l'action.
O fcondit de l'esprit et immensit de l'univers.
Son corps ! Le dgagement rv, le brisement de la grce croise de
violence nouvelle !
Sa vue, sa vue ! tous les agenouillages
anciens et les peines relevs sa suite.
Son jour ! l'abolition de toutes souffrances
sonores et mouvantes dans la musique plus intense.
Son pas ! les migrations plus normes que les
anciennes invasions.
O lui et nous ! l'orgueil plus bienveillant
que les charits perdues.
O monde ! et le chant clair des malheurs
nouveaux !
Il nous a connus tous et nous a tous aims. Sachons, cette nuit
d'hiver, de cap en cap, du ple tumultueux au chteau, de la foule la plage,
de regards en regards, forces et sentiments las, le hler et le voir, et le
renvoyer, et sous les mares et au haut des dserts de neige, suivre ses vues,
ses souffles, son corps, son jour.
Je voudrai terminer par
trois ponctuations de ce texte extraordinaire.
D'abord, Rimbaud attribue
au Gnie deux attributs contradictoires. Il est le charme des lieux fuyants
et le dlice surhumain des stations. Or, je pense que c'est ce que doit
tre le reprage dont je vous parlais des points d'appui de la politique et de
son Ïuvre dans les mouvements locaux ou plus vastes. a se donne dans des
singularits presque insaisissables, il faut tre trs attentif pour discerner
la prsence des motifs rels dans une situation. Mais a procde aussi d'une
construction solide de ce qui est le plus fortement tabli. Il ne faut jamais
sacrifier le charme des lieux fuyants au dlice surhumain des
stations, il ne faut pas sacrifier le nomadisme des lieux fuyants, le cte mouvement, passage, l'immobilit des pouvoirs.
Mais il ne faut pas non plus sacrifier la ncessit d'une vision stratgique
solide, installe, partage, l'opportunisme des circonstances.
Deuximement, Rimbaud
nous dit aussi que la politique nouvelle doit assurer la sortie relle du monde
dominant, elle ne doit pas s'y installer, elle ne doit pas se contenter de le
critiquer indfiniment de l'intrieur. Il faut en sortir. Il faudra bien
organiser la sortie du capitalisme. Je dirais plus volontiers sa sortie que son
renversement. Tout comme, pour Platon, la philosophie c'est la sortie de la
caverne du semblant. Et cette sortie implique deux choses. L'accueil positif de
l'vnement, ce qui autorise l'espoir d'une nouveaut en brisant les lois de la
domination, c'est ce que Rimbaud appelle magnifiquement le brisement de la
grce nouvelle. Accueillir positivement ce qui se passe comme une occasion
de sortie, et pas seulement de pitinement. Et une fois sorti, il y a
l'invention active, il y a le travail des consquences les plus lointaines de
l'vnement, celles qui anantiront l'ordre ancien. Une fois la sortie opre,
on se retournera vers lui et on dira : Ç c'est fini, c'est
pass È. Et Rimbaud le nomme cette fois-ci violence nouvelle, les
deux ensemble : une violence n'est acceptable que si elle est nouvelle,
elle n'est pas alors violence au sens habituel du terme, mais cration,
invention.
Et enfin, il nous indique
que cette nouveaut politique, il faut la fois la vouloir, l'affirmer, l'appeler,
mais il faut aussi la voir o elle se trouve, il faut avoir l'Ïil exerc pour
voir o dans le mouvement, dans quel mot d'ordre, dans quelle action, se situe
vraiment le point dcisif. C'est--dire voir o est le chemin que notre pense
emprunte, doit emprunter. Et il faut en parler aux autres, c'est a qui est
fondamental. Il faut le renvoyer aux autres avec l'enthousiasme ncessaire. Il
faut cet lment neuf, historique, o peut se construire la nouvelle politique,
il faut le hler, le voir – le percevoir dans son chemin cach
– et le renvoyer - c'est--dire le lguer tous les autres.
C'est comme a qu'on va conclure, avec Rimbaud : sachons tous avoir du gnie, c'est--dire cette nouvelle politique qui va venir, cette politique d'mancipation qui va venir, qui viendra, qui est l mme, qui n'est peut-tre pas assez hle, pas assez vue, pas assez renvoye. Sachons la hler, la voir, la renvoyer la terre entire, laquelle en ce moment ce gnie manque cruellement.
6 juin 2016
Le 17 octobre 2016, la sance
du sminaire sera consacre au livre que Monique Dixsaut a publi l'anne
dernire : Platon-Nietzsche. L'autre manire de philosopher (dit.
Fayard coll. Ç Ouvertures È). Elle runira Monique Dixsaut, Dimitri
El Murr, Quentin Meillassoux et Alain Badiou.
Selon Monique Dixsaut, tant Platon que Nietzsche soutenaient d'une certaine faon une indivision ultime de la vie et de la pense (ou de l'art et de la philosophie), mais ils ne la prenaient pas par la mme entre : Nietzsche a voulu dire que la pense elle-mme pourrait tre une expression immanente de la vie, tandis que Platon pensait qu'il fallait entrer dans la question de la vie par la pense. Ce qu'ils ont en commun, c'est au fond l'ide que la philosophie, son dsir propre, consiste construire une insparation de la vie et de la pense, qui est plus importante que l'ide de la hirarchie de l'une ou de l'autre.
Publication de la version thtralise de la traduction de La Rpublique de Platon (reprsente au dernier festival d'Avignon) ; dans le mme volume : L'incident d'Antioche, pice crite dans les annes 80 du sicle dernier.
Ce que je voulais vous
dire aujourd'hui.
Pour l'essentiel, notre
trajectoire a t d'explorer ce que j'ai appel les oprateurs de finitude,
c'est--dire tout ce qui est capable de recouvrir un point d'o quelque chose
d'essentiel et d'infini pourrait jaillir, ou se montrer, par ce qu'on pourrait
appeler des plaques de finitude : des nominations, des allgations, des
oprations matrielles aussi, qui recouvrent tout cela et finalement le
dterminent partir de donnes qui sont celles de la conservation du monde
existant.
En ralit, les oprations
majeures de l'oppression, sous toutes ses formes, ont longtemps t dsignes
sous les mots soit de rpression soit d'exploitation. Il y a une longue
histoire d'ailleurs du rapport complexe entre exploitation et rpression dans
les figures concrtes de la domination. Il a ainsi t dit, d'un ct, que
l'exploitation tait systmique, qu'elle tait la vraie racine de l'oppression,
parce qu'elle tait inscrite dans le systme fondamental de l'organisation conomique
et sociale : au cÏur des choses, on trouvait le fait qu'en dfinitive, dans le
rgime du capitalisme sous toutes ses formes, il s'agit de faon systmique d'extraire
de la plus-value partir de la force de travail. a dfinit l'exploitation au
sens strict, technique, du terme, tel que le marxisme l'avait dgag. Puis,
d'autre part, il y avait la rpression, c'est--dire les oprations de force
que le pouvoir dominant mobilise contre l'existence effective des rvoltes,
contre tout ce qui gnerait ou troublerait ses intentions, son devenir, les
lois qu'il propose etc. Il y a eu tout un long dbat, qui n'a jamais vraiment
t termin, sur la question de savoir si le point cl de la politique
d'mancipation relevait dans sa capacit annuler ou contrarier des effets
rpressifs, ce qui d'une certaine manire tait la fin des fins une logique
de guerre civile, ou d'insurrection, ou de rvolution dans le sens le plus
effectif ou le plus prcis du terme. C'est--dire se hausser un niveau
d'activit et d'organisation qui rend possible l'annulation de la supriorit
rpressive de ceux qui, par ailleurs, sont les exploiteurs. D'une certaine
manire, le processus d'mancipation tait un processus qui travaillait ce
que la capacit rpressive de l'appareil d'tat, de ses sous-produits, de ses
drives diverses, puisse un moment donn tre, premirement neutralise, et
deuximement renverse effectivement dans la figure qui tait historiquement
dfinie comme la prise du pouvoir et le remplacement d'une figure de l'tat par
une autre.
L'autre vision aurait t
qu'il fallait s'en prendre, par des mthodes complexes et varies, l'exploitation
elle-mme. Le cÏur de la question n'tait pas seulement de neutraliser la
capacit rpressive mais de modifier en profondeur, de dtruire et de remplacer
la systmique de l'exploitation. D'o un dbat trs complexe sur la vision de
la politique rvolutionnaire comme articulation d'un point de vue stratgique
qui dracinerait l'exploitation et qui aurait en mme temps tactiquement besoin
de neutraliser la capacit rpressive de l'appareil d'tat qui soutient et
protge ce systme d'exploitation. Il y avait une figure quasiment allgorique
de la chose : c'tait la situation o vous avez des grves ouvrires massives,
qui, d'une certaine faon, se situent au niveau mme, dans le lieu mme, de
l'exploitation dans sa figure systmique, c'est--dire un refus de supporter
plus avant l'exploitation proprement dite ; vous avez l'intervention de
l'appareil rpressif pour briser cette grve ; et vous avez alors
l'intervention d'une force de mobilisation populaire vaste et ventuellement
capable de riposter, de se dfendre, qui va neutraliser la capacit rpressive
de l'appareil d'tat et rendre en un certain sens, idalement, la grve
intgralement victorieuse, c'est--dire capable de se saisir de l'appareil
productif lui-mme. C'est une mtaphore, ce n'est pas comme a que,
historiquement, les choses se passent, mais c'est une image trs forte de ce
que pouvait tre la pense, au fond la plus banale, la plus rpandue, des
activits effectives de la politique d'mancipation dans une articulation
toujours recherche entre la figure de l'exploitation et la figure de la
rpression.
Ceci faisait en ralit
deux figures majeures de l'espace de reprsentation de la politique d'mancipation
: la grve gnrale et l'insurrection. Si vous regardez bien historiquement,
c'est ce complexe grve gnrale-insurrection qui a t pendant longtemps,
surtout en Europe, la dtermination immanente de ce qu'taient en fin de compte
les enjeux, les objectifs, de la politique d'mancipation. L'idal, propos
dans maintes figures, c'tait l'articulation des deux, c'est--dire une grve
gnrale pratique dans une corrlation effective la neutralisation des
capacits rpressives de l'appareil d'tat. Je pense que cette figure a connu
une apoge dans la Catalogne de la priode de l'Espagne rpublicaine - sous la
direction des anarchistes, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu
des grves d'une force telle que les ouvriers s'emparaient effectivement de
larges pans, sinon de la totalit, de l'appareil productif et par ailleurs une
capacit, sous la forme de milices populaires, de neutralisation de la capacit
de rpression tatique, qui faisait qu'on s'emparait aussi du pouvoir de
l'espace, du pouvoir urbain : on s'emparait de Barcelone, de Valence É Et
c'est pour cela qu'il y a eu l des crations importantes, des choses
significatives, des choses dont il faut s'inspirer encore aujourd'hui, parce
que, mon avis, il y a eu l la mise en Ïuvre d'une articulation non
compltement tatise de la relation entre destruction du systme
d'exploitation et capacit de neutralisation de la rpression. D'une certaine
manire, il y a eu, idalement, une articulation effective, historique, du
principe sous-jacent l'ide de grve gnrale ( savoir, s'emparent
directement de l'appareil productif ceux-l mmes qui en sont les victimes sous
le capitalisme) et de la capacit anti-rpressive
donne dans une figure insurrectionnelle. Deux grandes figures hrites dj grosso
modo de la deuxime moiti du XIXe sicle et se poursuivant vrai dire
largement jusqu' nos jours.
Sauf que, entre-temps, on
s'aperoit que cette figure a toujours tendance se scinder, s'carter, se
dfaire, parce qu'en ralit la pense insurrectionnelle dans son principe
subjectif n'est pas identique la grve gnrale dans son principe subjectif.
Parce que la pense insurrectionnelle c'est quelque chose qui a trait quand
mme l'appareil d'tat – vous brisez l'appareil d'tat, mais
immdiatement vous tes l'appareil d'tat – tandis que la
philosophie sous-jacente la grve gnrale, c'est quelque chose qui, au fond,
vise un lieu, l'usine, qui n'est pas proprement parler tatique, mme si elle
a des rapports trs serrs avec l'tat. C'est un lieu, et ce lieu peut
dans certaines circonstances tre tenu et considr comme un lieu politique.
Mais en fin de compte, dans tous ces cas, vous voyez que le pouvoir de la
finitude semble li ou organis d'une part par la figure systmique de
l'exploitation, qui au lieu d'ordonner la production l'galit gnrale de
l'humanit comme telle, l'organise en fonction du profit d'individus
particuliers, et d'autre part par la figure insurrectionnelle qui, elle, s'en
prend directement l'tat en tant qu'il est un tat de classe, c'est--dire en
tant qu'il a cette limite fondamentale de se prtendre l'organisateur de la socit
en gnral alors qu'en ralit il est au service d'une petite fraction de cette
socit. Dans cette tradition rvolutionnaire, je dirais volontiers Ç anarcho-communiste È, je ne sais pas comment l'appeler - elle s'est appele Ç anarcho-syndicaliste È
un moment donn, mais c'tait trop vers d'un seul ct – on avait aussi
une assignation singulire de la finitude qu'on avait l'intention de dtruire,
c'est--dire du lieu de l'infini si vous voulez. L'infini, c'tait d'un ct la
capacit surmonter la coercition tatique, militaire, policire etc. et de
l'autre le fait finalement de constituer le lieu usine comme un lieu
d'indpendance politique populaire effective.
Tout le point est de
savoir qu'est-ce qu'on fait de cet hritage, car ce que je voulais dire, c'est
que je ne suis pas sr que cette figure - combinaison du vecteur subjectif
insurrectionnel et de la figure de la grve gnrale comme pouvoir ouvrier -
soit encore historiquement pertinente, en tout cas dans nos rgions. Quand
on voit les manifestations organises par la CGT, avec aux avant-postes des
brigades de jeunes gens dcids
en dcoudre avec les flics, on peut voir a comme une figure heureuse aprs
tout. Mtaphoriquement, on pourrait dire : voil, on a les travailleurs,
qui symbolisent le ct Ç grve gnrale È (mme si leur grve n'est
pas vraiment gnrale, mais peu importe, symboliquement ils reprsentent a) et
d'un autre ct nous avons des brigades de jeunes gens qui reprsentent
Ç l'insurrection È. Mais on n'est pas sr que ce soit rel, tout a,
on n'est pas compltement sr que ce n'est pas prcisment une figure rpte,
et non pas invente, de quelque chose qui pour part a disparu. Franchement,
qu'il y ait des bagarres avec les flics et que a se passe au cours de grandes
manifestations, j'ai une tendresse pour a. D'ailleurs je l'ai beaucoup fait
quand j'tais plus jeune. Mais c'est une raison suspecte, a. Parce que si je
l'ai fait, c'est que a se faisait dj depuis longtemps et que a se faisait
dans des formes peut-tre plus organiquement lies la situation de l'poque
que ce n'est le cas aujourd'hui. Je
prends cet exemple, qui est un exemple trs concret, car d'une certaine manire
il incarne bien ce que je vous disais, c'est--dire la rmanence de la figure selon
laquelle, en ralit, il y a deux dimensions et que tout le problme est de
savoir comment penser l'intersection de ces deux dimensions. Comment la
volont, le prestige et le courage insurrectionnels, quand mme polariss du
ct de la destruction de l'adversaire, se nouent avec la dimension grve
gnrale ouvrire qui est, elle, polarise par tout autre chose :
substituer la gestion systmique de la dictature du profit, au lieu mme o
la plus-value est extorque, quelque chose qui serait un autre rgime de
souverainet. Qu'est-ce que cela signifie quand on a le sentiment de voir le
retour de cette figure-l, y compris sous le mot Ç convergence des
luttes È ? Car ce mot, Ç convergence des luttes È, il a
toujours signifi a : la composition d'un lment insurrectionnel et d'un
lment de soustraction la dictature du travail sous sa forme aline. C'est
dj comme a que marchaient les insurrections de 1848, une jeunesse dcide
la bagarre, avec les tudiants de Polytechnique d'un ct, qui convergeaient,
plus ou moins bien d'ailleurs, avec les ouvriers de la ville de l'autre, soit
des leves populaires lies, elles, la question du travail.
D'ailleurs il faut savoir,
pour qui en a l'exprience, que lorsque la grve est relle, elle est un tat
de choses et pas simplement un moyen. Une vraie grve, c'est une grve qui
est telle que les ouvriers finissent par dire Ç on est en grve È
comme si c'tait une valeur intrinsque, un tat de choses. C'est pour a que
les fins des grandes grves, celles qui ont t mobilisatrices, fortes, avec
des assembles gnrales, un puissant comit de grve etc. eh bien, c'est trs
difficile obtenir, trs souvent les syndicats sont obligs de forcer les
choses pour que a finisse et quelquefois ils n'y arrivent mme pas. Une scne
fondamentale de mai 68 c'est quand la CGT a dboul Renault-Billancourt pour
dire Ç maintenant, c'est fini È, qu'ils ont t siffls, et qu'ils
ont d remballer leur marchandise. a a dur encore deux semaines É Ce sont des
scnes qui indiquent quelque chose de fondamental qui est que la vraie vise
subjective d'une vraie grve, c'est rellement de mettre fin la figure
systmique qui rgne dans l'usine elle-mme et dont l'usine n'est qu'un petit
aspect, un aspect concrtement constitu comme lieu. Et que de l'autre ct, la
figure insurrectionnelle, mme si elle se solde finalement par une bagarre dans
un coin, est en fin de compte polarise sur l'apparition d'une structure de
force militarise alternative qui n'est plus celle de la police, de l'arme, de l'tat.
Est-ce qu'on reproduit le
fait que l'appareil d'tat ractionnaire bourgeois protge le maintien de
l'organisation systmique dans la figure o le dtachement insurrectionnel
serait appel protger la nouvelle figure de l'organisation de la
production ? On peut imaginer des choses comme a. Mais ce n'est pas sr.
Et ce n'est pas sr pourquoi ? Ce que je pense, c'est que l'identification
de l'adversaire est, dans cette figure, encore insuffisante. L'adversaire, le
systme existant, ce n'est pas l'exploitation directe au lieu du travail ajoute aux flics, savoir l'appareil qui dfend ce systme
d'exploitation directe. C'est une reprsentation qui a domin parce qu'elle
avait une figure concrte forte, en particulier l'poque o il y avait encore
des tas de grandes usines au cÏur des villes. Mais avec les immenses
dsindustrialisations qui ont frapp nos pays, cela ne fonctionne plus dans nos
pays comme une image complte pour une raison trs simple, je crois : les
oprateurs de finitude se sont ramifis, ils ne se rduisent pas la
brutalit, simple d'une certaine manire, de la coexistence entre
l'exploitation de la force de travail dans l'usine et de la capacit rpressive
reprsente par la police et par l'arme. Ce n'est donc pas cette apparence de
double combat – des dtachements capables d'affronter la police d'un ct
et de l'autre des organisations ouvrires capables de provoquer des grves
gnrales – ce n'est pas ce dispositif-l qui est mon avis pertinent
aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on sache quel est le dispositif
pertinent ...
Les oprateurs de finitude ont chang et, en particulier dans nos pays, le point cl c'est qu'il existe une classe moyenne trs importante. Cette classe moyenne, si on regarde bien, est une classe qui n'est pas directement homogne l'appareil d'tat, mme si elle lui donne son agrment ou si elle se rend tous les trois ou quatre ans pour l'lire, le conforter, et elle n'est pas non plus exactement dans la figure du travail productif alin. Elle est donc incertaine et en mme temps elle dtermine largement le cours politique des choses. Or les oprateurs de finitude auxquels cette classe moyenne dans son extension diffrentie est soumise sont des oprateurs de finitude de type nouveau. Ce n'est pas la figure de l'exploitation de la force de travail ouvrire dans sa pertinence historique, a n'est pas non plus le fait qu'elle est intgre comme telle du ct de l'appareil d'tat. Pourquoi donc la grande classe moyenne occidentale soutient-elle, finalement assez fermement, le systme de domination actuel ? C'est la question cl qu'il faut se demander. Il y a cela plusieurs rponses et c'est largement le soubassement du dbat politique actuel - je laisse de ct ceux qui pensent que tout va trs bien, qui se rjouissent d'tre dans un pays o la classe moyenne soutient fermement, tranquillement et dmocratiquement, les ignominies de l'oligarchie dirigeante. On pourrait dire : c'est trs simple, elle le soutient parce qu'elle y a son intrt, elle est richement entretenue par cette socit, et elle ne voit pas du tout pourquoi elle irait rejoindre l'norme et gigantesque masse des gens qui, dans d'autres continents, n'ont rien du tout, n'arrivent pas survivre au point qu'ils n'ont pas d'autre ressource que de prendre des bateaux qui coulent pour venir chez nous. Mais c'est un tout petit peu plus compliqu. Je pense qu'il faut diffrencier les oprateurs spcifiques par lesquels se constitue, en dehors des oprateurs de finitude antrieurs, la soumission de la classe moyenne. Encore une fois, elle n'est ni soumise la rpression tatique comme telle, ni rellement interne l'exploitation usinire de la force de travail. Elle est l, abondante, et dans nos pays trs abondante (plus de la moiti des gens) et elle dcide en un certain sens les nuances de l'tat. C'est elle fondamentalement qui choisit entre la gauche et la droite, c'est--dire entre le mme et le mme quelques nuances prs. C'est une classe qui on est arriv faire penser que ce type de nuances est dcisif quant son propre avenir. C'est une opration tout fait particulire qui ne se rduit pas aux deux autres. a donne des choix varis, d'ailleurs, l'intrieur de la figure des nuances politiques disponibles, des choix qui font qu'on a pu recouvrir les aspirations ventuelles de cette classe en dfinitive entretenue, mprise, sollicite, divise (flottant avec des parties quand mme plus basses, des parties plus hautes etc.), on a pu arriver une domestication moyenne de cet ensemble-l en procdant la conviction qu'en dfinitive le systme existant, dont en gnral elle connat, et mme discute, les ingalits, les vilenies etc., que tout a tait conforme sa propre existence condition qu'on lui laisse, elle, le choix des nuances des couleurs gnrales de l'affaire. Donc ce n'est pas vrai qu'elle ne dcide rien, il faut nuancer le fait que dans l'lection, on ne dcide rien. Du point de vue de la classe moyenne, on dcide quelque chose, c'est pour a qu'elle y tient comme la prunelle de ses yeux, qu'elle est dmocratique dans l'me et qu'elle va voter en sries. Elle pense rellement que quelque chose lui est confi l. Et je pense que c'est vrai : quelque chose lui est confi, condition que cela ne remette en rien en cause les donnes systmiques en place, en particulier que cela ne remette pas en cause ce que, en dernier ressort, vhicule cette socit. Ë savoir, la fin des fins, chelle mondiale, d'une part l'activit d'exploitation absolue de la force de travail, jusqu' sa quasi extnuation dans certains pays (il faut voir comment travaillent les ouvriers chinois aujourd'hui, pour ne pas parler des ouvriers du Bangladesh, de ce qui se passe dans les usines au Cambodge etc. É. chelle mondiale, la puissance du systme d'extorsion et de pillage de la ressource humaine reste videmment massive). Et d'autre part, les interventions policires, militaires, dictatoriales, de torture, restent aussi massives, concernent des populations gigantesques. Cette polarit demeure, mais dans nos rgions, o, d'une certaine faon, la classe moyenne s'est dveloppe, installe, je pense qu'il faut dire qu'elle accepte ce systme-l parce que certaines choses lui sont donnes. Parmi ces choses, il y a bien sr un standing matriel peu prs Ç normal È, si je puis dire, qui fait que a n'a rien voir naturellement avec ce que peut tre la vie d'un paysan Centrafricain, d'un Congolais du Kiwu, ou de la majorit des Chinois et voire mme des Russes. Le niveau gnral de la classe moyenne est un niveau de survie paisible pour l'essentiel. Mais a, ce n'est pas le point de recouvrement subtil le plus important, parce que, idologiquement, il est clair que ce quoi cette classe tient absolument, c'est ce qu'elle appelle la dmocratie. La dmocratie ce n'est pas immdiatement la mme chose que le fait qu'on lui assure, bon an mal an, un train de vie honorable, c'est donc quoi exactement ? C'est, je pense, qu'elle est corrle l'tat. Non pas qu'elle en rgente le principe gnral, mais elle est matresse du systme des inflexions nuances de ce pouvoir. C'est pour a que c'est elle qui dcide entre la droite et la gauche. Je dirai mme qu'elle dcide du fait qu'il est ncessaire qu'il y ait une gauche. Je pense que la gauche, plutt qu'une force, c'est une ide. C'est pour a que c'est indestructible. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui disent : Ç il y a une crise de la gauche !È. Sartre, il y a quarante ans, crivait : Ç la gauche est un cadavre tomb la renverse et qui pue È. Il n'y a absolument rien de nouveau dans le fait que la gauche est en crise, elle est cadavreuse dans son essence originaire. Parce qu'elle prtend tre une alternative, alors qu'elle est une variable d'ajustement. C'est comme a qu'il faut la dfinir : une variable d'ajustement, c'est--dire la possibilit permanente pour la classe moyenne de se reprsenter qu'elle peut changer quelque chose. Changer quelque chose, c'est appeler la gauche au pouvoir, de tout temps, et la gauche au pouvoir est naturellement dans les limites de sa fonction de variable d'ajustement et donc elle est ncessairement toujours un peu malade de ne pouvoir faire peu prs rien de ce qu'elle a dclar qu'elle ferait. Ce qui est un statut quand mme assez particulier : d'avoir pour mtier de ne pas faire ce que vous aviez dit que vous aller faire É
Mais l'existence de ce mtier est en vrit l'existence d'une abstraction. La gauche, c'est une abstraction, une ide, c'est a son tre propre. C'est l'ide qu'on peut dans un systme aussi violent, robuste et install, et de surcrot, comme on l'a dit au dbut de cette sance, historiquement victorieux (pour l'instant), c'est l'ide que dans un tel systme, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qui reste de nuances possibles l'intrieur de cela, et la gauche c'est au fond l'ide qu'on peut toujours, et a c'est un oprateur de finitude, qu'on peut toujours faire prendre pour un changement vritable quelque chose qui n'en est pas un, pourvu qu'on vous laisse quand mme un espace de nuances spcifiques par rapport aux actions du pouvoir dans une priode dtermine. Cette ide est trs importante, parce qu'au fond elle est la projection de l'existence mme de la classe moyenne qui est coince entre d'un ct l'oligarchie capitaliste, qui est quand mme en voie de concentration ininterrompue, surtout en ce moment, c'est quelque chose de stupfiant : c'est quelques centaines de personnes absolument dtermines qui cumulent des fortunes inimaginables, et de l'autre par l'norme masse proltaire mondiale. Alors entre les deux, il faut qu'elle se dtermine librement dans un champ qui lui est propos. Ce champ, c'est le champ des nuances que, au fond, dans nos pays, le pouvoir d'tat s'autorise plus ou moins. L'oprateur spcifique de finitude dans nos rgions destination de la classe moyenne, c'est de lui tolrer de lgifrer sur les nuances de la vie politique, cette lgislation sur les nuances pouvant mme tre reprsente comme des changements importants – qui sont en ralit des choses peu prs minuscules chelle plantaire, mondiale ou tout simplement relle. La classe moyenne est l subjectivement dans sa fonction, qui lui permet un truc auquel elle tient normment et qui est la fonction critique. Il suffit qu'il y ait un espace de nuances et que cet espace de nuances soit reconnu comme important, comme faisant partie de la vie de l'tat, pour que, d'une certaine manire, vous soyez en position de reconnatre cette fausse importance comme le systme de votre propre potentialit politique. On a l une finitude constitutive, l'usage d'une classe dtermine, nombreuse, et mme majoritaire dans nos pays, qui consiste crer un espace de libert minimale qui est charg de reprsenter la libert en soi, sous le nom, tout fait caractristique, de Ç libert d'opinionÈ. Quand on est philosophiquement form Platon, on sait que l'opinion ce n'est pas grand chose, c'est une libert toute petite. Parce que la libert vritable, ce n'est pas une libert d'opinion, mais une libert effective, une libert de transformation. La libert d'opinion, elle, n'est pas transformatrice, elle est au contraire au lieu exact de la nuance dont je vous parlais, qui, d'une certaine faon, permet de donner un certain jeu un systme qui est par ailleurs une gigantesque machine dont la transformation radicale est presque inimaginable. Dans l'tat de victoire, d'installation, de richesse, de militarisation qui est le sien aujourd'hui, les nuances sont inopportunes, si je puis dire.
Je voulais simplement dire, au terme de tout cela, le point suivant. Je pense que nous sommes dans une poque de transformation des figures dominantes de ce qui constitue l'alternative, la deuxime possibilit, non pas au niveau systmique – parce que, en gros, au niveau systmique, ce qu'on a eu, ce qu'on voit, c'est que le systme antrieur s'est mondialis, mais en ralit il est identique lui-mme pour l'essentiel – non pas au niveau systmique, donc, mais au niveau des oprateurs de finitude, c'est--dire du discours articul, et arm aussi d'ailleurs, du camp adverse, au niveau de l'espace dans lequel se meut la pense ractionnaire et oppressive actuelle dans le systme gnral de ses propositions de finitude. Autrement dit, est en train de se mettre en place, et a depuis les annes 80, non seulement une figure victorieuse du capitalisme, puisqu'il n'a plus d'alternative visible, installe, mais quelque chose de plus qui est le nouveau systme de perptuation de cette victoire, dans des conditions, prcisment, o l'alternative n'est pas constitue. Parce qu'il faut bien voir que d'une certaine manire l'existence de l'alternative tait aussi une occasion d'inventions oppressives, les forces dominantes taient sur le qui-vive, quand mme. La preuve, c'est qu'elles faisaient des concessions. Entre le New Deal de Roosevelt, le programme du CNR la fin de la Guerre, les lois sociales votes la hte au moment du Front populaire etc., il y a eu de longues priodes de concessions. Et ces concessions taient elles-mmes des oprateurs de finitude en ralit, mais dans un contexte antagonique, c'est--dire dans un contexte o les deux voies existaient effectivement et donc la conflictualit tait visible grande chelle. On pouvait donc introduire des concessions. Or vous voyez bien aujourd'hui que la puissance publique elle-mme est affaire retirer ces concessions, les enlever une par une. Ë la fin des fins, le risque tant que la classe moyenne se retrouve toute nue, si a va trop loin. Parce qu'elle a vcu, elle, de ces concessions, elle en a t le principal profiteur. Mais faute d'un adversaire sa mesure, l'oligarchie dchane ne songe qu' revenir aux beaux temps de sa prosprit du XIXe sicle, quand il n'y avait rien en face. De ce point de vue-l, il faut bien reconnatre qu'une chose qui lui a fait trs peur, la bourgeoisie impriale, c'est Staline. C'est pas mon homme, Staline, il a t terrible pour son peuple, mais au niveau international il a t utile. Parce que les autres, ils avaient peur. Il leur a foutu la ptoche, a c'est bien vrai. Peut-tre plus mme qu'il n'en avait l'intention.
Ë partir du moment o la figure de l'antagonisme disparat, on a deux effets nouveaux au niveau des figures de recouvrement finies, si je puis dire. Premirement, on n'a plus tre dans un rgime de concessions relles, on est mme pouss par la brutalit de la concurrence capitaliste liquider tout a, on prend donc le risque que les classes moyennes soient branles, parce que si on leur enlve tout elles ne seront pas contentes. Et comment pallier ce risque ? Eh bien il faut quand mme ouvrir un peu plus le robinet de l'ide dmocratique. C'est pour cela qu'on voit apparatre des phnomnes trs tranges comme un candidat socialiste aux tats-Unis – il n'est pas encore candidat et il ne le sera probablement pas, mais il fait une campagne trs active ; on voit un raidissement de la social-dmocratie britannique dirige par quelqu'un qui est conu comme un infme gauchiste dans les catgories anglo-saxonnes ; on voit Podemos en Espagne, Syriza en Grce, chez nous on voit mme Ç Nuit debout È. Donc, on voit des choses comme a qui sont la ncessit de raffirmer, l'intrieur du systme, la fiabilit du contrat concernant les nuances. Ce contrat est obscurment menac, aux yeux de la classe moyenne elle-mme, qui d'ailleurs ne cesse d'crire qu'il y a crise de la dmocratie. Ç Crise de la dmocratie È, a veut dire : Ç Nous n'avons plus accs suffisamment de nuances. Qu'on nous redonne une vraie gauche È. Mais Ç redonner une vraie gauche È, c'est pas facile dans les temps prsents, parce que la gauche elle-mme - j'entends par la gauche, celle qui pouvait arriver au pouvoir, de temps en temps, c'est--dire les socialistes fondamentalement - faisait partie du systme antrieur, elle tait sous le parapluie gnral du fait qu'il y avait des communistes. On pouvait toujours dire : Ç attention, il y a les communistes, alors donnez-nous de la nuance en pagaille È. Et, on leur en donnait quand mme. Jusqu' Mitterrand. Il y a une chose que raconte Attali, et que je trouve absolument formidable, c'est que Mitterrand lui aurait dit : Ç on devrait faire notre programme jusqu'au bout, comme a fait Lnine È, mais, a-t-il ajout, Ç c'est impossible È. En 1983, les nuances, c'tait impossible. Et puis aprs, on a tout dnationalis ce qui avait t nationalis É et a s'est poursuivi jusqu' nos jours.
Je vais conclure. L'entreprise dont j'essaie de donner les arrire-plans philosophiques remonte jusqu'au fait que je vous donne comme exercice de l't de bien lire le tract mathmatique qui vous a t distribu. Je vous avais dj fait la dmonstration au tableau, mais certains m'ont dit qu'on ne voyait rien. Alors l, vous avez la version papier ! Lisez-le, je vous assure, c'est la leon la plus profonde qui soit sur le fait que, quand la question est srieuse, il n'est plus question de nuances, on doit absolument se confronter ce qui est impossible. Parce que le systme, c'est sa propagande essentielle, vous dclare que quelque chose est impossible, en tout cas. C'est--dire qu'il y a quelque chose inaccessible aux nuances, quelque chose ne sera pas mis en jeu dans le systme existant tel qu'il est. C'est ce qu'on voit sur ce tract mathmatique : quand c'est fini, on peut montrer qu'il y a plus de parties que d'lments, on peut le montrer tranquillement par une mthode constructive. C'est une feuille du tract. Et puis, de l'autre ct du tract, vous avez le cas infini. Alors l c'est diffrent, l on voit apparatre que quelque chose est impossible. Et a, c'est le moment o, d'une certaine manire, on va pouvoir peut-tre djouer les oprations de finitude, condition de ne plus se contenter de nuances, naturellement. C'est--dire condition de ne pas tre dans la finitude, de ne pas tre dans la dmonstration constructive, mais en tant rellement dans le mouvement dialectique qui fait que la question de ce qui est impossible nous indique expressment ce qui doit constituer notre possibilit.
