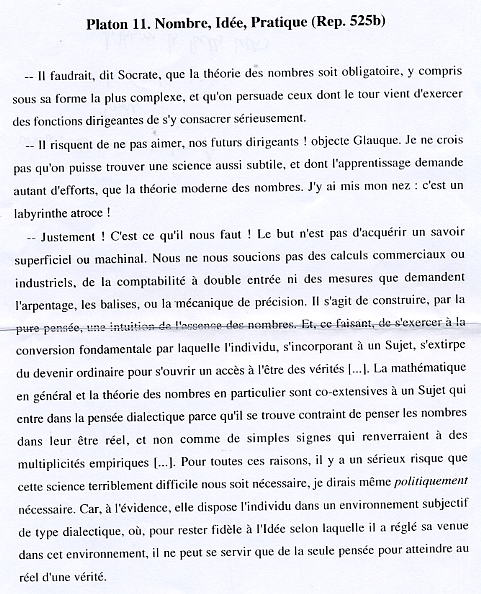Pour
aujourd’hui : Platon ! (2)
Séminaire d’Alain
Badiou (2008-2009)
[notes de Daniel
Fischer]
Table des matières :
Argument 1
19 Novembre 2008 2
17 Décembre 2008 5
21 Janvier 2009 10
Palestine-Israël 10
Platon : la Caverne 12
4 Mars 2009 14
1° - La situation 15
2° - La sortie 16
3° - Le lieu de la pensée 17
4° - Le retour 17
8 Avril 2009 17
Platon, 9. Poème et Mathème à l’épreuve de l’Idée (République,
517b) 19
20 Mai 2009 20
Récapitulation en six points 20
République, 518b sq 23
Commentaires 23
10 juin 2009 24
Argument
La situation planétaire de la
pensée atteste aujourd’hui que toutes les formes du relativisme, notamment le
prétendu « dialogue des cultures », sont liées à l’emprise du
capitalisme mondialisé, des inégalités monstrueuses qu’il engendre, et des
formes politiques aussi hypocrites que violentes qui lui sont associées sous le
nom vague de « démocratie ». Tout de même que l’individualisme
affiché, la prosopopée du « bonheur » personnel et les politiques
identitaires de tous ordres ne sont que le revers d’une implacable progression
de la persécution des plus faibles et du contrôle de tous par l’État.
Il est donc rigoureusement
impossible de penser une césure quelconque dans les représentations dominantes
sans s’en prendre à leur noyau, qui est ce que j’ai appelé le
« matérialisme démocratique », et dont tout le ressort est qu’il n’y a rien d’absolu ni de vrai, mais
seulement l’égalité des convictions personnelles et la finitude animale des
identités.
Pourquoi notre guide, au regard de
cette situation, est-il, depuis l’année dernière, Platon ? C’est que Platon a
donné l’envoi à la conviction que nous gouverner dans le monde suppose que
quelque accès à l’absolu nous soit ouvert, non parce qu’un Dieu vérace nous
surplombe (Descartes), ni parce que nous sommes nous-mêmes les agents du
devenir-sujet de cet Absolu (Hegel comme Heidegger), mais parce que le sensible
qui nous tisse participe, au-delà de la
corporéité individuelle et de la rhétorique collective, de la construction des
vérités éternelles.
Ce motif de la participation, dont
on sait qu’il fait énigme, nous le reprendrons de telle sorte qu’il nous
permette d’aller au-delà des contraintes idéologiques contemporaines. Avec Platon,
nous saurons soutenir qu’il n’est pas vrai que n’existent que des individus et
des communautés, avec, entre elles, la négociation de quelques contrats. Il
n’est pas vrai que l’alpha et l’oméga de l’existence collective soit l’équité
des contrats et la convocation dans les urnes. Cette « équité » se
réalise universellement comme consentement à l’injustice, et ces votes incessants
ne sont que les cérémonies de l’impuissance. Aussi bien faut-il soutenir qu’outre les corps et les
langages, les individus, les cultures et le réseau revendicatif des identités,
il y a des vérités éternelles, et que corps et langages peuvent participer dans
le temps à l’élaboration combattante de cette éternité. Ce que Platon n’a cessé
de tenter de faire entendre aux sourds, raison pour laquelle nous nous tournons
vers lui.
19 Novembre 2008
Y a-t-il des traits communs entre la séquence historique où
écrivait Platon et la nôtre ? Puisque nous sommes dans la crise – la crise
du capitalisme, bien entendu, mais aussi quelques autres crises qui
l’accompagnent pour former une sorte « d’ambiance générale de crise »
- il faut rappeler que Platon lui-même a écrit dans une période critique, aux
lisières de la conquête macédonienne, période où la fin de la cité grecque
était déjà lisible. Platon a proposé un paradigme de la cité juste, de la cité
conforme à l’idée, au moment même où le réel auquel ce paradigme devait
« s’appliquer » était en train de s’effondrer ; il a en quelque
sorte prononcé l’éloge funèbre de ce qui venait à lui manquer, de sorte que son
paradigme, je le dirais volontiers endeuillé.
Le monde dans lequel nous vivons se présente quant à lui
comme l’articulation de deux éléments (et ce dans la vision que lui-même
en donne) : l’autorité du commerce et la figure normative de la démocratie représentative.
La tentative de correction qui en a été proposée au 19ème siècle,
sous des noms divers (communisme, socialisme, … peu importe ici), a elle-même
donné lieu à des paradigmes dont on sait qu’ils se sont effondrés avec la
disparition des États socialistes. Ils se sont effondrés, notez-le bien, préalablement
à la réalisation du paradigme (i.e.
avant que le système antérieur, capitaliste, ait été remplacé). Nous sommes par
conséquent les témoins d’une situation post-platonicienne singulière :
celle de l’effondrement simultané du réel à corriger (crise du capitalisme) et
des paradigmes censés s’y substituer (disparition des États socialistes).
Simultanéité qui rend compte de l’unité dialectique profonde qui relie
l’effondrement de l’URSS et la crise des USA.
L’intérêt du retour à Platon (pour autant qu’il se confirme)
serait alors de pouvoir aborder la crise du biais d’une arche temporelle plus
grande qu’on ne le fait ordinairement. Nous devrions pouvoir nous poser des
questions comme : Quelle est la relation du paradigme et du réel ?
Qu’est-ce que la pensée politique (en particulier dans un horizon où se laisse
entrevoir la fin possible de l’asservissement de la politique à la figure de
l’État) ?
*
Dans ses interventions théoriques, mais également pratiques
(cf. son séjour sicilien), Platon est dans une tonalité mixte. Il est partisan
de traiter les problèmes à fond (nous dirions aujourd’hui qu’il est un
radical), mais, en même temps, une note de mélancolie rationnelle tempère cette
radicalité : quand il entend traiter les problèmes à la racine, il dit ne
pas être sûr de pouvoir s’en sortir. Platon est un optimiste voilé. Quand à la
fin du livre IX de La République, un des
jeunes gens résume la leçon qu’il tire du dialogue au stade où celui-ci est parvenu
en déclarant qu’il ne faut certainement pas se mêler de politique, Socrate lui
rétorque vertement « : Nom d’un chien (littéralement :
« par le chien »), si [il faut s’en mêler] ! » Et il précise :
« la cité dont nous avons tracé le plan, et qui n’est fondée que dans nos
discours », celle dont on peut se demander si « elle existe en aucun
endroit de la terre », l’homme sensé
s’en occupera « ailleurs que dans sa patrie, à moins que quelque
divin hasard lui en créé la possibilité ».
Autrement dit : celui qui entend « se mêler de politique » va agir selon l’idée qu’il se fait de la
politique et dans un lieu qui n’a aucune raison – sauf hasard improbable (ce
que, dans mes termes, je nommerais un événement) – de coïncider avec sa patrie.
L’interprétation courante donnée de ce passage est que, pour Platon, la
politique est une utopie à usage personnel dont l’application au sein du pays
d’origine relève du pur hasard. C’est une interprétation selon moi tout à fait
erronée et il faut plutôt comprendre que pour Platon la découpe du
lieu où va opérer l’action politique n’est
pas donnée empiriquement : le lieu
politique n’est pas pré-donné, il n’est pas prescrit de l’extérieur de la
politique. La politique, en tant que pensée en acte dans le collectif, construit
son propre lieu.
A l’inverse, l’État est le nom de ce qui organise la découpe
pré-donnée de l’action politique, il est l’organisateur des lieux prescrits
pour la politique quand celle-ci n’est pas « selon l’idée ». Il
s’agit aussi bien de découpe spatiale - et l’on aura des entités telles
que : pays, nations … - que de découpe au sein des
populations (sexes, classes, familles, provenances …), ou d’histoire des
lieux, pour en faire des lieux partagés et légitimes etc. Bref, l’État est le
transcendantal de la politique. Ce que refuse Platon, c’est que l’État, dont
l’existence est universellement attestée de tout temps, soit l’unique
transcendantal de l’action politique. C’est aussi le point de vue de Marx quand
il déclare que les prolétaires n’ont pas de patrie. Qu’il s’agisse comme ici
d’internationalisme, ou de la thèse selon laquelle le sujet politique est un
sujet de classe, ou encore de celle qui affirme que l’Histoire se confond avec
l’histoire de la lutte des classes, dans tous ces cas ce qui est à l’œuvre
c’est une dé-localisation politique, la
postulation qu’il existe des lieux politiques autres que ceux qui sont
prescrits par l’État.
Qu’en est-il aujourd’hui des découpes prescrites dans la
sphère étatique ?
La découpe géographique articule deux types d’espaces :
l’espace ouvert du capitalisme mondialisé, caractérisé par une intense
circulation de capitaux, de marchandises et, en ce qui concerne les personnes,
des élites dirigeantes; et des espaces fermés marqués par l’érection de murs,
la pratique d’expulsions etc. (exemple : l’Europe). A quoi, il faut opposer,
comme nous l’avons déjà fait ici même, l’axiome : il n’existe qu’un seul
monde, il n’y a qu’un seul monde des sujets vivants. Selon cet énoncé les étrangers qui vivent parmi nous sont déclarés appartenir
au même monde que nous. Il n’en découle aucune centralité politique quant à la
question des étrangers. Il faut entendre l’axiome comme une prescription
symptomatique de la dé-localisation.
La découpe sociologique a quant à elle en son cœur la normativité
des clôtures et pour impératif l’intégration. Il faut reconnaître qu’elle est
largement consensuelle (autour de la thèse selon laquelle l’intégration de tous
ceux qui « partagent les mêmes valeurs que nous » est hautement
désirable). Une telle découpe ne peut absolument pas convenir à une
« politique selon l’idée ».
Enfin la découpe historique consiste en l’affirmation selon
laquelle l’histoire des politiques d’émancipation (quel que soit le nom qu’on
lui donne : communisme, politique égalitaire …) est désormais close. On
lui opposera l’idée qu’elle est au contraire toujours ouverte.
Bref détour par Marx et sa thèse fameuse (et abondamment
moquée) sur le dépérissement de l’État. Il faut la comprendre, à la lumière de
ce que nous venons de dire de Platon, comme une thèse sur la dés-étatisation.
Marx, comme Platon, pense que la politique est un processus auto-suffisant, à
distance de ce que l’État peut en prescrire ; elle l’est d’ailleurs à un
point tel, pour Platon, que la cité dont traite La République est totalement dépourvue de lois (celles-ci sont sans
objet dans une cité dont le fonctionnement est immanent au processus
politique). S’adosser à la thèse du dépérissement de l’État, c’est se
soustraire aux conceptions qui font de l’État un facteur obligé de toute
politique, qu’on le conçoive comme dépositaire du bien-être collectif possible
ou au contraire comme instance oppressive (comme « police », selon
l’expression de Rancière) [en définitive, les visions de l’État oscillent
toutes entre ces deux pôles]. Pour Platon, comme pour Marx, toute politique est
d’abord une sortie, un pas de
côté … pour aller où ? Pour aller là où – selon ce qu’en dit l’État - il
n’y a pas de lieu. Le trajet de la politique est incalculé (et sans
garantie).
*
Il vaut la peine de reconvoquer ici la définition hégélienne
de l’État. « L’État est la réalité en acte de l’Idée morale objective » (Principes de la philosophie du droit § 257). Dans l’État, le concept est réalisé, l’État
est le concentré réel de « l’accord de la réalité empirique et
du concept ».
Dans la société civile, les individus croient réaliser leur
liberté comme si leur volonté était la volonté rationnelle « en soi et
pour soi ». Mais c’est « l’État,
comme réalité en acte de la volonté substantielle (qui) est le rationnel en soi
et pour soi » (ibid. § 258). En effet : « Si on confond
l’État avec la société civile et si on le destine à la sécurité et à la protection de la
propriété et de la liberté personnelle, l’intérêt des individus, en tant que
tels, est le but suprême en vue duquel ils sont rassemblés, et il en résulte
qu’il est facultatif d’être membre d’un État. Mais sa relation à l’individu est
tout autre; s’il est l’esprit objectif, alors l’individu lui-même n’a
d’objectivité, de vérité et de moralité que s’il en est un membre.
L’association en tant que telle est elle-même le vrai contenu et le vrai but,
et la destination des individus est de mener une vie collective » (ibid.).
Comme le dit Jean Hyppolite, « c’est seulement en voulant consciemment
l’État [dont les membres sont des citoyens conscients de vouloir l’unité du
Tout] que l’individu dépasse la contingence du libre arbitre pour entrer dans
la terre native de la liberté »[1].
« L’État est la réalité en acte de la liberté concrète; or la liberté
concrète consiste en ceci que l’individualité personnelle et ses intérêts
particuliers reçoivent leur plein développement et la reconnaissance de leurs
droits pour soi (...), en même temps que d’eux-mêmes ils s’intègrent à
l’intérêt général, ou bien le reconnaissent consciemment et volontairement
comme la substance de leur propre esprit, et agissent pour lui, comme leur but
final » (ibid. § 260).
Ces thèses hégéliennes - n’est réel que ce qui est interne à
l’État, la liberté concrète n’est concevable que dans le cadre transcendantal
de la légalité (étatique) – sont extraordinairement répandues jusqu’à nos
jours. On peut soutenir que notre démocratie parlementaire est la forme
politique la plus homogène à l’essence hégélienne de l’État : elle réalise un
transcendantal suffisamment souple, suffisamment labile, pour assurer le
fonctionnement de l’État avec un maximum d’efficacité. Pour Hegel toute liberté
hors du cadre étatique est tenue soit comme insignifiante soit comme
terroriste. Et de fait l’insignifiance peut être particulièrement pénible. Je
pense au personnel politique écarté de l’État pendant de longues années; certes
les individus peuvent occuper leur temps en gesticulations diverses, en
élaborations de « plateformes », en émissions médiatiques etc.; mais
personne n’est dupe, à commencer par eux-mêmes : l’être politique réel est
interne à l’État, ou n’est pas ; c’est pourquoi ces hommes et femmes
politiques, furieusement hégéliens, traînent leur désêtre avec une morosité
véritablement pitoyable. Je ne ferai que mentionner la tentation de vouloir
échapper à l’insignifiance par la terreur, mais on n’échappe pas ce faisant à
l’État, puisque c’est l’État qui fournit le cadre qui oppose insignifiance et terreur.
*
Il est donc
essentiel dans l’action politique de constituer par soi-même sa propre norme
d’évaluation. Ce n’est pas sans risque car on est alors amené à errer sans
repères, à être exposé à l’arbitraire des auto-évaluations. Mais c’est principiellement
que l’action politique est sans garantie. Pour autant qu’elle se situe hors du
transcendantal étatique, la politique est sous la règle d’une normativité
réflexive. On pourrait traduire ainsi la
fin du livre IX de La République : « Il
ne fait nulle différence que notre politique soit réalisée sous la forme d’un
État ou qu’elle le soit un jour car c’est d’elle seule que doit relever
l’action ». La politique ici n’est pas en rivalité par rapport au
transcendantal étatique, ce n’est pas une prescription contre une autre
prescription, l’idée politique ne prescrit pas une figure de l’État mais
seulement un devenir.
Je dirais synthétiquement que la politique est une
séquence articulée à une forme étatique et qui organise une sortie de cette
figure par construction de nouveaux lieux. L’idée
politique est le sceau de la liberté concrète, mais ce qui chez Platon en fait
une liberté c’est – contrairement à Hegel – sa capacité à se localiser hors
pouvoir sans pour autant être impuissante.
Son essence est le devenir par lequel adviennent des lieux nouveaux; ceux-ci ne
sont pas situés dans quelque
extériorité (ce ne sont pas des phalanstères) : ils sont internes à la situation mais sans être
réductibles à la découpe de l’État, ils existent à travers un système de
relations hétérogènes non prescrites par l’État. Par parenthèse, on voit ici à
quel point Platon est le contraire de ce qu’on en dit d’ordinaire : l’idée
n’est pas chez lui quelque chose d’extérieur, mais elle est toujours dans la
forme d’un devenir, elle n’est pas un résultat (réalisé ou pas). Une séquence de sortie, quand la
politique procède selon l’idée, ne peut jamais se reconnaître dans l’achèvement
d’un État. La raison pour laquelle aussi bien Lénine que Mao se sont attelés au
dépassement du parti-État, c’est qu’ils voulaient continuer l’action politique. Ils n’ont pas voulu jouer aux rois fainéants et s’en
tenir aux acquis (comme l’a fait Tito par exemple).
*
Selon Hegel, la vérité de l’État, c’est la guerre. « La
guerre comme état dans lequel on prend au sérieux la vanité des biens et des
choses temporelles qui, d’habitude, n’est qu’un thème de rhétorique
artificielle, est donc le moment où l’idéalité de l’être particulier reçoit ce
qui lui est dû et devient une réalité »
(Principes de la philosophie du droit § 324). La guerre devient la politique de l’État dans les moments où le
transcendantal étatique ordinaire perd de son efficacité : guerre aussi bien
intérieure (criminalisation des oppositions qui sont perçues sous la forme
d’une prolifération d’activités à potentialité terroriste) qu’extérieure (avec
pour enjeu le fondement territorial de la découpe étatique). A l’inverse, la
politique selon l’idée est principiellement une politique de paix. Ce qui
n’exclut pas formellement un recours éventuel à la violence ; mais cette
violence est ce qui est requis pour la défense des lieux politiques, et ces
lieux politiques sont avant tout des lieux de paix.
Ce qui amène à envisager la question du risque et du
sacrifice. Il y a là-dessus aujourd’hui trois points de vue.
Du point de vue hégélien, le moment du sacrifice guerrier
est la pierre de touche de la politique selon l’État. C’est la position des
États-nations. « Si le sacrifice pour l’individualité de l’État est la
conduite substantielle de tous et, par conséquent, un devoir universel, en même
temps, on peut la considérer comme le côté de l’idéalité en face de la réalité
de l’existence particulière et elle entraîne une condition particulière et une
classe qui lui est consacrée, la classe du courage » (Principes de la philosophie du droit § 325). Comment se fait-il que, par masses, les gens
aient pu être amenés à aller à la guerre ? La réponse est dans Hegel : c’est
qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’un « devoir
universel ». Vous allez m’objecter
qu’on néglige alors la force coercitive de l’État. Elle existe mais elle est
effectivement secondaire : si le paysan de Bigorre s’est retrouvé à Verdun, ce
n’est pas fondamentalement parce que la gendarmerie l’y a amené de force, mais
parce qu’il y est allé volontairement et s’il l’a fait c’est parce que,
hégélien conséquent, il considérait qu’il s’agissait là d’un « devoir
universel » au nom de l’État dont il
se considérait comme un citoyen. Aujourd’hui l’État aurait beaucoup plus de mal
à persuader les gens d’aller combattre en Afghanistan ; si Hegel revenait parmi
nous, il s’agirait pour lui, sans aucun doute, d’un signe évident que l’État en
question est en voie de décomposition.
Du point de vue du platonisme vulgaire (i.e. du platonisme
récupéré par la théologie), le sacrifice guerrier est légitimé au nom de la
transcendance de l’idée elle-même. Dans ces actions sacrificielles
d’inspiration religieuse, l’idée fonctionne comme une sorte d’État intérieur.
On pense avant tout aujourd’hui aux actions guidées par l’Islam, mais ce même
sacrifice pour l’idée on le trouvait déjà dans un personnage comme le Chen de
la Condition humaine de Malraux, ou bien
chez les anarchistes de L’Espoir,
voire chez quelqu’un comme Lawrence d’Arabie.
Et dans le vrai platonisme ? Le point de départ n’est pas
ici le sacrifice, mais le risque. Le risque est inhérent au processus en
devenir de la politique elle-même. C’est en son essence un risque défensif. Les
Chinois avaient déjà établi le primat de la défense stratégique. Il s’agit,
dans la politique, de protéger la nouvelle découpe des situations (ce qui peut
aussi amener, dans certains cas, à préconiser le repli). On peut en donner
plusieurs exemples : la barricade (dont on a à juste titre mis en doute la
pertinence militaire, mais qui, du point de vue symbolique, est une mesure de
protection du bout de rue « libéré »), la zone libérée des
maquisards, les usines occupées, la rue elle-même (on l’a vu lors du renversement
du Shah d’Iran : un pouvoir ne résiste pas éternellement à la présence
incessante, jour après jour, de masses de gens occupant la rue), voire les
foyers d’ouvriers africains. C’est un risque organisationnel (autrement dit, un
risque pris vis-à-vis d’un lieu organisé). Il s’oppose à la fois au sacrifice
et à la plainte. Il se défie à la fois de la tension sacrificielle qui exagère
et sublime le risque, et de la position défensive pure qui peut virer à la
plainte. [Dans les accidents qui nous arrivent] « comme dans un
coup de dés, nous devons, selon le lot qui nous échoit, rétablir nos affaires
par les moyens que la raison nous prescrit comme les meilleurs, et, lorsque
nous nous sommes heurtés quelque part, ne pas agir comme les enfants qui tenant
la partie meurtrie, perdent le temps à crier, mais au contraire accoutumer sans
cesse notre âme à aller aussi vite que possible soigner ce qui est blessé,
relever ce qui est tombé, et faire taire les plaintes par l’application du
remède [2] »
(Rep X, 604c). Régime non romantique de
la décision non pathétique.
17 Décembre 2008
J’avais terminé la dernière fois en parlant d’un régime non
romantique de la décision risquée. Ce sont les caractéristiques de ce qui
ouvrirait, sous condition d’un événement, à la possibilité du nouveau - soit en
l’absence de toute garantie (d’où le risque), de façon telle qu’un sujet s’y
constitue (dimension de la décision) et que c’est situé au-delà du couple
sacrifice / plainte (régime non romantique).
J’ajouterai que cette décision ne saurait être purement
négative. J’entends par là qu’elle doit transcender l’affect anti-répressif. Et
je pense que ce que Platon nomme l’Idée, c’est précisément quelque chose qui
interdit que l’action soit close dans sa négativité.
On le voit sur la question de l’écart entre l’opinion et l’epistemè (que l’on traduit habituellement par savoir, mais
que l’on peut aussi bien traduire par vérité). Notez, c’est un point important, que l’opinion,
comme le savoir, traitent du même objet, que ce que l’un et l’autre disent
porte sur le même « ce qui se passe ». La réponse de Platon est que, contrairement
à l’opinion, l’epistemè est
indexée à ce qu’il appelle le principe. Or qu’est-ce que le principe pour Platon ? Vous
avez, sur une question donnée, des gens qui s’expriment « pour » et
d’autres qui s’expriment « contre ». Cette alternative pour / contre
est typique du régime de l’opinion. Vous approchez du principe quand cette
alternative est incorporée dans une construction plus vaste de nature affirmative. Platon emploie ici volontiers des métaphores spatiales
et parle de la construction d’un lieu de l’Idée. Construire un lieu de l’Idée suppose qu’on
s’arrache à l’alternative pour / contre ; c’est la raison pour laquelle je
commençai tout à l’heure en disant que la politique (et, plus généralement, l’ouverture
d’une novation) est toujours la relève d’un affect anti-répressif qui, quant à
lui, reste pris dans la logique de l’opinion. Cette relève de l’opinion, Platon
l’appelle : la dialectique.
Je prendrai l’exemple, un peu oblique, de la chute du Shah d’Iran.
Qu’est-ce qui a entraîné cette chute ? Il faut saluer ici l’intuition
remarquable de Michel Foucault qui, tout seul au début, clamait qu’il y avait
là un phénomène tout à fait singulier. On peut dire que le lieu de l’Idée, dans
le cas présent, ça a été l’existence de manifestations de rue tout autant
gigantesques qu’obstinées : ce n’est pas exactement le fait qu’il y ait eu
des manifestations nombreuses qui était étonnant, que ceci que le peuple, tous
les jours, se rassemblait dans la rue, présence obstinée et massive par
laquelle est venue au jour la conviction que le Shah pouvait choir sous
l’influence d’une puissance qui lui était supérieure. C’était cela l’Idée et
les manifestations, en relève du régime d’opinion exprimé dans
l’alternative « pour ou contre le Shah », construisaient le lieu
de cette Idée.
A la fin de son livre Métamorphoses de la dialectique
dans les dialogues de Platon (édit. Vrin,
2001) [selon moi, l’un des meilleurs livres consacrés à Platon, raison pour
laquelle je vous en recommande vivement la lecture] Monique Dixsaut écrit ceci,
avec quoi je suis en plein accord : « L’intelligence ne se
soumet à aucune règle, à aucun impératif extérieur, elle est libre, aussi bien
d’inventer les procédés qu’elle met en œuvre que de les modifier et d’envoyer
promener ses propres résultats. Pour autant que sa liberté rencontre une
limite, celle-ci lui vient du dedans, non du dehors – ce qu’une intelligence
n’est pas libre de faire, c’est renoncer à désirer l’intelligible. N’est intelligible,
au sens platonicien, qu’un terme où l’intelligence se retrouve. Quels que
soient les termes dont l’intelligence s’empare (et s’en emparer, pour elle,
c’est dialectiser), elle les altère, puisqu’elle les réfère à leur réalité
intelligible, qu’on peut bien appeler une Idée, à la condition que
l’intelligence se retrouve aussi dans ce terme-là. Comprendre la nécessaire
différenciation que la puissance dialectique introduit dans les instruments
qu’elle utilise pour se rendre intelligibles les êtres qu’elle cherche, et
aussi pour se rendre à elle-même intelligibles ses propres instruments, cela
aurait dû interdire de parler d’une méthodologie platonicienne, interdire de
croire possible que Platon formule des règles séparables du mouvement de la
pensée qui, simultanément, les invente ou les réinvente et les applique ».
La dialectique n’est pas, ne saurait être, une méthode. L’essence
de la dialectique c’est l’inséparabilité de la pensée et de ce que la pensée pense dans son mouvement propre.
Par opposition à une méthode à propos de laquelle se pose la question de son
« application » à tel domaine d’objets, la dialectique suppose qu’il
y a un mouvement indivis de l’invention (de pensée) et de l’application, un
mouvement qui est à lui-même son propre résultat. Comme le dit Amantha,
dans la traduction que je vous propose de La République (VI, 511e) : « Vérité objective et clarté
subjective sont deux dimensions du même processus ».
Platon, 7. L’acte
dialectique (République, Livre
VI, 511b sq.)
-- Apprenez
maintenant ce que je nomme la deuxième section de l’être en tant qu’il s’expose
à la pensée pure. Le chemin du raisonnement est ici fondé sur la seule
puissance du dialectiser : mes hypothèses ne sont pas traitées comme des
principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent d’appuis et
de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique. Quand on y
arrive, le déploiement discursif se renverse en mouvement descendant, qui
parcourt toutes les conséquences du principe jusqu’à la conclusion, sans se
servir jamais de rien de sensible, mais passant d’une forme à une autre par des
médiations elles-mêmes formelles, pour enfin conclure sur une forme.
Glauque
alors, comme souvent, entreprend de mettre en forme, c’est le cas de le dire,
sa compréhension du discours du Maître :
Vous
affirmez que faire théorie de l’être saisi dans son exposition à la pensée par
les moyens du savoir que détient le dialectiser est plus approprié que de s’en
remettre aux techniques scientifiques, dont le modèle est la géométrie. Certes,
les mathématiciens, qui traitent les hypothèses comme des principes, sont
contraints de procéder discursivement, et non empiriquement. Mais leur
intuitionner restant suspendu aux hypothèses et ne s’ouvrant nul accès au
principe, ils ne vous paraissent pas avoir la pensée de ce dont ils font
théorie, qui pourtant, repris dans la lumière du principe, relève bien d’une
pensée intégrale de l’être. Il me semble que vous appelez pensée analytique la
procédure des géomètres et de leurs semblables, et que vous la distinguez de la
pense dialectique. Regardons votre diagramme. Vous situez cette pensée
analytique quelque part entre l’opinion (accordée à la section AD du diagramme)
et la pensée pure, ou intellection dialectique (accordée à la section suprême,
EB). De là, du reste, que la section EC, à laquelle correspond cette pensée
analytique, est de longueur égale à la section CD, à laquelle correspondent les
objets de l’opinion. Vif contraste avec l’écart entre la section AD, à laquelle
sont consacrées les images et la section de la dialectique, EB, écart qui est
comme de un à quatre. Le calcul montre aussi ...
Belle
technique, excellent résumé ! coupe Socrate. Le diagramme représente le schéma
complet des dispositions de l’être tel qu’il vient à l’apparaître et tel que
peut s’y constituer un Sujet.
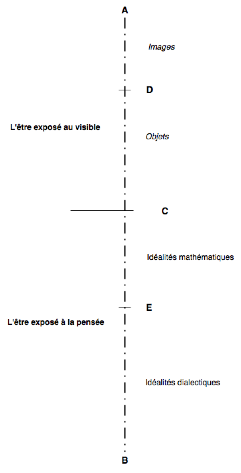
- Aux
quatre sections, faites correspondre les quatre états qui en articulent la
venue pour un Sujet. Pour la plus considérable, EB, parlons de pensée pure,
d’intellection, ou mieux encore de pensée dialectique. Pour celle qui vient
ensuite, CE, nous emploierons pensée discursive, ou entendement, ou mieux
encore, pensée analytique. Pour la troisième, DC, disons
« certitude », et pour la dernière, AD, « supposition ».
Nous supposons en effet qu’une image renvoie à quelque référent réel, et nous
sommes certains que les objets réels existent. L’existence des idéalités mathématiques
est à son tour supposée dans la pensée analytique. Mais nous sommes certains de
l’universalité des principes idéaux auxquels nous conduit la pensée
dialectique. Cet ordre peut aussi se dire : plus un être se donne dans
l’élément de la Vérité, plus le Sujet le pense dans sa propre clarté.
En sorte,
songe tout haut Amantha, que vérité objective et clarté subjective sont deux dimensions
du même processus.
*
La dialectique est une interruption de l’opinion. Toutes
deux traitent, j’y insiste à nouveau, d’un même objet, mais cet objet, pris en
charge dialectiquement, va se trouver exposé autrement et dans un autre lieu.
Dans le diagramme ci-dessus (qui est ma reprise de la théorie platonicienne de
la division de la ligne), le franchissement de la barrière matérialisée par la
lettre C équivaut à un changement d’exposition (c’est par un tel franchissement
que la logique de l’alternative, la logique du pour ou contre, va être relevée
au profit de la localisation de l’Idée). Il y a donc rupture par rapport à
l’opinion (ce changement de régime de la pensée rappelle ce que disait Deleuze,
à savoir que l’on ne pense pas spontanément, que l’ascèse qui impersonnalise la
pensée la livre au dehors : cf. Deleuze, la clameur de l’être p. 127).
Mais, encore plus fondamental que cette rupture, la
dialectique, et là je rejoins complètement ce qu’écrit Monique Dixsaut, créé
de l’inséparé au point de l’objet.
Les commentaires qui suivent sont tirés du livre cité plus
haut de Monique Dixsaut.
Dans la section inférieure de
l’intelligible (CE), l’âme part d’hypothèses pour aller vers une conclusion.
Dans la partie supérieure (EB), elle va d’une hypothèse à un principe universel
anhypothétique; mais une fois qu’elle a saisi le principe, elle descend jusqu’à
la conclusion, sans se servir d’absolument rien de sensible, mais en se servant
des formes elles-mêmes, « passant d’une forme à une autre par des médiations
elles-mêmes formelles, pour enfin conclure sur une forme ». La dialectique
comme la pensée analytique ont affaire avec le « trait essentiel »
imprimé par les réalités en soi à la multiplicité qui en participe. C’est
pourquoi toutes deux partent d’hypothèses : elles hypothèsent l’existence
intelligible et toujours même de l’objet sur lequel elles réfléchissent. La
différence est que les hypothèses du dialecticien « ne sont pas traitées
comme des principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent
d’appuis et de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique ».
Le fait, pour la dialectique, de ne pas prendre ses hypothèses pour des
principes, suffit pour Platon à en
faire une science plus exacte que les sciences mathématiques (les
mathématiciens prennent comme principe une chose dont ils n’ont pas de savoir,
toutes leurs déductions pourront bien être cohérentes, cela ne fera jamais une
science). Dialectiser, c’est refuser que les réalités intelligibles dont
parlent les sciences mathématiques aient le caractère d’évidence qu’elles leur
prêtent ; on ne peut pas avoir de savoir de ce que le logos n’a pas mis en
question.
Le fait d’être
« anhypothétique » n’est pas une propriété essentielle de tout
principe : en effet, nous venons de voir que, pour les mathématiciens, une
hypothèse peut parfaitement remplir la fonction de principe. Être
anhypothétique, c’est la condition
pour que le dialecticien, à la différence du mathématicien, accepte de parler
de « principe ». Il ne s’agit donc pas de remonter vers un, ou
vers le, principe qui serait anhypothétique en soi et pour soi, mais d’aller
vers de l’anhypothétique, autrement dit de substituer à un terme qu’on se
contente de poser comme évident – une hypothèse – un terme de l’être duquel on
peut rendre raison parce qu’on a d’abord commencé par se demander ce qu’il est.
La dialectique se sert pour cela exclusivement de formes dont tout ce qui en
est dit dans le passage qui nous intéresse est qu’elle en utilise certaines
pour aller vers d’autres ...
Je vais prendre un autre exemple.
Supposons que le gouvernement commette une action dégoûtante
(on a véritablement, à l’heure actuelle, l’embarras du choix pour une telle
supposition). Cette action sera notre objet initial, à propos duquel vont
s’exprimer des opinions alimentées par une certitude (voir le segment DC du diagramme). En ce qui
concerne les opinions hostiles à l’action dégoûtante, il va s’agir de la
conviction qu’il n’y a là, de la part du gouvernement, que mensonges, images
falsifiées, prosopopées médiatiques etc. Comme il y aura aussi des opinions
favorables à l’action du gouvernement, il va se constituer une scène
conflictuelle, la scène du pour et du contre, scène qui a son autonomie propre
et qui peut même inclure certaines formes de violence.
La pensée analytique
(voir le segment CE du diagramme) commence avec la question : « De quoi ce
qui se passe là est-il le symptôme ? ». C’est le moment où l’on fait des hypothèses. Soyons plus précis. Supposons que l’action
dégoûtante soit l’inculpation de jeunes gens accusés, sans l’ombre d’une
preuve, d’actions de sabotages sur les voies ferrées. On fera alors l’hypothèse
que le thème de l’anti-terrorisme est brandi, de façon « réfléchie »,
pour camoufler une pratique de terreur provenant en réalité de l’État lui-même,
l’objectif étant en fin de compte pour celui-ci de créer une opinion craintive
et progressivement accoutumée aux menées violentes qu’il déploie. Il peut
certes arriver qu’une telle pensée analytique soit exacte. Mais, et c’est un
point fondamental, pour Platon, le principe qui lie l’intelligence de la chose
dont on parle n’est pas inclus dans la description analytique elle-même, il ne
lui est pas transitif (« mes hypothèses ne sont pas traitées comme des
principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent d’appuis et
de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique »). Pour
accéder au principe, il faut emprunter une voie qui va au-delà de l’analytique
– et qui est précisément l’intellection dialectique (« la section suprême,
EB »).
Qu’est-il ce principe,
dans notre exemple ? Eh bien c’est qu’en réalité tout État, et pas seulement
celui qui est à l’origine de l’action dégoûtante, mais l’État de par sa nature,
est terroriste. L’action dégoûtante de l’État, qui a été notre point de départ,
est par là universalisée, avec pour conséquence de délégitimer l’État. On aura
ainsi arraché le symptôme initial (l’inculpation des jeunes gens) à la logique
de l’opinion et à l’obsession du pouvoir. L’enjeu n’est pas de moraliser l’État
(le vœu d’un « bon État » qui serait incapable de vilenies) mais de
faire advenir l’Idée d’un collectif en capacité d’élaborer une subjectivité
anti-étatique. Ce qu’est la dialectique, c’est l’apparaître effectif de l’Idée,
la construction de son lieu, dans l’inséparabilité des hypothèses et des
conséquences (comme je le disais pour commencer : la dialectique est un
mouvement qui est à lui-même son propre résultat – voir aussi les
formulations de Monique Dixsaut).
L’Idée est la concentration intelligible de l’ensemble du
mouvement dialectique.
Puisqu’il est question de dialectique, il est du plus grand
intérêt, en compagnie de l’éminent hégélien qu’est Slavoj Zizek qui nous a fait
l’amitié d’être là ce soir, et avant de lui donner la parole, de confronter
Platon et Hegel. Je vais vous donner pour cela quelques citations tirées de la
préface à la Phénoménologie de l’Esprit.
1) « Le
vrai est le devenir de soi-même » [3]
est une thèse d’inséparabilité (au sens que nous venons de voir) présente chez
Platon sous la forme du principe.
2) « La
connaissance vraie exige que l’on s’abandonne à la vie de l’objet, qu’on
exprime la nécessité intérieure de l’objet ». Cette thèse anti-méthodique est également une thèse
« platonisable » (où se retrouve l’idée que nous avons vue tout à
l’heure selon laquelle le savoir a affaire au même objet que l’opinion).
3) « La
connaissance vraie est le royaume que l’esprit se construit dans son propre
élément » est une thèse d’immanence
présente chez Platon.
4) [Toute
chose en vient à] « appréhender et exprimer le Vrai non seulement comme
substance mais précisément aussi
comme sujet », formule illustre qui
est également une thèse d’inséparabilité.
Que signifie cette comparaison ? Elle montre que Hegel et
Platon sont plus proches qu’on ne le dit habituellement, pour peu que l’on se
déprenne de l’image construite par la théologie d’un Platon habité par la
transcendance; elle montre aussi que ce n’est pas arbitrairement que le terme dialectique
se retrouve dans les deux cas (Hegel était
parfaitement au fait des thèses immanentistes et d’inséparation présentes chez
Platon). Ce qui les sépare par contre, et de façon irréductible, c’est que chez
Hegel la puissance du Vrai est relative à la puissance intrinsèque du négatif,
conception totalement absente chez Platon.
*
[D. F.] A cette première partie « apollinienne » a
succédé une seconde partie « dionysiaque » avec l’intervention de
Slavoj Zizek. Difficile de transcrire le torrent zizékien. On peut juste
signaler qu’en environ une heure de temps celui-ci a charrié, pour les
bousculer, les cahoter, les noms (entre autres) de Hitchcock, Chomsky, Borges,
Proudhon, Wagner, Brecht, Marx, Deleuze et bien sûr Hegel (mais pas Platon). Au
cours de cette soirée consacrée à la dialectique, la (pseudo) opposition de
l’apollinien et du dionysiaque a en quelque sorte été obliquement thématisée –
pour être récusée – par S. Zizek (prenant appui sur Hegel). Par le biais
notamment de la critique du thème de la « vie verte » opposée à la
« grisaille du concept » ou, en termes plus philosophiques, de la
surabondance vitale, des multiplicités proliférantes mettant en échec les
efforts de la Représentation pour les « cadrer ».
Plutôt qu’un résumé approximatif de ses déclarations, on
peut ici reproduire un extrait d’un ouvrage de S. Zizek. A propos de
l’introduction à la Phénoménologie de l’esprit, il écrit que Hegel « tient que toute tension entre la
notion (l’intellection discursive) et la réalité, toute relation de la notion
avec ce qui apparaît comme son Autre irréductible et qu’elle rencontre dans
l’expérience sensible, est toujours une tension intra-notionnelle :
autrement dit, elle implique toujours une détermination notionnelle minimale de
cette altérité. Ce qui se présente à l’expérience comme l’altérité de l’objet
irréductible dans le cadre notionnel du sujet et qui lui est impénétrable est
toujours-déjà la (fausse) perception, « réifiée », d’une inconsistance
de la notion à elle-même (...) Le cercle vicieux de « l’expérience »
tient à ceci que nous, sujets historiques, finis, manquerons à jamais de
l’instrument de mesure qui garantirait notre contact avec la chose même (ce qui
se dit aussi : il n’y a pas de métalangage) ».
A un autre moment, S. Zizek a fait remarquer qu’une certaine
lecture de Badiou qui en fait avant tout un « penseur du multiple »
(l’être comme dissémination pure que ne stabilise aucune loi de l’Un) manquait
une dimension essentielle de sa pensée pour laquelle ce qui est
« premier » c’est précisément l’Un, et plus exactement l’incongruence
de l’Un avec lui-même.
21 Janvier 2009
Palestine-Israël
Je reviens de Palestine. J’ai été en Israël. J’ai en fait été des deux côtés. Je voudrais vous dire certaines choses ce soir à propos de ce voyage.
Je vous parle au moment où la guerre à Gaza semble se terminer. Ce n’était d’ailleurs pas vraiment une guerre, mais une opération punitive. On ne peut pas parler de guerre quand il s’agit de l’assaut de l’armée d’un État contre une ville où vit une population désarmée et démunie, affaiblie par un blocus de plusieurs mois. Cela rappelle plutôt ce qui s’est passé au moment de la Commune de Paris ou du ghetto de Varsovie.
1. Je rappelle la définition de l’État tirée des Principes de la philosophie du droit de Hegel qui fait de l’État l’instance obligée au moyen de laquelle se découpe le lieu politique (dans mon lexique actuel : l’État est le transcendantal du lieu politique). Corollaire : toute novation politique consiste à lever ce transcendantal, consiste à établir des conditions différentes de celles que l’État prescrit. La situation en Israël-Palestine est telle que la politique obéit là-bas de façon extrême à cette figure : il y a là-bas une visibilité maximale, et consciemment assumée, des relations entre l’État et les espaces politiques qu’il régente (une visibilité maximale de l’État comme transcendantal de la topologie politique). Cela se donne en particulier dans une réglementation tatillonne et changeante concernant les points d’entrée et de sortie d’un lieu : à aucun moment il n’est possible d’oublier la nature territoriale du contrôle exercé par le transcendantal étatique. On en a une expérience physique immédiate en Cisjordanie lorsque, pour aller d’un village à un autre distant du premier de 5 km, la distance réellement parcourue doit être multipliée par 5 ou 6 par le jeu des barrages et des check-points : les trajets concrètement effectués offrent une vue sur quelque chose d’essentiel concernant la nature de l’État. Il s’y ajoute des éléments de surveillance panoptique à la Bentham ; j’ai pu m’en rendre compte à l’université Al-Quods de Jérusalem où l’on m’a expliqué que l’antenne que j’avais remarquée sur une colline proche était en réalité un « œil » braqué en permanence sur le campus (et destiné à signaler tout rassemblement suspect). L’espace n’est donc pas seulement découpé par l’État, il est aussi exposé.
2. Les formes de la coercition exercée sur les sujets oscillent entre deux bords. Il y a d’une part un contrôle capricieux dont les règles, changeantes, s’insinuent dans l’existence quotidienne : pour aller de Ramallah à Naplouse, les conditions pour avoir le permis de circuler peuvent être remplies un jour et ne plus l’être le lendemain, selon des règles apparemment totalement arbitraires. Il y a un caprice inhérent à l’existence même de la règle, qui, sans prévenir, peut passer de l’anodin au subitement rigide. Mais d’un autre côté, il y a une politique de force dont je pense que le principe est de montrer qu’elle est en capacité d’être illimitée. Le « rationnel » de la chose, si on peut dire, a été exprimé par un militaire israélien dans cette déclaration : « Nous [sous-entendu : mais pas vous], nous sommes un État ». La violence de l’attaque israélienne dont nous avons été les témoins rappelle la théorie qui avait été développée à l’époque de la guerre américaine au Vietnam (et sur laquelle Chomsky avait dit des choses intéressantes), théorie connue sous le nom de « politique du fou ». Les actions que vous entreprenez doivent pouvoir convaincre votre adversaire que vous êtes capable de faire n’importe quoi : vous devez accomplir quelque chose dont on puisse dire : « S’ils ont été capables de faire cela, alors il n’y a plus qu’à jeter l’éponge ». C’est la raison pour laquelle je pense que les réactions qui se sont fait entendre et qui mettaient l’accent sur l’usage disproportionné de la force, sur la violence gratuite (« pourquoi tant de morts ? »), pour compréhensibles qu’elles soient, manquaient l’essentiel, à savoir que l’usage déchaîné de la force a été en l’occurrence délibéré et préparé de longue date[4]. La « politique du fou » s’enseigne dans les écoles militaires israéliennes et est considérée comme une méthode rationnelle et efficace. Il s’agit d’établir comme point subjectif que, dans un conflit donné, une des puissances en présence ne se plie pas à la norme. Il n’est donc pas accidentel (de l’ordre de la « bavure ») que les destructions aient outrepassé toute rationalité militaire, cela est au contraire central. C’est cela que j’appelle le principe d’illimitation. Une des formes les plus « pures » en est le bombardement par les Américains de Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que celui de Dresde à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale par les Anglais (dont Churchill avait bien dit que le message qu’il impliquait était moins destiné aux militaires qu’à la population allemande elle-même). C’est là, à mon avis, que sont enracinés les fondements de la « politique du fou ». Il s’agit d’une « montée aux extrêmes » (pour reprendre les catégories de Clausewitz) dans des conditions telles que l’adversaire doit être convaincu que lui-même ne pourra pas monter aux extrêmes à l’intensité, ou à la hauteur, où vous, vous le pouvez.
3. Il y a une prolifération de lois, mais celles-ci peuvent être soustraites d’un seul coup. Ce n’est pas seulement une loi qui disparaît alors, mais c’est le principe même qui régissait la loi précédente qui est dénié. Le meilleur exemple en a été les élections à Gaza. Comme vous le savez, en votant pour le Hamas, les Gazaouis ont « mal » voté. De sorte qu’à l’annonce des résultats la règle qui présidait à la tenue des élections ne valait plus (le gouvernement algérien n’a pas agi différemment après la victoire électorale des islamistes). Il est quand même frappant de constater que la règle essentielle de notre « démocratie » est en réalité une règle à façon. L’État est un transcendantal qui se représente comme une prescription, mas lui-même se soustrait à cette prescription.
4. Il n’est nulle part aussi évident qu’en Israël-Palestine que, ainsi que Hegel en avait formulé le principe, la vérité de l’État c’est la guerre. La guerre n’est pas accidentelle, elle est bien intrinsèque à la situation. Par voie de conséquence, il est impossible d’entrer dans la situation à partir des dispositifs étatiques, il faut partir de la situation elle-même. Il est en particulier insensé d’y entrer par la dichotomie Juifs/Arabes, les critères ethniques ou racialistes ne font que perpétuer la situation de guerre, ne font qu’entériner le transcendantal étatique. Les critères religieux ne sont pas meilleurs : un prétendu conflit entre judaïsme et islam est d’autant moins pertinent que 30% des Palestiniens ne sont pas musulmans mais chrétiens. Enfin, la thèse de deux États est, d’ores et déjà, une thèse sans avenir : les populations qui vivent sur ce bout de territoire sont tellement intriquées, ramifiées, que toute thèse séparatrice ne peut que majorer la violence existante. Pour l’État d’Israël, il n’existe qu’un seul État légitime et, dans l’hypothèse de deux États, l’autre État n’aurait qu’une légitimité concédée par le premier. Le plus grave est que la thèse des deux États divise les Palestiniens eux-mêmes ; j’ai pu constater que les dissensions entre Fatah et Hamas sur la question de l’État faisaient de Naplouse, en particulier, une ville au bord de la guerre civile. Il y a un risque réel à ce que les Palestiniens ne se voient offrir d’autre choix politique que soit se ranger sous la bannière d’un État fantoche autoritaire « ami de l’Occident », soit s’identifier à une opposition islamiste violente et terroriste aux choix fermés (cette alternative calamiteuse est déjà celle qui structure l’Égypte de Moubarak). L’organisation de noyaux actifs de gens situés en dehors de l’opposition Fatah / Hamas me paraît essentielle pour l’avenir.
Il faut donc partir de la singularité de la situation. Il y a en Israël un mouvement populaire d’une force extraordinaire qui se manifeste dans l’opposition à la guerre, mouvement certes minoritaire mais où je vous prie de croire que chacun paye de sa personne, notamment dans la liaison avec les Arabes Palestiniens. Ce mouvement illustre une thèse que j’ai défendue devant vous, selon laquelle l’existence politique dépend de la capacité à se soustraire au mirage de l’État : c’est la capacité à exister en ce sens, en suspendant délibérément la question de l’accession au pouvoir, qui va déterminer la situation.
5. La question véritablement à l’ordre du jour est donc : comment dés-étatiser la politique ? Il faut assumer que la population d’Israël-Palestine vit sans État légitime : elle doit se tourner vers elle-même, dans une liaison forte entre les Israéliens progressistes et les Palestiniens, puis, face à l’État – dans sa double modalité d’État fort : l’État d’Israël et d’État faible : l’Autorité palestinienne – il est nécessaire que cette existence populaire manifeste une inertie maximale. C’est déjà ce que font les refuznik israéliens qui dint non aux injonctions de l’armée et c’est ce que font les Palestiniens qui refusent de participer au climat de guerre civile entre Fatah et Hamas. Il ne faut pas avoir peur pour cela d’une certaine monstration de la faiblesse qui, si elle tient bon quant à la primauté de la politique, doit pouvoir éviter les pièges du couple plainte (dénonciations de nature humanitaire) / sacrifice (idéologie du martyre). Au cours de ce voyage, j’ai entrevu l’importance de que pourrait être une laïcité vraie – vous savez pourtant que le thème de la laïcité n’était pas vraiment jusqu’à présent ma tasse de thé. J’appellerai donc volontiers laïque toute personne qui
a) fait prévaloir l’existence du peuple sur l’État et qui, contrairement à une longue tradition, pense que l’État n’est pas le réel de la politique
b) et, en même temps, soutient que l’existence populaire ne peut se présenter dans la vêture d’une religion. L’existence populaire doit être affirmée sans tenir compte des identités : elle n’est pas l’addition des identités qui la constituent et qui seraient comme les atomes de cette existence ; au contraire : les identités doivent être surmontées.
En définitive, je suis persuadé qu’Israël-Palestine est le lieu métonymique de toutes les grandes contradictions de notre monde, que là-bas, aujourd’hui, elles sont exposées avec la visibilité la plus complète.
Platon : la Caverne
Nous commençons l’examen de ce texte célébrissime qu’est l’allégorie de la Caverne.
Quelques remarques préliminaires.
1) Le texte original de Platon ouvre le livre VII de La République. Le livre VI se terminait par la théorie de la Ligne, que nous avions commentée la dernière fois. Nulle part ailleurs dans La République n’est plus absurde la coupure entre livres. Elle survient, comme je vous en avais déjà fait la remarque, au moment où un montage conceptuel va être repris dans la figure d’un récit. La fin du livre VI expose la théorie de l’acte dialectique, l’allégorie de la Caverne est la mise en fiction de cet acte. Il y a là quelque chose de général : si vous avez pénétré l’essence d’une construction conceptuelle, vous devez pouvoir en produire une image, un diagramme. C’est ce que j’appellerai l’axiome du diagramme. La coupure entre les deux livres opérée par quelque grammairien alexandrin se produit donc au moment de la production de la preuve. Le moment est d’autant plus paradoxal que Platon est réputé avoir œuvré à la destitution des images : il vient d’établir qu’il faut s’évader du monde des images et, pour nous en convaincre, il nous présente une image de cette évasion (la machinerie baroque mise à contribution a quelque chose à voir avec le cinéma). C’est le moment où la pensée – en l’occurrence la question théorique qu’est l’acte dialectique – doit aussi s’activer comme question d’existence; et ce moment requiert que l’on soit capable d’articuler poème et mathème. Platon, par conséquent, non seulement ne procède pas ici à un protocole d’expulsion des poètes, mais convoque le poème et ce pour montrer que sa question ne peut être confinée au seul domaine théorique.
2) Platon invente dans ce passage, par le biais de l’aliénation dans les images, la catégorie de société du spectacle. Il est même encore plus radical que Debord car ses spectateurs, « emprisonnés sur leur siège, les yeux fixés sur l’écran, la tête tenue par des écouteurs rigides qui leur couvrent les oreilles », sont contraints au spectacle. Qui sont cependant les « invisibles montreurs » qui agitent les objets dont les spectateurs voient les images ? Qui est le maître des images ? Debord aurait certainement répondu qu’il y a un système de production des images et que celui-ci se confond avec le capitalisme. Chez Platon, la question demeure à l’état d’énigme. Toute libération est une pensée du dehors; comme le rappelait Deleuze, on ne pense pas spontanément mais seulement de force, comme poussé dans le dos. « Imaginons qu’on détache un spectateur, qu’on le force soudain à se lever, ... ». Qui est ce libérateur, qui sont les « rudes gaillards payés par nous (?) » qui sont les agents de cet arrachement ? Là aussi, le texte platonicien laisse la question à son énigme.
3) Quelques autres anticipations de Platon : a) le processus de libération doit accéder de façon immanente à sa propre idée, l’éblouissement sur les flancs de la montagne (l’Absolu) est le résultat du processus de libération et non sa cause, l’idée ne précède pas le processus; Platon est proche ici de Hegel - b) la joie de l’émancipation est indubitable, mais elle suppose une douleur (le spectateur, détaché de ses liens, contraint à regarder la lumière qui jaillit des projecteurs, est ébloui, ses yeux lui font atrocement mal) et produit une pitié (il prend en pitié ses compagnons d’imposture, ceux qui sont restés cloués sur leur fauteuil de visionnaires aveugles); cette fois Platon anticipe Schopenhauer.
4) Les opérateurs de translation auxquels j’ai eu ici recours pour ma traduction
J’ai voulu rendre le texte de Platon contemporain de notre régime d’images. Les ombres éclairées à la chandelle sur les parois de sa caverne ont quelque chose de franchement néolithique. J’ai donc eu recours aux prestiges combinés du cinéma et – pour conserver l’énigme des montreurs invisibles – des ombres chinoises.
Pour présentifier la violence obscure de la sortie de la salle de spectacle, j’ai par contre appelé Kafka à la rescousse, avec ces « agents » qui, sans ménagements, viennent arracher le spectateur à sa situation ordinaire.
J’ai voulu ponctuer – sans prétendre résoudre – la principale énigme du texte, qui est celle de tous ces objets qui circulent derrière les spectateurs (« poupées, marionnettes etc. ») et dont on ignorera à jamais la provenance. Ce qui, une fois de plus, est souligné par Amantha quand elle fait remarquer que les ombres de l’expérience ordinaire, avant l’arrachement, étaient plus « réelles » que ces mystérieux objets.
Enfin, j’ai voulu donner plus d’ampleur au passage à l’extérieur, pour un meilleur équilibre avec la salle de spectacle, et pour cela j’ai mis à contribution la prose de Samuel Beckett (« il voit se lever Vénus, encore ... »).
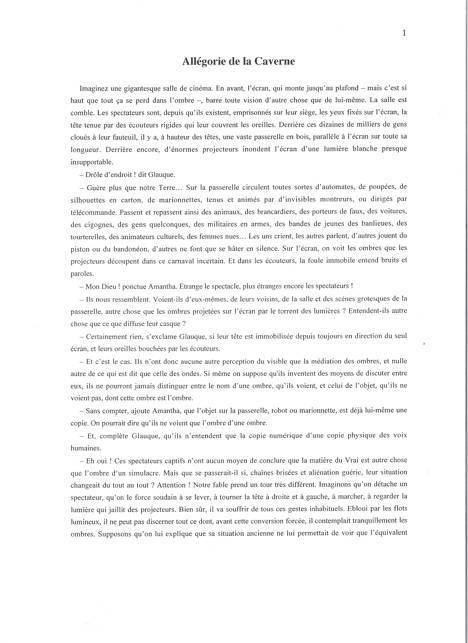

4 Mars 2009
Je vais reprendre ce soir la lecture de l’allégorie de la caverne, mais en la reliant avec notre situation contemporaine. Je vais faire en somme comme si la caverne de Platon était elle-même l’allégorie de notre propre caverne. Bien qu’à l’évidence Platon n’ait pas écrit La République dans le contexte d’une crise systémique du capitalisme, je voudrais montrer comment son texte fonctionne vis-à-vis d’un référent aussi anachronique.
Il y aura quatre parties dont voici les titres : 1° La situation – 2° La sortie – 3° Le lieu de la pensée – 4° Le retour
1° - La situation
La situation (ou : la question de l’organisation de l’apparence)
Reportez-vous au début du texte qui nous introduit dans la salle de cinéma. Nous nous arrêterons pour l’instant à la réplique de Glauque (« Drôle d’endroit ! »), à laquelle Socrate répond : « Guère plus que notre Terre ».
Ce lieu décrit un emprisonnement caractérisé par une fixité (« les yeux fixés sur l’écran, la tête tenue par des écouteurs rigides qui leur couvrent les oreilles ») : ce qui se donne à percevoir est strictement contraint. Cet assujettissement du voir et de l’entendre rappelle la problématique de Jacques Rancière, attachée à la description des régimes d’adéquation entre la visibilité des choses et la signifiance des mots (c’est aussi ce que, pendant longtemps, on a appelé « l’idéologie dominante »). Cet emprisonnement, à mes yeux, désigne l’élément fixe inhérent à toute situation.
Quel est alors l’élément de mobilité qui lui correspond ? Eh bien c’est la théorie des marionnettes tenues et animées par d’invisibles montreurs (animaux, brancardiers …) qui circulent sur la passerelle et qui organisent une fiction de savoir (« fiction » car ne pouvant voir que ce spectacle-là, la « foule immobile » n’a aucun moyen de « conclure que la matière du Vrai est autre chose que l’ombre d’un simulacre »). Dans notre monde, l’organisation de l’apparaître repose de même sur l’articulation d’une mobilité (les simulacres de « l’idéologie dominante ») à une fixité (l’économie capitaliste) : des ombres sont machinées comme mobilité du point d’une fixité cachée, invisible car située derrière.
« Ils n’ont aucune autre perception du visible que la médiation des ombres et nulle autre de ce qui est dit que celle des ondes ». Ce passage introduit à l’opinion en tant que celle-ci est toujours un rapport entre une fixité et une mobilité. Car on peut caractériser l’opinion comme la conviction d’un rapport unique et bien défini entre mobilité et fixité sous réserve d’un secret caché. Dans la situation contemporaine, nous dirons : l’opinion concerne la mobilité de l’apparaître (l’apparaître machiné comme systèmes d’ombres) dans le cadre d’un assujettissement qui renvoie à une structure secrète, structure dont il faut savoir que le secret a été éventé dans l’ouvrage en plusieurs volumes de Karl Marx Le Capital.
Afin que la mobilité de l’apparaître soit régulièrement produite, la condition de l’alignement des spectateurs (vis-à-vis de l’écran) est cruciale. Or, le secret, dans des temps de crise comme ceux que nous connaissons, i.e. lorsque la machine fait entendre des bruits de panne, a tendance à s’exhiber (mais à contrecœur). Quelque chose dans le mobile demande à ce que l’on en sache plus sur ce qui est fixe. Quand le spectacle a pour effet que les spectateurs tendent à se retourner, même un peu, parce que des manutentionnaires sont en train de transporter des pièces de décor ou autres matériaux de l’arrière vers l’avant, cela crée un certain chambard matériel et pour tout dire ça désaligne un peu. La rectification de l’alignement devient fondamentale dans la confection d’une idéologie.
Ce qui va puissamment contribuer au ré-alignement est ce que
j’appellerai volontiers les oxymores de la situation. On les trouve en particulier dans les multiples
explications qui nous sont prodiguées à propos du capitalisme dans la
production journalistique. Il y a le capitalisme moralisé, qui est l’oxymore par excellence : car non seulement
capitalisme et morale sont, dans leur essence, sans aucune relation mais on
voit mal comment un système fondé sur le profit, i.e. sur la cupidité de ses
agents, serait moralisable. Il serait injuste de ne pas citer aussi le marché
régulé - en contradiction explicite avec
l’idée selon laquelle c’est la dé-régulation qui constitue la vertu même du
marché, idée qui a été le credo général pendant les années où le système
semblait en pleine forme (en tout cas, en France, depuis Mitterand-Bérégovoy) -
ou encore la privatisation étatisée.
On peut remarquer qu’en situation de crise l’oxymore, dont la nature héraclitéenne est évidente (lutte du feu et de l’eau, transformation de chaque chose en son contraire) tend à prendre l’avantage sur la tautologie propagandiste de la période antérieure qui, quant à elle, est plutôt de nature parménidienne (ce qui est, est, et ce qui n’est pas, n’est pas). Remarquons également que les deux parties de l’oxymore sont dissymétriques et en tension et que l’on cherche à faire passer l’une des deux, en général le substantif (tenant-lieu du capitalisme) pour un terme invariant et fixe.
Je dirai, pour conclure ce point, que l’essence même du ré-alignement réside dans la croyance en ces oxymores [5].
2° - La sortie
« Que se passerait-il si, chaînes brisées et aliénation guérie, leur situation changeait du tout au tout ? »
De la sortie dont il est ici question, on dira, même s’il s’agit apparemment d’une sortie vers l’extérieur, que c’est une sortie immanente, qu’elle se produit à l’intérieur de la situation, dont tout l’enjeu est de ne pas en être captif.
Je vous avais déjà fait remarquer que Platon exclut toute forme de désalignement spontané (« on détache un spectateur, on le force à se lever etc. ») ; cette même idée circule jusqu’à Deleuze, que l’on considère à tort comme un spontanéiste, et qui insistait sur le fait qu’on ne pense que forcé. Pour qu’il y ait désalignement, il faut une forme de contrainte, une poussée du dehors, qui désigne, dans mon vocabulaire, son caractère événementiel. Le meilleur terme, à mon avis, est ici celui d’écart, un écart qu’il faut comprendre comme non transitif à la situation elle-même. L’idée qu’on ne peut accéder à un autre mode du visible que sur le mode de la contrainte s’oppose à l’idée pour laquelle ce qui importe c’est l’acquisition d’un savoir nouveau. Or, si on dévoilait aux spectateurs la mécanique de la machination des apparences, cela ne changerait pas grand-chose, ils seraient peut-être « stupéfaits et gênés », et c’est tout. La connaissance immédiate n’est pas porteuse d’émancipation. Non seulement c’est le contraire qui est vrai, pour Platon (c’est l’émancipation qui rend le savoir possible, au moment de la redescente vers la caverne, on le verra tout à l’heure); mais l’explication va s’intégrer au ré-alignement lui-même. C’est patent quand on considère les explications qui se multiplient actuellement dans la presse (sous la forme privilégiée des oxymores que nous avons vu tout à l’heure) ; elles illustrent simplement cette règle générale qui veut qu’en cas de crise de l’apparaître, des spécialistes du savoir se présentent immanquablement pour montrer des bouts de la machine mais dans une finalité de ré-alignement. Ce n’est d’ailleurs pas l’exactitude du savoir mobilisé qui importe en l’occurrence, mais sa pure fonction de savoir.
La question de la sortie – ou de l’écart – combine ainsi le hasard et la discipline. Hasard, parce qu’il n’y a aucune causalité pour établir la raison du retournement de certain(s) spectateur(s) (aspect événementiel) [6]. Discipline et suivi des conséquences, parce que ce sont là les manières d’endurer la violence de la séparation. La sortie pose en effet la question de la violence. On oppose habituellement la violence à la raison, celle-ci étant supposée tempérer celle-là. Mais ce dont il s’agit dans la sortie, c’est de la violence même de la raison. La séparation est fondamentalement une violence, à commencer par cette violence immanente qu’est la séparation d’avec soi-même. C’est un mouvement forcé, aux deux sens du mot, « on le force soudain à tourner la tête à droite et à gauche », c’est douloureux, comme l’est toute torsion subjective. Cette violence séparatrice, ce n’est pas la violence oppositionnelle de qui est en réaction contre (un état de choses, des forces contraires etc.), elle est plus profonde, c’est la violence de la séparation de qui est « lié et effectivement réel seulement dans sa connexion avec autre chose » quand il obtient « un être-là propre et une liberté distincte » (comme s’exprime Hegel dans le passage de la préface à La Phénoménologie de l’Esprit consacré à « la puissance du négatif »), et aussi la séparation de l’un qui se divise en deux et dont, comme chacun sait, on ne sort pas entier, laissant toujours derrière soi un misérable produit, un rebut en haillon, parfois au prix d’un aveuglement (voir plus loin) comme Œdipe à Colone.
De même que l’essence du ré-alignement réside, on l’a vu, dans la croyance aux oxymores, la séparation est caractérisée par l’absence de toute crédulité à leur égard. Pourquoi ? Parce que c’est dans la croyance aux oxymores que gît le désir que ça continue comme avant. L’enjeu, quand il y a un dysfonctionnement dans l’apparaître, est de ne pas s’installer dans le désir de sa réparation (« que le spectacle continue ! »). Il y faut sans doute une certaine dose d’aveuglement. Je me réfère là à un passage troublant, et à mon sens très profond, du texte de Platon, lorsque le spectateur, après avoir été arraché de son fauteuil, est traîné à travers un tunnel crasseux, avant de déboucher à la lumière sur le flanc de la montagne. C’est que toute émancipation suppose la traversée d’un aveuglement. S’il n’y avait pas cet aveuglement, on ne consentirait tout simplement pas à la séparation. On parle volontiers de l’aveuglement du militant révolutionnaire. Eh bien je pense que c’est une dimension qu’il faut totalement assumer : il y a toujours, dans l’expérience révolutionnaire, un tel moment de traversée inconsciente d’un passage aveugle puisque toute la question est alors celle d’un changement des modes du voir (et il y a nécessairement du non-vu entre deux formes différentes du voir). Que signifie dans ces conditions l’éblouissement du spectateur qui découvre la lumière ? Je ne pense pas qu’il faille parler ici d’illumination. Ce dont il s’agit c’est de la constitution d’une nouvelle visibilité : c’est le même monde, la même situation, qui vont être vus, mais dans un registre nouveau de la visibilité qui permet le retour à l’ombre ancienne (la redescente) pour la voir autrement.
La propagande contemporaine cherche au contraire à nous ré-accoutumer à l’ombre. La solution qui a été trouvée est de soutenir que l’ombre elle-même est une lumière (c’est vraiment l’oxymore des oxymores) sous la forme suivante : les défauts, les excès, de la machine sont enfin connus, et c’est ce qui va permettre de les réparer. La lumière reste intérieure à l’ombre première, il n’y a donc pas besoin que la lumière provienne d’ailleurs. C’est un point subjectif de démarcation essentiel : l’ombre elle-même contient-elle sa lumière propre (l’ombre est-elle en capacité de se rendre visible elle-même ?) ou bien est-il nécessaire qu’une autre lumière, venue d’ailleurs, permette de voir l’ombre différemment ?
3° - Le lieu de la pensée
Je passerai aujourd’hui rapidement sur le troisième terme, le lieu de la pensée, que nous avons longuement commenté sous le nom d’idée du bien (ou idée du vrai) pour conclure sur le retour.
4° - Le retour
Notre évadé de la salle de cinéma, dès lors que, sur la flanc de la montagne, il a vu, ébloui, l’être (das ist), pourrait s’en tenir là : il a vu la soleil et « le contemple, dans la béatitude qu’il soit tel qu’il est ».
Mais Platon est formel : cela ne suffit pas, il faut qu’il redescende dans la salle pour partager l’ensemble de son expérience avec les captifs de l’apparence, afin de les forcer à leur tour à s’arracher à leurs fauteuils. On comprend désormais qui sont ces « rudes gaillards » qui empoignent sans ménagement les spectateurs cloués à leur siège : ce sont des ex-évadés redescendus parmi leurs anciens compagnons. Tel est l’enseignement incontournable de Platon, présenté pourtant comme le prototype de l’idéaliste : la béatitude ne suffit pas, ou plutôt : le seul usage licite de la béatitude, une fois que l’on y est parvenu, est de la partager avec ses semblables. Et Platon ajoute : cela ne se passe pas simplement. Car l’évadé qui redescend dans la caverne et qui connaît, parce qu’il l’a expérimentée, une possibilité jusque là insoupçonnée de la situation, ne peut qu’imposer cette connaissance.
Si nous appelons militant la figure de cet évadé, on voit qu’il y a, de façon intrinsèque, une violence militante : comment pourrait-il en être autrement, puisque cette possibilité doit être expérimentée et qu’il n’y a pas d’autre façon de l’expérimenter. De la même façon, Platon nous suggère, si l’on transpose dans nos termes contemporains, que ce qu’on appelle un mouvement ne peut être que pré-politique : car livré à lui-même, un mouvement n’a d’autre loi que de perdurer selon son propre principe de satisfaction. Or, il n’a de sens que s’il implique la descente (vers la caverne), le retour, l’usage diagonal de la liaison avec autre chose que lui-même – autrement dit : on se soulève toujours pour tous.
La seule attestation que l’on a bien à faire avec un mouvement d’émancipation ne peut être apportée que par le fait qu’il emprunte une direction différente de la direction qui l’a constitué lui-même. Il n’y a pas de consommation narcissique du vrai.
8 Avril 2009
Nous avions parlé la dernière fois de la violence de la sortie de la Caverne, dont je vous avais dit qu’on ne sort que forcé. Nous savons qui sont les « rudes gaillards » venus du dehors qui empoignent sans ménagement les spectateurs cloués à leur siège : ce sont des ex-évadés redescendus parmi leurs anciens compagnons. Il y a là manifestement un cercle, car il n’y a pas d’élucidation intra-rationnelle de la première sortie. Il faut justement tenir que la sortie n’est pas inscrite dans les virtualités systémiques [la théorie structurelle soutient à l’inverse que quelque chose pourrait advenir qui soit soustrait à ce cercle].
L’État de la situation est le système des contraintes qui limitent la possibilité des possibles. Une procédure de vérité est organisation des conséquences d’un événement incalculable. Un fait, par contre, n’est qu’une conséquence de l’existence de l’État. Une vérité ne peut donc être composée de purs faits. L’Histoire, qui est toujours l’Histoire de l’État, est composée de faits historiques. L’Histoire est une construction narrative après-coup concernant l’État; c’est une projection symbolique du devenir de l’État.
Reprenons la définition lacanienne de l’Idée comme ce qui expose une vérité dans une structure de fiction. L’Idée va projeter un fragment de réel dans la symbolique de l’Histoire. Cette projection ne peut donc qu’être imaginaire car aucun réel ne se laisse symboliser tel quel. On dira que l’Idée est l’opération imaginaire par laquelle un individu trouve la ressource de consister en sujet en projetant un fragment de réel dans la narration symbolique d’une Histoire. Il est par conséquent judicieux de dire que l’Idée est toujours idéologique – ou, qu’à l’inverse, l’idéologie est la projection, toujours imaginaire, d’un fragment de réel dans une Histoire symbolique.
Empiriquement, l’Idée c’est ce, finalement, à l’abri de quoi un individu va s’incorporer à une vérité. L’Idée, c’est ce qui explique que vous pouvez aller dans une réunion de trois personnes en pensant que vous montez sur la scène de l’Histoire. En quoi vous n’avez pas tort, ni raison d’ailleurs. Vous êtes simplement dans le registre de l’Idée en tant que l’Idée va articuler votre détermination individuelle à la procédure de vérité – procédure de vérité non pas en tant que réel insymbolisable, mais en tant que projection possible de ce réel dans un ordre symbolique qui est de l’ordre de l’Histoire[7]. L’Idée du communisme, c’était ça : ce qui projetait l’Idée, toujours fragmentaire, de séquences de la politique révolutionnaire dans le registre symbolique de l’Histoire. Comme le réel politique n’est pas symbolisable comme tel – il procède simplement, dans le réel – c’est dans la médiation de l’Idée que l’individu peut s’incorporer à ce réel, dans la représentation symbolique que, ce faisant, il est un agent historique (et non pas simplement un individu incorporé à une procédure). Cette opération, il n’y a aucune raison de dire que c’est une tromperie, qu’elle relève de l’illusion ; cette opération est de l’ordre de l’engagement lui-même, tout engagement individuel se fait au régime de l’Idée.
Ou encore : l’Idée c’est la médiation entre l’individu et le sujet – si on appelle « sujet » ce qui oriente le corps de vérité dans sa part non factuelle, dans sa part non réductible aux faits. On peut dire que l’Idée présente la vérité comme si elle était un fait ; on a ainsi pu parler d’une « patrie du communisme » : c’est ce qui permettait de représenter la procédure de vérité dans la figure factuelle, massive, d’un pouvoir d’État. L’Idée est la médiation opératoire entre le réel et le symbolique (l’Histoire, en tant qu’ordre symbolique, est toujours une histoire de l’État, alors que le réel, lui, est in-symbolisable). L’Idée présente à l’individu quelque chose qui se trouve entre l’événement et le fait ou quelque chose qui pourrait être le factuel de l’événement lui-même – i.e. quelque chose entre le hasard et la nécessité : ce qui était hasardeux l’est effectivement mais, d’une certaine façon, se laisse inclure dans une nécessité plus vaste.
Pourquoi l’Idée est-elle requise ? C’est que l’histoire des vies ordinaires, l’histoire des existences, est tenue dans l’Etat. Famille, travail, patrie sont les médiations classiques par lesquelles la vie, en tant qu’Histoire, est une part de l’Histoire de l’Etat. La projection d’un héroïsme individuel, i.e. de la possibilité d’une exception à cela, exige nécessairement l’Idée. Et ceci pour deux raisons. La première est que sur ce point (le point de l’exception), il faut aussi être en partage avec les autres : ce qui entend se montrer comme exception doit aussi, désormais, être une possibilité ouverte à tous. Or, l’Idée est requise s’il s’avère nécessaire de convaincre un ami, un collègue de bureau etc. de vous accompagner à une réunion politique ou à l’exposition d’un artiste qui vous semble essentiel ; car l’Idée est une médiation indispensable, non réductible au réel lui-même, au réel comme réel, i.e. ce à quoi il s’agira finalement de s’incorporer. La deuxième raison est que l’événement est une surprise et que l’Idée est une grande puissance d’anticipation – anticipation non pas de l’événement lui-même, qui est précisément incalculable, mais de son accueil. Dans l’élément de l’Idée, vous êtes dans une disposition individuelle qui vous tourne en quelque sorte vers l’accueil de la proposition événementielle. L’Idée est toujours l’affirmation qu’une nouvelle vérité est historiquement possible, autrement dit que la ligne de partage établie entre le possible et l’impossible peut être encore une fois déplacée. Ce déplacement sera rendu possible par un événement qui va déjouer toute prévision ; c’est pourquoi l’Idée ne peut être que la subjectivation anticipée de l’accueil d’un tel surgissement. C’est comme d’être dans la conviction que l’amour est possible ; cette conviction ne vous renseigne pas sur l’identité de la personne dont vous serez éventuellement amoureux.
*
Reste la question des autres figures subjectives. Ce que nous avons considéré jusqu’à présent ne concerne que le sujet fidèle. Mais, en toute rigueur, il doit également y avoir des Idées réactives. Je rappelle – cf. Logiques des mondes - que le sujet réactif est celui qui tente de se convaincre que la nouvelle possibilité n’est en réalité pas nouvelle, i.e. qu’elle est en fait interne à la situation, et que par conséquent s’y incorporer est une erreur fatale; le sujet réactif n’est pas quelqu’un qui est dans l’opposition frontale à la nouveauté, c’est quelqu’un qui dit : « comme vous, nous aimons l’égalité, nous aimons les ouvriers, la démocratie, mais attention ! Il faut y aller de l’intérieur de la situation, il faut tenir compte de la réalité etc ». Le sujet réactif incarne une véritable orientation : c’est lui en effet qui, chevauchant le corps de vérité nouvellement apparu, l’oriente vers une voie de garage. Il effectue une ré-orientation immanente du corps de vérité dans la situation, par réduction progressive de ce qui en lui était originairement en exception, pour finir par le domestiquer, par en faire un simple fait ; autrement dit : il s’agit d’une orientation désorientante, pour reprendre le terme que nous avons utilisé ici il y a deux ans.
On pourrait montrer qu’il existe une figure réactive pour chaque procédure de vérité. Dans le cas de la Révolution française, la figure réactive la considère comme vaine car du point de vue de la symbolisation historique générale, il apparaît que la Révolution française n’a rien produit qui aurait pu se produire sans elle (vous reconnaissez l’argumentaire développé par François Furet). L’opération de la figure réactive consiste ici à projeter le réel dans la symbolique générale de l’Histoire, afin d’en exténuer la vitalité. Or, quand un réel est en exception de l’état historique des choses, cette exception n’est justement pas résorbable dans une différence symbolique. En définitive, l’opération du sujet réactif se fait sous l’Idée que la vérité du réel c’est la projection symbolique. L’Idée inverse étant précisément que le réel de la projection symbolique, le réel de l’Histoire, c’est là que gît la vérité. Nous avons d’un côté l’exténuation du réel par le symbolique et de l’autre l’exaltation du réel par le symbolique. C’est la même opération dans les deux cas (projection dans l’Histoire) mais avec une valence retournée. On peut donc dire de l’Idée réactive en général qu’au nom de la projection historique, elle détourne l’individu d’une incorporation réelle (l’exception réelle sera toujours au yeux de la figure réactive une utopie impraticable, elle sera toujours à ses yeux déniée dans son réel – c’est cela que veut dire « utopie » - au nom de la nécessité symbolique de l’Histoire) et de l’Idée du sujet fidèle qu’au nom de la projection symbolique, au nom de l’Histoire, elle exalte l’exception réelle.
Je voudrais conclure ce point en disant que je pense que la gauche, depuis un siècle et demi (depuis l’époque de la Commune ?) c’est le nom en politique de la figure réactive. Les faits le prouvent. Et il y a toujours de la gauche ... dès qu’il y a de la vérité. C’est la raison pour laquelle la gauche ne peut pas disparaître : elle est le nom moderne du sujet réactif dans le champ politique qui, en la matière, est matriciel (il serait intéressant de se demander qu’est-ce que la gauche en art, en amour, dans la science)[8]. Si la sortie de la Caverne est nécessairement violente, c’est avant tout qu’il faut rompre avec les formes subjectives de l’asservissement, i.e. en fin de compte avec le consentement à l’idée qu’on peut améliorer l’état des choses. L’élément subjectivement violent, en l’occurrence, c’est la rupture avec la gauche. Car l’obstacle à la généralisation de l’Idée émancipatrice, c’est qu’elle n’est en réalité pas la seule : il y a toujours, comme son ombre, l’Idée de gauche, i.e. l’Idée qui prétend dire la même chose que l’Idée émancipatrice à ceci près qu’elle s’épargne la sortie. Toute sortie comporte de fait une double rupture : il faut d’abord accéder au régime de l’Idée, i.e. accepter qu’il y a quelque chose qui se passe; mais une fois cette première rupture acquise, il faut encore rompre avec l’organisation réactive, i.e. avec l’Idée qu’on pourrait l’obtenir par amélioration immanente de ce qui existe. Ce n’est plus alors l’Idée contre l’apparence comme dans la première rupture, mais Idée contre Idée. Ce sont en effet toujours deux Idées qui sont proposées au regard de ce qui advient.
C’est un point qui n’est pas parfaitement éclairci dans le texte de Platon. Nous avons vu qu’il y avait chez lui sur les questions décisives une double présentation des choses : une version conceptuelle et une version narrative ou semi-poétique. Je pense que la raison en est que sur ces questions décisives, il est précisément aux prises avec l’existence possible de deux Idées. Dans la version conceptuelle ou géométrisée de la question, Platon ignore la deuxième Idée, l’Idée réactive : tout se passe comme si, une fois qu’est advenue la nouvelle possibilité, la partie est en quelque sorte gagnée (gagnée par celui que j’appelle le sujet fidèle). Dans la version narrative ou en poème, par contre, les choses sont plus obscures, plus confuses : il n’est pas entièrement suffisant d’avoir un protocole de sortie des apparences; quelque chose d’autre advient, une possibilité inaperçue entre en jeu sans qu’elle soit thématisée comme telle. Mais Platon ne va pas jusqu’au bout dans l’élucidation de la duplicité de l’Idée, il lui manque en somme une théorie cohérente de ce qu’est la gauche.
Platon, 9. Poème et Mathème à l’épreuve de l’Idée (République, 517b)
-- Ce que nous devons maintenant faire, chers amis,
est absolument clair. Nous devons unifier la
présentation imaginaire des choses dont nous venons de nous délecter — cette histoire du grand cinéma
cosmique et de celui qui s’en évade — et la présentation symbolique, ou plus exactement géométrique, que nous avons
proposée il y a une heure : la ligne
où sont marqués, par des segments inégaux, les quatre types de rapport au réel, de l’image à l’Idée
dialectique en passant par l’opinion et l’Idée analytique.
- Ce n’est pas
évident, remarque Glauque. On a deux mondes d’un côté et quatre procédures de
l’autre.
- Mais ce quatre
est divisé en deux, le visible et l’intelligible. En gros, on peut d’abord comparer
ce qui se déploie visiblement comme apparence au cinéma, à la prison des
spectateurs, et la lumière des projecteurs à la puissance du soleil. Ensuite, l’anabase de l’évadé dans la montagne et sa
contemplation des cimes, posons que c’est
l’ascension du Sujet vers le lieu de la pensée pure. Ces comparaisons, mes jeunes amis, sont conformes à ce que j’espère et
que vous désirez tant connaître. Bien
sûr, ce n’est que du point de l’Autre, et non de l’individu, cette pauvre
chose, fut-il Socrate, que se décide
si une pareille espérance est fondée. Je dois quand même dire que tout ce qui m’est apparu dans la
variété de mes expériences se dispose à partir d’un unique principe de
son apparition : A l’extrême limite du connaissable,
mais hors de son champ, se tient ce que j’appelle faussement l’Idée de la Vérité. Je dis « faussement », puisque comme
nous l’avons vu cette prétendue Idée,
ayant pour fonction de soutenir l’idéalité de toute Idée, ne saurait être elle-même
une Idée comme les autres. C’est du reste pourquoi il est très difficile d’en
construire un concept. Cependant, si on y parvient, on se voit contraint de
conclure que c’est selon cette « Idée » qu’un
étant quelconque s’expose à l’éclat de ce qu’il détient d’exactitude et
de beauté. Et si l’on poursuit nos comparaisons, on dira qu’à la donation de la
lumière et à l’action du seigneur de la lumière, tels que nous les expérimentons dans le visible, correspondent
exactement, dans le registre de l’intelligible,
la venue, selon l’Idée de la Vérité, tant des vérités particulières que de la
pensée qui y correspond.
- Mais, dit
Amantha, le front plissé, la comparaison est boiteuse.
Exercice pour la prochaine fois : pourquoi la comparaison est-elle boiteuse ? Et pourquoi cette boiterie constitue-t-elle le fond du problème ?
20 Mai 2009
Récapitulation en six points
Récapitulation des points nodaux de l'interprétation de l'allégorie de la Caverne. Il y en a six.
1. Qui sont les spectateurs enfermés dans la Caverne ? Pour Platon, ce sont des représentants de l'humanité ordinaire. Il y a donc, avec cette salle de cinéma où ils sont enfermés, une vision bien particulière de l'humanité ordinaire, une vision de la vie ramenée à son infrastructure : c'est une vie où l'on ne peut distinguer entre vie et survie, une vie réduite à sa pure et simple perpétuation. C'est la vie toute simple, toute nue (car il n'y a pas plusieurs types de vie) avec l'attribut crucial que c'est une vie sans Idée (c'est ce qui la définit comme survie). La métaphore en est donnée dans le fait que les spectateurs sont immobilisés là où ils sont.
2. Il n'existe pas pour Platon de mouvement spontané qui orienterait vers la sortie. Autrement dit, il n'y a pas dans la vie elle-même de ressource pour la vie. C'est sa thèse anti-vitaliste. De l'intérieur même de la vie, toute spontanéité n'est jamais qu'un changement d'images, une revendication ne peut aller au-delà du souhait d'un changement de programme.
3. La croyance en la possibilité d'un changement qui soit à la fois réel mais ne portant que sur le programme, i.e. un changement intra-systémique, cette croyance à sa manière est une Idée. C'est l'Idée de la possibilité d'une survie qui soit une vie, l'Idée que la vie n'a pas besoin de sortir – Idée qui revient à celle-ci : la vie n'a pas besoin de l'Idée du Vrai. La vie peut se passer de ce décrochement ultime qu'est l'Idée du Vrai (dont je rappelle que dans le lexique platonicien, elle s'appelle l'Idée du Bien) qui pour Platon est, nous l'avons vu, quelque chose comme une idée de l'idée (i.e. ce par quoi il y a idéalité de l'idée). Si l'on peut s'en passer, c'est qu'on peut se contenter d'une sorte d'idéalité restreinte, celle précisément qui rend possible une transformation sur place, sans sortir. Comme je vous l'ai déjà dit, cette Idée d'une sortie de l'intérieur mais qui resterait à l'intérieur (comme si l'on était passé à travers une fausse porte), cette Idée d'une sortie immanente, peut être appelée : la gauche. La gauche en son essence est la forme idéalisée de l'asservissement qui se donne dans la considération de la possibilité de son amélioration immanente.
4. La sortie vers la vie réelle est toujours liée à une violence et c'est une violence avant tout exercée sur soi-même. Quelque chose vient représenter le dehors (thème que l'on retrouve chez beaucoup de penseurs contemporains, et notamment Foucault et Deleuze, et qui chez moi – mais pas seulement chez moi – porte le nom d'événement) et cette représentation du dehors entraîne une discontinuité avec soi-même.
5.
Cette violence enveloppe une double rupture. D'une part, et c'est le plus connu, une rupture
avec la logique des intérêts, les intérêts qui organisent la survie de
l'individu. Mais d'autre part, il y a rupture avec l'Idée selon laquelle cette
première rupture peut s'effectuer selon les lois de ce monde : cette deuxième
rupture, c'est la rupture avec la gauche.
6. Qu'est-ce qui fait que l'autre venu du dehors est reconnaissable par celui qui va s'y soumettre ? Ou encore : comment se fait-il que cet autre, celui qui redescend vers la Caverne, ne s'intègre pas complètement à la « représentation dominante » (et, au contraire, y déroge) ? La réponse est qu'il doit porter sur lui les stigmates de la sortie, il doit revêtir certain attribut qui soit l'index du fait qu'il est effectivement sorti. Je traduits cette Idée dans mon langage : tout événement doit porter les stigmates d'un événement antérieur. Il fait résonner l'avoir-eu-lieu d'un autre événement que ce faisant il évoque / convoque. C'est ce qui explique que les partisans de Rosa Luxembourg aient pu se reconnaître dans l'appellation « spartakistes » qui, par-delà plusieurs siècles d'oubli, réalisait la résurrection de la révolte des esclaves antiques. Toute surrection n'est une insurrection que parce qu'elle est une résurrection. C'est donc parce que « celui qui redescend » porte les stigmates du dehors, c'est-à-dire en définitive les stigmates d'un événement qui a déjà eu lieu (lui-même en écho d'un événement antérieur, selon une récurrence infinie) qu'il va pouvoir ne pas être avalé par la représentation.
*
Il y a de l'obscur sur cette question dans le texte platonicien. Il est certain que Platon a ultérieurement été aux prises avec sa propre théorie des Idées (dans le Parménide, dans le Sophiste). Ma thèse est néanmoins qu'il n'a pas parfaitement théorisé le point décisif qu'est la double rupture : la rupture avec ce qu'il y a, la rupture critique (« première rupture ») doit en effet s'accompagner d'une rupture avec un certain type d'Idée quant à ce qu'il pourrait y avoir, i.e. avec un certain régime de la promesse. Je dirais que la théorie chez Platon, sur ce point, est que le possible n'est pas au point de l'impossible. Le slogan d'Obama reprend cette théorie à merveille : Yes, we can ! Avec Obama, les promesses sont internes au lieu, selon la règle de l'idéalité restreinte. Or, on a vu au moment de sa campagne que ce régime de promesses peut susciter un authentique enthousiasme de masse. Ce qui n'est pas vraiment surprenant : car sinon, i.e. si on se transportait au point de l'impossible, il faudrait assumer une vraie bascule dans l'inconnu – et ce dans une dimension de risque qui peut, à certains moments, être sans mesure. On comprend qu'une telle option puisse rendre hésitant ...
Prenons un exemple avec la crise actuelle. Le mot d'ordre « Sauvons les banques ! » a fait l'objet d'un consensus très large dont l'existence est en elle-même remarquable. Car ce mot d'ordre contrevenait de façon évidente aux lois du marché, quasiment considérées comme sacrées dans la période immédiatement antérieure. Seule une petite minorité d'idéologues, fidèles à ces lois, estimait que s'il y avait des canards boiteux parmi les banquiers, il fallait les laisser couler, et qu’ils n'avaient ainsi que ce qu'ils méritaient. Cette attitude n'a été suivie par l'État américain qu'une seule fois, et, devant le tollé, n'a pas été reconduite. Pourquoi ? C'est que la faillite cumulée des grandes banques aurait ouvert à une crise systémique de grande ampleur, à moins que l'État ne se soit décidé à s'engager dans une intervention à grande échelle (nationalisations). Dans les deux cas, on sortait du lieu. Or, le rôle de l'État n'est pas de procéder à la sortie du lieu mais au contraire d'en assurer le gardiennage. Les dirigeants du lieu sont prêts à flirter avec l'idéalité restreinte (i.e. la gauche), quitte à puiser dans les thèmes du « capitalisme à visage humain » ou à d'autres apparentés, pour sauver le lieu lui-même [9].
Platon entend réserver un cas de figure où la sortie serait une possibilité du lieu lui-même. C’est ce qu’est pour lui l’éducation. On voit que sur ce point, où il consent à restreindre la deuxième rupture, Platon a des positions apparentées à celles de la gauche – c’est son côté chef d’État potentiel (vous savez qu’il a eu des expériences malheureuses en ce domaine). Il y a là à mon sens l’origine de ce que je vous ai indiqué comme étant la double exposition par Platon du même motif : exposition mathématique (par exemple la théorie de la division de la Ligne) et sa reprise sous une forme poétique (l’allégorie de la Caverne). La présentation mathématique ouvre à une présentation ordonnée, placée, de l’impossible : il s’agit de quitter le régime de l’image pour celui de l’Idée (c’est par conséquent la première rupture qui est ici mise en scène) et le trajet consiste à passer du non savoir à l’Idée par la médiation du savoir. Pour Platon c’est une didactique (au sens même où Brecht utilisera le terme) car il est persuadé que cela peut s’enseigner. Quant à la présentation poétique (l’allégorie de la Caverne), il s’agit d’un récit et c’est le récit d’une expérience. Le trajet cette fois-ci c’est : de l’intérieur vers l’extérieur par la médiation d’une conversion existentielle. Ce qui est traité ici, c’est la deuxième rupture, celle avec l’idéalité restreinte (ce qui montre d’ailleurs que ce n’est pas dans l’élément du savoir que l’on peut rompre avec l’idéalité restreinte). Les deux ruptures sont donc thématisées, il y a d’une part une didactique et d’autre part une conversion, mais elles ne le sont pas en tant que telles, leur thématisation est cachée. Par contre, cette présentation platonicienne a été à l’origine d’un oxymore qui a eu une fortune extraordinaire, la didactique de la conversion, et d’une interrogation passionnée sur sa possibilité (notamment dans le cadre religieux). Le ralliement (à la foi) doit passer par un élément analytique, par un catéchisme, mais peut-il être efficient sans un élément de conversion existentielle ? A l’inverse, mettre l’accent sur la conversion existentielle sans la nécessité de passer par les défilés du catéchisme est-il bien raisonnable[10] ?
Retenons l’existence d’une tension entre une transmission à polarité mathématique et une transmission à polarité poétique … transmission de quoi ? De ceci qu’il y a eu expérimentation de l’impossible, expérimentation que quelque chose s’est ouvert. La didactique mathématique est précieuse pour la première rupture (à propos de laquelle les poètes ne sont pas très bons). Par contre pour la deuxième rupture, il faut une apologie existentielle du dehors, une histoire épique ou héroïque des tentatives antérieures, car il faut se convaincre de possibilités tenues pour impossibles. C’est là que l’élément poétique est irremplaçable.
République, 518b sq
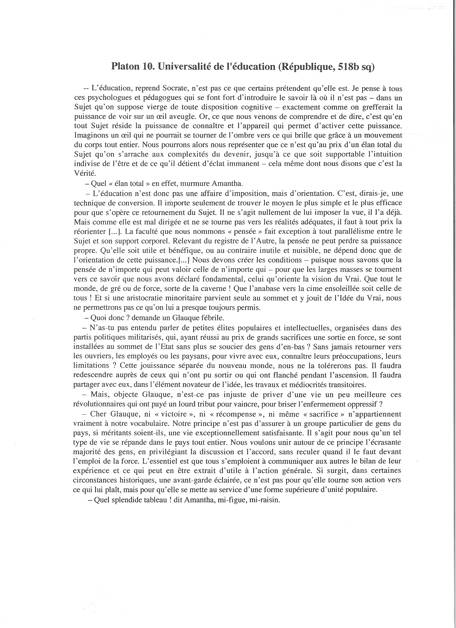
Commentaires
Retenons du premier paragraphe que tout Sujet peut connaître. L'éducation n'est pas en son essence une transmission. Il ne s'agit pas d'apprendre, ni même d'apprendre à apprendre, mais d'activer quelque chose qui est déjà là et qui est une « puissance de connaître ». Cette activation est une conversion du sujet tout entier (métaphorisée par l'œil « qui ne pourrait se tourner de l'ombre vers ce qui brille que grâce à un mouvement du corps tout entier »). La question de la connaissance n'est en réalité pas tant de l'acquérir que de la supporter – de supporter, au sortir de la Caverne, « l'intuition indivise de l'être et de ce qu'il détient d'éclat immanent ». C'est une question d'être et non une question d'avoir. D'ailleurs, la grande passion humaine n'est pas de vouloir connaître, mais de vouloir ignorer. Le paradoxe en la matière c'est de proposer à quelqu'un quelque chose dont on sait que c'est en partie insupportable.
Dans le deuxième paragraphe, il est précisé que l'éducation est une affaire d'orientation : « il importe seulement de trouver le moyen le plus simple et le plus efficace pour que s'opère (le) retournement du Sujet ». Il s'agit de réorienter une faculté que le Sujet a déjà (la doctrine de la réminiscence telle qu'elle est exposée dans l'épisode de l'esclave du Ménon est ici fondamentale). On voit à cette occasion la proximité de Platon avec le Jacotot du Maître ignorant qui n'est donc pas si anti-platonicien que le dit Jacques Rancière. La pensée relève du registre de l'Autre (je rappelle que je traduis systématiquement par « l'Autre » toutes les occurrences du mot theos chez Platon) : elle n'est pas une faculté de l'individu (elle « fait exception à tout parallélisme entre le Sujet et son support corporel »), c'est plutôt l'individu qui est un site possible pour la pensée. La pensée est un acte, quelque chose qui arrive, dont, en droit, on ne peut pas dire qu'elle est de quelqu'un, mais plutôt qu'elle est en quelqu'un. C'est aussi pourquoi, intrinsèquement, elle est de tous : la pensée est omniprésente et errante, sa distribution sur tel ou tel individu est contingente. C'est à tous que la sortie est destinée. « Sortez tous ! » tel est l'énoncé métapolitique fondamental. Que va-t-il se passer alors « si une aristocratie minoritaire parvient seule au sommet et y jouit de l'Idée du Vrai » ?
Platon est formel : ces aristocrates minoritaires doivent redescendre. Il ne précise pas quelle éducation ils auraient reçue qui leur aurait donné ce goût pour la redescente. Ce qui est sûr c'est qu'ils doivent assumer leur responsabilité universelle, sans égard pour la « victoire » ou la « récompense » de quelque « groupe particulier de gens ». C'est la notion même de « victoire » qu'il faut d'ailleurs changer : la victoire est nécessairement une victoire universelle, elle ne saurait être celle d'une « avant-garde éclairée ». L'éducation de celle-ci devrait tenir en trois points : a) il faut être sorti; b) il faut être redescendu et avoir tout mis en partage; c) il faut obtenir de nouvelles sorties. Sur ce dernier point, il faut travailler à opérer des ruptures du premier type, mais aussi des ruptures du deuxième type, car le destin qui menace le révolutionnaire c'est de devenir une nouvelle aristocratie de gauche.
Dans cette éducation, il ne devrait pas être possible de séparer nettement mathématique et poésie; il faut trouver le principe d'une éducation mixte réalisant l'oxymore de la double exposition. Il faut chercher à stimuler dans le Sujet la conviction qu'il ne doit pas y avoir de disjonction entre conversion existentielle et savoir déployé. Or, une telle discipline existe qui navigue précisément entre mathématique et poésie. Cette discipline c'est la philosophie.
10 juin 2009
[Dernier séminaire de l’année. A la rentrée, commencera le troisième et dernier volet consacré à Platon, toujours sous le même intitulé : « Pour aujourd’hui, Platon ! »]
Nous allons retraverser ce soir, en six points, ce qui a été dit la dernière fois à propos de l’éducation.
1) Qu’est-ce que être éduqué ?
Nous avons dit que tout Sujet peut connaître. L’éducation n’est pas un mouvement d’expression de soi et encore moins un remplissage par des connaissances transmises. Être éduqué veut dire : reconnaître qu’on a puissance de connaître. Rabelais, on nous l’a appris à l’école, disait qu’il faut une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. Ce n’est pas exactement la même idée que celle que défend Platon : pour celui-ci, la tête est déjà bien faite, dès le départ. Ce qu’il combat dans la conception ordinaire de l’éducation, c’est tout ce qui vise à empêcher chacun d’avoir ce sentiment de disposer d’une tête bien faite. C’est contre l’impuissance – l’impuissance imaginaire, le fait de s’imaginer impuissant – que Platon mène une lutte acharnée. Il y a une fonction égalitaire de l’éducation puisque celle-ci suppose que la puissance de connaître est déjà là, chez chacun. Il n’y a pas d’inégalité de nature. Ce qu’il y a, par contre, ce sont des obstacles à l’éducation sous la forme de jugements portés sur certains individus censés dépourvus de la puissance de connaître, jugements qui sont intériorisés par les intéressés de façon imaginaire. L’éducation doit dissoudre ces obstacles, et non les entériner comme cela se passe si souvent.
2) L’éducation n’est pas un dressage
Le dressage est l’acquisition de réflexes au moyen de l’alternance de récompenses et de punitions. Dans l’éducation, ce qui est en jeu ce n’est pas de façon essentielle une acquisition, en l’occurrence de connaissances : ce dont il s’agit c’est d’être capable de supporter les connaissances plutôt que de les acquérir. C’est avant tout une question de courage : courage de supporter des vérités qui sont hétérogènes aux opinions, ce qui suppose d’obtenir, nous l’avons vu, une conversion du sujet, la conversion qui permet le courage de connaître. Pascal, on le sait, nommait divertissement l’ensemble des puissances imaginaires qui détournent de la puissance de connaître et de l’obligation qui en résulte à supporter le vrai. Car il n’y a pas seulement le fait que la vérité est dissimulée (elle est dissimulée de diverses façons par la propagande adverse) ; il y a surtout le fait que le sujet ne tient pas du tout à y aller voir. L’éducation consiste donc à lutter contre le divertissement au sens pascalien (ou encore, comme on disait à l’époque révolutionnaire, à oser aller à contre-courant). A quoi l’on vous répondra, en jouant des deux sens du mot divertissement, qu’en ce cas l’éducation ce n’est vraiment pas drôle. C’est que, dans l’éducation, il y a aussi l’introduction obligée de la difficulté : tout ne peut pas être facile tout le temps.
3) Je ne ferai que rappeler que l'éducation est une affaire
d'orientation (il s'agit de réorienter une faculté que le Sujet a déjà) et non
une transmission.
4) Et que la pensée dont tout individu est capable relève du
registre de l'Autre : elle n'exprime pas une faculté de l'individu, c'est
plutôt l'individu qui est un site possible pour la pensée. C'est alors qu'il
expérimente l'abolition de sa propre limitation individuelle. Qu'il soit
intensément absorbé dans la contemplation d'une œuvre d'art, dans la résolution
d'une démonstration mathématique, dans la participation à une manifestation
politique, ou qu'il soit pris dans une extase amoureuse, l'individu ressent les
limites de son individualité qui, simultanément, sont indiscernables de
l'universalité de la pensée. A de tels moments, l'individualité fonctionne
comme le support de ce qui l'excède (et qui relève de l'Autre) et non comme
limitation. Dans mon lexique, ce dont il s'agit là c'est que le corps individuel est incorporé à quelque chose de plus vaste que lui. Spinoza, lui,
parle de béatitude intellectuelle.
En définitive, le but de l'éducation est de rendre possible de tels moments,
qui sont, disons-le, des moments de bonheur (ou de joie) au cours desquels, comme le dit également Spinoza,
« nous expérimentons que nous sommes éternels ». Moments en droit
ouverts à tous.
5) A l'inverse, ce qui n'est pas universel, soit
l'absolument particulier, est toujours le résultat d'un dressage. Le dressage
est toujours un dressage à la différence tandis que le vrai est le même pour
tous (c'est en quoi consiste précisément son universalité). Or, toute
institution éducative concrète est en général un mélange impur d'éducation au
sens où nous l'avons vu (avec ce que cela comporte de difficultés et de nécessaire
patience) et de dressage. Il s'agit, dans les faits, de contenir le dressage,
de le repousser dans les marges, de faire en sorte qu'il soit dans le processus
de son dépérissement, mais non pas de vouloir l'éliminer. Je serais vraiment
surpris que parmi ceux qui sont présents ici ce soir et qui ont eu à éduquer
des enfants, il y en ait qui puissent déclarer qu'ils ont été totalement
indemnes de toute manœuvre de dressage. La solution adoptée par Platon sur ce
point est, il faut bien le reconnaître, particulièrement détestable.
L'éducation ne concerne chez lui que la classe des gardiens, dont il fait une
aristocratie ou une avant-garde éclairée, et il réserve le dressage pour les
autres membres de la société. On a d'un côté une éducation pure sans dressage
et de l'autre un dressage tout simplement bestial. Le présupposé, concernant
les gardiens, est qu’il y ait des subjectivités qui puissent résulter d'une
éducation pure : ce que Platon exprime là c'est en réalité son préjugé
aristocratique, qui s'avère incapable de reconnaître l'irréductible mixture de
dressage et d'éducation qui compose tout projet pédagogique. Car l'universalité
qu'il a en vue est portée par la particularité nécessairement incarnée dans des
individus limités. Tout ce qu'il dit sur l'éducation des gardiens est excellent,
mais avec la réserve majeure que cela doit concerner tout un chacun et non pas
une élite sélectionnée. C'est du moins ainsi que je le conçois, s'il s'agit
bien de mettre Platon à contribution en vue, pour paraphraser Pascal, de
« préparer au communisme ».
Je rappelle que le mouvement d'ensemble de La République est, pour élucider une interrogation sur la justice à
l'échelle de l'homme, de faire un détour « macroscopique » par des
considérations sur la justice à l'échelle de la société et ce afin de revenir
au problème initial. Nous avons commenté le recours par Socrate à la notion
d'isomorphie entre les deux ordres de questions (cf. Rep 368d – extrait 8 : deux réalités peuvent-elles
relever de la même Idée ?) avec la métaphore du même texte écrit en petites et en grandes lettres. Socrate
lui-même reconnaissait qu'il y avait là un trompe-l'œil car pour déterminer « que le texte écrit en grosses lettres est le
même que celui écrit en petites lettres, c'est qu'il a pu les lire, les petites
lettres. Comment démontrer l'isomorphie de deux réalités, si on ne comprend
rien à la structure de l'une d'entre elles ? ». L'acharnement de Platon à
la pureté, à la séparation, et, in fine, à
la séparation de l'âme et du corps (le thème du corps comme tombeau de l'âme)
est en réalité du même tonneau. Ce thème platonicien de l'âme (enfin) débarrassée
du corps (cf. Phédon) a une
tonalité mélancolique indéniable; la séparation ainsi conçue, ce n'est en fin
de compte rien d'autre que la mort[11].
6) Je ne ferai
que rappeler que, dans l'allégorie de la Caverne, tout usage aristocratique de
l'éducation est une corruption de celle-ci : les échappés de la salle de cinéma
doivent redescendre auprès de leurs compagnons, c'est un impératif. C'est la
conception aristocratique de Platon elle-même qui est ici battue en brèche ;
c'est absolument présent dans le texte même si Platon lui-même n'arrive pas à
le dire.
*
Je voudrais revenir sur le thème de la double rupture. Ce
que j'ai appelé « première rupture » s'effectue par rapport au
prestige immédiat des hiérarchies imaginaires et nous avions dit que la mathématique
était ici d'une aide inappréciable en enseignant qu'il n'y a que des
multiplicités indifférentes (ce que j'ai aussi nommé : la soustraction
ontologique). Cette première rupture, systémique, est une rupture critique qui
identifie le champ ontologique comme tel (le régime dominant des opinions et
des apparences). La deuxième rupture concerne quant à elle un acte, l'acte de
sortir pour rencontrer un peu de réel, un acte qui requiert une certaine dose
de violence (avant tout sur soi-même) et qui est de nature événementielle.
Parce qu'il devrait être possible, d'ores et déjà et ici même, que la vanité
des représentations soit elle-même représentée, le paradigme langagier emprunté
est poétique et non plus mathématique, car ce dont il s'agit c'est que quelque
chose commence. La langue de l'événement
c'est la poésie. La poésie est l'intensification de la langue adéquate à
la nomination de l'impossible.
J'avais déjà abordé, dans mon Court traité d'ontologie transitoire, cette question du double registre d'énonciation de
la façon suivante : S'ouvre la vaste question de ce qui se soustrait
à la détermination ontologique. La question de ce qui n'est pas l'être en tant
qu'être. Car la loi soustractive est implacable : si l'ontologie réelle se
dispose comme mathématique en éludant la norme de l'un, il faut aussi, sauf à
rétablir globalement cette norme, qu'il y ait un point où le champ ontologique,
donc mathématique, se détotalise, ou reste en impasse. Ce point, je l'ai nommé l'événement. On peut donc tout aussi bien
dire qu'outre l'identification, sans cesse à reprendre, de l'ontologie réelle,
la philosophie est aussi, et sans doute surtout, théorie générale de
l'événement. C'est-à-dire théorie de ce qui se soustrait à la soustraction
ontologique. Ou théorie de l'impossible propre des mathématiques. On dira aussi
que pour autant que la mathématique s'assure en pensée de l'être comme tel, la
théorie de l'événement vise la détermination d'un trans-être (Court traité d'ontologie transitoire p. 56-57).
C'est parce que Platon manque (ou masque) ce point, que là où l'ontologie
défaille, là où elle « reste en impasse », il se met à poétiser, à
raconter une histoire (en l'occurrence, l'allégorie de la Caverne).
Le protocole de la double rupture ne concerne pas seulement
la politique mais le rapport de l'individu aux processus de vérité en général.
Il suppose une éducation achevée, soit la fonction critique de l'éducation
complétée par sa dimension de conversion (qui est critique de la précédente).
Cette disposition complète, il est juste de la nommer par le terme d'Idée. L'idée, ce n'est pas la vérité elle-même, mais ce
qui constitue pour l'individu la disponibilité à telle ou telle vérité, ce qui
permet à cet individu de se représenter son incorporation à une vérité. Mais il
faut compter avec la gauche, et la gauche est partout. L'amour, qui traite de
l'altérité constitutive comme telle, du caractère toujours-au-régime-de-l'autre
de l'expérience, a son Etat qui est la famille et sa gauche (ou son Idée
réactive) qui soutient qu'une socialisation familiale peut venir au point
fondamentalement asocial où se situe l'amour (ou encore : qu'il existe une
destination sociale de l'amour). Cette Idée de gauche pour l'amour, je la
nommerai volontiers : le conjugalisme. De même l'Etat de l'art est
l'académisme, soit la préférence donnée à la continuation sur l'Idée d'un
déplacement des formes et la gauche va défendre l'Idée d'une normativité
possible de l'articulation entre forme et [ce qui n'est encore que] non-forme.
Enfin, la gauche en science ce serait son usage technique, i.e. le technicisme.
L'Idée réactive aurait ainsi un quadruple visage : le
conjugalisme, l'académisme, le technicisme et la gauche.
Additif