S’orienter dans la pensée, s’orienter dans l’existence
Séminaire public d’Alain Badiou
II.
2005-2006
(notes
de Daniel Fischer)
19 OCTOBRE 2005................................................................................................................................................ 1
Qu'est-ce que vivre?......................................................................................................................................... 1
30 NOVEMBRE 2005............................................................................................................................................. 3
14 DECEMBRE 2005.............................................................................................................................................. 3
11 JANVIER 2006................................................................................................................................................... 4
15 MARS 2006........................................................................................................................................................ 5
26 AVRIL 2006....................................................................................................................................................... 6
31 MAI 2006............................................................................................................................................................ 6
Un poème de Wallace Stevens,
sur le devenir-vrai (ou lumière)................................................................. 7
Soliloque dernier de
l'amant intérieur (1954).......................................................................... 7
14 JUIN 2006.......................................................................................................................................................... 7
Soliloque dernier de
l'amant intérieur (1954)................................................................................................ 8
19 OCTOBRE 2005
Pour caractériser l’état des choses actuel, j’ai antérieurement avancé
le terme de « matérialisme démocratique » (cf. octobre 2003) dont la
thèse fondamentale, je le rappelle, est la suivante : il n’y a que des
corps et des langages. Autrement dit,
ce qu’il y a ce sont des corps plus ou moins affectés par des langages.
Nous avions conclu, l’année dernière, à la péremption de la figure
dialectique comme figure d’identification de l’adversité [c’est une figure où l’émancipation
présuppose l’oppression, et se gagne sous la forme de la négation de la négation;
c’est de l’autre que vous vient votre identité, l’identité et l’adversité
appartiennent au même devenir, qui est le devenir de la contradiction]. Si l’on
veut que le protocole d’identification contemporain de l’adversaire soit autre
chose que cela, qui est saturé, il faut construire une scène idéologique
nouvelle, en incise à la domination du matérialisme démocratique.
Dans ce but, nous consacrerons cette année à la construction d’un appareillage
de pensée – que je propose d’appeler « dialectique matérialiste » -
dont l’énoncé constituant est : il n’y a que des corps et des langages,
sinon qu’il y a des vérités.
Deux temps, donc : 1. une logique du il y a ; 2. une logique de l’exception (sinon que).
La pente majeure du matérialisme démocratique est précisément la thèse
selon laquelle il n’y a pas d’exception. Il n’y a qu’un marché, qu’une économie, qu’une politique etc. et en définitive
il n’y a qu’un seul ordre des choses. « C’est comme ça », est-il
ajouté. Avec cette présomption de l’Un, le matérialisme démocratique est d’ailleurs
conséquent avec lui-même : l’exception, i.e. ce qui n’est pas comme le
reste, ce n’est effectivement pas intrinsèquement démocratique … La force (ou l’astuce)
du matérialisme démocratique est que l’instance de l’Un y est camouflée par la
multiplicité pure : le multiple sans rivages des corps et des langages
(puisqu’il n’y a que cela), la multiplicité équivalente des cultures, des
postures sexuelles, la reconnaissance de « l’autre », tous ces thèmes
et leur acceptation normative sont l’horizon naturel du matérialisme démocratique.
La brèche introduite dans le il y a par le sinon que, la brèche de l’exception, je l’appelle : « vérité ».
Il faut bien comprendre la logique de la brèche : la première partie de l’énoncé
il n’y a que des corps et des langages, sinon qu’il y a des vérités est en partage avec la logique du matérialisme démocratique
(puisqu’il s’agit de deux logiques matérialistes); le travail (c’est un travail logique) consiste à
greffer de façon immanente sur la logique du il y a une logique de l’exception.
Nous soutenons que le matérialisme démocratique est une idéologie. Si
tel est bien le cas, il est de l’ordre du semblant, de l’imaginaire, de l’illusion
etc. La difficulté est qu’il s’agit d’un semblant tel qu’il est argumenté du
réel. C’est une situation
relativement inédite. Lorsque l’idéologie était informée par la religion, les
choses étaient plus claires, l’argument idéologique était nettement tiré d’une
extériorité au réel (transcendance). Le matérialisme démocratique dit
exactement l’inverse, à savoir que c’est tout ce qui n’est pas lui qui argue d’une
extériorité au réel ; il met au défi tout adversaire potentiel d’admettre le il
y a. C’est l’idéologie qui se présente dorénavant comme le contraire de l’imaginaire
! Quitte à retrouver quand même la figure imaginaire de l’Un et du Tout, par le
biais de ce qui est en fin de compte le noyau de la logique du il y a, à savoir
la forclusion de l’exception …
C’est un semblant de réel que nous présente le matérialisme démocratique.
La question - difficile – est de penser le réel de ce semblant de réel :
car que le réel du matérialisme démocratique soit du semblant (en d’autres termes :
que l’on se fasse avoir), cela est certain; par contre, savoir précisément où
est situé le point d’imposture qui consiste à forclore l’exception, cela est moins clair. Question difficile, car nous
voulons éviter une réponse à la Baudrillard, comme quoi en dernière instance
tout ça, soit le réel du matérialisme démocratique, relève du simulacre, du
virtuel etc. Comment une thèse matérialiste sur le il y a, thèse que nous
sommes contraints de partager, nous l’avons dit (car il est vrai que ce qu’il y
a ce sont des corps et des langages), comment une thèse qui est même raisonnablement
démocratique, est-elle susceptible de fonctionner comme une imposture radicale
?
Il nous faut construire une théorie du réel du semblant, une théorie du
réel de l’apparaître (et non de l’apparaître de l’apparaître cf. Baudrillard),
i.e. que nous avons besoin d’une nouvelle grande Logique qui soit en capacité de relayer la logique
dialectique. Une condition essentielle pour cette théorie est que l’exception n’y
soit pas en exception ontologique par rapport au régime du il y a :
puisque nous admettons qu’il n’y a que des corps et des langages, les vérités
(l’exception) doivent avoir un corps. C’est une figure de torsion. La scène des
vérités n’est pas une autre scène, elle n’est pas en exception par rapport au régime
du il y a lui-même, elle est une exception immanente. Il nous faudra donc aborder la question décisive du corps
des vérités.
*
Tout ceci sera développé dans le livre que je viens de terminer et qui
paraîtra au printemps 2006, livre intitulé Logiques des mondes.
En voici, in extenso et en primeur, la conclusion, dont le titre est :
Qu’est-ce que vivre ?
Qu'est-ce que
vivre?
O.
Nous voici à même de proposer une réponse à ce qui, depuis toujours, est la
question « intimidante » - comme le dit un personnage de Julien Gracq - à
laquelle, si grand soit son détour, la philosophie est à la fin sommée de répondre:
Qu'est-ce que vivre? « Vivre », évidemment, non pas au sens du matérialisme démocratique
(persévérer dans les libres virtualités du corps), mais bien plutôt au sens de
la formule énigmatique d'Aristote: vivre« en Immortel ».
Nous
pouvons tout d'abord reformuler le système exigeant des conditions d'une réponse
affirmative du type: « Oui! La vraie vie est présente. »
1.
Ce n'est pas un monde, donné dans la logique de son apparaître - l'infini de
ses objets et de ses relations - qui induit la possibilité de vivre. Si du
moins la vie est autre chose que l'existence. L'induction d'une telle
possibilité repose sur ce qui, dans un monde, fait trace de ce qui lui est
advenu sous les espèces d'une disposition foudroyante. Soit la trace d'un événement
évanoui. Une telle trace est toujours, dans l'apparaître mondain, une existence
d'intensité maximale. Par incorporation du passé du monde au présent qu'ouvre
la trace on apprendra qu'antérieurement à ce qui advint et n'est plus, le
support d'être de cette existence intense était un inexistant du monde. Fait
trace dans le monde, et signe pour la vie, la naissance d'un multiple à l'éclat
de l'apparaître, auquel il n'appartenait que sous une forme éteinte.
La
première directive philosophique à qui demande où est la vraie vie est donc la
suivante: « Prends soin de ce qui naît. Interroge les éclats, sonde leur passé
sans gloire. Tu ne peux espérer qu'en ce qui inapparaissait. »
2.
Il ne suffit pas d'identifier une trace. Il faut s'incorporer à ce qu'elle
autorise comme conséquences. Ce point est crucial. La vie est création d'un présent,
mais cette création est, comme l'est pour Descartes le monde au regard de Dieu,
création continuée. Autour de la trace, autour de l'éclat anonyme d'une
naissance au monde de l'être-là, se constitue la cohésion d'un corps antérieurement
impossible. Accepter ce corps, déclarer ce corps, n'est pas suffisant pour être
le contemporain du présent dont il est le support matériel. Il faut entrer dans
sa composition, il faut devenir un élément actif de ce corps. Le seul rapport réel
au présent est celui d'une incorporation. Incorporation à cette cohésion immanente
au monde que délivre, nouvelle naissance au-delà de tous les faits et balises
du temps, le devenir-existant de la trace événementielle.
3. Le déploiement des conséquences liées à la trace événementielle,
conséquences qui créent un présent, se fait par le traitement de points du
monde. Il se fait, non par le trajet continu de l'efficace d'un corps, mais par
séquences, point par point. Tout présent est fibré. Les points du monde où
l'infini comparaît devant le Deux du choix sont en effet comme les fibres du présent,
sa constitution intime dans son devenir mondain. Il est donc requis, pour que
s'ouvre un présent vivant, que le monde ne soit pas atone, qu'il y ait des
points où s'assure, fibrant le temps créateur, l'efficace du corps.
4.
La vie est une catégorie subjective. Un corps est la matérialité qu'elle exige,
mais de la disposition de ce corps dans un formalisme subjectif dépend le
devenir du présent; qu'il soit produit (le formalisme est fidèle, le corps est
directement situé « sous » la trace événementielle), qu'il soit raturé (le
formalisme est réactif, le corps est tenu à une double distance de la négation
de la trace), ou qu'il soit occulté (le corps est nié). Ni la rature réactive
du présent, qui nie la valeur de l'événement, ni, a fortiori, son
occultation mortifère, qui suppose un « corps » transcendant au monde, n'autorisent
l'affirmation de la vie, qui est incorporation, point par point, au présent.
Vivre
est donc une incorporation au présent sous la forme fidèle d'un sujet. Si
l'incorporation est dominée par la forme réactive, on ne parlera pas de vie,
mais de simple conservation. Il s'agit en effet de se protéger des conséquences
d'une naissance, de ne pas relancer l'existence au-delà d'elle-même. Si l'incorporation est dominée par le formalisme
obscur, on parlera de mortification.
La
vie est en définitive le pari fait sur un corps advenu à l'apparaître qu'on lui
confiera fidèlement une temporalité neuve, tenant à distance la pulsion
conservatrice (l'instinct mal nommé « de vie ») comme la pulsion mortifiante (l'instinct
de mort). La vie est ce qui vient à bout des pulsions.
5.
Parce qu'elle vient à bout des pulsions, la vie s'ordonne à la création séquentielle
d'un présent, laquelle constitue et absorbe un passé de type nouveau.
Pour le matérialisme démocratique, le présent n'est jamais créé. Il affirme
en effet de façon tout à fait explicite qu'il importe de tenir le présent dans
la limite d'une réalité atone. C'est que pour lui, toute autre vision plie les
corps au despotisme d'une idéologie, au lieu de les laisser libre de gambader
dans la diversité des langages. Le matérialisme démocratique propose de nommer « pensée
» la pure algèbre de l'apparaître. Il résulte de cette conception atone du présent
une fétichisation du passé comme « culture » séparable. Le matérialisme démocratique
a la passion de 1'histoire, il est, véritablement, le seul authentique matérialisme
historique.
Contrairement à ce qui se passe dans la version
stalinienne du marxisme, version dont Althusser a hérité, tout en la
contrariant de l'intérieur, il est capital de disjoindre la dialectique matérialiste,
philosophie de l'émancipation par les vérités, du matérialisme historique,
philosophie de l'aliénation par les corps-langages. Rompre avec le culte des généalogies
et des récits revient à restituer le passé comme amplitude du présent.
Je l'écrivais déjà il y a plus de vingt ans, dans ma Théorie du sujet :
l'Histoire n'existe pas. Il n'y a que des présents
disparates dont l'éclat se mesure à la puissance qu'ils détiennent de déplier
un passé qui soit à leur mesure.
Dans le matérialisme démocratique, la vie des corps-langages est la
succession conservatrice des instants du monde atone. Il en résulte que le passé
est chargé de doter ces instants d'un horizon fictif - d'une épaisseur
culturelle. C'est du reste pourquoi le fétichisme de l'histoire s'accompagne
d'un discours insistant sur la nouveauté, sur le changement perpétuel, sur la
modernisation impérative. Au passé des profondeurs culturelles s'accorde un présent
dispersif, une agitation précisément dépourvue, elle, de toute profondeur. Il y
a des monuments qu'on visite et des instants dévastés qu'on habite. Tout change
à tout instant, et c'est la raison pour laquelle on contemple 1'horizon historique
majestueux de ce qui ne changeait pas.
Pour
la dialectique matérialiste, c'est presque l'inverse. L'immobilité stagnante du
présent, sa stérile agitation, l'atonie violemment imposée du monde, est ce qui
frappe d'abord. Peu, très peu de changements capitaux dans la nature des problèmes
de la pensée, depuis Platon (par exemple). Mais à partir des quelques procédures
de vérité que déplient, point par point, des corps subjectivables, on
reconstitue un passé différent, une histoire des achèvements, des trouvailles,
des percées, qui n'est nullement une monumentalité culturelle, mais une
succession lisible de fragments d'éternité. Car un sujet fidèle crée le présent
comme être-là de l'éternité. En sorte que s'incorporer à ce présent revient à
percevoir le passé de l'éternité elle-même.
Vivre,
c'est donc aussi, toujours, expérimenter au passé l'amplitude éternelle d'un présent.
Nous accordons à Spinoza la célèbre formule du scolie de la proposition XXIII
du livre V de l'Ethique: « Nous sentons et nous expérimentons
que nous sommes éternels. »
6. Il importe toutefois de nommer cette expérimentation.
Elle n'est pas de l'ordre du vécu, ni de celui de l'expression. Elle n'est pas
l'accord enfin trouvé des capacités d'un corps et des ressources d'un langage.
Elle est incorporation à l'exception d'une vérité. Si l'on convient d'appeler «
Idée » ce qui à la fois se manifeste dans le monde - dispose l'être-là d'un
corps - et fait exception à sa logique transcendantale, on dira, dans le droit
fil du platonisme, qu'expérimenter au présent l'éternité qui autorise la création
de ce présent, c'est expérimenter une Idée. Il faut donc assumer ceci: pour la
dialectique matérialiste, « vivre », et « vivre pour une Idée» sont une
seule et même chose.
Le matérialisme démocratique ne voit, dans ce qu'il nommerait plutôt une conception
idéologique de la Vie, que fanatisme et instinct de mort. Et il est vrai que
s'il n'y a que des corps et des langages, vivre pour une Idée est nécessairement
l'absolutisation arbitraire d'un langage, auquel les corps doivent être ordonnés.
La reconnaissance matérielle du « sinon que » des vérités autorise seule qu'on
déclare, non pas du tout que les corps sont soumis à l'autorité d'un langage,
mais qu'un nouveau corps est l'organisation au présent d'une vie subjective
sans précédent; et je soutiens que l'expérimentation réelle d'une telle vie,
intelligence d'un théorème ou force d'une rencontre, contemplation d'un dessin
ou élan d'un meeting, est irrésistiblement universelle. En sorte que l'avènement
de l'Idée est, pour la forme d'incorporation qui lui correspond, tout le
contraire d'une soumission. Elle est, selon le type de vérité dont il s'agit,
joie, bonheur, plaisir ou enthousiasme.
7.
Le matérialisme démocratique présente comme une donnée objective, un résultat
de l'expérience historique, ce qu'il appelle « la fin des idéologies », mais il
s'agit en réalité d'une injonction subjective violente, dont le contenu réel
est: « Vis sans Idée. » Or, cette injonction est inconsistante.
Qu'elle
accule la pensée au relativisme sceptique est une évidence désormais assurée.
La tolérance, le respect de l'Autre sont, nous dit-on, à ce prix. Mais on voit
tous les jours que cette tolérance n'est elle-même qu'un fanatisme, car elle ne
tolère que sa propre vacuité. Le scepticisme véritable, celui des Grecs, était
en réalité une théorie absolue de l'exception: il plaçait les vérités si haut,
qu'il les jugeait inaccessibles au faible intellect de l'espèce humaine. Il
s'accordait ainsi au courant principal de la philosophie antique, lequel pose
qu'accéder au Vrai est le propre de la part immortelle des hommes, de ce qu'il
y a en l'homme d'inhumain par excès. Le scepticisme contemporain, celui des
cultures, de l'histoire, de l'expression de soi, n'a pas cette hauteur. Il est
simple accommodement à la rhétorique des instants et à la politique des
opinions. Aussi dissout-il d'abord l'inhumain dans l'humain, puis l'humain dans
la vie ordinaire, puis la vie ordinaire (ou animale) dans l'atonie du monde. Et
c'est de cette dissolution que résulte la maxime négative « Vis sans Idée »,
inconsistante de ce qu'elle n'a plus aucune idée de ce que peut être une Idée.
C'est
la raison pour laquelle le matérialisme démocratique se propose en fait de détruire
ce qui lui est extérieur. Comme nous l'avons remarqué, c'est une idéologie violente
et guerrière. Cette violence résulte, comme tout symptôme mortifère, d'une
inconsistance essentielle. Le matérialisme démocratique se veut humaniste
(droits de l'homme, etc.). Mais il est impossible de disposer d'un concept de
ce qui est « humain » sans en venir à cette inhumanité (éternelle, idéelle) qui
autorise l'homme à s'incorporer au présent sous le signe de la trace de ce qui
change. Faute de reconnaître les effets de ces traces, où l'inhumain ordonne
que l'humanité soit en excès sur son être-là, il faudra, ces traces et leurs
conséquences infinies, pour maintenir une notion pragmatique purement animale
de l'espèce humaine, les anéantir.
Le
matérialisme démocratique est un ennemi redoutable et intolérant de toute vie
humaine - c'est-à-dire inhumaine - digne de ce nom.
8.
L'objection banale est que si vivre dépend de l'événement, la vie n'est promise
qu'à ceux qui ont la chance de l'accueillir. Le démocrate voit dans cette «chance»
le stigmate d'un aristocratisme, ou d'un arbitraire transcendant: celui que
depuis toujours on lie aux doctrines de la Grâce. Et il est vrai que j'ai
plusieurs fois utilisé la métaphore de la grâce, pour indiquer que vivre, ce
qui s'appelle vivre, suppose toujours qu'on accepte d'œuvrer aux conséquences,
généralement inouïes, de ce qui advient.
Réparer
l'injustice apparente de ce don, de ce supplément incalculable d'où procède la
relève d'un inexistant, c'est à quoi s'emploient de longue date les tenants,
non point de Dieu, mais du divin. Le plus récent, le plus talentueux et le plus
ignoré d'entre eux, Quentin Meillassoux, élabore pour ce faire une théorie entièrement
neuve du « pas encore» de l'existence divine, accompagnée d'une promesse
rationnelle concernant la résurrection des corps. Tant il est vrai que c'est
bien des nouveaux corps et de leur naissance qu'il est inévitablement question
dans cette affaire.
9.
Je crois aux vérités éternelles et à leur création fragmentée dans le présent
des mondes. Ma position sur ce point est tout à fait isomorphe à celle de Descartes:
les vérités sont éternelles parce qu'elles ont été créées, nullement parce qu'elles
sont là depuis toujours. Pour Descartes, les « vérités éternelles », dont nous
avons rappelé, dans la préface, qu'il les posait en exception des corps et des
idées, ne sauraient être transcendantes au vouloir divin. Même les plus
formelles, mathématiques ou logiques, comme le principe de non-contradiction, dépendent
d'un acte libre de Dieu. :
Dieu
ne peut avoir été déterminé à faire qu'il fût vrai que les contradictoires ne
peuvent être ensemble et par conséquent il a pu faire le contraire.
Bien
entendu, le procès de création d'une vérité, tel que s'en constitue le présent
par les conséquences d'un corps subjectivé, est très différent de l'acte créateur
d'un Dieu. Mais en son fond, l'idée est la même. Qu'il soit de l'essence d'une
vérité d'être éternelle ne la dispense nullement d'apparaître dans un monde et
d'être inexistante antérieurement à cette apparition. Descartes a sur ce point
une formule très remarquable:
Encore
que Dieu ait voulu que quelques vérités fussent nécessaires, ce n'est pas à
dire qu'il les ait nécessairement voulues.
L'éternelle
nécessité concerne une vérité en elle-même, l'infinité des nombres premiers, la
beauté picturale des chevaux de la grotte Chauvet, les principes de la guerre populaire
ou l'affirmation amoureuse d'Héloïse et Abélard. Mais non point son processus
de création, suspendu qu'il est à la contingence des mondes, à l'aléatoire d'un
site, à l'efficace des organes d'un corps, à la constance d'un sujet.
Descartes
s'indigne qu'on puisse supposer les vérités séparées des autres créatures et
devenues en quelque sorte le destin de Dieu:
Les
vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éternelles, ont été établies de
Dieu et en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des créatures.
C'est en effet parler de Dieu comme d'un Jupiter ou Saturne, et l'assujettir au
Styx et aux destinées, que de dire que ces vérités sont indépendantes de lui.
J'affirme
aussi que toutes les vérités sans exception sont « établies » d'un sujet, forme
d'un corps dont l'efficace crée point par point. Mais comme Descartes je pose
que leur création n'est que l'apparaître de leur éternité.
10.
Je m'indigne donc, comme Descartes, de ce qu'on fasse déchoir le Vrai au rang
du Styx et des destinées. A vrai dire, pour ce qui me concerne, je m'indigne
deux fois. Et la vie tient aussi son prix de cette double querelle. D'abord
contre ceux, culturalistes, relativistes, gens des corps immédiats et des
langues disponibles, pour qui l'historicité de toutes choses exclut qu'il y ait
des vérités éternelles. Ils ne voient pas qu'une création véritable, une
historicité d'exception, n'a d'autre critère que d'établir, entre les mondes
disparates, l'évidence d'une éternité. Et que ce qui apparaît n'est dans l'éclat
de son apparition qu'autant qu'il se soustrait aux lois locales de l'apparaître.
Une création est trans-logique, de ce que l'être y bouleverse l'apparaître.
Ensuite, contre ceux pour qui l'universalité du vrai prend la forme d'une Loi
transcendante, devant laquelle on doit plier le genou, à laquelle il faut
conformer nos corps et nos mots. Ils ne voient pas que toute éternité, toute
universalité, doit apparaître en un monde et y être, « patiemment ou impatiemment
», créée. Une création est logique, dès lors qu'une vérité est une apparition
d'être.
11.
Cependant, je n'ai pas besoin de Dieu, ni du divin. Je crois que c'est ici et
maintenant que nous nous suscitons, que nous nous (re)suscitons comme
Immortels.
L'homme
est cet animal dont le propre est de participer à de très nombreux mondes,
d'apparaître en d'innombrables lieux. Cette sorte d'ubiquité objectale, qui le
fait transiter presque constamment d'un monde à l'autre, sur le fond de
l'infinité de ces mondes et de leur organisation transcendantale, est par
elle-même, sans qu'il soit besoin d'aucun miracle, une grâce: la grâce purement
logique de l'innombrable apparaître. Tout animal humain peut se dire qu'il est
exclu que partout et toujours il ne rencontre qu'atonie, inefficience du corps
ou défaut d'organes aptes à en traiter des points. Incessamment, dans quelque
monde accessible, quelque chose advient. A tout animal humain est accordée,
plusieurs fois dans sa brève existence, la chance de s'incorporer au présent subjectif
d'une vérité. A tous, et pour plusieurs types de procédures, est distribuée la
grâce de vivre pour une Idée, donc, la grâce de vivre tout court.
L'infini
des mondes est ce qui sauve de toute dis-grâce finie. La finitude, le constant
ressassement de notre être mortel, pour tout dire, la peur de la mort comme
unique passion, tels sont les ingrédients amers du matérialisme démocratique.
On relève tout cela quand on s'approprie la variété discontinue des mondes et
l'entrelacs des objets sous les régimes constamment variables de leurs
apparitions.
12.
Nous sommes ouverts à l'infinité des mondes. Vivre est possible. Par conséquent,
(re)commencer à vivre est ce qui seul importe.
13.
On me dit quelquefois que je ne vois dans la philosophie qu'un moyen de rétablir,
contre l'apologie contemporaine de l'ordinaire et du futile, les droits de 1'héroïsme.
Pourquoi pas? Cependant, 1'héroïsme ancien prétend justifier la vie par le
sacrifice. Mon vœu est de le faire exister par la joie affirmative que procure
universellement le suivi des conséquences. Disons qu'à 1'héroïsme épique de qui
donne sa vie, succède 1'héroïsme mathématique de qui la crée point par point.
14.
A propos d'un de ses personnages Malraux note, dans la Condition humaine: «
Le sens héroïque lui avait été donné comme une discipline, non comme une
justification de la vie. » Je place en effet l'héroïsme du côté de la discipline,
seule arme et du Vrai et des peuples, contre la puissance et la richesse,
contre l'insignifiance et la dissipation de l'esprit. Encore faut-il, cette
discipline, l'inventer, cohérence d'un corps subjectivable. Alors, elle ne se
distingue plus de notre désir de vIvre.
15.
L'animal désabusé dont la marchandise est l'unique repère, nous ne serons
livrés à sa forme que si nous y consentons. Mais de ce consentement nous
protège l'Idée, arcane du présent pur.
*
Je
voudrais ponctuer aujourd’hui seulement deux points.
Vous lisez au point 4 :
La vie est ce qui vient à bout des pulsions. Je parle ici de la vie affirmative, la vie qui a constitué son adversaire en toute
clarté, celle qui n’est plus hantée par un adversaire obscur, insaisissable
(vous aurez remarqué qu’une difficulté majeure de la vie a pour origine le fait
d’être perpétuellement hanté par un adversaire dont on ignore la nature voire
même l’existence). Être dans la grammaire de l’exception (sinon que), qui est ce qui porte le venir à bout des pulsions,
telle est la condition pour une incorporation au présent.
Le
dernier point, qui est en somme mon dernier mot (point 15) : L'animal
désabusé dont la marchandise est l'unique repère, nous ne serons livrés à sa
forme que si nous y consentons. Mais de ce consentement nous protège l'Idée,
arcane du présent pur. Je voudrais commenter le terme
« consentement ». Celui-ci est essentiel au fonctionnement du
matérialisme démocratique pour la raison que nous avons vue précédemment :
le matérialisme démocratique ne fonctionne pas à l’illusion, à la tromperie.
Etant matérialistes, nous partageons avec lui l’énoncé de son il y a, nous acceptons
qu’il n’y a que des corps et des langages ; mais cela ne signifie pas que
nous consentons à ce que cela signifie la forclusion de l’exception. Ce
qui nous protège de ce consentement, c’est l’Idée – l’Idée qu’il y a des
vérités, l’Idée qu’il y a effectivement un nouveau présent attestable, le
présent des vérités.
Nous
commencerons la prochaine fois par l’examen des énoncés 5 et 6.
30 NOVEMBRE 2005
Quelques remarques
concernant les récentes « émeutes des jeunes de banlieue ».
1) Il faudrait d’abord
méditer sur le mot même de « banlieue » (ou de « cité »).
Il y a dans ce pays une tendance générale à l’apartheid vis-à-vis des gens des
classes populaires et particulièrement, en leur sein, vis-à-vis de ceux de filiation
étrangère. La « banlieue », contrairement aux anciens quartiers
ouvriers qui étaient internes à la
ville (voyez à ce sujet le beau livre de Eric Hazan : L’invention de
Paris), est perçue sous un régime
d’extériorité ou d’extra-territorialité. Alors qu’elle est une dimension à part
entière de la ville, elle est mise en scène comme un lointain. D’où l’idée (qui passe comme une lettre à la poste)
d’y envoyer des hommes en armes,
dont une déclaration gouvernementale récente a précisé qu’ils ont l’intention
d’y demeurer pour toujours – il
n’est pas exagéré de dire que la représentation de ces territoires est celle de
territoires occupés.
2) Nous voyons actuellement
se constituer sous nos yeux un phénomène relativement nouveau en France, un
racialisme anti-Africain noir, avec ses mots propres
(« subsaharien » !), ses identifiants (polygamie, mais peut-être
bientôt, qui sait, cannibalisme …) et ses très concrètes lois de persécution
(contre le regroupement familial, en particulier). L’idée commune à maints
racialismes se fait à nouveau entendre : « Ces gens-là font trop
d’enfants », ainsi que son thème sous-jacent : l’angoisse d’une
invasion immanente.
3) Ce qu’il y a eu
d’important dans les récents événements, plus que les émeutes elles-mêmes,
c’est ce qui s’est passé du côté de l’Etat, c’est la disposition prise par
l’Etat. Il est remarquable – et inquiétant – de constater la facilité avec
laquelle une révolte en fin de compte circonscrite a pu déboucher sur l’état
d’exception et la facilité avec laquelle cela a été accepté par une large
partie de l’opinion contrôlée par l’Etat. Le fameux Etat de droit se délite
sous nos yeux et ce peu de temps après qu’il ait été constitué en vache sacrée.
Quelle en est la raison ? C’est que dans la société actuelle, les pauvres
(gardons ce terme général) doivent être persuadés que ce qui leur arrive est de
leur faute ; pour ceux d’entre eux qui sont de filiation étrangère, il
importe dès lors qu’ils intériorisent l’idée qu’ils ne sont pas organiquement
d’ici mais qu’ils y sont simplement tolérés. Leur présence en France est le
résultat d’une simple bénévolence. Ils doivent en conséquence être comme tout
le monde (qu’ils n’aient pas les moyens d’être comme tout le monde est une
autre affaire, mais dont on se moque complètement). Les caractères de la disposition
prise par la politique étatique s’en déduisent aisément : à la fois
racialiste et censitaire (exclusion des pauvres).
4) Nous avons croisé l’année
dernière la figure oppositionnelle. Il faut convenir qu’elle a fait merveille
au cours des derniers événements. Je rappelle que j’avais caractérisé la figure
oppositionnelle comme celle du ralliement masqué ; cela s’est une fois de
plus vérifié. L’opposition, coincée entre son impossibilité de rompre le pacte
essentiel qui la lie à l’ordre dominant et l’impossibilité de dire la même
chose que le gouvernement, a fait la seule chose qui lui restait à faire :
disparaître. D’où l’extraordinaire faiblesse de ses réactions (y compris sur le
simple plan « humanitaire »).
5) L’émeute comme telle. Il
est évident qu’elle ne constituait aucunement un sujet politique : ce
qu’ont fait les jeunes, incendier quelques voitures etc., est à l’évidence limité,
pauvre, mais ils n’ont pas fait autre chose que ce qu’ils savaient faire. Le
leur reprocher, c’est reprocher à une émeute de ne pas être autre chose qu’une
émeute, à savoir une insurrection. On a entendu de beaux esprits constater avec
dépit que les jeunes s’attaquaient à leurs propres voitures, à leurs propres
écoles etc., que c’est leur propres quartiers qu’ils saccageaient. Fallait-il
qu’ils marchent sur l’Elysée pour recueillir l’approbation ? Toutes les
émeutes récentes (Los Angeles, …) ont pour théâtre les quartiers d’habitation
des émeutiers ; je signale d’ailleurs que s’ils en sortaient, on leur
tirerait dessus, ça ne fait pas l’ombre d’un doute … Qu’est-ce qu’une
émeute ? C’est quelque chose qui organise la visibilité d’un
problème ; une émeute a une valeur symptômale. Quel est donc ici le
problème ? On ne peut que proposer des hypothèses. La mienne est la suivante :
le problème qui a été mis en scène par les émeutes est l’existence d’un écart
considérable entre d’un côté le pays et les gens qui y vivent et de l’autre
côté l’Etat. Ce qui est advenu à la visibilité est qu’une masse considérable de
gens relève pour l’Etat de la simple police. L’oubli de l’origine de l’affaire
est ici très frappant : c’est, rappelons-le, la mort de deux jeunes qui
avaient la police aux fesses dans des circonstances qui ont été par la suite
recouvertes par des mensonges éhontés de la part de ladite police ; ce ne
sont pas des abstractions sociologisantes sur les « cités », le
défaut d’intégration etc. Il est quand même extraordinaire qu’il n’y ait
eu aucune auto-critique de la part du gouvernement sur les mensonges
policiers ; et encore plus extraordinaire qu’on ait osé mettre en balance
la mort de deux gamins (auxquels aucun hommage n’a été rendu) et quelques
voitures brûlées. Allez parler d’intégration à des gens dont vous déniez
manifestement la qualité de personnes. Ce qui a été dit par les jeunes c’est
ceci : nous sommes de ce pays (y compris sur le plan formel : la
grande majorité des jeunes émeutiers était constituée de jeunes Français) et
tout se passe comme si l’Etat ne nous comptait pas – l’Etat s’est d’ailleurs
empressé de valider cet énoncé en promulguant dans la foulée une série de
mesures discriminatoires (notamment contre le regroupement familial, avec
toujours l’objectif de culpabiliser les étrangers …). D’un certain point de
vue, la subjectivité qui s’est manifestée est donc essentiellement nationale (plus que sociale). Et la remise en cause d’une
appartenance nationale est toujours une affaire grave ; c’est dans une
zone années 30-40 que l’on entre à nouveau, une zone où l’on farfouille jusqu’à
la nième génération pour voir si l’on est d’ici ou pas … Vous savez que je suis un optimiste né.
Mais là, je dois dire que je trouve la situation franchement très mauvaise et
dangereuse …
6) Ce qui nous amène à la
question de la responsabilité personnelle de chacun. Le vieux mot d’engagement
est à nouveau à l’ordre du jour. Car décréter l’état d’exception contre des
gamins en colère, cela est absolument répugnant. Et ces gamins, on ne doit pas
les laisser seuls face à la police. Il faut dès à présent être dans la posture
exigée par le démantèlement des lois scélérates actuellement en préparation. Il
faut affirmer le droit ouvrier et populaire, le droit des gens d’ici à être
ici.
*
Revenons
à notre analyse du matérialisme démocratique. Je lui oppose ce que j’appelle la
dialectique matérialiste : deux matérialismes en présence par conséquent,
le terme se trouvant tantôt sous la forme d’un substantif et tantôt sous celle
d’un adjectif (nous reviendrons ultérieurement là-dessus). Cette opposition
prend finalement acte de ceci que l’idéalisme a été vaincu. Je rappelle que
pour Althusser, c’est encore l’antagonisme entre le matérialisme et l’idéalisme
qui structurait toute l’histoire de la philosophie (et même, plus précisément,
qui à l’intérieur même de toute philosophie, scindait la part qui était en fin
de compte du côté de l’émancipation de celle qui était du côté de l’idéologie
et de la conservation). « L’idéalisme a été vaincu » c’est une
variante de l’énoncé nietzschéen « Dieu est mort » et c’est aussi un
énoncé qui valide l’anticipation de Marx dans le Manifeste
quand il déclarait : « Partout où la bourgeoisie a conquis le
pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales,
idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à
ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister
d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures
exigences du paiement “au comptant“. Elle a noyé les frissons sacrés de
l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité
petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste ». La défaite de
l’idéalisme c’est cela que signifie que « tous les liens complexes et
variés … (ont été dissous) dans les eaux glacées du calcul
égoïste » ; car ce que Marx annonçait il y a 150 ans a fini par se
réaliser. Mais sans qu’il y ait eu pour autant victoire de la voie
émancipatrice. Il était en définitive inattendu que le dispositif contemporain
de la domination soit une variante singulière du matérialisme. Faut-il alors
inverser les signes et proclamer que c’est l’idéalisme qui est devenu le
support de la voie émancipatrice ? Cette tentative existe aujourd’hui, je
la comprends, mais je la pense vaine et sans avenir et ceci pour la raison que
l’idéalisme est une configuration effectivement
morte ; on ne la ressuscitera pas (en dépit de sa propension spontanée à
le faire). La seule issue est une scission du matérialisme lui-même.
Pour
définir ce que c’est que vivre (en un sens qui tranche sur le simple
« survivre » dénoncé par les situationnistes, i.e. la capacité à se
tenir dans la vie comme sujet), j’ai recours, dans le texte qui porte ce titre
(Qu’est-ce que vivre ?), à des formules dont nous
avons débuté le commentaire la fois précédente : incorporation au
présent, venir à bout des pulsions (paragr. 4) et l’Idée,
arcane du présent pur (paragr. 15). Il s’agit de construire une liaison
nouvelle, qui n’a rien d’évident, entre le venir-à-bout-des-pulsions (i.e. le
venir-à-bout-de-l’immédiat), la souveraineté de l’Idée et la création d’un
présent. Rien d’évident car, concernant la puissance de l’Idée contre les
pulsions, le matérialisme semble nous enseigner l’exact contraire ; et,
concernant le lien entre l’Idée et la création d’un présent, on nous a appris
que l’Idée est précisément ce qui est au-delà du présent. L’enjeu est de penser
que l’Idée puisse être par rapport au corps dans un rapport qui ne soit pas
transcendant et par rapport au présent dans un rapport qui soit autre chose
qu’une indifférence. Il est de construire une solidarité organique entre la
construction d’un présent (présent réel, présent de l’action, de la création)
et l’Idée dont on maintiendra – c’est une gageure – le caractère d’éternité
(sinon, cela serait trop facile). Parler de « vérité éternelle »,
c’est une redondance. Elle est retrouvée / Quoi ? L’éternité. / C’est
la mer allée / Avec le soleil. Rimbaud assigne l’éternité
à l’alliance de la mer et du soleil, c’est son droit, c’est le droit de la
poésie. La question est : peut-on n’opposer à la disposition actuelle que
la métaphorique naturelle du poème ? Répondre par l’affirmative, c’est
opter pour le retrait comme seule issue à la dévastation à laquelle le monde
est livré, un retrait dans le poème (il n’y en a pas d’autre) [1].
Nous soutiendrons qu’une option plus radicale est possible, une option dont
l’arrimage au présent ne serait pas seulement l’arrimage au présent naturel.
L’enjeu c’est de concevoir l’Idée dans une articulation au corps et au présent
qui ne soit pas résignée au retrait. Nous souscrirons à l’énoncé magnifique de
Spinoza : Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et expérimentant
qu’il y a en nous quelque chose d’irréductible à
ce que l’on nous prescrit d’être selon la nécessité, nous sentirons la
solidarité entre éternité et exception.
*
Nous lisons au paragr. 5 : Pour le matérialisme
démocratique, le présent n'est jamais créé. Il affirme en effet de façon tout à
fait explicite qu'il importe de tenir le présent dans la limite d'une réalité
atone. C'est que pour lui, toute autre vision plie les corps au despotisme
d'une idéologie, au lieu de les laisser libre de gambader dans la diversité des
langages. Le matérialisme démocratique propose de nommer « pensée » la
pure algèbre de l'apparaître. Il résulte de cette conception atone du présent
une fétichisation du passé comme « culture » séparable. Le matérialisme
démocratique a la passion de 1'histoire, il est, véritablement, le seul
authentique matérialisme historique. Le matérialisme démocratique pose un
principe d’équivalence générale : permutabilité des corps, équivalence des
langages. C’est en quoi il est démocratique :
son relativisme, la non hiérarchisation des choses, excluent qu’il y ait une
clause d’absoluité. Ce que j’entends par réalité atone,
c’est que pour le matérialisme démocratique la réalité ne comporte pas de
clause de décision radicale (autre que son axiome constitutif : « Il
n’y a que des corps et des langages »).
J’appelle point d’un monde un moment où les
apparences de ce monde se contractent en un point qui soumet les processus en
cours à l’astreinte de la décision pure (i.e. à l’instance du Deux). Un monde
atone est un monde dont on suppose qu’il est sans point. D’où la thèse :
une conséquence du matérialisme démocratique est d’exiger l’atonie du monde (ou
que l’atonie soit l’idéal de ce monde). Et cette autre : vivre, c’est traiter
quelques points.
La garantie que le monde est atone s’appelle sécurité
dans les termes d’aujourd’hui. Le désir d’atonie a une tradition française ancienne ;
on peut citer la (trop) fameuse phrase de Voltaire qui conclut Candide :
« Il faut cultiver notre jardin » ; le point culminant de cette
tradition a été le pétainisme, une période où il était enjoint de faire comme
si les Allemands n’étaient pas là et que le voisin juif ne courrait pas le
risque permanent d’être arrêté.
Toujours dans le paragr.
5 : Dans le matérialisme démocratique, la vie des corps-langages est la
succession conservatrice des instants du monde atone. C’est la 2ème
conséquence de l’axiome du matérialisme démocratique : l’abolition du
présent (qui se surajoute à l’abolition des points du monde). Dé-temporalisation
qui rappelle la phrase de Mallarmé : Il n’est pas de Présent, non, un
présent n’existe pas. Faute que se déclare la Foule.
A quoi la dialectique
matérialiste répond par des conséquences contraires : elle ouvre à la
possibilité que le monde ne soit pas atone en introduisant une clause
d’exception dans son axiome constitutif (sinon que) et, pour autant qu’il existe une exception, elle
ouvre à la possibilité d’un présent. Contre le sécuritaire atone, elle pose la
possibilité de l’existence de quelques points, i.e. la possibilité qu’il y
ait quelque chose à décider, et par
voie de conséquence la possibilité que soit réouverte la question du présent
réel. Mais où le fait-elle ? Question topique. Où se trouve pour la pensée
d’aujourd’hui le point qui permette de décider entre matérialisme démocratique
et dialectique matérialiste ? Où décide-t-on aujourd’hui qu’il y a quelque chose qu’il n’y a pas ?
14 DECEMBRE 2005
Notre tâche consiste à
construire un cadre d’évaluation de la situation idéologique contemporaine. Il
s’agit en fin de compte de disposer une orientation dans la pensée mais aussi
dans l’existence et pour cela de venir à bout des effets de désorientation de la contemporanéité.
Des points de désorientation
ou des problèmes sans issue, je vais en énumérer quelques-uns. De ceux qui, si
nous ne sommes pas capables de les traiter, risquent par leur multiplication
d’avoir des effets subjectifs désastreux.
1) Tiré de l’actualité la
plus immédiate, un sondage paru aujourd’hui [14.12.05] nous
« apprend » que 63 % des personnes interrogées pensent « qu’il y
a trop d’immigrés » en France ; un nombre substantiel de sondés
estiment également « que cela ne va pas s’arranger » (autrement dit,
qu’il y aura encore plus d’immigrés à l’avenir). Que peut vouloir dire ce
sondage ? Et d’abord que signifie « trop » ? Quelle est la
figure de mesure qui autorise à dire « trop » ? Et
« immigré » ? Fait-on allusion à des ressortissants de
nationalité américaine, polonaise … ? ou bien c’est des Noirs et des
Arabes qu’il s’agit, selon des critères racialistes ? L’énoncé en question
est foncièrement opaque (avant
tout pour l’auteur même de l’énoncé) ; et c’est cette opacité de la norme
mise en jeu qui rend le jugement désorientant - pour l’auteur du jugement, je
le répète. Selon le même sondage, un grand nombre de personnes disent ne plus
« se sentir chez soi » ; c’est une autre façon de nommer leur
propre désorientation : ils sont perdus chez eux.
2) La Chine – voilà un pays
qui, il y a à peine 20 ans, était considéré comme un paradigme révolutionnaire
extrémiste ; c’est aujourd’hui le concurrent principal des USA et ce non
pas à la façon de l’URSS du temps de la guerre froide, mais dans l’homogénéité
du même système (capitaliste). Comment est-ce possible ? Quel est le
principe de ce renversement ? La Chine, de fait, désigne aujourd’hui un
espace incertain, une interrogation majeure de la planète en termes de
puissance.
3) Comment s’est installée
la disjonction contemporaine entre philosophie et mathématique ? Au plus
loin du nouage essentiel qui les caractérisait dans la philosophie classique
(et qui a duré jusqu’à Husserl), nous avons une spécialité, la philosophie des
sciences, qui ne porte aucunement remède à leur disjonction, bien au contraire.
C’est la question, de type foucaldien, de ce qui organise les partages
disciplinaires. Or, le fait qu’on valide la disjonction entre philosophie et mathématique
ou qu’on ne la valide pas a selon moi une importance cruciale quant à
l’identification de la pensée.
4) D’où peut provenir que
des intellectuels qui se situent (et sont situés par l’opinion) à gauche dans
le spectre de l’intelligentsia puissent tenir des propos racialistes ? Certes
on s’en indigne et l’on a raison ; mais qu’est-ce qui, en profondeur, peut
expliquer un tel cheminement ?
5) Comment un grand pays
cosmopolite (conséquence entre autres de son passé de puissance impériale), à
tradition révolutionnaire universellement reconnue – j’ai nommé la France,
peut-il tenir des collégiens appartenant à des milieux populaires comme ses
ennemis intérieurs principaux ? Là encore, l’indignation est nécessaire
mais je trouve que la dimension énigmatique de cette dérive pathologique ne nous frappe pas assez. L’emportement de l’Etat
n’est pas seulement réactionnaire, répugnant etc., mais, plus important encore,
il est désorientant. C’est selon
moi une question transcendantale (nous reviendrons sur ce terme).
6) D’où vient qu’il y a de
nos jours une raréfaction patente entre art de masse et densité
artistique ? Ou encore : d’où vient le lien constatable entre
l’inventivité artistique et le caractère élitaire de son public ? Car un
tel lien n’a rien de nécessaire : le 19ème siècle offre de
nombreux exemples de croisement entre la novation artistique et le plus vaste
public (on peut citer Hugo, Dickens, Tolstoï, ..) et au 20ème siècle
c’est le cinéma comme art de masse qui en a été une brillante illustration (Chaplin,
Hitchcock, Kurosawa, ..). Ce hiatus, de façon significative, affecte
aujourd’hui le cinéma lui-même : l’espace se réduit aux grosses
productions industrielles (si l’on ne va pas voir King-Kong, on s’expose à une solitude écrasante - qui est, curieusement,
celle du grand singe lui-même) ou à quelque forme de résignation élitiste sans
avant-garde, ce qui n’est pas très bon. Il y a là à nouveau une désorientation,
qui a pour effet de rendre l’évaluation artistique elle-même très difficile.
7) Pourquoi le mot
« ouvrier » a-t-il été un mot de la politique dans la France de 1940
(qui comptait au plus 10% d’ouvriers) et qu’il y a disparu depuis les années
1970 alors que les ouvriers représentent actuellement environ 30% de la
population (et probablement plus de la moitié si on compte aussi les petits
employés). Même Arlette Laguillier, dont l’organisation s’appelle Lutte Ouvrière, ne parle plus d’ouvrier mais de
« travailleur(se) ». Si les données sociologiques qui sont
habituellement présentées comme « explications » (la soi-disant
disparition des ouvriers) sont fausses, à quoi donc ce phénomène intervenu dans
la langue de la politique est-il corrélé ? Et dites-vous bien que la
disparition d’un mot de la politique est toujours quelque chose de significatif.
« Ouvrier », cela a été le mot qui, au sein de la dissidence
populaire, de la rébellion populaire, a nommé sa puissance immanente de
discipline, cela commence de plus en
plus à être reconnu. D’où l’effet majeur de désorientation entraîné par la
disparition du mot.
8) Dans quelles conditions
s’est opérée la prise de pouvoir sur les masses (et notamment les masses
jeunes) de la musique ? Je
soutiens en effet que le pouvoir de la musique, quoi qu’on en dise
habituellement, est aujourd’hui plus important que celui des images. Et que
c’est en tant qu’elle est indistincte, pluraliste et sans hiérarchie (et dans
tous les cas déconnectée de l’invention musicale) qu’elle exerce ce pouvoir.
Quand on la célèbre annuellement (« fête de la musique »), c’est
précisément ce pouvoir que l’on célèbre. Pouvoir qui est en grande partie celui
du rythme – et qu’il ne faut pas attribuer trop vite à ses supports
technologiques : la technologie n’est justement qu’un support, elle n’est
pas le pouvoir lui-même.
9) Comment la conception
empiriste-grammairienne de la philosophie (souvent appelée, assez improprement,
philosophie analytique, ou encore philosophie anglo-saxonne) a-t-elle pu
trouver prise en France, y compris dans les milieux académiques ? En
France où pourtant il existe une fort longue tradition hostile à cette
conception (au moins depuis Descartes ; c’est, si vous voulez,
l’opposition de Descartes à Locke). Car la philosophie française s’est
construite comme une philosophie du concept, et ce y compris jusqu’à Deleuze (qui caractérisait
l’activité philosophique comme production de concepts). A quel moment les
digues ont-elles cédé ? Et qu’on ne réponde pas par le poids des universités
américaines ou autres explications, précisément empiristes, du même genre : c’est à l’intérieur même de la
philosophie qu’il faut chercher la faille, le défaut de la cuirasse …
10) Est-il vrai, comme on le
dit un peu partout, qu’il y a fusion du réel et de l’image ? Sommes-nous
effectivement entrés, via les technologies du virtuel, dans un monde
caractérisé par l’existence de zones d’inséparabilité entre l’image et le
réel ? Il faut pour soutenir une telle thèse disposer d’une théorie du
réel, dont je pense en dernière instance qu’elle est de nature empiriste. Cette
thèse, je la soupçonne de n’être au fond qu’une idéologie : autrement
dit, l’indiscernabilité du réel et
de l’image, c’est une idée que l’on voudrait que nous ayons. Car si le réel et
l’image sont substituables, alors nous sommes entraînés vers une théorie du
réel qui est hors d’état de nous proposer un point : toute décision est vaine car déjà
pré-ensevelie dans les images qui lui correspondent.
11) Pourquoi y a-t-il
aujourd’hui une hégémonie de la danse dans le spectacle vivant ? Question
qui n’est pas un jugement sur la danse contemporaine, marquée au contraire par
une inventivité remarquable. L’interrogation porte sur l’autorité, partout
constatable dans le spectacle vivant, du corps sur le texte – ou, dans les
termes du matérialisme démocratique : l’autorité du langage du corps sur
les autres langages.
12) Enfin, pourquoi la
quasi-invisibilité actuelle de la poésie ? Et ce malgré l’existence de
grands poètes. Pourquoi cette ressource infinie et immanente de la langue
qu’est la poésie est-elle secondarisée, confinée dans un espace étroit ?
La raison en est selon moi que la poésie fonctionne de façon essentielle comme
une déclaration – un poète c’est quelqu’un qui déclare, quelqu’un qui parle en
son nom propre, et qui parle à tous au nom de son immanence à la langue – et
que le monde contemporain en portant atteinte à la poésie porte atteinte à la
déclaration en tant que telle.
Ces différents points du
monde contemporain, que celui-ci entérine comme des évidences de son propre
devenir, sont foncièrement énigmatiques et fonctionnent à ce titre comme des symptômes de désorientation. Ils
constituent une « ligne hermétique de partage de l’ombre et de la
lumière » (R. Char Dans la marche in : Paroles en archipel) ; selon la direction imprimée,
nous pouvons, avec eux, être tirés vers l’obscurité ou vers la clarté. C’est
notre sort, actuel, d’être des « gens du crépuscule » : non pas
ceux par qui transite la nuit qui vient, mais ceux par qui le jour est retenu,
ceux qui se retiennent de consentir à la nuit.
*
Conseils de lecture
- sur la ville : L’Invention
de Paris de Eric Hazan (Points Seuil)
- sur la subjectivité du
colonisé : La maison de l’araignée, un roman de Paul Bowles (Le Livre de Poche)
- sur l’esclavage et
Toussaint-Louverture : The Black Jacobins de Cyril L.R. James (Penguin Books - en
anglais) ; Les Jacobins noirs : Toussaint-Louverture et la révolution
de Saint-Domingue Editions
Caribéennes 1984 ou L’Harmattan 2000 (en français, mais apparemment
épuisé)
*
Autrefois,
« dialectique » (l’adjectif) était opposé à « métaphysique » :
le matérialisme dialectique était opposé à l’idéalisme métaphysique comme une
philosophie du mouvement et de la contradiction versus une philosophie de
l’immobile et de l’immuable. Que devient ce terme après la fin de l’idéalisme
et la scission du matérialisme (cf. séance précédente) ?
Notre thèse est qu’il est
possible qu’existe quelque chose qui vienne en excès de la stricte répartition
corps / langage ; cet excès n’est pas un troisième terme supplémentaire
ontologiquement distinct des deux premiers ni leur synthèse.
« Dialectique » est ce qui va désigner l’opération instaurant la
possibilité de cet excès sur le deux dans la figure d’une exception
immanente (i.e. ni introduction d’un
troisième terme isolable ni synthèse des deux termes premiers) : ce qui va
être nommé ainsi c’est l’écart entre les deux termes, ce qui est entre corps et langage, l’entrouvert des
deux. Qu’est-ce que cet écart ? L’écart dialectique c’est le moment où la
conjonction entre les deux termes est indistincte de leur disjonction, ce
moment où il est possible que « ni (le corps) ni (le langage) »
veuille dire la même chose que « et (le corps) et (le langage) ».
Conjonction disjonctive ou disjonction conjonctive (mais pas : synthèse
disjonctive, au sens de Deleuze, et vous voyez pourquoi je mets de côté le
terme synthèse).
Le présent, le présent affirmatif, n’a pas d’autre contenu :
pouvoir dire « cela » et
« cela » et
« cela », … et que ce présent ne soit ni sous la loi du passé ni commandité par l’avenir : on sait très bien que
s’il y a le présent réel, le présent intense, le passé est incorporé dans la
vie du présent et, de même, que l’avenir se tisse de ce présent-là. Quand il
n’y a pas de présent, comme dans le matérialisme démocratique, on a à la fois une
fétichisation du passé comme « culture » séparable (paragr. 5) et le surgissement du passé sous la forme
d’un impératif : le « devoir de mémoire ». Comme s’il était
dit : il y a effectivement autre chose que la marchandise, à savoir le
passé ; et pour cette raison, il justifie une légifération monumentale -
mais sous la forme d’un culte misérable (les lois sur le passé). Et toujours
pour colmater l’absence de présent, on lui assortit la prégnance de
l’immédiat : nous sommes livrés à l’immédiat comme aux lions, relation sans
relation (il n’y a par principe pas de relation dans l’immédiat) qui se donne
dans la figure de la jouissance, et c’est un martyre - asservissement à
l’immédiat qui est au fond de la souffrance des jeunes.
La dialectique matérialiste
comporte par contre une relation entre le présent et l’éternité : à
l’immédiat du matérialisme démocratique, elle oppose l’éternité en tant
qu’immanente au présent créé. Il y aura donc deux dispositions subjectives
opposées, enracinées dans des temporalités différentes. Cette relation propre à
la dialectique matérialiste, il nous reste à la construire - « il nous
reste » ; comprenez que cette tâche nous occupera jusqu’à la fin de
ce séminaire. Je vous donne dès à présent les principales étapes de cette
construction.
D’abord une définition. On appelle monde un lieu de l’être-là des multiplicités, i.e. un
espace d’apparaître (le lieu où apparaissent les multiplicités).
Thèse 1 : il y a des
mondes ; ou encore : il n’y a pas un univers (les multiplicités apparaissent multiplement)
Thèse 2 : la pensée de
ce pluriel est possible ; ou encore : il y a une (des) logique(s) des
mondes
Thèse 3 : il y a des
événements (il y a des changements dans la logique du monde concerné)
Thèse 4 : la pensée de
l’événement est possible, dans son être, dans son apparaître et dans ses
conséquences
Thèse 5 : tout
événement laisse une trace, qui est identique à la relève de l’inexistant
Thèse 6 : autour de la
trace peut apparaître un nouveau corps
Thèse 7 : ce nouveau
corps peut porter la forme d’un sujet
Thèse 8 : un corps
subjectivé va créer point par point une vérité
Thèse 9 : cette vérité
est éternelle (bien que produite dans un monde, elle est reconnaissable comme
telle dans tout monde et l’objet possible d’une résurrection
trans-mondaine ; l’éternité c’est la communication des présents).
11 JANVIER 2006
Des multiplicités pures aux
vérités éternelles en passant par la consistance de l’apparaître (la logique),
tel est, échelonné selon dix thèses, le trajet que je vous ai proposé la
dernière fois. Il y a donc trois moments : au départ l’indifférence ontologique
(les multiplicités quelconques) ; au terme du trajet la disponibilité,
active au présent, des vérités éternelles ; et, entre les deux, la logique
des corps, ou plutôt ce que j’appellerai le moment scindé de la logique :
l’exposition de l’apparaître, mais aussi la fragilité de cette exposition, ce
qui peut venir la perturber sous la forme de l’événement ; ou encore
: le transcendantal et ce qui fait incise dans le transcendantal.
Scission qui renvoie à la
question (matérialiste) décisive : à quelles conditions peut-il y avoir de
nouveaux corps ? Soit :
à quelles conditions peut-il y avoir une exception à la logique d’un monde ?
Commençons par l’índifférence
ontologique.
Le il y a pur, l’exposition
de multiplicités quelconques, est pensable et cette pensée, depuis qu’elle
existe, s’appelle mathématique. C’est une langue formelle, non destinée du
point de vue anthropologique, qui combine de façon indémêlable deux traits, qui
sont deux manques : le manque de l’Un (l’étant est multiple pur, multiple
sans-un) et le manque de sens (l’ab-sens). Elle dit l’ab-sens de l’absence de
l’Un. Ce qui peut se dire aussi : il n’y a pas de destination de l’être,
énoncé - que nous validons - qui est au plus loin des thèses heideggériennes
sur l’historialité de l’être (selon lesquelles l’être nous destine en tant que
l’être est destiné).
Il faut remarquer que la
langue mathématique est une parfaite transcription abstraite du matérialisme
démocratique lui-même. Après tout, ce dernier ne dit-il pas qu’il y a ce qu’il
y a et que tout fait également sens (l’énoncé « tout fait également
sens » est réciproquable à « rien ne fait sens »). Le
matérialisme démocratique professe une restriction de l’expérience à la dimension
de l’indifférence ontologique. Il faut donc assumer que le matérialisme
démocratique est en compatibilité avec la mathématique, aussi bien qu’avec la
dialectique matérialiste, à ceci près que pour celle-ci l’indifférence
ontologique n’est pas exclusive de son « opposé » : les vérités
éternelles. Pour le matérialisme démocratique, l’indifférence ontologique doit
faire loi (c’est même le ressort de son nihilisme) : loi de la circulation
marchande sous la figure de l’équivalent général monétaire. Ne reste que la loi
du nombre, ce qui est tout à fait cohérent avec ses propres axiomes :
quand tout se vaut, il ne reste qu’à compter (aussi bien ses sous que ses voix
– solidarité de la monnaie et du suffrage).
« Du côté
opposé », nous avons l’éternité des vérités et la disponibilité de l’éternité comme présent. Ce
que désigne cette expression c’est ceci qu’une vérité, créée dans un monde
déterminé, est disponible pour tout autre monde : c’est très précisément
pour cette raison qu’on peut dire d’une vérité qu’elle est éternelle. Et tout en étant éternelle, elle est disponible
au présent : il n’est pas de
l’essence de l’éternité d’être séparée du présent : comme l’a vu Rimbaud,
elle peut être là, et, inaperçue
l’instant d’avant, être l’objet de retrouvaille : Elle est
retrouvée./ Quoi ? -
L’éternité.
L’apparition d’un nouveau
corps (ma thèse 6) va créer point par point une vérité (th. 8), mais ce pour
autant que le monde lui propose des points à traiter ; le nouveau corps
est tributaire en cela du monde où il apparaît et en outre rien ne garantit
qu’il dispose du traitement des points que le monde lui propose (c’est en ce
« point » que s’est échouée la théorie du parti au 20ème
siècle). C’est ainsi qu’une vérité, quoique éternelle, est marquée du monde où elle procède, où elle est
éprouvée : c’est pourquoi, de l’éternité d’une vérité, on dira aussi
qu’elle est singulière.
Une vérité, créée dans un
monde singulier, est reconnue comme telle du point de tout autre corps
subjectivable dans un autre monde : « reconnue » au sens où
cette vérité est disponible, utilisable par un nouveau corps subjectivable et ré-incorporée
pour ses fins propres (i.e. aux fins
de production d’autres vérités). Je vais vous donner quatre exemples de
réincorporation (que vous pourrez aussi prochainement consulter en les lisant,
puisqu’ils sont tirés de Logiques des mondes, dont la parution est imminente :
février ?), un exemple pour chacune des quatre procédures de vérité.
1) La réincorporation par
Picasso de la représentation des animaux dans l’art rupestre. Des raisons qui
ont amené les hommes de Lascaux, de Pech-Merle ou de la grotte Chauvet à
peindre des chevaux sur les parois de leurs cavernes, nous ne savons à peu près
rien : motifs religieux ? rites propitiatoires de chasseurs ? ou
simple amusement ? Et pourtant ces chevaux sont là des milliers d’années
plus tard dans leur stupéfiante évidence d’art. Ce que Picasso en redispose, à
ses propres fins (qui sont de répondre à la question : qu’en est-il de la
peinture post-cubiste ?), va au-delà de la ressemblance : il s’agit
de l’animal en tant qu’il a une figure d’apparaître et ce qui en est exhibé
(dans les deux cas) c’est une reconnaissance schématique de l’idée de cheval, de ce qu’on pourrait appeler sa
« caballéité ». Un cynique grec, pour objecter à Platon, disait qu’il
savait ce qu’est un cheval, mais qu’il n’avait jamais rencontré l’idée de
cheval ; les chevaux de Lascaux et leur réincorporation par Picasso sont
un démenti à ses affirmations.
2) Les textes mathématiques
d’Archimède (3ème siècle avant JC) ont traversé les siècles dans une
quasi-totale incompréhension et il a fallu attendre les 15ème et 16ème
siècles pour que non seulement leur opacité se dissipe mais pour qu’ils
deviennent des éducateurs dans la période historique en question :
réincorporés dans un dispositif nouveau, ils ont accompagné les mathématiciens
de ce temps dans l’invention du calcul infinitésimal. J’aimerais parler à ce
propos d’une véritable résurrection
– s’il n’y avait pas la charge religieuse du mot (et si je n’avais pas par
ailleurs quelques casseroles religieuses à traîner) ; je garde quand même
le mot : dans le matérialisme démocratique, aucun corps ni aucun langage
jamais ne ressuscitent, alors que la résurrection des vérités est autorisée par
la dialectique matérialiste. Je vois trois instances possibles de la résurrection
(en suivant le fil d’une coquetterie lacanienne) : une instance imaginaire
qui concerne la résurrection des corps (c’est la dimension proprement
religieuse), une instance symbolique qui touche à la résurrection des langues
(dimension qu’on pourrait dire historique, au sens où Michelet disait que
l’histoire, c’est « la résurrection intégrale du passé », i.e. la
résurrection du langage homogène à tel passé) et enfin une instance réelle, lorsqu’une
procédure de vérité est intéressée (comme dans les exemples que j’ai
cités) : c’est la seule résurrection réelle. Et j’ajouterais – toujours dans la proximité de
Lacan – que si un sujet a la forme
d’un corps (de vérité) subjectivable et qu’il se nourrit de réincorporations,
on peut dire de lui qu’il est ce qui
s’incorpore une vérité pour une autre vérité. Dire l’éternité des vérités, c’est dire aussi qu’un sujet est
l’entre-deux des vérités.
3) Je ne ferai que
mentionner les deux autres exemples : dans la politique, c’est la reprise,
la réincorporation dans les textes léninistes de la question que posait il y a
près de deux mille ans un texte chinois intitulé « La dispute sur le sel
et le fer », question (aujourd’hui encore non résolue) qui est la
suivante : l’égalité peut-elle se passer de l’Etat ?
4 Et, dans le domaine
amoureux, où l’on est nécessairement réduit aux amours archivées (Tristan et
Yseult, Héloïse et Abélard, …), c’est la réincorporation par l’opéra romantique
(Les Troyens à Carthage de
Berlioz) des amours de Didon et Enée tels que Virgile nous les a narrés.
*
La théorie des vérités
éternelles comporte-t-elle une dimension anthropologique ? Si la question
se pose, c’est parce qu’un individu humain peut participer à la constitution
d’un corps de vérité, d’un sujet - ça
peut lui arriver - mais lui-même
en tant qu’individu n’est pas le
corps nouveau. Le matérialisme démocratique soutient, dans l’ordre anthropologique,
qu’il n’y a que des individus (et des communautés). A cet égard la maxime de la
dialectique matérialiste sera : il n’y a que des individus et des
communautés sinon qu’il peut y avoir des sujets. La subjectivation, en ce sens, est toujours ruineuse
pour le matérialisme démocratique, elle est de l’ordre de l’imaginaire
néfaste ; d’où sa définition spéculative du totalitarisme : un
individu, dans le totalitarisme, c’est un individu qui s’imagine qu’il est un sujet (c’est la transposition, du point
de vue anthropologique, de la thèse ontologique – qu’il partage, nous l’avons
vu, avec la dialectique matérialiste – suivant laquelle l’être n’est pas
destiné). La dialectique matérialiste, quant à elle, pose un écart entre
individu et sujet ; elle pose que l’individu est subjectivable : il
n’est pas pris dans l’égalité anonyme du ce qu’il y a, mais il peut être
incorporé à un nouveau corps (de vérité). Ce n’est pas exactement que
« l’individu peut devenir sujet » (comme il a pu m’arriver de le dire
à des fins de simplification propagandiste) : une telle formulation, qui
suppose une sorte de mutation sur place, doit trop à la transcendance et aux
doctrines de la conversion. Je dirai aujourd’hui : dans les conditions de
la constitution d’un nouveau corps, il y a possibilité pour un individu à
s’incorporer à ce nouveau corps. C’est une thèse matérialiste : la subjectivation, pour ce multiple du monde
qu’est un individu, est une possibilité offerte par ce monde ; ce n’est
pas une ressource de l’individu ; le problème de l’individu c’est : accepte-t-il
(ou non) la proposition que lui fait le monde ?
*
Qu’y a-t-il entre les multiplicités pures et les vérités éternelles,
quelle est la structure du réel qui rend possible le trajet de l’un à l’autre
et dont la pensée puisse permettre de faire l’économie de notions telles que
grâce ou miracle ?
Je vous propose le schéma suivant, qui nous servira de guide pour les
prochaines fois.
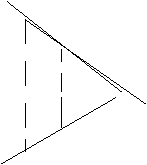

Sur la diagonale du haut, qui représente
« le côté des multiplicités », nous inscrirons une série de notions
et nous en inscrirons une autre sur la diagonale du bas qui représente
« le côté des vérités éternelles ». A chacune des notions sur une
diagonale correspondra une notion sur l’autre diagonale : nous aurons
ainsi des couples de notions et, par resserrement progressif, nous parviendrons
au sommet du triangle où se trouve l’événement.
Je vous donne la liste des couples de
notions. Le premier terme appartient à la série « multiplicités » et
le second à la série « vérités éternelles ».
Être-là / Présent créateur
Consistance logique / Nouveau corps
Transcendantal / Conditions d’existence
pour un nouveau corps
Inexistant / Trace
Points / Organes du corps
Evènement
On voit donc que l’événement a deux
bords : du côté des multiplicités, il y a la question des conséquences. Du
côté des vérités éternelles, l’événement s’évanouit.
*
Je vais vous lire un poème écrit il y a plus d’un demi-siècle dans
lequel le pouvoir d’anticipation du poète nous donne la vision d’un monde livré
au matérialisme démocratique, un monde d’où le vrai s’est absenté.
Lecture de la fin du poème de P.P.Pasolini « Les cendres de
Gramsci ».
15 MARS 2006
Un point concernant la campagne diffamatoire menée contre A. Badiou à
l’occasion de la parution de son livre Circonstances 3 ; portée du
mot « juif ».
Quelques bribes extraites de l’argumentaire de sa réponse :
Dans la préface de Logiques des mondes, l’axiome fondamental du matérialisme démocratique
« Il n’y a que des corps et des langages » est également proposé sous
la forme d’une variante : « Il n’y a que des individus et des
communautés ». Le terme « communauté » est ici pris comme
équivalent à « culture » et en fin de compte à « langage »,
à quoi s’adjoint « individu » qui vient à la place de « corps ».
L’omniprésence, dans la néo-langue aujourd’hui dominante, de la
conjonction des termes « ensemble » et « différent ».
Quelques exemples tirés du livre de E. Hazan : LQR – La propagande du
quotidien (édit. Raisons d’agir
2006) [LQR pour Lingua Quintae Respublicae, Langue de la Cinquième République, en hommage à Victor
Klemperer et à sa LTI] :
« Au lendemain du choix de Londres pour les Jeux 2012, [B.
Delanoë] confie de Singapour au Figaro (7 juillet 2005) : « Je pense d’abord à tous ceux qui, à Paris,
en France et dans le monde, ont porté cette candidature [de Paris], son
exigence, ses valeurs, à ceux qui ont eu le plaisir de construire ensemble en étant différents » (p. 111-112) [souligné par A.B.]. « La
France est une terre d’accueil et d’ouverture. Elle est riche d’une diversité
qui est au cœur de son identité » (J. Chirac [ou celui qui écrit ses
discours] devant la 2ème université d’été du mouvement « Ni
putes, ni soumises » 8 octobre 2004) (p. 48).
La « communauté » permet l’articulation correcte (au sens de
« politiquement correct »), i.e. normative, de la conjonction
ensemble-différent : elle avère la diversité (il y a différentes
communautés, et toutes méritent égale reconnaissance et protection par la loi)
et elle s’intègre harmonieusement avec ses semblables dans l’ensemble démocratique.
« Cependant, le matérialisme démocratique admet un point d’arrêt
global à sa tolérance multiforme. Un langage qui ne reconnaît pas l’universelle
égalité juridique et normative des langages ne mérite pas de bénéficier de
cette égalité » (Logiques des mondes
p. 10). La promotion d’un langage particulier comme « mauvais
langage » est une conséquence inévitable de ce dispositif ; et il est
clair que cette fonction, il n’y a pas si longtemps assurée par
« totalitarisme », est aujourd’hui dévolue à « Islam ». Il
est de la nature du matérialisme démocratique de sécréter quelque forme
d’hétérophobie (phobie de l’autre).
Si on considère la triangulation ensemble / différent / victime, le
signifiant qui surgit pour verrouiller cette figure – et pour assurer le
gardiennage le plus efficace de la conjonction ensemble-différent – est
aujourd’hui le signifiant « juif ». De fait, la destruction des Juifs
d’Europe par les nazis fournit une base historique irrécusable à la convocation
de ce signifiant-là pour désigner la position victimaire.
Mais, d’une part, on se reportera à ce que dit L’Ethique (de A.B.) quant à ce que signifie la promotion de la
position victimaire [ainsi : Toute intervention au nom de la civilisation exige un mépris premier de la situation tout entière, victimes
comprises » (L’éthique édit.
Hatier p. 15) et « Le lien entre politique et Mal s’introduit (…) du biais
de la prise en considération, et de l’ensemble (thématique des communautés), et
de l’être-avec (thématique des consensus, des normes partagées) » (p. 59).
Et d’autre part, ce qui arrive là au signifiant « juif » est
précisément quelque chose qui lui arrive (on peut même dater d’une vingtaine d’années, pas plus, la construction
idéologique qui a abouti à ce que « juif » soit le nom qui fasse
signe pour désigner la triangulation ensemble / différent / victime) ; il
n’y a rien dans son essence qui le prédispose à cette fonction. Pire :
c’est la signification propre d’universalité impliquée dans le signifiant « juif » qui
est sacrifiée dans cette opération.
Placé dans la position de verrou qui vient d’être dite, le signifiant
« juif » est devenu un bastion fort du matérialisme démocratique.
Trajectoire contre-nature et particulièrement dangereuse …
***
Commentaire du schéma introduit la dernière fois :
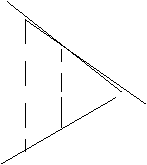

Les extrémités du cône sont désignées par : MULTIPLICITES
INDIFFERENTES (point sup. gauche), EVENEMENT (sommet droit), VERITES ETERNELLES
(point inf. gauche).
Dans l’espace entre les deux diagonales il y a Il y a. C’est-à-dire
au centre – car telle est bien la « place » de « il y a »,
qui nomme à la fois les multiplicités indifférentes et les vérités éternelles ainsi
que l’écart qui les sépare :
« il y a » inclut le statut de l’être en même temps que son
exception ; il désigne les deux côtés du sinon que.
La région de l’être est située au-dessus de la diagonale
supérieure : elle est ce qui rend intelligible ce qui s’espace entre les
multiplicités indifférentes et l’événement. Elle est par conséquent ce qui
permet de penser qu’un événement advient au multiple : que l’événement a un
lieu, son lieu, qu’il advient à telle
situation, pour reprendre le lexique de L’être et l’événement (je dirai aujourd’hui : à tel monde) ; ou encore : que telle situation
est exposée à la possibilité événementielle.
La région du sujet est située au-dessous de la diagonale
inférieure : elle est ce qui rend intelligible ce qui s’espace entre
l’événement et les vérités. « Sujet » est en effet ce qui nomme cet
espacement, ce qui, sous la condition surnuméraire d’un événement (alors que la région de l’être est
sous la seule condition des multiplicités indifférentes), et porté par un
corps, en configure les effets de vérité.
Si on chemine sur la diagonale supérieure, une série de notions est
inscrite que nous rencontrons pas à pas – successivement : être-là ;
consistance logique ; transcendantal ; inexistant ; points.
« Evènement » est
situé au sommet du cône.
être-là [les définitions
sont tirées du « Dictionnaire des concepts » qui se trouve à la fin
de Logique des mondes] :
désigne le multiple pensé selon son apparition dans un monde, le multiple pensé comme
« là », et non selon sa stricte composition ontologique.
[consistance] logique :
théorie générale de l’être-là, i.e. théorie générale de l’apparaître ; ce
qui permet la pensabilité de la cohésion de ce qui vient à exister – autrement
dit : la pensabilité de ceci que dans l’apparaître (soit en dehors de la
mathématique), il n’y ait pas le chaos.
transcendantal :
concept central de la théorie de l’apparaître ; désigne la capacité
constitutive de tout monde d’attribuer à ce qui se tient là, dans ce monde, des
intensités variables d’identité à tout ce qui s’y tient également. Ce qui
apparaît dans un monde est réglé par le transcendantal selon un réseau de
différences et d’identités. Le terme est à l’évidence repris de Kant, mais avec
deux altérations majeures : a) il n’est supposé aucun sujet constituant au
transcendantal (le transcendantal est une disposition immanente à l’apparaître
lui-même) ; b) il n’y a pas d’unicité du transcendantal (il y a des logiques et donc il y a des mondes).
inexistant : désigne
l’élément d’un multiple qui existe « le moins possible » dans le
monde ; on pourrait dire : le néant d’un monde ; ce qui y
apparaît sur le mode nul tout en y étant.
points : un point du
(transcendantal d’un) monde est la comparution de la totalité infinie du monde
devant l’instance de la décision, soit la dualité du « oui » et du
« non ». Un monde sans point sera dit atone ; un monde avec beaucoup
de points sera dit tendu.
événement : j’en
distingue 4 types :
la modification : désigne un changement dans le
monde qui ne résulte d’aucune transformation du transcendantal (le monde change
en restant sous la même loi)
le fait : désigne une perturbation locale réelle
d’intensité faible
la singularité (faible) : désigne une
perturbation locale réelle d’intensité forte, mais dont les conséquences ne
comportent pas que l’inexistant du site acquiert une existence
événement (ou singularité forte) : perturbation
locale réelle dont les conséquences comportent que l’inexistant du site
acquiert une existence. L’événement ayant disparu, il en reste dans le monde
une trace effective, la trace événementielle (alors que dans L’être et l’événement, il n’en restait que le nom) ; la trace est une supplémentation du monde (autour de laquelle va s’organiser un nouveau
corps).
Je vous avais signalé qu’une lecture verticale du
schéma était possible en considérant les couples constitués par une notion
située sur le « côté des multiplicités » (diagonale supérieure) et
par celle qui lui est associée sur le « côté des vérités » (diagonale
inférieure). La liste de ces couples conceptuels donne par conséquent :
Être-là / Présent créateur
Consistance logique /
Nouveau corps
Transcendantal / Conditions
d’existence pour un nouveau corps
Inexistant / Trace
Points / Organes du corps
Remarquons que, les diagonales étant
orientées, lorsque l’on progresse dans l’intelligence du mouvement subjectif
(i.e. de l’événement vers les vérités éternelles), on effectue un mouvement de
rétrogradation sur l’autre diagonale : ainsi « nouveau corps »,
qui est l’avant-dernier terme sur le « côté des vérités », est couplé
à « consistance logique », qui n’en est que le deuxième terme de
l’autre côté. Ce qui a une signification profonde : quand on se rapproche
des vérités, on s’enfonce dans l’être : plus on est éclairé par l’éclat
des vérités et plus on côtoie les multiplicités indifférentes dans leur
dissémination - c’est ce que, dans L’être et l’événement, j’avais appelé le caractère générique des vérités.
Voilà un point dialectique
fort (qui contribue à justifier l’appellation « dialectique matérialiste »). Plus une vérité est distincte,
et plus elle est intelligibilité de l’indistinct.
26 AVRIL 2006
Hommage à deux disparus : le jeune philosophe français François
Zourabachvili et le poète russe (et tchouvache) Aïgui.
*
Un point concernant le récent mouvement anti-CPE. Trois questions
méritent d’être posées.
1) Dans quelle séquence s’inscrit-il ? Trois réponses
possibles : selon une vision ultra-courte, la plus homogène il faut le
remarquer, le mouvement est coextensif à la durée des manifestations qui ont eu
explicitement pour thème le retrait du CPE, soit environ deux mois ; selon
une vision moins courte (et moins homogène aussi), la temporalité du mouvement
doit inclure la révolte des jeunes des banlieues et la séquence qui nous
intéresse commencerait alors en octobre-novembre 2005 ; enfin, selon une
vision longue, le début de la séquence remonterait en fait à décembre 1995 avec
les manifestations contre le projet Juppé sur les retraites et elle se
poursuivrait avec les mouvement des sans papiers et notamment l’occupation de
l’église Saint-Bernard (1996) pour inclure également le non au référendum sur
la Constitution européenne.
Vous voyez immédiatement que la question de l’ouverture des possibles
qui accompagne celle de la datation de la séquence reçoit des réponses tout à
fait différentes selon le type de réponse apportée.
2) A supposer que cette question ait été résolue, il faudrait aborder
celle de l’unité subjective du mouvement. Par exemple : quel(s) mot(s)
d’ordre se sont-ils dégagés dont on pourrait dire qu’ils ont condensé cette
unité subjective ? La réponse n’est pas claire tant les mots d’ordre de la
période ont oscillé entre la particularité tactique (retrait du CPE) et une
grande généralité idéologique (critique du libéralisme), sans qu’aucun ait pu
prétendre assurer la jonction de ces deux aspects.
3) Enfin, à supposer qu’une formulation subjective ait pu être
clarifiée, il faudrait se demander dans quel espace politique elle
s’inscrirait. Pour le dire nettement : le mouvement était-il ou non
interne au parlementarisme ? Y a-t-il au fond un autre enjeu politique que
la remise en selle de la gauche ? Nous avons déjà longuement traité de
cette catégorie de « la gauche » ; il ne fait pas l’ombre d’un
doute que l’embuscade pour mettre dans la balance le poids du mouvement en vue
des élections de 2007 est déjà tendue – dans la perspective d’une victoire de
la gauche, le remplacement du CPE ne devrait pas poser de problème : je
propose dès maintenant de le renommer CPA ou Contrat Pour l’Avenir …
Tout ceci pour dire que, du moins dans l’étape du mouvement que nous
connaissons, l’hétérogène naturel légué par la situation – ce que Mao aurait
appelé les contradictions au sein du peuple – n’a pas été transformé en espace
politique nouveau. Le plus difficile reste donc à faire. Et le mouvement a
mangé son pain blanc.
*
Revenons à notre schéma.
La région du il y a nomme, nous l’avons vu, les multiplicités
indifférentes et les vérités éternelles ainsi que l’écart qui les sépare. Ce
qu’il s’agit de penser c’est comment dans un même monde une juxtaposition est possible entre multiplicités
indifférentes et vérités éternelles. C’est une question apparemment très
différente de celle de Platon puisque chez lui il y a deux mondes : le sensible et l’intelligible. Mais
c’est une présentation de Platon un peu scolaire : car ce qui est
véritablement platonicien, c’est la question de la genèse du deux : comment se fait-il que cette table qui est là
devant moi ne m’apparaît comme table que parce qu’elle communique avec l’Idée
de table (comment communique-t-elle ? c’est tout le problème, que Platon
résout par ce qu’il appelle la participation et qui n’est pas simple). C’est
pourquoi la question que nous nous posons, qui est celle du deux au point du
même, est en son fond une question de
type platonicien. Je considère même comme une maxime typique du platonisme la maxime
suivante : Tout un est deux. Ce qui donne dans nos termes : tout monde est
susceptible d’être le lieu de quelque chose de trans-mondain, d’être le lieu de
quelque chose qui dans un autre monde est (a été) identifiable comme vérité –
et qui peut être réactivé.
Nous avons dit que l’événement était la survenue d’une dé-régulation du
transcendantal. La question de la datation d’une séquence telle que nous
l’avons évoquée tout à l’heure n’est autre que la question de l’amplitude
temporelle, ou de l’échelle, à partir de quoi l’événement peut être disposé
pour être ce qu’il est, soit l’ouverture d’une multiplicité de possibles.
On ne parlera d’événement que s’il y a relève de l’inexistant. Il s’agit donc, fondamentalement, d’identifier pour
un monde son point d’inexistence : qu’est-ce qui y inexistait de telle
sorte que l’événement le fait apparaître dans un état d’existence
indubitable ? S’agissant du soulèvement des jeunes des banlieues, il est
tout à fait clair que ce dont il s’agit c’est que des gens d’ici sont
considérés comme des corps étrangers. Le moment de la révolte a correspondu à
l’apparition de cet inexistant sur le devant de la scène avec une intensité
maximale : on ne voyait et parlait que de cela, donnant lieu à un
foisonnement d’opinions et de discussions : ces corps inexistants subitement
envahissants, « en trop », on découvrait que ce qu’on désirait c’est
qu’ils n’aient jamais existé et on souhaitait publiquement, puisqu’ils
« n’aiment pas la France », qu’ils la quittent – par
parenthèse : je trouve cet argumentaire cocasse ; il m’arrive souvent
de ne pas trouver la France aimable, je ne vois véritablement pas ce qu’il y
avait à aimer dans la France de Pétain ou, quand j’étais jeune, dans la France
de la guerre d’Algérie ; il ne s’ensuit pas que le départ devienne de ce
fait impératif. Il faut admettre qu’il n’est pas donné à tout le monde d’être
en état de trouver que Sarkozy est un type formidable. La véritable question,
vous le voyez bien, c’est : qui existe ici ? Question qui a été beaucoup moins évidente dans le
mouvement anti-CPE, où ce qui frappe avant tout c’est la dimension
conservatrice (au sens strict du mot : un mouvement dont l’enjeu est que
les choses restent comme elles sont) – en sachant qu’à ceux (et ils ont été
nombreux) qui ont reproché aux jeunes de ne pas aimer prendre de risques, eux
dont le but suprême serait d’être des fonctionnaires etc., on ne peut que
répondre : « pourquoi prendraient-ils des risques, si après
avoir été taillables et corvéables à merci, le résultat de ces prises de
risques est l’enrichissement de la même poignée de milliardaires … »
Supposons que le monde ait été affecté par un événement. Nous allons
examiner les corrélations qui
s’établissent entre les termes des deux diagonales de notre schéma selon la
« lecture verticale ».
1ère corrélation : inexistant / trace.
Une fois l’événement disparu (car un événement finit toujours par
disparaître), quelle va en être la trace dans le monde ? Ma réponse est
que cette trace est précisément la relève de l’inexistant. Réponse différente
de celle que j’avais avancée dans L’être et l’événement, car elle tient compte des critiques qui m’avaient
été faites à l’époque (principalement par J.F. Lyotard) : ma thèse dans L’être
et l’événement était que la trace de
l’événement évanoui était sa nomination : il s’agit d’un processus truqué,
avait déclaré Lyotard, car la nomination suppose un sujet qui n’est justement
constitué que par cette nomination même. Dans Logiques des mondes, je soutiens que la trace de l’événement coïncide
avec la relève de l’inexistant, i.e. avec la visibilité intense de quelque
chose qui, tout en étant, était auparavant en retrait de l’apparaître. Ce
statut est aujourd’hui selon moi celui des prolétaires d’origine étrangère ;
mais vous le rencontrez aussi bien dans l’exemple (canonique) de la rencontre
amoureuse : il y a là quelque chose qui n’avait proprement pas lieu d’être
et qui apparaît avec une intensité ravageuse (et d’autant plus ravageuse que
précisément, avant la rencontre, il n’y avait pas lieu que cela apparaisse).
S’il y avait une éthique générale des vérités, ce qui n’est pas évident, une de
ses maximes serait certainement d’être vigilant à ce qui n‘apparaît pas –
par parenthèse, c’est l’exact opposé de la figure commerciale qui enjoint de ne
s’intéresser qu’à ce qui apparaît maximalement (« déjà 2,5 millions de
spectateurs ont vu ce film » ; « taux de satisfaction = 85
% » ; le fait que de tels énoncés puissent avoir une valeur
publicitaire, l’idée d’être comblé à pouvoir être compté comme le 2,5
millionième + 1 cela est typiquement anti-événementiel).
2ème corrélation : consistance logique / nouveau
corps
La trace seule demeure une fois l’événement disparu ; c’est elle
qui va (main)tenir le non-apparaître dans l’apparaître ; c’est autour
d’elle que va s’organiser une multiplicité que j’appelle un nouveau corps. Ce nouveau corps (de vérité) est constitué de ce qui
existe maximalement en relation avec la trace, de ce qui s’incorpore à une vérité en devenir. Il est corrélé avec la
consistance logique car la question majeure pour le nouveau corps est celle de
la consistance – mais comment consister, selon quels principes singuliers,
puisque, l’événement précisément l’atteste, le transcendantal a été
remanié ? Quelle va être la consistance, forcément nouvelle, de la
procédure de vérité ? En politique, cette question est évidemment celle de
l’organisation ; mais elle n’est pas propre à la politique, elle concerne
tous les types de procédures de vérité : dans l’amour, c’est la question
du couple, et plus exactement de ce que je nommerais volontiers la discipline
du couple – soit la question du
nouveau régime de compatibilité immanent qui régit le processus de
vérité ; mais c’est aussi la nouvelle disposition du corps poétique
qu’invente un poème : ainsi la coupure nouvelle dans les langues russe et
allemande liée à la figure de l’interruption dans les poèmes respectifs d’Aïgui
et de Celan.
3ème corrélation : être-là / présent créateur
Il en résulte un nouveau présent, qui est le mode propre d’apparaître
d’une vérité dans un monde : être contemporain du nouveau corps implique
une nouvelle temporalité, une nouvelle manière de vivre au présent.
4ème
corrélation : transcendantal / conditions d’existence pour un nouveau
corps
Mais l’expression de ce
présent créateur est-elle autorisée par le transcendantal du monde ? Il y
a en effet des conditions restrictives qui rendent compte de ce que ce n’est
pas dans n’importe quel monde que n’importe quoi peut surgir (penser le
contraire relève de ce que Novalis appelait « l’idéalisme
magique ») : ces conditions sont les conditions transcendantales
liées au monde dans lequel a lieu le surgissement ; et elles s’articulent
autour de la possibilité même de l’incorporation : pour que l’incorporation
soit possible, il est indispensable que le nouveau corps ne soit pas un corps
fermé. Car dans une telle éventualité, l’inertie de sa fermeture transformerait
l’événement en pure répétition. On le voit bien dans l’amour, où la
fermeture du corps s’appelle jalousie (voyez La Prisonnière de Proust). L’amour s’y transforme en itération, en
piétinement, de la trace ; ce qui reste de la rencontre amoureuse, dès
lors que soustrait au monde, soustrait à l’exposition au monde, donne lieu à
une expérience défensive et fait surgir la figure ét(h)ique de l’impuissance.
Avec cette sorte de restriction dans l’espace des vérités, une espèce de
« finitude » est donc quand même en définitive présente.
5ème
corrélation : points / organes du corps
Le point est le lieu de
l’incorporation. C’est le lieu, je l’ai dit, où l’infini comparaît devant le
Deux du choix. Quand le monde contient peu de points - ce que j’appelle un
monde atone - il y a donc peu de moments d’incorporation, peu d’expériences
décisionnelles, peu d’occasions où l’on est sommé de parier quelque chose. Répétition
et incorporation sont indiscernables. Pour qu’un monde atone cesse de l’être,
il suffit parfois simplement de changer d’échelle : ainsi le mouvement
anti-CPE, dont nous avons vu qu’en l’état il se prêtait peu à la novation
politique, du moins dans la vision ultra-courte que l’on en a, peut – peut-être
– s’intégrer dans un espace qui contient des points si on l’inclut dans une
séquence plus vaste débutant avec décembre 1995. L’organe c’est ce qui, dans le nouveau corps, est apte à
traiter les points. Y a-t-il dans le mouvement un organe apte à traiter le
point « récupération par la gauche parlementaire » ? De façon
générale, l’organe est ce qui est apte à traiter un point au bénéfice d’une ré-ouverture
de l’incorporation, de la
réactivation d’une vérité trans-mondaine qui, du fait même qu’elle est
réactivable dans un autre monde, est éternelle.
31 MAI 2006
En complément de l’hommage à Aïgui : lecture du poème Nietzsche
à Turin (se reporter au livre de Léon
Robel paru chez Seghers dans la collection « Poètes d’aujourd’hui »1).
Vous connaissez mon attachement à la mathématique. Eh bien celui que
j’ai pour la poésie n’est pas moindre. Il s’agit pour moi, vous le savez, de
deux conditions fondamentales de la philosophie, chacune spécifiée par son type
d’énonciation propre. Le poème, comme forme radicale de la langue, comme ce qui
fait matière de l’abrupt dont la langue est capable, est toujours dans la forme
de la déclaration ; il est à ce titre éminemment singulier. Il s’oppose en cela à la dimension argumentative
de la mathématique qui, quant à elle, est foncièrement anonyme, étant normée par une conformité à une règle partagée
(partageable) par tous et à son intégrale transmissibilité. Je soutiens
cependant que l’indifférence conjointe au mathème et au poème définit l’anti-philosophie dans sa variante
basse, pas celle des grands anti-philosophes (de Rousseau à Lacan), mais
l’anti-philosophie proche du journalisme, celle qui est en définitive à
l’unisson des opinions.
*
Une autre disparition récente, celle survenue à l’âge de
quatre-vingt-quatorze ans, de Jean Grosjean. Je vous recommande vivement la
lecture de ses poèmes (Elégies) et
surtout de ses proses courtes qui, sous le nom de « récits »,
inaugurent en réalité un nouveau genre littéraire : Clausewitz (un pur chef-d’œuvre), Elie, Darius, Pilate,
Jonas, Samson …
*
Un bref conseil : intéressez vous à ce qui se passe actuellement
en Afghanistan car l’importance de la guerre qui s’y déroule tend à être
minorée par rapport à celle en Irak. C’est pourtant la première de celles
qu’ont menées les Américains dans la région après le 11 septembre, dans
l’approbation quasi-générale (les talibans étant universellement honnis). Ils y
rencontrent une résistance opiniâtre (la moitié sud du pays échappe à leur
contrôle, il y a eu tout récemment d’importantes manifestations anti-US à
Kaboul). L’armée française, et c’est une grande différence par rapport à
l’Irak, est tout à fait présente sur le terrain, ce qui fait de ce conflit un excellent
analyseur de la position de la France sur le plan international. L’Afghanistan
est, avec l’Irak et l’Iran, un élément majeur de la scène politique qui se joue
là-bas à l’heure actuelle.
*
C’est à la pensée de la conjonction d’une incommensurabilité que nous
sommes voués, celle des multiplicités indifférentes et des vérités éternelles.
Indifférentes, les multiplicités le sont essentiellement au sens. Nous ne parlerons pas pour autant de non sens :
les thèses absurdistes (échos du « de trop » sartrien) ne sont qu’un
renversement interne aux formules théologiques. Il faut plutôt se situer en
amont du partage du sens et du non sens,
dans une région hors du sens qui n’implique cependant pas son impensabilité. Et, de fait, qu’il puisse y avoir une vérité hors
sens est quelque chose que la science mathématique vérifie jour après jour. Les
vérités éternelles attestent l’existence de processus en exception, en incise,
aux multiplicités indifférentes. La thèse pourrait se formuler ainsi :
l’indifférence absolue de l’être comme tel ne fait pas obstacle à la
reconnaissance en exception des vérités éternelles.
C’est une thèse de l’époque de la mort de Dieu. Quand on dit « Dieu
est mort », on suppose que le Dieu dont on parle était vivant et qu’il lui
est arrivé quelque chose sous la forme d’un événement, événement qui est précisément
sa mort. Or « Dieu », dans le dispositif de la métaphysique, était le
garant que les vérités ont du sens ; ce que nommait « Dieu »,
c’est la conjonction du sens et des vérités – et même d’une Vérité :
tenant-lieu de l’infini, « Dieu » nommait un point de vérité
éternelle.
Dire que la mort de Dieu est un événement réel, et prendre cet énoncé
au sérieux, c’est en particulier assumer que cette mort est irréversible. C’est
donc aussi dire que les « intégrismes, loin de manifester un « retour
du religieux », sont des formations politico-étatiques bien
contemporaines, réelles - et virulentes - inventions dans l’espace de la prise
du pouvoir » (v. Court traité d’ontologie transitoire chap. « Dieu est mort »), analysables dans
l’espace de la politique et non de la théologie.
Assumer la mort de Dieu (= assumer le fait que cet événement nous est
arrivé), c’est se prononcer sur la séparation du sens et des vérités. Or, ce
n’est pas ce qui se pratique habituellement ; car, le plus souvent, le
thème de la mort de Dieu est utilisé pour substituer la question du sens à
celle des vérités : nous serions devenus orphelins des vérités éternelles
et serions désormais livrés à la seule question des conditions de production du
sens, i.e. à la question de la pluralité des interprétations. Tel est le geste inaugural de Nietzsche, à la suite
duquel se sont engouffrés tous les relativismes, mais aussi la posture de
Deleuze et sa réflexion sur, précisément, la logique du sens. Deleuze m’a une fois écrit qu’il n’avait « pas
besoin » de la catégorie de vérité. Mais si le Sens est un nom suffisant
pour la vérité (car Deleuze semble parfois identifier les deux termes) alors
c’est que Dieu existe (sur tout ceci : cf. Logiques des mondes p. 408-10). Pour moi, dans la mort de Dieu, c’est le
sens qui est sacrifié, et non les vérités : « en tant que dysfonctionnement
localisé du transcendantal d’un monde, l’événement n’a pas le moindre sens, ni
n’est le sens » (LM p. 408). Cette défection du sens, c’est ce que
pratique quotidiennement la mathématique, nous l’avons dit ; mais c’est
aussi aux lisières du hors sens que s’aventure l’entreprise poétique. C’est la
raison fondamentale pour laquelle selon moi poésie et mathématique sont toutes
deux considérées comme des épreuves pour la pensée.
Si conjoindre multiplicités indifférentes et vérités éternelles
apparaît comme la conjonction d’un incommensurable, c’est précisément parce que
ce court-circuit revient à se passer de la médiation du sens. Ce propos de
raccordement peut être décrit comme la surrection d’un sujet dans l’étalement,
dépourvu de sens, du multiple – il y faut (juste) un point focal de
discontinuité, l’événement, et une série de conditions connexes, les différentes
« stations » figurées sur les deux diagonales de notre schéma.
*
Je voudrai apporter quelques précisions sur certaines de ces
« stations ».
Point : un point du
(transcendantal d’un) monde est, nous l’avons vu, la comparution de la totalité
infinie du monde devant l’instance de la décision, soit la dualité du
« oui » et du « non »., C’est la forme du monde qui
contraint à ce choix, il ne s’agit aucunement d’une délibération abstraite
(« tout choix est un choix forcé », disait Lacan). Ce choix s’impose
cependant pour autant qu’un sujet
est en cause ; quand un corps subjectif est parvenu à traiter un point,
c’est là qu’il est légitime de parler
de victoire – de victoire
subjective. A quoi sert-il, pour un corps subjectif, de remporter des
victoires, i.e. d’être parvenu à traiter un point ? La réponse est : à se
renforcer. Autrement dit, à être apte à traiter de nouveaux points (à remporter
d’autres victoires, à venir). Il n’y a de victoire que point par point. Mais
jusqu’où comme ça ? Jusqu’à la transformation du monde ? Réponse
fallacieuse, ou plutôt illusoire (mais d’une illusion nécessaire) : l’idée
d’une transformation du monde est inconsistante, elle n’est qu’un
accompagnement nécessaire pour le corps subjectif, pour le renforcement du corps
subjectif : pour que le monde puisse être transformé, il faudrait déjà que
le monde fût un tout - ce qui est contradictoire avec nos axiomes. Jusqu’où
alors ? Réponse : sans fin. Il n’y a pas de dernier point. Le sujet fidèle se définit comme celui qui ne renonce pas à traiter
les points, sans fin.
Trace
La trace (de l’événement) est la relève de l’inexistant.
C’est donc un phénomène de l’apparaître, la conséquence d’une modification de
l’évaluation transcendantale. Relisez le paragraphe 1 du texte « Qu’est-ce
que vivre ? » et vous comprendrez que « la première directive
philosophique à qui demande où est la vraie vie est .. la suivante : « Prends
soin de ce qui naît. Interroge les éclats, sonde leur passé sans gloire. Tu ne
peux espérer qu'en ce qui inapparaissait. » Tout héroïsme fondateur [et en
particulier celui que j’ai nommé « héroïsme mathématique », de ce
qu’il crée la vie point par point] se fait au détriment de ce qui importe. On
peut remarquer à cet égard l’inaptitude constitutive des grands moyens d’information
à repérer la survenue des choses importantes puisqu’ils ne prêtent attention,
précisément, qu’à ce qui compte.
D’où l’opération paradoxale qu’est l’incorporation à
la trace. Paradoxale puisqu’il s’agit d’accorder sa propre
intensité d’existence à une chose dont on témoigne qu’elle apparaît
maximalement alors même qu’elle inapparaît pour énormément d’autres témoins. Il
n’est d’ailleurs pas étonnant que ceux-ci réagissent en traitant les différents
expérimentateurs de vérités de « visionnaires », de
« fous » etc. Ce n’est pas sans raison quand on pense aux individus
engagés dans les passions amoureuses, dans ce qu’on appelle les
« utopies » politiques, ou bien dans les inventions
artistiques : ils ont effectivement des « visions » que la
plupart de leurs contemporains n’ont pas et ils en font propagande ; ils
font exactement propagande pour un insoutenable. Des gens qui ont des
« visions », il faut reconnaître qu’il y en a pléthore. Que dit-on de
la jeune fille qui a aperçu la Vierge dans un arbre ? On dit qu’elle a eu
une vision. La véritable question est : comment reconnaître qu’une vision
n’est pas fallacieuse ? Il n’y a qu’une seule réponse : par ses
conséquences. Et plus exactement : par l’appareil de ses conséquences (cf.
plus bas).
Organe : c’est ce qui, dans
le nouveau corps subjectif, est apte à traiter les points. Il y a là aussi un
paradoxe : car l’organe, en raison même de cette fonction, tend à se
spécialiser au sein du corps subjectif (l’organe devient le spécialiste du
traitement des points) et ce faisant il se sépare du reste du corps. La
division qui en résulte au sein du corps subjectif entre en contradiction avec
ce qui en fait la force, à savoir son unité. Dans Logiques des mondes,
j’ai donné comme exemple de ce processus la révolte des esclaves autour de
Spartacus (en 73 av. J.-C.) : v. p. 59 sq. L’armée qui s’est alors
constituée a été amenée à traiter des points successifs dans la situation, soit
« ce qui confronte la situation globale à des choix singuliers, à des décisions
où sont engagées le « oui » et le « non ». Faut-il
réellement marcher vers le sud, ou attaquer Rome ? Affronter les légions,
ou se dérober ? Inventer une nouvelle discipline, ou imiter les armées
régulières ? » (LM p. 60). Les organes apparus au sein de l’armée des
esclaves pour traiter ces points se sont comportés comme des détachements
spécialisés ; en réalité, « le corps … est … toujours divisé par les
points qu’il traite » (LM p. 61). Or, il est essentiel, pour l’avenir même
du corps subjectif, de trouver une compatibilité entre la spécialisation et
l’unité subjective. Exigence de compatibilité qui doit amener à reformuler
le principe même de l’unité, à l’épreuve des points.
En politique, cette question n’est autre que la recherche
d’une compatibilité entre organisation et unité subjective.
Cette question décisive est au centre du livre magnifique d’André Malraux L’Espoir.
On y voit opposés, dans le contexte de la guerre d’Espagne, les tenants de ce
qu’il a appelé « l’illusion lyrique », à savoir ceux qui entendaient
s’appuyer principalement sur l’élan des masses, sur la force liée à l’unité
subjective des combattants (principalement représentés par la mouvance
anarchiste) et ceux qui donnaient la priorité à l’organisation, à la discipline
(globalement : les staliniens). Et comme vous le savez les affrontements
fratricides auxquels cette opposition a donné lieu ont été particulièrement
sanglants.
La résolution de ce type de problèmes est proprement l’épreuve
existentielle des vérités. Il n’en est de solution que cas par
cas. En sachant qu’il n’est rien de plus périlleux qu’une victoire. Une
victoire c’est le traitement réussi d’un point. Et c’est l’organe qui en
définitive remporte la victoire. Quand une victoire a été remportée, il importe
encore de vaincre la victoire elle-même – à savoir de remettre l’organe à sa
place. Et pour cela, la meilleure boussole c’est de ne
jamais oublier l’inexistant – l’inexistant dont procède, en
dernière instance, le corps subjectif. La fidélité, c’est ne pas
renoncer à traiter les points, nous l’avons vu, mais en le faisant dans
l’élément de la relève de l’inexistant. Le péril majeur réside en ce que la
victoire peut vous faire oublier l’inexistant. C’est précisément là que l’on
peut dire que vous avez été vaincu (et non, comme le veulent
les acceptions habituelles qui situent la défaite, en termes de résultat, du
côté de l’échec d’un processus historique, de son enlisement, de sa dénaturation,
de sa trahison etc.). Quand la victoire vous a fait oublier l’inexistant, c’est
à ce moment-là qu’on peut dire que le monde – le principe transcendantal du
monde - vous a vaincu.
On peut donner des exemples
en dehors de la politique. Le processus amoureux est amené à traiter une série
de points dans sa confrontation au monde tels que : où
logerons-nous ? où passerons-nous les vacances cet été ? etc. Le
corps subjectif correspondant est immanquablement appelé à se spécialiser et,
de victoires en victoires, est susceptible de se transformer en machine
familiale ; le cas typique est celui de ces couples qui s’occupent si bien
de leurs enfants qu’ils s’oublient eux-mêmes comme couple (ils ont oublié le
fondement même du corps subjectif qu’ils constituent, le Deux qu’ils ont amené
à l’existence par leur rencontre, et qui, antérieurement à elle, était inexistant).
[Note de DF : un
couple qui décide de placer son existence sous le commandement de l’amour
peut-il de façon conséquente se résoudre au mariage ? Dans une telle
situation, quelle place accorder à la sexualité ? Telles sont
quelques-unes des étonnantes questions que se posent les protagonistes du grand
roman de Thomas Hardy Jude l’obscur]
*
Voici un poème de Wallace Stevens que
nous commenterons la prochaine fois et où vous entendrez un écho de ce qui
vient d’être dit.
Un poème de
Wallace Stevens, sur le devenir-vrai (ou lumière)
Soliloque dernier
de l'amant intérieur (1954)
Lumière, la première du
soir, et c'est comme une pièce Où l'on se repose et, sans trop de raison, pense
que
Le monde imaginé est à la
fin des fins le bon.
Voici, donc, le plus
intense rendez-vous.
Et dans cette pensée nous
nous recueillons, Hors toutes les indifférences, en une chose :
En une seule chose, un
simple châle
Autour de nous étroitement
serré, car nous sommes pauvres,
Une chaleur, une lumière,
un pouvoir, la miraculeuse influence.
Ici, maintenant, nous nous
oublions l'un l'autre et nous-mêmes. Nous sentons l'obscur d'un ordre, une
totalité,
Un savoir, celui qui a
ménagé le rendez-vous.
A l'intérieur de ses
frontières vitales, dans l'esprit,
Nous nous disons que Dieu
et l'imagination ne font qu'un...
Et quelle est haute cette
lumière très haute qui éclaire le noir.
Hors de cette lumière-là,
hors de l'esprit central, Nous élevons dans l'air du soir une demeure,
Où il nous suffit d'être
ensemble.
(ln « Description
sans domicile» Traduction Bernard Noël
Editions Unes, 1989)
14 JUIN 2006
En guise de récapitulation, je voudrais situer ce que je
vous ai dit cette année dans le cadre plus large du thème débuté à l’automne
2004 et que j’ai intitulé « Comment s’orienter dans la
pensée ? »
La première année a été consacrée à l’examen de
catégories destinées à l’analyse de la situation présente, de catégories avec
lesquelles on peut penser la conjoncture. Le fil conducteur a été les
catégories de la dialectique, et plus précisément les difficultés rencontrées
dans leur maniement : nous nous sommes demandés ce que devenait la notion
d’adversaire à partir du moment où l’on n’entrait plus dans la
situation par les catégories habituelles de la négativité, mais sans renoncer
pour autant à l’existence de catégories antagoniques. On peut rétrospectivement
donner comme intitulé à cette année : « pour une théorie non
dialectique de l’antagonisme ».
L’année suivante (cette année, par conséquent) a eu
pour thème l’orientation dans l’existence. La thèse contre laquelle j’ai pris
position – thèse non formulée comme telle mais qui occupe selon moi une
position dominante dans le monde contemporain – est celle de l’indistinction de
l’être et de l’apparaître. Elle se dit : ce qui est est ce qui apparaît.
Substantialisation du semblant qui n’est rien d’autre que l’extension du
fétichisme de la marchandise déjà pointé par Marx. Ce que la critique nietzschéenne
des arrière-mondes (i.e. la mise en question de la dualité être / apparaître) a
pu en son temps avoir de pertinent est aujourd’hui exposé au péril de consonner
avec le philosophème dominant selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer ce
qui est et ce qui apparaît, et qui, en tant qu’il apparaît, est ce qui a
valeur. Cette indistinction de l’être et de l’apparaître est ce qui nous est
aujourd’hui imposé. D’où ma stratégie, qui consiste à relever le drapeau du
platonisme, tombé il faut bien le dire bien bas au cours du siècle
précédent : il s’agit de revenir à l’écart de l’être et de l’apparaître
pour tenter de s’opposer au régime implacable du semblant. Là aussi, de même
que précédemment avec les catégories du négatif, nous rencontrons un écueil
potentiel : si la distinction être / apparaître doit à nouveau être
articulée, elle doit pouvoir l’être sans pour autant avoir à sacrifier
l’apparaître au nom de la vérité. La voie est de montrer qu’une vérité
procède aussi selon l’apparaître, ce
que j’ai fait en établissant une théorie de la consistance de l’apparaître. Tel est l’objet de mon livre Logiques des mondes. Autrement dit : je récuse un certain platonisme
que l’on peut qualifier de « mystique » (et qui selon moi ne correspond
pas véritablement à la pensée de Platon) selon lequel l’apparaître est le lieu
du faux, du semblant [auquel s’opposerait le vrai, le réel – ce platonisme-là,
c’est celui que Nietzsche avait dans sa ligne de mire] ; et, symétriquement,
je récuse aussi l’idée selon laquelle l’être est à jamais retiré dans
l’inconnaissable, dans un autre monde. J’affirme au contraire que la vérité est
de ce monde et que l’être est connaissable.
Plus précisément : qu’il y a des vérités
éternelles, qu’elles apparaissent dans des mondes déterminés (elles sont intra-mondaines) et pourtant que, se soutenant de l’être, elles ne sont
pas réductibles à un monde (elles sont aussi trans-mondaines). Nous retrouvons la question du deux au point du
même (telle vérité est dans le monde et elle est (a été) identifiable comme vérité dans un autre monde), question
dont je vous ai dit la dernière fois que c’est une question typiquement
platonicienne (et que Platon traite sous le chef de la participation ou de la
réminiscence). Ce que Pascal, à sa façon fulgurante, avait déjà formulé en ces termes : « Platon, pour préparer au
christianisme ». Car pour le chrétien, il est arrivé (et d’une certaine
façon, il ne cesse d’arriver) que l’absolu est dans le monde : c’est le mystère même de
l’Incarnation. L’Incarnation c’est l’être-là du vrai comme tel. Dans mes
termes : les vérités éternelles sont l’apparition de l’universalité.
Toutes ces catégories aboutissent à la conclusion
suivante, selon moi recevable aujourd’hui : l’absolu existe. Ce qui signifie que la chance de l’absolu nous est réellement
donnée. Idée qui est tout sauf évidente aujourd’hui (la propagande autour de
nous ne cesse de la combattre) et qui nécessite de réactiver de façon
combattante l’aphorisme de Hegel : « L’absolu est auprès de
nous ». C’est une démarcation décisive : quand vous avez l’absolu
auprès de vous, de fait vous vivez autrement. De quoi s’agit-il sinon, selon une formule que
j’utilise depuis longtemps, de tenir sur l’impossible, soit de tenir sur un point réel unanimement
considéré comme impossible (ou, variante, de créer des possibles, de faire
apparaître des possibles tenus antérieurement pour impossibles). Et c’est là
que pèse, vous le savez, la propagande contemporaine dont le ressort est
précisément de contraindre au possible - aujourd’hui au possible prescrit par
les formes dominantes de l’apparaître. Il s’agit par conséquent de tenir sur
l’écart entre être et apparaître, comme principe de perturbation du régime du
possible. Je donne comme caractéristique essentielle de l’événement que l’être,
« ordinairement support des objets, « monte en personne » à la
surface de l’objectivité », i.e. de l’apparaître (cf. Logiques des
mondes p. 380).
Incidemment, ceci devrait nous apporter quelques
clartés sur la question jugée si intéressante par la propagande contemporaine,
à savoir celle de la contradiction entre les démocraties occidentales et le
fanatisme islamique. Pourquoi cette question est-elle considérée comme
tellement centrale ? La raison en est que le terroriste offre la figure
exemplaire de ce qui arrive quand on a affaire à des gens qui pensent que
l’absolu est auprès d’eux ; il suffit de regarder le terroriste pour se
convaincre qu’une telle pensée est « absolument » délétère. Il ne
fait aucun doute que tout l’intérêt de cette propagande est de
disqualifier l’idée d’une orientation possible dans l’existence à partir d’un
point d’impossible. Par ailleurs on peut aisément repérer chez les terroristes
un certain culte de la mort, l’emploi de méthodes fascisantes (tuer des gens de
façon indiscriminée) etc. qui ne méritent que la condamnation la plus ferme.
Tout le point est donc de pouvoir séparer l’exercice du jugement politique à leur égard (condamnation sans équivoque)
de la façon dont la figure du terroriste est instrumentée par la propagande –
propagande dont, je le répète, l’injonction est la suivante : « Vivez
dans la modestie du possible ! » Ce peut être sous la forme :
« Tenez-vous tranquille ! » ou « Mariez-vous et ayez
des enfants ! » ou bien « Adonnez-vous à la culture ! »
[cela fait longtemps que je pense que l’opium du peuple, ce n’est plus la
religion, mais la culture] mais cela peut aussi se décliner de diverses autres
façons, dont en définitive le cœur est : « Achetez nos
produits ! ».
*
L’année prochaine, il faudra en venir aux
prescriptions. Je dirais, en reprenant la formule de Descartes, qu’il va s’agir
de fonder une morale provisoire.
Une morale maintenant, allons bon, nous voici décidément en plein archaïsme.
Après tout, pourquoi pas ? A la place du mot d’ordre dominant
« Modernisez-vous ! », je propose celui-ci :
« Archaïsez-vous ! » J’entendrai par morale les règles minimales sous lesquelles une vie
véritable est possible pour faire face à la pression dissolvante (rappelez-vous la phrase du Manifeste :
« Tous les liens complexes et
variés qui unissent l’homme féodal à ses supérieurs naturels, [la bourgeoisie] les
a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et
l’homme, que le froid intérêt, les dures exigences du paiement “au comptant“) du
monde contemporain. La morale est ce qui organise la résistance à la
dissolution, à la multiplicité égarée
(regardez autour de vous : les gens sont profondément égarés,
désorientés). Pourquoi provisoire ? La raison en est dans le caractère
intervallaire de l’époque où nous vivons, une époque sans prédicat clarifié où
quelque chose s’achève sans que se dessine nettement ce qui est en train de se
mettre en place. Ce qui nous contraint à penser en faisant l’économie d’un sens
de l’Histoire. La situation était plus confortable quand les majuscules
(Histoire, Classe, …) travaillaient pour nous. Quoi qu’il en soit, il faut
faire avec – faire avec les vérités dont on dispose, avec l’écho d’événements
du passé déjà lointains, plus ou moins obscurcis, et l’occurrence d’événements
futurs (c’est cela un intervalle, un temps situé entre des événements) mais
sans dire pour autant que l’on attend (pour vivre) qu’il se passe quelque
chose.
La meilleure préparation à la venue d’une relance
réside dans la conviction que l’absolu réside auprès de nous.
*
Je redonne le poème de Wallace Stevens que je vous ai
lu la dernière fois.
Soliloque dernier
de l'amant intérieur (1954)
Lumière, la première du
soir, et c'est comme une pièce Où l'on se repose et, sans trop de raison, pense
que
Le monde imaginé est à la
fin des fins le bon.
Voici, donc, le plus intense
rendez-vous.
Et dans cette pensée nous
nous recueillons, Hors toutes les indifférences, en une chose :
En une seule chose, un
simple châle
Autour de nous étroitement
serré, car nous sommes pauvres,
Une chaleur, une lumière,
un pouvoir, la miraculeuse influence.
Ici, maintenant, nous nous
oublions l'un l'autre et nous-mêmes. Nous sentons l'obscur d'un ordre, une
totalité,
Un savoir, celui qui a
ménagé le rendez-vous.
A l'intérieur de ses
frontières vitales, dans l'esprit,
Nous nous disons que Dieu
et l'imagination ne font qu'un...
Et quelle est haute cette
lumière très haute qui éclaire le noir.
Hors de cette lumière-là,
hors de l'esprit central, Nous élevons dans l'air du soir une demeure,
Où il nous suffit d'être
ensemble.
(ln « Description
sans domicile» Traduction Bernard Noël
Editions Unes, 1989)
Lumière
fait ici référence à la venue d’une vérité. Il y a une lumière, la première
du soir, dont les caractéristiques
sont examinées : elle est ce qui advient, ce qui nous offre une
chance ; c’est comme une pièce où l’on se repose et non pas une excitation comme dans la
traditionnelle représentation de la venue du vrai dans la pensée dialectique
(effervescence du négatif) et, sans trop de raison, (on) pense que le monde imaginé est à la fin des
fins le bon : ce vrai, plus
fondamental, est la création d’une nouvelle forme de calme. Pas le calme
ordinaire, mais la conquête d’un calme de forme nouvelle. On a simultanément la
conversion d’un impossible en possible, ou d’un imaginaire en réel (le monde
imaginé) et une tranquillité
nouvelle, le calme d’une certitude (est à la fin des fins le bon).
Tout en étant dans le calme, c’est néanmoins le
plus intense rendez-vous. Car, hors
toutes les indifférences, hors
l’indifférence de l’être, nous nous recueillons en une chose. En une seule chose –
car nous sommes pauvres – presque
rien : un simple châle autour de nous étroitement serré. C’est une image, elle-même pauvre, mais pour dire le
nouveau, pour dire la nouvelle capacité, le pouvoir, la miraculeuse influence, ce sont ces mots, des mots nouveaux, qui viennent.
Où ? Quand ? Ici, maintenant, nous autres, animaux humains, nous allons être
au-delà de nous-mêmes, nous allons être dans une figure inédite de
nous-mêmes : nous nous oublions l’un l’autre et nous-mêmes car nous sentons la puissance du vrai, nous sentons celui qui a ménagé le
rendez-vous, façon magnifiquement
exacte de désigner la trace de l’événement. Cela fonctionne comme un savoir,
lui-même obscur.
Nous nous disons que Dieu et l’imagination ne font
qu’un … autrement dit que le monde
imaginé est à la fin des fins le bon.
D’avoir touché au vrai nous fait toucher l’infini : car l’absolu est
auprès de nous, qui nous excède. Cette lumière très haute qui éclaire le
noir figure la vérité supposée
achevée ; c’est pourquoi elle apparaît si lointaine, si haute, à nous, militants du vrai, incorporés que nous
sommes à une vérité fragile et menacée. Nous ne sommes pas dans le face-à-face
avec la vérité dans la figure de la totalité ; cette figure-là a
existé ; et aussi elle a métaphorisé la conviction qu’il y avait un esprit
central qui communiquait de façon
essentielle avec la vérité totale en position centrale. Nous sommes hors de
cette lumière-là. Aujourd’hui, nous,
la communauté des incorporés à une vérité, soustraits à l’indifférence, nous
élevons dans l’air du soir une demeure où il nous suffit d’être ensemble.
–––––––