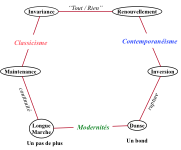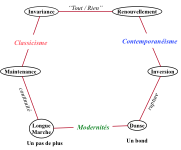
mamuphi
mathématiques - musique – philosophie

(org. C. Alunni,
M. Andreatta, A. Cavazzini et F. Nicolas)
Saison 2017-2018
Toutes
ces activités ont lieu à l’Ircam
un
samedi par mois
de
10h à 13h et de 15h à 18h en
salle Stravinsky ou Shannon
·
21 octobre 2017 - Musique
& politique (III) ; org. A. Cavazzini & F. Nicolas
·
18 novembre 2017 – Musiques
actuelles et enregistrements : éclairages mathématiques et philosophiques ;
org. M. Andreatta
·
9 décembre 2017 - Design,
science et création ; org. M. Béjean (avec l’ANR Descitech)
·
20 janvier 2018 - Philosophie contemporaine de
mathématiciens ; org. C. Alunni et C. Paoletti
·
10 février 2018 - Mathématiques
et dialectique à partir de la pensée romantique ; org.
A. Cavazzini
·
24 mars 2018 - De
l’opposition, depuis 1968, entre modernités et
« contemporanéisme » ; org. F. Nicolas
·
7 avril 2018 – Atelier Théorie
de Galois ; org. M.
Béjean & F. Nicolas
·
26 mai 2018 - La rupture de 1848 ; org.
V. Anger – La séance est annulée et reportée à la
prochaine saison.
***
Pour tout contact:
–
Charles Alunni :
alunni [at] ens.fr
–
Moreno Andreatta : andreatta [at] ircam.fr
–
Violaine Anger : v.anger [at] wanadoo.fr
–
Andrea Cavazzini :
andreacavazzini [at] libero.it
–
François Nicolas : fnicolas
[at] ircam.fr
***
21 octobre 2017
Musique et politique (III)
·
Frederico Lyra - Adorno
malgré lui-même, ou : premiers pas vers une Dialectique Négative du
jazz [1]
·
François Nicolas - L’hétérophonie
comme formalisation musicale d’un peuple ? [2]
·
Laurent Feneyrou - Une
musique de la Révolution : Per
Massimiliano Robespierre de
Giacomo Manzoni [3]
·
Mariem Hazmoune - Le
devenir-sujet de l’objet. La voix, le timbre et la scène du commun [4]
·
Sylvain Diciolla – Égalité [5]
*
18 novembre 2017
Musiques actuelles et
enregistrements : éclairages mathématiques et philosophiques [6]
· Roger Pouivet - L’authenticité des enregistrements
musicaux [7]
· Frédéric Bisson - Surfusion musicale : états et
transitions phonographiques [8]
· Agnès Gayraud - Esthétique de la
pop et composition [9]
· Moreno Andreatta - Les maths dans la chanson : réflexions
philosophiques autour d’un outil analytique et compositionnel [10]
*
9 décembre 2017
Design,
Science et Création
·
Michel Paty - Intuition et création rationnelles en
mathématiques et en physique [11]
·
Jean-François Bordron - L’« image
médiatrice » [12]
· Mathias Béjean - Penser des pratiques de “science immersive” ? [13]
· Laure Garreau - Résidence de recherche en Design au Centre National d’Études Spatiales [14]
·
Joël Chevrier - L’alliance Sciences&Design, base
d’enseignements « Learning by doing » [15]
*
20 janvier 2018
Philosophie contemporaine de
mathématiciens [16]
·
Charles Alunni - Galois philosophe [17]
[ vidéo ]
·
François Nicolas – D’une longue marche de la modernité
musicale, à la lumière de l’algèbre galoisienne [18]
( pdf ) [ vidéo
]
·
Catherine Paoletti
- Nombre
et Consensus [19]
[ vidéo ]
*
10 février 2018
De
la singularité du vivant à la mathesis
singularis [20]
· Giuseppe Longo - La
singularité physique du vivant : où en sommes nous ? [21]
( diapositives ) [ vidéo ]
· Alessandro Sarti - Hétérogenèse différentielle et dynamiques
post-structurelles: un cadre théorique/mathématique [22]
( diapositives ) [ vidéo ]
· Andrea Cavazzini & Mathias
Béjean - Dialogue sur l’idée et les enjeux d’une mathesis singularis [23]
( diapositives ) [ vidéo ]
*
24 mars 2018
De l’opposition, depuis 1968, entre modernités et
« contemporanéisme » [24]


Expériences
· Alain Franco – L’expérience de Parts (www.parts.be)
· Jean-Luc Plouvier – L’expérience de Ictus (www.ictus.be)
[ vidéos : 1°partie – 2° partie ]
Monographies
· Eric Brunier - Manet & Cézanne, deux modernités peu
conciliables [25]
[ vidéo ]
· Rudolf di Stefano - Deleuze et la modernité cinématographique [26]
[ vidéo ]
· François Nicolas - Boulez et la modernité picturale de Klee [27]
[ vidéo ]
*
7 avril 2018
10h-18h : salle SHANNON (2° sous-sol)
Enquête
mamuphique sur la théorie de Galois
(Atelier
mamuphi : Mathias Béjean et François Nicolas)
Née en 830,
l’algèbre se retrouve, mille ans plus tard, radicalement enlisée au point que
les plus grands mathématiciens de l’époque (Lagrange et Cauchy) déclarent la
fin d’une discipline saturée et conseillent de tourner la page.
L’impasse est la
suivante : l’équation algébrique formalise une fracture, de part et
d’autre du signe « = », entre inconnue et connu en vue de la
réduire (c’est-à-dire de connaître l’inconnue). Or il va très
progressivement s’avérer que l’équation ne peut, au-delà du degré 4, être
réduite avec ses moyens propres (c’est-à-dire par radicaux) : ainsi
l’algèbre ne peut résoudre sa faille par les ressources qui l’ont constituée.
Mieux : Abel démontre que cette impuissance est une impossibilité et donc
que l’équation algébrique, qui définit un petit collectif de nombres (ses
« racines »), ne pourra, la plupart du temps, arriver à les
déterminer individuellement. Si l’algèbre s’avère n’être qu’une machine à
transformer des individus inconnus en collectifs d’anonymes, à quoi bon ?
C’est le moment
(1830) où entre en scène le Parsifal de l’algèbre, le très jeune Galois qui
réinvestit d’un œil entièrement neuf l’impasse de l’algèbre classique. En
explorant minutieusement les conditions d’impossibilité pour la
résolution des équations algébriques, il dégage la dynamique sous-jacente qui
préside au partage possible/impossible : l’impossibilité devient ainsi
circonstanciée, relative à la situation dans laquelle l’équation s’enracine
(son « corps de rationalité ») ; et si l’on ne peut déterminer
individuellement les éléments du collectif défini par l’équation, c’est parce
que la forme statique de l’équation n’avoue pas la dynamique secrète dont elle
procède. Galois dégage ainsi la dynamique de groupe (groupe de
symétries) qui rend possible/impossible le passage d’une statique de départ
(l’équation) à une statique d’arrivée (la formule par radicaux).
Ce faisant, Galois,
loin d’abandonner ou de déconstruire l’algèbre, l’étend à de tout nouveaux
horizons que, deux cents ans plus tard, la mathématique la plus contemporaine
n’a de cesse d’explorer. Ici l’algèbre classique, confinée à la statique des
équations résolubles, n’est ni détruite ni délaissée : elle devient une
survivance enclavée, un musée pédagogique, cette réserve historique qu’on fait
visiter aux lycéens pendant que l’algèbre moderne, elle, se déploie en
dynamiques de groupes dont les bonnes vieilles formules par radicaux ne
figurent plus que de rares photos instantanées.
Pour nous
mamuphistes, qui ne sommes pas tous des « working
mathematicians »,
enquêter aujourd’hui sur cette théorie de Galois, c’est bien sûr comprendre
comment opère cette nouvelle dynamique, mais c’est surtout comprendre comment
l’algèbre moderne a pu ainsi se dégager de l’algèbre classique :
comprendre les pas, les audaces, les déplacements et les renversements qui lui
ont permis de ressaisir dynamiquement l’impasse classique au point même de ses
conditions d’impossibilité, comprendre les décisions prises pour ajouter
quelque point à la situation dans laquelle le problème classique s’était
enraciné pour finalement s’y ensabler et pour ainsi la révolutionner de
l’intérieur (avec, en son cœur, cette adjonction-extension que Galois invente
pour ce faire).
Cette constitution
d’une orientation moderne au long cours est, pour nous aujourd’hui, du plus
grand intérêt, en un temps où de nouveaux interdits (de Kant à Adorno en
passant par Wittgenstein) prétendent élever chaque impuissance à la hauteur
d’un impossible pour mieux décréter la fin des politiques d’émancipation
(surgies au sortir de 1830), la fin de la musique écrite (inventée il y a mille
ans exactement), la fin du poème, la fin de la métaphysique, ad libitum…
La présentation des
principaux résultats de cette enquête mamuphique se déroulera en cinq
temps :
1. historique de l’équation
polynomiale au principe de l’algèbre classique ;
2. situation et
problématisation de l’algèbre autour de 1830 ;
3. théorie de Galois
(version de base pour équations quintiques) : on suivra ici le livre de
Ian Stewart (Galois Theory) ;
4. théorie de Galois
(version généralisée et abstraite) : on suivra ici le cours ENS d’Olivier
Debarre et Yves Laszlo ;
5. conclusions et
perspectives mamuphiques de travail.
Chemin faisant, on abordera les points suivants :
–
Pourquoi, dans « la langue polynomiale », le pluriel ne
commence-t-il vraiment qu’avec le 5, quand il commence en français avec le 2,
en grec (après le duel) avec le 3, et en langue Sakao (après le duel et le
triel) avec le 4 ?
–
Comment cette théorie articule-t-elle quatre types de structures :
les corps (de nombres), les anneaux (de polynômes), les groupes (de symétries)
et les espaces vectoriels (d’extensions) ?
–
Quel rôle joue, en toute cette affaire, la division de la même expression
polynomiale P en une fonction P(x) et une équation P(x)=0 à
partir du moment où P(x)=∏(x-Ri) met au jour que la fonction P(x)
mesure la différence synthétique de x aux racines Ri de
l’équation ?
–
Parmi les nombreuses propriétés polynomiales mises en œuvre par cette
théorie, quelles sont celles qui sont relatives (au corps de définition)
et celles qui constituent des invariants absolus ?
–
Pour ce faire, comment, en chaque circonstance, mesurer le réel d’un
produit à ce qui l’annule et le réel d’une transformation à ce qu’elle ne
transforme pas ?
–
Comment la théorie circule-t-elle entre les quatre continents
mathématiques d’alors : arithmétique, géométrie, algèbre et analyse ?
On examinera à ce titre quelques démonstrations articulant algèbre et
arithmétique, algèbre et géométrie, algèbre et analyse.
–
Comment l’adjonction-extension inventée par Galois devient-elle
l’opérateur d’une mutation décisive : de l’ancienne fonctionnalité
classique (ici polynomiale) vers la nouvelle fonctorialité moderne (ici
entre corps et groupes) ?
–
Qu’en est-il d’une dialectique mathématique entre la rationalité d’une
définition et la calculabilité d’une détermination ? Comment la
connaissance de l’inconnu se divise-t-elle ainsi en une solution
(définissant la dynamique du groupe inconnu) et/ou une résolution
(déterminant l’identité statique de l’individu inconnu) ?
–
Et, ce faisant, quelle transfiguration du désir algébriste, quels
renoncements locaux pour quelle résurrection globale ?
***
[1]
Dans cette intervention, il s’agira de relire la théorie
« Afrological » du théoricien et compositeur George Lewis à la
lumière (ou à l’ombre) de certains aspects de la Dialectique Négative de Adorno
[2] Pas plus que la différence des deux sexes (qui n’est
pas la distinction grammaticale de trois genres), l’œuvre musicale ne met en
jeu l’antagonisme politique (qui ne se réduit pas à la lutte et au combat).
Cette dernière limitation restreint la puissance formalisatrice de l’œuvre
musicale aux unités fondées sur la coexistence de termes opposés.
Dans ces conditions,
-
Peut-on étendre le type polyphonique d’unité musicale à un nouveau type
d’unité qu’on nommera hétérophonique
(tout comme le type polyphonique a
précédemment étendu les types homophonique
– cf. grégorien - et antiphonique –
cf. rondeau) ?
-
En particulier, quelle adjonction musicale mettre en œuvre pour étendre
un pluriel de voix à un multiple de collectifs vocaux ?
-
Peut-on interpréter une telle symbolisation musicale dans les termes
(entièrement hétérogènes) de préoccupations politiques contemporaines :
qu’est-ce que « peuple » veut politiquement dire, suivant quelle
dialectique entre non-antagonisme et antagonisme, et selon quelle articulation
à l’« agonisme » (H. Arendt, C. Mouffe…) ?
-
Au total, où précisément le musicien doit-il autolimiter la puissance
formalisatrice de la musique et ses raisonances
centrifuges (là même où, à partir de 1750, l’intellectualité musicale de Rameau
ne sut se suspendre) ?
[3] Lecteur
de Michelet, Mathiez ou Walter, Giacomo Manzoni a réalisé, pour Per
Massimiliano Robespierre (1975), un montage dense d’extraits de
discours de Robespierre, de témoignages de ses contemporains, d’œuvres
littéraires qui le mettent en scène et de jugements historiques, politiques et
philosophiques contradictoires, depuis la Révolution française jusqu’à la fin
des années 1950, sur son exercice du pouvoir.
Le propos de Manzoni est de représenter non les événements de la vie de
Robespierre – même s’il en conserve quelques épisodes saillants – mais sa
pensée en acte.
Musicalement, son « action scénique » déploie une
écriture essentiellement chorale, ainsi que des variations sur l’hymne que
François-Joseph Gossec composa pour la fête de l’Être suprême. En outre,
Robespierre est ici chanté non par un seul interprète, mais par un « Quatuor
vocal », intermédiaire entre le sujet et le chœur, qui altère
l’identification classique et rend collective, tel un groupe en fusion, une
vision de la Révolution et de l’Histoire.
[4] Lors de la précédente édition, quelques propositions
autour du rapport entre l’informel, le matériau et l’économicité ont été
exposées, en vue de proposer un régime esthétique de perception tourné vers le
primat, dans l’objet, des articulations entre les voix plutôt que l’analyse du
matériau. Il s’agira à présent de poursuivre l’écoute de l’œuvre de Luciano
Berio en prenant en compte la co-activité des voix par
laquelle se constituent des scènes du commun. Cet exposé s’efforcera d’acter
l’existence de l’objet, l’œuvre, en dehors de son rapport au sujet, et de
conjurer dès lors l’autorité des catégories de lecture restreignant son
existence à sa compréhension (mimesis, apparence, fiction, etc.). Nous
présenterons ensuite un cheminement qui aboutit à la perception de
l’articulation des éléments constituant l’œuvre, et ce en deux points : la
possibilité théorique et musicale d’un devenir-sujet de l’objet-voix — que
cette voix soit humaine, instrumentale ou informatique. Et l’examen du timbre
en tant que catégorie politique, en tant que singularité plurielle laquelle
configure de façon immanente le propre et le commun des voix.
[5]
Certaines notions portent en elles-mêmes
l’interdisciplinarité : c’est le cas de l’égalité, notion commune aux
mathématiques et au droit.
Nous interrogerons dans cette intervention cette
notion comme pierre de touche entre musique et politique, au travers d’un
moment historique : le XVIIIème siècle en Europe. C’est en effet à ce
moment qu’a été mis en œuvre concrète en musique le tempérament égal et qu’ont
surgi en politique les grands idéaux d’égalité dont la Révolution Française
s’est voulue l’application concrète.
Nous examinerons comment cette notion d’égalité dans
ces deux aspects a parcouru les deux siècles suivants pour aboutir au XXème
siècle au dodécaphonisme et au communisme.
Comment et pourquoi l’égalité a-t-elle trouvé place au
même moment en musique et en politique ? S’agit-il d’une nécessité
historique de l’Esprit au sens hégélien ? Sur quels points ces deux mises
en œuvre ont-elles divergé, ne se sont pas rencontrées ? Et quelles prospectives
peut-on en déduire pour le XXIème siècle pour les systèmes compositionnels et
politiques ?
[6] Cette séance est consacrée à la popular music, terme dont l'équivalent français serait celui de « musique populaire
enregistrée », comme le suggère Agnès Gayraud, ou
« musiques actuelles »,
si l'on se tient à une classification institutionnelle et académique, désignant
à la fois le rock, la pop, le jazz et la chanson. Bien que considérées
traditionnellement en opposition à la catégorie de musique savante, autour de
laquelle et sur laquelle s'est concentrée l'analyse musicale - de la naissance
de la musicologie systématique chez Guido Adler jusqu'à la musicologie générale
de Jean-Jacques Nattiez - les musiques dites « actuelles » constituent le terrain idéal pour confronter des
orientations philosophiques que l'on n'a pas l'habitude de faire dialoguer.
Loin de s'opposer ou, pire, de s'ignorer, philosophie analytique et philosophie
continentale peuvent trouver dans la popular
music un objet d'étude singulier sur lequel comparer leurs propres méthodes
avec un double regard, à la fois sur l'enregistrement mais aussi sur l'acte
créatif sous-jacent. On glissera ainsi progressivement de l'enregistrement à
l'analyse formelle des processus compositionnels à travers deux démarches créatives,
l'une puisant ses sources dans une philosophie critique et l'autre inspirée
directement d'une activité de recherche autour de la formalisation
mathématique.
[7] Dans
mon livre Philosophie du rock (PUF, 2010), je parle d’un ami pour lequel
un enregistrement ne pouvait pas être une œuvre musicale (p. 27-28). Frédéric
Bisson, dans La Pensée rock dit : « Qui reproche à un
enregistrement de ne pas être un concert ? » Cet ami, pour Frédéric
Bisson, aurait été un « idiot », faisant une erreur sommaire de catégorie.
Certes, c’était une erreur de catégorie, mais elle n’avait rien de sommaire. La
musique a été ontologiquement bouleversée par l’enregistrement, ce
n’est pas rien ! Beaucoup de gens pensent qu’un enregistrement est un
pis-aller, et que la musique doit être « vivante ». Nous avons
ainsi bien du mal à accepter qu’une œuvre musicale ne soit pas quelque chose
au-delà de son enregistrement, et accessible, au moins en droit, indépendamment
de lui. Mon ami posait ainsi un problème crucial, celui de l’authenticité
des enregistrements. Il avait tort de penser que les enregistrements manquent
d’authenticité, et j'expliquerai pourquoi, mais non, il n’était pas idiot
!
[8] La musique a
été ontologiquement renouvelée par la technologie d’enregistrement, ce fait remarquable
a été dûment reconnu par la philosophie contemporaine, notamment par les
théories de Theodore Gracyk ou de Roger Pouivet. Ces théories distinguent entre
les œuvres musicales dont l’existence ne dépend pas de leur enregistrement, et
les œuvres « phonographiques » qui, au contraire, n’existeraient pas
sans l’enregistrement qui les a construites. Mais cette différence n’est
peut-être pas si essentielle. Je défendrai une différence très différente. La
phonographie ne désigne pas étroitement une catégorie d’œuvres, mais un nouvel état
de l’expérience musicale, au sens où la physique parle des états solide,
liquide et gazeux de la matière. Or, les états musicaux ne sont pas
substantiels, ils entrent dans un système de transitions.
L’enregistrement d’une œuvre notationnelle (état gazeux) ou d’un concert (état
liquide) les fait changer d’état : il les « solidifie ». Et,
réciproquement, une œuvre aussi solide qu’une « œuvre
phonographique » est toujours en surfusion : elle conserve des
gouttes d’événements, qui sont essentielles à son appréciation adéquate. Dans
une telle reconception, la notion d’ « authenticité », appliquée
à l’enregistrement musical, pourra-t-elle demeurer pertinente ?
[9] Ce
que Roger Pouivet et Frédéric Bisson appellent le rock, je l’appelle la pop, au
sens large de musique populaire enregistrée. Comme eux, je fais dépendre
l’ontologie des œuvres pop de l’enregistrement, mais contrairement à eux,
j’estime que nous avons affaire à ce genre d’œuvres dès les premières décennies
du XXe siècle, quand Jimmy Rodgers était une star du yodel dans
toute l’Amérique via la radio, ou dès lors que les field recordings des
folkloristes ont commencé à être autonomisés de leur statut initial de
documents ou archives d’ethnomusicologie, et à être traités comme des œuvres
autonomes (initiant par exemple la carrière d’un musicien comme Lead Belly).
L’enregistrement et toutes les possibilités qu’il implique, au premier chef
desquelles, la reproductibilité, mais aussi le traitement, le mixage, est la
condition formelle indispensable pour penser la pop comme art musical. S’il est
une esthétique de la pop, elle procède tout entière de cette détermination.
Toutefois, elle ne peut se laisser comprendre pleinement qu’en fonction
d'enjeux spécifiques, au centre desquels la question de la popularité, comme
catégorie esthétique, opère comme une force de gravité. Dans un livre à
paraître, j’ai essayé de déployer une esthétique de la pop comme art musical
qui articule cette détermination ontologique (l’enregistrement) et cette force
de gravité de la popularité. Entre utopie et dystopie esthétique, la catégorie
de la popularité se laisse appréhender cette fois de manière dialectique (la
pop est tramée d’anti-pop!). La composition, dans le cadre de la musique
populaire enregistrée, procède toujours des règles esthétiques de genres
donnés. On ne compose pas de la même manière si l’on fait du heavy metal,
de la synth pop ou de la trap. Mais je m’intéresserai ici au pôle
esthétique que constitue le hit (comme utopie de la popularité et non pas
seulement comme fait industriel), susceptible de réconcilier l’expert et
l’ignorant, de transcender les genres. J'en arriverai par là à mes propres
problèmes de compositrice en rapport à ces enjeux.
[10] Loin d'être un art
mineur, la chanson pose des défis majeurs à la musicologie une fois qu'on
l'approche avec des outils formels et des modélisations computationnelles. Dans
cette présentation j'aborderai en particulier la question des représentations
géométriques et de leur pertinence dans l'analyse mélodique, harmonique et
rythmique d'une chanson. A partir d'exemples remarquables de chansons
permutationnelles (Se telefonando de
Costanzo/Morricone) et "semi-hamiltoniennes" (Madeleine de Paolo Conte) j'essaierai de montrer, à travers
quelques exemples tirés de ma propre démarche "oumupienne", comment
utiliser des techniques issues de la combinatoire et de la théorie des graphes
pour enrichir la palette d'outils compositionnel au service des "musiques
actuelles". On esquissera en conclusion les possibles implications
philosophiques d'une telle démarche computationnelle, en particulier en ce qui
concerne la nature algébrico-géométrique du style musical.
[11]
Le fait que la
connaissance scientifique soit essentiellement orientée vers l’objectivité et
la rationalité, ainsi que son caractère de réalisation collective et
historique, ont tendu et tendent encore souvent, à masquer le rôle effectif, et
en fait fondamental, qu’y tient l’aspect individuel, d’ailleurs inhérent à
toute considération sur la pensée. La pensée, et la pensée scientifique ne fait
pas exception, opère par le moyen de ”formes symboliques”, vouées à être
communiquées et transformées en référence à leur fonction, mais qui ne sont pas
concevables sans les individualités qui en sont le siège. C’est dans cette
perspective que l’on peut (et doit) admettre que la science résulte d’actes de
création par des pensées individuelles s’efforçant de comprendre ce qui est
posé au-delà d’elles-mêmes selon sa consistance et sa signification supposée
(le “monde naturel“ ou un ensemble lié d’idéalités comme celles proposées par
les mathématiques). Il est possible de suivre et d’analyser (jusqu’à un certain
point) le cheminement de la pensée créatrice de savants en accompagnant leurs élaborations,
et d’autant mieux s’ils nous éclairent par leurs réflexions sur leurs
cheminements. On proposera quelques exemples, notamment chez Poincaré pour les
mathématiques et chez Einstein pour la physique qui éclairent de manière
particulièrement parlante les rapports qu’entretiennent l’exigence
d’intelligibilité rationnelle, l’intuition prise dans un sens qu’il conviendra
de préciser, et l’imagination qui l’accompagne (également à préciser), avec la
création de formes conceptuelles et théoriques inédites, simples objets de
pensée, mais que l’on peut rapporter très exactement à des phénomènes ou à une
architecture du monde. Un vaste champ de réflexion philosophique sur la nature
et la signification de la connaissance scientifique parmi les œuvres de la pensée
humaine se trouve ainsi ouvert devant nous.
[12]
L’image a un statut
métaphysique particulier en cela qu’elle n’est pas exactement un système
symbolique et ne possède pas non plus une place déterminée dans l’ontologie.
Elle n’est pas véritablement un langage, ni non plus un objet. Elle semble,
pour cette double raison, être à la fois un monde à part et celui qui peut
résumer tous les autres. Nous dirons qu’elle est médiatrice. Nous nous
appuierons sur des exemples pris à la philosophie, et à diverses sémiotiques.
Nous penserons en particulier aux rôles des images dans le cheminement des
découvertes scientifiques.
[13]
L’ANR Descitech vise à
étudier de nouvelles pratiques de recherche et d’enseignement mêlant
scientifiques et designers dans des configurations qui s’orientent vers des
efforts d’imagination et d’exploration du sens. Considérant les constructions
symboliques, individuelles et collectives, qui émergent de telles expériences,
il ouvre à des questions sur les rapports entre expérience, formalisation et
théorie. Ces questions seront discutées au regard des exposés de la journée,
puis à partir d’une analyse des expérimentations menées dans le cadre de
Descitech.
[14]
Cette expérience de
recherche en design s’est déroulée dans un environnement spécifique, celui de
l’aérospatiale, sur lequel nous reviendrons dans un premier temps afin de
retracer les méthodes et outils qui ont été mis en place pour faire enquête par
l’immersion et « par le design ». Dans un second temps, nous présenterons les
questionnements et hypothèses de recherche (en design) qui en sont ressortis.
Aussi nous reviendrons sur la notion de modélisation en design (maquettage et
manipulation) comme un potentiel à redécouvrir pour la recherche scientifique
et l’ingénierie.
[15]
Nous avons exploré à
Paris, à Grenoble et à Shenzhen, comment des étudiants d’horizons très variés
peuvent collaborer en petit groupe (3 ou 4) sur des projets qu’ils définissent
au cours d’ateliers se déroulant dans des FabLabs /MakerSpaces. L’objectif est
de produire un dispositif, un prototype ou un device qui apporte un élément de
solution, ou qui éclaire la question, pour ensuite l’exposer en public. Dans le
cadre du projet de recherche Descitech, nous avons cherché à mieux comprendre
comment une alliance Sciences&Design constitue une base pour ces formations
et comment une stratégie très ouverte de type « Learning by doing »
permet à cette alliance de se construire et d’être féconde.
[16] À l'âge classique, mathématique, philosophie naturelle
et métaphysique se développaient de concert. La mathématique a conquis son
autonomie grâce à ce compagnonnage, mais elle a rompu ses liens historiques
avec la philosophie. Or, celle-ci ne s’en est plus guère soucié, si ce n’est en
surplomb et à travers une discipline désormais séparée, qui prend la
mathématique comme objet d'étude fantasmé, plutôt que comme alter ego dans la
puissance de pensée. Or, c’est une
problématique commune qui s’impose : celle de la philosophie dans laquelle
trois mathématiciens (Évariste Galois, Gian-Carlo Rota & Gilles Châtelet)
se sont intensément engagés, parfois au prix de leur vie, en affrontant des
questions (théoriques, sociales ou politiques) particulièrement brûlantes, et
toujours en prise directe avec leur discipline.
[17]
Il s’agit d’analyser la copie de philosophie au concours d’entrée à l’École
préparatoire, en 1829, d’Évariste Galois (1811-1832). Considéré par ses
contemporains comme quelqu’un éprouvant la « fureur des
mathématiques » (cf. son professeur Louis-Émile Richard (1795-1849) à
Louis-le-Grand) ou des « dispositions heureuses » pour cette science
(cf. Sophie Germain (1776-1831)), son parcours et ses écrits mathématiques ont
été la source de multiples études depuis l’édition à titre posthume de son
œuvre, en 1846, jusqu’à aujourd’hui. Elles sont de nature mathématique,
historique ou littéraire mais il manquait, selon nous, une étude à caractère
épistémologique.
Dans cette copie il répond à la
question : « Définir l’induction.
Donner les règles de la méthode inductive »
posée par le jeune maître de conférences nouvellement nommé à l’École
préparatoire : Jules Michelet (1798-1874). Le commentaire final du
correcteur, l’inspecteur général de l’Université, l’abbé André-René-Pierre
Daburon (1758-1838), est le suivant : « il y a du travail, de la
réflexion dans ce travail. Peu de résultats » ; et il conclut que
« L’induction n’est pas définie : elle est mal appréciée dans la
dernière phrase. Les règles sont omises ». Après l’examen des arguments
avancés par Galois, la question est de savoir si sa copie porte en germe sa
pensée mathématique, celle qu’il exprime quelques mois plus tard dans la prison
de Sainte-Pélagie par la formule célèbre : « Sauter à pieds joints sur les
calculs, grouper les opérations, les classer suivant leurs difficultés et non
suivant leurs formes, telle est, suivant moi, la mission des géomètres
futurs » ?
Nous dépasserons le cadre strict de sa copie pour en
faire une sonde épistémologique de l’œuvre mathématique en gestation de Galois.
La première remarque, c’est que le sujet proposé au
concours aura « profité » à l’impétrant Évariste Galois ! Car il
s’agit là en effet d’un sujet de « philosophie des sciences ». À
notre connaissance, malgré l’absence d’ouvrages spécifiquement consacrés à la notion
d’induction, ce thème faisait partie
des cours suivis sans doute par les futurs candidats à l’entrée à l’École
normale. La seconde remarque est qu’une simple lecture du texte d’épreuve
témoigne de ce que la copie du candidat Galois est une authentique copie de
philosophie. Car, en 1829, Galois est déjà
un mathématicien hors norme, qui réfléchit en mathématicien créatif sur les
principes de sa discipline : il est en effet en train de déplacer
radicalement l’angle d’attaque, tant en mathématique (algèbre, calcul
infinitésimal, théorie des nombres…) qu’en philosophie (lieu d’expression
conceptuelle des principes comme de la méthode nouvelle).
[18]
Les mathématiques modernes naissent autour de 1830 avec la théorie de
Galois , qui révolutionne l’algèbre en repensant l’équation polynomiale
comme correspondance entre corps (de résolution) et groupes (de permutations)
de ses racines. Ce faisant, Galois résout une crise algébrique des équations
irréductibles (qui, par bien des points, s’apparentait à l’antique crise
arithmétique des nombres irrationnels ) et arrache ainsi les
mathématiques au climat désabusé qui y dominait depuis un
demi-siècle pour les engager sur ce que Grothendieck nommera, un siècle
et demi plus tard, « une longue marche », toujours en cours.
Quel type de modernité mathématique émerge ainsi dans
les « extensions et groupes de Galois » ? Comment, en algèbre,
configurent-elles l’opposition du classique et du moderne ? Ce
renversement de l’algèbre (où désormais
le polynôme structure le produit de ses zéros en groupe stable au lieu de le
disperser en résolutions individuelles) peut-il intéresser aujourd’hui de tout
autres types de modernités, ensablées dans leurs propres saturations, à
commencer par la modernité musicale, engagée par Schoenberg, mise à mal après
1968 par la postmodernité et, depuis la mort de Carter et de Boulez, tenue pour
forclose par la plasticité contemporaine de la performance, du mixage et de la
numéricité ? À quelles conditions serait-il possible de reprendre la
longue marche de ces modernités (politiques, artistiques, amoureuses…) aux
points mêmes où une mélancolie résignée
les a abandonnées ?
L’hypothèse sera qu’un certain style galoisien
de pensée peut ici nous éclairer, nous guider et nous encourager. Nous en
thématiserons, pour ce faire, les caractéristiques suivantes : réduplication
(de l’énonciation), renversement (de la problématique), dualisation
(des corrélations), extension (d’ensemble), adjonction (élémentaire)
et renoncement (circonscrit), soit au total le faisceau de six
gestes :
1.
Rédupliquer (ou dialectiser)
l’énoncé du problème dans son énonciation : Galois, en établissant la
pensée algébrique dans ce qu’elle ne connait pas de l’inconnue sans plus la
cantonner à ce qu’elle peut en connaître (c’est-à-dire à l’équation formalisant
les relations connues de l’inconnue), dispose ainsi l’énonciation algébrique
sous le signe même de l’inconnaissable qu’elle étudie.
2.
Renverser (ou retourner)
l’ordre du problème en sorte de ressaisir le point où l’on bute comme la ressource
d’où repartir : Galois « groupe » les racines algébriquement
indiscernables pour mieux travailler la structure même de leur ambiguïté.
3.
Somme toute, dualiser
(ou réciproquer) les deux faces du problème en les saisissant
dans l’unité dialectique de leur opposition, dans l’ambiguïté duale de leur
séparation : Galois, prolongeant l’algébrisation cartésienne de la
géométrie, géométrise l’algèbre des polynômes en sorte qu’on puisse interpréter
et formaliser chacune en l’autre. Cette dualité (ou réciprocité) des
rôles est au cœur de la dimension fonctorielle de la
« correspondance de Galois » : fonctorialité (contravariante)
entre extensions de corps et réductions de groupes.
4.
Étendre, soit sortir
de l’impasse par le haut en créant de nouvelles notions qui autorisent l’extension
du domaine de travail : Galois, reliant la résolubilité de l’équation à
son corps de résolution, explore les extensions de corps (donc de la situation
constituante) qui vont autoriser de nouvelles possibilités.
5.
Pour mettre en œuvre cette
extension, adjoindre : Galois invente ce faisant la méthode si
puissante de l’adjonction-extension.
6.
Last but not least,
accepter de payer le prix du nouvel espace étendu en renonçant à ces
premières motivations qu’il devient rétroactivement possible de caractériser
comme une sorte de stade juvénile de la discipline : ainsi Galois
défétichise le millénaire désir algébrique de résolubilité.
Au total, Galois contribue ainsi à l’histoire
mathématique de ces révolutions où une notion de prime abord privative se
retourne en socle affirmatif pour de nouveaux élans : l’inconnu
(Al-Khawârizmî), l’irréductible (Galois), l’irrationnel
(Dedekind), l’infini (Cantor), le non-euclidien (Riemann), l’invariant
(Klein), l’incomplétude et l’indécidable (Gödel), l’irrégulier
(Hironaka), l’indiscernable (Cohen), l’infinitésimal (Robinson,
Conway), le non-commutatif (Connes), etc., toutes notions qui font bien
sûr écho à l’inconscient (Freud).
Tout ceci ne constitue-il pas une étonnante ressource mamuphique
pour ceux qui, ne cédant pas sur leur désir de modernité musicale ,
devront, tôt ou tard, reconvertir la dimension soustractive et ascétique de sa
séquence fondatrice (a-tonalité, a-thématisme et a-métricité)
en la figure affirmative et expressive d’une troisième séquence ,
extrayant par le haut la composition moderne de son enlisement constructiviste
(sérialisme) ?
[19]
Nous partirons de la question du nombre et du quantitatif versus qualitatif dans ses déclinaisons mathématiques, et ce du
point de vue philosophique, à partir de ses développements chez Gilles
Châtelet. Gilles considère que « le nombre n’est pas fondamentalement lié
au compte, mais qu’il se laisse penser, en deçà, antérieurement ou plus originairement »,
notamment par une philosophie du nombre relevant du physico-mathématique, où
« Le maintien d’une opposition entre qualitatif et quantitatif souvent
entendue comme opposition de la figure et du nombre –, nous semble peu
pertinente ». Son souci de clarification philosophique de la question du
nombre est également amarré à sa volonté de démystification de l’impensé numérique, mais cette fois, dans
sa dimension politique. D’une part,
l’instrument de la fabrique du consensus (Manufacture
of Consent selon Edward Bernays) dont
la perception du nombre par les masses constitue un mode de gestion systémique
généralisé, exploite le facteur de désintégration de tout élément singulier
– dont le contre-modèle mathématique serait la véritable concrétude géométrique développée par Alexandre
Grothendieck. D’autre part, pour Gilles Châtelet, la victoire de l’homme moyen
qui accompagne celle du techno-populisme a pour corrélat l’indifférenciation, la disparition des marges au profit de l’index
de comportements sociaux visant à un équilibre, à une communication, à une
sorte de “pseudo-chuchotement”, à un accord parfait, par le simple recours à la
moyenne statistique visant à constituer l’idéal-type de l’homme contemporain
qui résulte du fantasme de l’auto-organisation.
[20]
Cette journée souhaite explorer le statut des mathématiques à partir des
limites supposées structurelles qui définissent leur champ. Notre hypothèse de
départ est que les mathématiques représentent la forme paradigmatique du théorique en vertu de la rigueur et de la
nécessité idéales qui sont immanentes à leurs constructions. En ce sens, l’idée
« classique » de la Théorie qui a guidé le savoir scientifique depuis
l’Antiquité est une idée essentiellement mathématique, qui tend à identifier la
Théorie rigoureuse à la possibilité de repérer des invariants à travers des opérations d’idéalisation. Or une telle
exigence concernant le repérage d’invariants pose le problème du statut
théorique d’objets ou de champs qu’il paraît impossible de soumettre à la norme
d’une invariance surplombant en quelque sorte la multiplicité de ses
variations. C’est à de tels objets qu’on a affaire dans les sciences du vivant ou dans les
recherches sur les pratiques de
l’invention : ces domaines d’investigation interrogent la possibilité
d’une théorisation, donc d’une mathesis,
de ce qui semble caractérisable uniquement comme singularité, discontinuité,
multiplicité… La question que nous souhaitons soulever à travers les
interventions de cette journée est la suivante : est-il possible de
concevoir un usage effectif des idéalités mathématiques là où aucune invariance
ne semble repérable ?
[21]
En science de la nature (ainsi que en sciences de l’homme), l’explicitation
théorique (ou éthico-politique) doit précéder l’engagement mathématique. Je
reviendrai sur les grands principes de la théorie de l’évolution, parfaitement
incompatibles avec le physico-mathématique, ainsi que sur quelques grandes
dualités entre celui-ci et une possible théorisation biologique en théorie des
organismes. Si le temps le permet, je mentionnerai quelques conséquences sur
notre santé des différents cadres théoriques de la microbiologie et de la
biologie moléculaire.
[22]
A la différence du calcul différentiel utilisé en physique-mathématique,
l'hétérogenèse est basée sur l'agencement de contraintes différentielles
distinctes point par point. Dans cet exposé on proposera un cadre théorique
pour la construction d’assemblages différentielles. On soulignera la
possibilité d'une hétérogénéité radicale des contraintes différentielles au
niveau de leurs géométries locales, de leurs dynamiques et des substances sur
lesquelles elles opèrent. Notre but est de libérer le devenir dynamique de
toute forme de symétrie unitaire et totalisante et de développer des formes,
des actions et des pensées au moyen de dispositifs de prolifération,
juxtaposition et disjonction.
[23]
Il s’agira dans cette intervention « bicéphale » de développer
certaines implications de nos questions initiales. Le rapport entre les
mathématiques et les objets qui semblent leur résister peut donner lieu à deux
questionnements distincts : 1) Quel usage peut-on faire des mathématiques
pour produire une théorisation rigoureuse de ces objets ? 2) Que devraient
être les mathématiques pour parvenir à rendre concevable de tels objets ?
La deuxième question renoue avec un projet implicite de la pensée mathématique
à l’époque idéaliste et romantique : penser une efficacité des
mathématiques qui ne dépendrait plus du primat d’un invariant afin de saisir
par cette nouvelle mathesis les
aspects dynamiques, singuliers, discontinus du réel. Peut-on concevoir des
mathématiques de la singularité et du devenir « purs » ? Et
qu’est-ce qu’un tel mode d’existence des mathématiques impliquerait quant à la
forme de la Théorie ?
[24]
Comment orienter aujourd’hui nos tâches en
matière d’arts, tout particulièrement d’art musical ?
Simplifions,
pour aller à l’essentiel : il nous faut prendre acte du fait que nous
sommes définitivement sortis d’un entre-temps,
ouvert après 68 par une postmodernité
dont les chatoiements ludiques ont accompagné déconstructions, désorientations
et désubjectivations, puis clôturé à partir des années 90 par un art contemporain de la performance, de
la mixité et de la plasticité numérique (qui, à l’ombre d’une idéologie occidentale
de « démocratisation », « décentralisation » et
« désinstitutionnalisation » déclarées libératrices, s’accorde au
diapason libéral d’un nouveau monde, globalement émancipé des utopies
modernistes du XX° siècle et livré à la jouissance compulsive de ces
marchandises dont la technologie nous promettrait le renouvellement indéfini).
Qu’on
croit ou non aux discours du semblant qui orchestrent ce basculement, force est
d’acter que le tournant du XXI° siècle s’est ainsi accompli.
Tenons
alors qu’il délivre à certains la question : quels nouveaux projets
stratégiques en matière d’arts ?
Pour
clarifier le champ de bataille qui s’est ainsi ouvert, dualisons les quelques
dispositions esthétiques qui rivalisent pour faire ressortir les grandes
oppositions d’orientation.
[voir diagramme dans le corps du texte]
Si
l’on distingue trois dispositions majeures (classicisme/modernités/contemporanéisme), leur dualisation configure trois vastes
oppositions quant aux tâches de l’heure :
1.
invarier ou renouveler ?
2.
répéter (pour maintenir) ou poser un nouveau pas (pour reprendre une
longue marche) ?
3.
bondir ou inverser/retourner ?
Sous
l’hypothèse générale qu’il s’agirait aujourd’hui d’articuler les trois
dispositions classique-moderne-contemporain
(la musique moderne ne se dit-elle
pas aussi musique classique contemporaine ?)
plutôt que de se cantonner sur un seul côté du diagramme, cette journée
voudrait interroger la manière dont chacun situe son projet dans ce nouveau
champ de forces.
Thématisons
ces questions selon leur matérialisation musicale.
–
Qu’en est-il aujourd’hui de l’œuvre musicale quand l’axiome dadaïste de
Duchamp « Faire des œuvres qui ne
soient pas d’art » (qui l’a conduit en 1935 jusqu’à l’insigne Concours
Lépine…) semble triompher dans les esthétiques du déchet ?
–
Qu’en est-il aujourd’hui de la dialectique mise en œuvre par
l’instrumentiste entre écriture musicale et instrument de musique quand
l’axiome romantique de Berlioz « Tout
corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique »
semble triompher dans l’avalanche des haut-parleurs ?
–
Qu’en est-il de l’écoute musicale quand l’axiome futuriste de Russolo
« Rompre le cercle restreint des
sons musicaux pour conquérir ces nouveaux bruits dont la guerre moderne
constitue le paradigme » semble prophétiser un sinistre retour, cent
ans plus tard, de « la rumeur des batailles » ?
–
Qu’en est-il des musiciens dont le XXI° siècle va avoir besoin si
l’axiome postmoderne d’Aperghis « Faire
musique de tout » se décline désormais en son corollaire
nihiliste : « Faire musique de
rien » ?
–
Au total, comment réactiver une autonomie musicale dont l’enlisement
dans une autarcie formaliste a pu légitimer le retour aux bonnes vieilles
fonctionnalités sociales ou culturelles de la musique (celles-là même que
Jdanov ou Thomas d’Aquin prônaient au nom d’une citoyenneté ou d’une communauté
bien comprises) ?
● Le matin (10h-13h), Alain Franco
et Jean-Luc Plouvier exposeront l’expérience accumulée, depuis bientôt vingt
ans, respectivement dans Parts (www.parts.be)
et dans Ictus (www.ictus.be) et
thématiseront leurs propres orientations musicales.
● L’après-midi (15h-18h), Éric Brunier,
Rudolf di Stefano et François Nicolas exposeront un projet commun Hétérophonies/68 (http://www.egalite68.fr/H68) de raisonances renouvelées entre modernités
picturales, cinématographiques et musicales.
[25]
On soutiendra la thèse suivante : l'art dit contemporain se
développe en se référant à la modernité de Manet alors que l'art moderne de
Braque et Picasso, en un mot du cubisme, s'est construit par l'extension de
l'œuvre de Cézanne. On développera la bifurcation que cela entraine, notamment
dans les tâches que la peinture peut se donner aujourd'hui.
[26]
Deleuze a écrit l’Image-mouvement et
l’Image-temps, et a fait là œuvre de philosophie. Il n’empêche que ces
deux livres ont le mérite de clairement délimiter la notion de modernité en
cinéma, en faisant valoir la coupure radicale qu’elle a accompli avec
le cinéma classique qui la précédait.
L’exposé lui, ne sera pas fait en philosophe, mais en cinéaste
engagé dans un faire contemporain. Il sera question d’identifier ce qui dans
les propositions théoriques de Deleuze opère réellement dans les films
modernes, mais surtout d’y repérer les impasses, tout particulièrement dans son
concept de « Peuple qui manque »
abondamment repris aujourd’hui par un certain contemporanéisme théorique et
cinématographique. Cela pour ouvrir une voie nouvelle, celle d’une production
cinématographique capable de renouveler les enjeux modernes, mais aussi pour
faire le pari qu’il est possible de passer d’un peuple qui manque à un peuple
là.
[27] Que penser
aujourd’hui de la manière dont Boulez, méditant l’œuvre de Paul Klee, réfléchit
ces raisonances entre modernités contemporaines qu’il appelle « profil
commun à une époque donnée et moyens employés dans différents domaines
coïncidant à un niveau profond » ? Que penser en particulier de
la manière dont Boulez profile ici une modernité musicale orientée, par une
« haine du romantisme », vers « une certaine
objectivité de l’expression que l’on aurait voulue sans faille » et
qui côtoie alors un « esprit néo-classique » rejetant toute
expression musicale ? Pour ce faire, on se concentrera sur un cours donné
par Klee (Bauhaus, 13 février 1922) et sur le tableau Éclair
physionomique qui donne forme picturale à son bilan.
L’interprétation
qu’en avance Boulez met en jeu deux déterminations : pour Boulez, l’objectivité
visée d’une expression sans faille s’appelle perception,
et la composition d’une telle potentialité repose sur la « transgression »
d’une discipline géométrisable. Dans ce cas, l’expressivité musicale – celle-là
même sur laquelle le Boulez de Darmstadt a buté pour y revenir, vingt ans plus
tard, sous l’angle d’un thématisme de type nouveau – n’apparaît-elle pas comme
le vaste impensé de la modernité sérielle ?
Pour
enquêter, à l’ombre de cette question, sur ce qu’expressivité veut
dire, on survolera deux siècles (d’avant 1789 jusqu’à 1968) d’une histoire
musicale qu’on périodisera en quatre étapes (classicisme / romantisme /
modernité atonale et néoclassicisme / modernité sérielle) pour mieux distinguer
cinq modes (classique, romantique, moderne soustractif, moderne
néoclassique, moderne constructiviste) selon la manière dont la composition
musicale assume sa part expressive. C’est en ce point où la composition
musicale, entendue comme dialectique construction/expression, s’éclaire de la
part d’interprétation que toute formalisation profile en intériorité que la
possibilité d’un sixième mode musical d’expression (et donc de composition) s’indique,
suggérant qu’il pourrait ainsi y avoir trois étapes dans la modernité musicale
et quatre modes (modernes) susceptibles d’y coexister.

![]()